Sur le fil...
Safara n°22 est désormais disponible...
![]() Télécharger l’article en version PDF
Télécharger l’article en version PDF
Résumé
Nous avons montré dans cet article jusqu’où les jeux perecquiens participent du même projet que la grammatologie derridienne. En dessaisissant la conscience écrivant des commandes de l’écriture, l’écrivain déploie un au-delà de la parole et de la subjectivité. L’écriture retrouve dès lors tout son sens d’expérience de l’exode que les Juifs que sont Georges Perec et Jacques Derrida ont vécue mieux que quiconque.
Mots clés : Autobiographie, citation, clinamen, contrainte, différance, déconstruction, disparition, dissimulation, écriture, grammatologie, intertextualité, jeu, littérature, mise en abyme, nom propre, Oulipo, parole, pli, signature, trace.
Summary
Through this article, we have shown to what extent Perecian representations draw on Derridian grammatology. By relieving the writing consciousness of the principles determining the act of writing, the writer displays a world beyond word and subjectivity. Writing regains, therefore, all the meaning of the experience of exodus that Jewish authors, Georges Perec and Jacques Derrida, lived through more than anyone.
Keywords: Autobiography, citation, “clinamen”, pressure, “différance”, deconstruction, disappearance, dissimulation, writing, grammatology, intertextuality, representation, literature, “mise en abyme”, proper noun, “Oulipo”, word, fold, signature, mark.
**********
« Si je tente de définir ce que j'ai cherché à faire depuis que j'ai commencé à écrire, la première idée qui me vient à l'esprit est que je n'ai jamais écrit deux livres semblables, que je n'ai jamais eu envie de répéter dans un livre une formule, un système ou une manière élaborée dans un livre précédent. » Penser/classer, Georges Perec, La librairie de XXI° siècles, [Seuil]
Introduction
Il s’agit dans cet article de faire jouer la différance[1] afin de faire « dialoguer » Georges Perec (1936-1982) et Jacques Derrida (1930-2004) à l’intérieur de l’espace que l’on appelle communément intertextualité (notion que nous aurons à définir plus loin). Bref il s’agit de repérer une même signature épistémologique.
À travers cette hypothèse, nous voulons faire communiquer deux axiomatiques dont les visées affichées sont de déconstruire[2], c'est-à-dire de faire déjouer, la philosophie chez l’un, la littérature chez l’autre, au profit de l’écriture. En d’autres termes, il est question, grâce à l’intertextualité à outrance, de faire déjouer les livres et autres principes de classement. Cela donne chez Georges Perec un bouleversement de l’idée qu’on a de la littérature. Écrire devient une pratique sans d’autre objet que de différer toute certitude. Notre travail (qui s’appuiera essentiellement, mais pas exclusivement sur W ou le souvenir d’enfance, désormais abrégé [W, +page(s)]) s’articulera en deux parties. Dans la première, nous borderons les problèmes épistémologiques de cette dialogisation avant de voir de quelle manière Georges Perec traite le matériau autobiographique[3] afin de mettre à jour le jeu sans rendement de l’écriture. Durant tout ce parcours interprétatif, ce seront les concepts derridiens qui éclaireront les concepts perecquiens.
1. Problèmes épistémologiques
1.1. Lire « G. Perec » et « Jacques Derrida : la question de la signature
Lire G. Perec à travers Jacques Derrida s’est avéré, pour surprenant que cela puisse paraître, une entreprise novatrice. En effet, cette grille de lecture est à peine effleurée, mais de fort belle manière, par Frédéric Marteau dans son article « L’obsession grammatographique : Ponge, Perec, Jabès »[4]. Nous l’avons également partiellement rencontrée, chez Bernard Magné[5]. Mais malheureusement, ils n’ont pas tiré de ce rapprochement judicieux suscité dans le texte perecquie n par les jeux sur les signifiants et signifiés toutes les conséquences grammatologiques[6] qui s’imposent.
Se livrer à une tel exercice de lecture, c’est montrer que le texte perecquien invite à ce qu’on le lise, qu’on le déplie selon l’axiomatique derridienne qui pose qu’un texte disperse toute mesure (logocentrique, en référence à la métaphysique de la présence qui la commande), que tout texte est entrainé dans le mouvement qu’il appelle la différance. Cette différance qui disperse toute différence générique légitime le fait qu’on rapproche un philosophe d’un écrivain.
Cette différance (avec a) rend possible toute différence la parole en faisant surgir le texte qu’il appelle gramme. Cette trace ne cesse de se dissimuler, de s’espacer, de se temporiser, de s’éclipser dans la potentialité[7]. Mais dans cet espacement, c’est en cela que c’est une trace, ou dans le vocabulaire pérecquien, ce lipogramme, il ne cesse jamais d’être question de cette lettre qui, comme dans la différance derridienne, rend possible les effets de textes inscrits à l’intersection des mots dans la parole.
Par l’effet de cette gramme, le texte est conçu afin de la dissimuler, ou plutôt le texte est conçu de manière à ce qu’il y disparaisse, s’y potentialise. C’est dire que les notions d’auteurs, de propriété, de signature, de livre, d’autobiographie sont ici inéluctablement déconstruites. Philippe Lejeune a parfaitement rendu compte des contraintes arbitraires qu’il glisse dans la pseudo-autobiographie, déconstruisant ainsi l’autobiographie en tant que telle à travers la remise en cause du principe de vérité censé être au cœur du pacte autobiographique[8] ; d’où le vaste projet autobiographique décrit dans Je suis né[9]. Il s’agit de choisir « douze lieux, des rues, des places des carrefours, liés à des souvenirs, à des événements ou à des moments importants de mon existence. » (p. 58). Georges décrit deux fois par mois ces lieux. La 1e fois il les décrit sur place et au présent, la deuxième fois dans n’importe quel lieu et de mémoire. Une fois écrits, ces textes, allant de quelques lignes à 6 pages ou plus, sont placés dans une enveloppe cachetée à la cire. Au bout d’un an (comptant 12 mois), les 12 lieux sont décrits sous deux angles différents. Georges Perec recommence alors pendant 12 ans le même travail en permutant les couples selon une table :
J’ai commencé en janvier 1969 ; j’aurai fini en décembre 1980 ! J’ouvrirai alors les 288 enveloppes cachetées, les relierai soigneusement, les recopierai, établirai les index nécessaires. Je n’ai pas une idée très précise du résultat, mais je pense qu’on n’y verra tout à la fois le vieillissement des lieux, le vieillissement de mon écriture, le vieillissement de mes souvenirs : Le temps retrouvé se confond avec le temps perdu : le temps s’accroche à ce projet, en constitue la structure et la contrainte ;
Le livre n’est plus restitution d’un temps passé, mais mesure du temps qui s’écoule ; le temps de l’écriture, qui était jusqu’à présent un temps pour rien, un temps mort, que l’on feignait d’ignorer ou qu’on ne restituait qu’arbitrairement, qui restait toujours à coté de livre (même chez Proust), deviendra ici l’axe essentiel. (p. 58)
L’intérêt d’un tel exercice, c’est qu’il disperse le genre autobiographique.
Nous voudrions par le truchement de la grille derridienne voir de quelle manière le clinamen[10] (autre correspondant pérecqueien de la différance derridienne) disperse l’assurance de la contrainte mathématique de la même manière que la formule mathématique (dont la contrainte ne nous donne qu’une infime idée, dont la contrainte explicite n’est qu’une indication) opère sur la trace d’une structure véritablement mathématique qui pointe un au-delà du sujet et ce faisant un au-delà de la parole. Ce jeu que nous qualifions, pour faire vite, de derridienne, justifie l’intertextutalité que nous faisons agir et qui, d’après Julia Kristeva, disperse la notion d’intersubjectivité[11], mais éclaire du coup un certain nombre de méta-contraintes[12] perecquiennes qui disséminent les contraintes 1es. Méta-contraintes qui renvoient à leur tout à d’autres méta-méta-contraintes (jusqu’à l’infini)[13]. C’est dire que la notion de contrainte est d’un incontestable rendement grammatologique dans la mesure où une contrainte n’est intéressante que dans la mesure où elle recèle une case vide, un clinamen, une marge de liberté créatrice : c’est le rêve de la chambre inutile[14].
Mais revenons à l’intertextualité pour y voir la différance à l’œuvre.
1.2. Comment se dé-noue un « dialogue » intertextuel ?
Ce dialogue outre-tombe ici noué et ce qui s’y dévoilera de résonances, de concordances bref de « ressemblances » (pour parler comme E. Jabès[15]) ne saurait surprendre. Les œuvres ne parlent mieux, ne « parlent » "véritablement que leurs auteurs morts : si d’aventure le verbe parler tel qu’on l’entend coutumièrement a du sens dans une telle transaction. Au lieu de s’intéresser à ce qui est échangé dans le registre économique de la métaphysique, il faudrait chercher à voir ce qui se trame dans ce don/contre-don où toutes « ressemblances » sombrent en cette connivence de principe par Baudelaire dénommée correspondance et qui rend possible cette ouverture, ce jeu qu’on appelle tantôt sérialité, tantôt récurrence. Or par cette productivité où la différance est comme masquée, nous sommes de plain-pied dans l’écriture oulipienne.
Certes Jacques Derrida, qui a traversé magistralement son siècle n’a, à notre connaissance, rien écrit sur Georges Perec. Très certainement ils ne se sont pas ignorés ; et surtout, tel que le champ « littéraire » était constitué à l’époque, Perec n’a pas pu ignorer les philosophèmes de Jacques Derrida. On peut même croire qu’il les mime, tout comme dans La Disparition il a mimé Jacques Lacan ; on peut même le dire dès lors que l’on donne toute sa portée à cette mimésis, dès lors qu’on prend la pleine mesure de cette économimésis[16].
L’essentiel n’est pas à trouver au niveau empirique des auteurs (dans les registres de l’influence et de la citation) mais bien au niveau des textes (dans le registre de l’intertextualité). C’est dans cette dimension que se décide ce qui est significatif pour l’accomplissement des œuvres : à savoir que l’une éclaire l’autre. C’est sur ce plan, et sur ce plan seulement, que l’on saura ce qui les noue, étant entendu, avec Edmond Jabès (1912-1991) (cet autre penseur juif) que
Le lien est la muette dague, hors du fourreau ; de sorte que se lier, c’est passer la corde autour d’une lame, c’est constamment refaire le nœud où le nœud est impossible.[17]
Lier c’est paradoxalement dénouer pour des outre-nœuds, des archi-nœuds.
Georges Perec a somptueusement préparé ce chemin de l’éclaircissement, afin d’indiquer la voie qui lie-et-délie ; il a somptueusement mis en œuvre telle foudroyant aphorisme du maître Jabès :
Ce qui est à lire, reste toujours à lire.
Tu lis. Tu te lies à ce qui se délie ─ à ce qui te délie dans ton lien.
Tu es nœud de correspondances.[18]
En vue de préparer cette opération de lecture (-dé-nouement), Georges Perec a dé-plié (marqué) son texte, très légèremen,t mais suffisamment. Sous sa forme apparente de la ressemblance, le pli qu’il imprime à son texte semble être une simple exhibition érudite. Cette citation, cette greffe qui paraît relever du prélèvement, de l’adaptation, est plus que cela. Dans l’oulipisme le masque des formules mathématiques préserve la signifiance de la formule qui n’a de cesse de la déconstruire comme mathème. La différance préserve ainsi sa souveraineté sous le couvert de la pseudo-assurance de l’auteur. Ce pli rhétorique méthodiquement narrativisé qui donne l’impression de garantir au texte une sorte de légitimité qu’il faut que le commentaire (cette forme achevée de la déconstruction, du dé-pliage, de l’ex-plicatio) doit augmenter, aggraver, accentuer.
Ce redoublement du pli, bien évidemment, doit rester fidèle à la logique abysmale de la différance. C’est à ce prix seulement que l’on peut faire recours aux différentes méthodes critiques : en ce qu’elles nous enseignent de quelle manière l’auteur, sa biographie, le contexte social, le contexte sociologique, les mythologèmes se trouvent dispersés dans et par le texte. Le commentateur ne doit donc pas arrêter le jeu infini de l’œuvre en faisant de ce pli « derridien », sinon du derridisme, du moins de la citation magnifiante. Il en fera tout au plus une remarque adressée au narrataire, le soulignement, la mise en jeu de l’intertextualité qui diffère le point de départ phénoménal vers une origine sans origine : un Babel avant la lettre. Il va de soi que le mythologème de Babel est spectaculairement déconstruit.
L’intertextualité, conformément au vœu kristévien, est ici convoquée comme un jeu bien particulier qui amène le lecteur à prendre conscience de la potentialité du texte. Par ce concept central chez les Oulipiens il faut comprendre le rien inaccessible. Paradoxalement, les mathèmes oulipiens ouvrent le jeu sans fin de la textualité : qui est soit intra-textualié (texte s’enlisant en lui-même) soit inter-textualité (le texte s’évanouissement dans un dehors qui lui est cependant intérieur).
En réalité, ce n’est point un paradoxe, puisque le texte est saisi par un jeu sans fin. On ne serait donc pas surpris (évidence qui n’en est pas moins une énigme : l’Énigme) que cette commune ignorance qui frappe ces aventuriers « parlent » le même langage. Ou plutôt que ces destins « parallèles » ne les ont pas empêchés de parler le même hébreu (au sens d’une langue cabalistique), en bons Juifs. On peut donc dire que cette judéité est inscrite dans leurs œuvres (vocabulaire géométrique qui articule des enjeux fondamentaux, doit évidemment minutieusement rectifié, déconstruit). Cette judéité[19] est inscrite uniquement au plan phénoménal (ce n’est qu’un différé), car la judéité (comme pour toutes les autres monolinguismes : albitude, négritude…) n’est qu’un lieu initial dont on dérive irrévocablement, ne serait-ce que par la mort. On en dérive comme on dérive dans l’idiome ; on en dérive comme on se dé-livre d’un Livre (du Torah) pour entrer dans un texte infini (une cabale, un livre borgesien). Ce dont il parle dans l’écriture c’est la pratique de l’errance, de la différ(r)ance magistralement expérimentée par le Guide Edmond Jabès. Pratique pour ne pas dire langage. L’(itin)er(r)ance se décline dans le monde de la fiction par la thématique de la recherche de la patrie.
Qu’est-ce que cette patrie dont il est si massivement question dans W ou le souvenir d’enfance? Cette thématique cache une géométrie bien paradoxale puisque la patrie c’est le lieu (mot-clef, s’il en fût, de l’imaginaire péréquien) du Père. Comme chez Alain-Robbe Grillet, la recherche du lieu origininaire (la patrie) est une constante pour quelqu’un d’aussi obsédé par la question des lieux que Georges Perec (l’obsession est une manière de vivre oniriquement la différance). La recherche de la patrie, c’est la recherche de cette case sans nom. Les lieux, les espaces, fussent-ils des patries, sont des points de fuites dans une topologie de l’exode. Pour quelqu’un appartenant de surcroît à un certain peuple de Dieu, il n’y a de lieux que de diff(errance). L’œuvre n’existe qu’en raison d’un point de fuite matérialisé ludiquement par le e.
2. Déconstruction de l’autobiographie
2.1. L’image (la figure) dans le tapis[20] : la question de l’origine
Jacques Derrida est mort : au plus fort de son nom, nous dit-il dans Ulysse Grammaophone[21] 2 doubles consonnes (les d et les r) faisant le chiffre de la dissémination : soit 4. Il signale d’ailleurs que le double r graphique, tel un ornement du discours, se lit 1 fois ce qui l’inscrit, par ce halo de silence qui l’entoure, dans le registre du secret, de la marque.
| D | D | |||||
| D | E | R | R | I | D | A |
| R | I | R | E | |||
| A |
Ce nom a été conçu ou à tout le moins relu (remarqué) par son attributaire comme une grille pérecquienne se prêtant à une cabale cachée. Ce nom propre qui se perd dans les jeux du texte, telle la signature derridienne qu’elle mime, ce nom propre qui se prête au jeu afin de se perdre dans un rire bruyant prévue par les possibilités anagrammatiques et paragrammatiques de derrida (une manière bien propre pour ce Juif de derrider la langue hébreue).
Georges Pérec est également mort. Au centre de son nom résonne avec assourdissement 4 fois (soit la formule de la différance 2X2) cette fois-ci une voyelle : la voyelle e. cette voyelle, cela a été signalé à propos de Jacques Derrida, est à la fois « une belle absente » une voyelle de deuil ; on ne la prononce mais elle permet telle la colonne derridienne d’articuler un jeu de consonnes
| G | E | O | R | G | E | S |
| P | E | R | E | C |
Elle permet à une figure tutélaire (le PÈRE) de s’élever, d’agir en sourdine: et à une archi-écriture (le e du féminin) de s’élever. Cette voix, on le pressent, est celle de la mère. Et cette mère est une île (un elle). Ce nom est donc, telle que présentée : c'est-à-dire en tant que source de jeu, de différance, est une préfiguration de la signature. Il constitue, ce nom ex-appropriable, tout un programme, la source de toute une cabale cachée. Programme autobiograhique ? Disons plutôt programme contre-autobioraphique (Ph. Lejeune). G. P. s’adonne alors avec brio à une écriture de deuil : bref à de la lipo-littérature. Littérature telle que la contrainte (cet autre nom de la différance) de la chose à ne pas dire libère le rien… à dire qui devient le tout à dire et finalement le tout-du-dire. Littérature où le Rien devient tout et libère l’espace de la disparition, l’espace(ment) de la redite, l’espace de la revenence[22]. Dans l’espace des titres des termes renvoyant à cette thématique spectrale prennent heureusement le relais des noms propres. Le même deuil suscite jeu et parole.
Mais une question, question que n’ignore pas la grammatologie, se pose : Au nom de quoi peut-on faire communiquer ces deux Signatures ?
2.2. La disparition
Soit la lettre e chez Georges Perec et dans le roman intitulé Disparition[23]. Soit la lettre la plus présente dans le nom de gEorgEs pErEc dans le roman censé ne point en avoir. De l’importance dont cette lettre se trouve attribuée on peut la tenir pour la signature de G. P. D’ailleurs pour confirmer la valeur de nom propres de cette lettre (sorte de paraphe[24] qui brouille les pistes de lecture), le héros principal de La disparition s’appelle Anton Voyl, il faudrait plutôt dire Anton Voy.l.. Le « lecteur attentif » dont il est question à la page 14 de W verrait très vite qu’il y ici un double problème que l’écriture/lecture s’attelle à résoudre. Résoudre étant ici ; écrire étant presque toujours refouler, écrire étant dire l’indicible :
Quinze après la rédaction de ces deux textes, il me semble toujours que je pourrais que les répéter […] Il me semble que je ne parviendrai qu’à un ressassement sans issue. Un texte issu sur mon père, écrit en 1970, et plutôt pire que le premier, m’en persuade assez pour me décourager de recommencer aujourd’hui.
Ce n’est pas, comme je l’ai avancé, l’effet d’une alternative sans fin entre la sincérité d’une parole à trouver et l’artifice d’une écriture exclusivement préoccupée de dresser ses remparts : c’est lié à la chose écrite elle-même, au projet de l’écriture comme au projet du souvenir. [W, 62-63]
C’est G. P. qui glose ici son écriture à l’intérieur de son roman confirmant le double problème. Le problème de la voyelle e (voyelle de l’indicible) et le problème du nom. Le nom du géniteur est toujours, apparemment, impossible à correctement être orthographié :
Cyrla Schulevitz13, ma mère, dont j’appris, les rares fois où j’entendis parler d’elle, qu’on l’appelait plus communément Cécile14, naquit le 20 août 1913 à Varsovie. […] [En gras dans le livre]
13. J’ai fait trois fautes d’orthographe dans la seule transcription de nom : Szulewicz au lie de Schulevitz.
14. Je dois à ce prénom d’avoir pour ainsi dire toujours su que sainte Cécile est la patronne des musiciennes et que la cathédrale d’Albi ─ que je n’ai vue qu’en 1971 ─ lui est consacrée. [W, 49,59]
La question du nom propre est au cœur du texte. Ce sont les fautes liées à l’énonciation de ce nom qui constitue la trame, ou si l’on préfère la substance autobiographique de ce texte. Le texte autobiographique est alors un pur écran pris dans le jeu de la différance.
Dans Anton Voyl, il est question d’une lettre disparue et ce faisant d’une énigme liée au nom propre. Le nom propre devient significatif du fait de la voyelle qui y fait défaut. Dans W., poursuivant la quête entamée avec La disparition, Georges Perec (aux pages 56 et 57) se livre à une assez longue dissertation sur la généalogie de ce nom (Perec), c'est-à-dire sur l’origine de cette marque et surtout sur ce qui est différé par/dans cette trace à travers une longue série de déformations. Il semble d’ailleurs que cette chose différée qui appelle le jeu oulipien (qui appelle la littérature) est plus qu’une affaire autobiographique. L’auto-psychanalyse à laquelle se livre par anticipation, coupant, si on peut parler ainsi, l’herbe sous les pieds du lecteur facile, est faite pour signaler l’inanité d’une telle lecture auto-biograhique, l’inanité d’une telle lecture mimétique. L’essentiel de l’auto-bio-grahie réside justement dans cette différance de la version vraie à la version racontée. L’essentiel est dans la dérive fabulatrice :
Je ne sais pas si je n’ai rien à dire, je sais que je ne dis rien ; je ne sais pas si ce que j’aurai à dire n’est pas dit parce qu’il est l’indicible (l’indicible n’est pas tai dans l’écriture, il a ce qui l’a bien avant déclenchée) ; je sais que ce que je dis est blanc, est neutre, est signe une fois pour toutes d’un anéantissement une fois pour toutes. [W, 63]
Tout nom est comme le Neutre, un trou béant qui ouvre la différance (le ressassement, le déplacement en abyme) au cœur de l’intégrité du sujet et de la parole. « Le nom de ma famille, écrit Jacques Perec, est Peretz. Il se trouve dans la Bible. En hébreu, cela veut dire « trou » » [W, 56]. L’altérité du nom (ici Perec, là Derrida) sème le trouble dans l’intégrité du Nom supposé propre. La question du signataire se déplace alors bien dangereusement :
Mon grand-père s’appelait David Peretz et vivait à Lubartow. Il eu trois enfants : l’aînée s’appelle Esther Chaja Perec ; le puîné Eliezer Peretz, et le cadet Icek Judco Perec. Dans l’intervalle s éparant leurs trois naissances, c'est-à-dire entre 1896 et 1909, Lubartow aurait été successivement été russe, puis polonaise, puis russe à nouveau. Un emploi d’état civil qui entend en russe, et écrit en polonais entendra, m’a-t-on expliqué, Peretz et écrira Père. Il n’est pas impossible que ce soit le contraire ; selon ma tante, ce sont les Russes qui auraient écrit « t » et les Polonais qui auraient écrit « c ». cette explication signale, plus qu’elle n’épuise, toute l’élaboration fantasmatique, liée à la dissimulation patronymique de mon origine juive, que j’ai faite autour du nom que je porte et repère, en outre, la minuscule différence existant en tre l’orthographe du nom et sa prononciation : ce devrait être Pérec ou Perrec (et c’est toujours avec un accent aigu ou deux « r », qu’on l’écrit spontanément) ; c’est Perec sans pour autant se prononcer Peurec [W, 56-57]
Ce qui est si savamment différé, dissimulé par l’écriture, c’est cette lettre (ce chiffre) qu’on ne voit : la figure du père. Comme dans la lettre volée d’Edgar Allan Poe, ce qui montre cache. Il suffit de ne plus se focaliser sur le e pour voir que cette voyelle-leurre qui fait cruellement défaut à Anton Voyl à laissé la place vacante en toutes lettres alphabétiques au Père ! (les consonnes de PeReC, moins le C désignent, comme référent et contre-signataire du texte, le Père) : « De mon père, je n’ai d’autre souvenir que celui de cette clé ou pièce qu’il m’aurait donnée en un soir en revenant de son travail. » [W, 45]
Le père énigmatique est donc bien la clef (d’or) de l’énigme. C’est lui dont l’impossible souvenir qui rend possible quelque chose comme un roman, quelque chose comme l’art figuratif : toutes choses qui rendent possible l’évocation de la place vacante, de la place différée.
Ce qui importe surtout au-delà de cette histoire de e (qui n’est qu’un prétexte, un signifiant) c’est ce qui dans la présence est différé, ce qui n’apparaît pas sur la scène de l’écriture. Ce qui, à proprement parler, dis-paraît. Toute lettre est une missive. Elle n’est jamais neutre. Toujours, elle implique le deuil. Dans la lettre, dans la langue, il y a la trace de la place du contre-signataire absent, puisqu’une lettre est à la fois vœu de présence et marque de distance. J’écris une lettre parce je ne suis pas là. L’histoire du roman que nous dresse admirablement Perec dans chacun de ses romans c’est l’histoire de cette quête de l’origine, c’est l’énigme de ce qui disparaît dans son apparition : ce qui se déplace en abyme (Francis Ponge) ou se met en abyme selon le point de vue choisi. Dans le roman ce que je raconte ouvre davantage une énigme qu’elle ne répond à des questions. D’où, en un style borgésien, cette cascade de récits prélevés dans la littérature. Récits racontant la même histoire sans fin dans une narration sans issue.
Le récit raconté importe moins que la formule qui l’a engendré. Le récit doit son existence au refoulement, à la dénégation de la lettre e. Il n’existe que pour ce qui refuse de se dire, d’être dit. Quelque part un tel récit est, à tous les sens du terme, déplacé. Sa migration, qui fait véritablement sens, fait penser au déplacement en abyme, à l’image dans le tapis. Comme pour le Nouveau roman, c’est l’aventure d’une écriture qui importe moins que l’écriture d’une aventure.
Le récit raconte les mésaventures de l’écriture, l’impossibilité de dire quelque chose qui se matérialise en un e et qui manifestera ailleurs d’une autre manière. Le récit raconte les mésaventures de la lettre muette e ou si l’on préfère un [e] qui s’écrira de toutes les manières, qu’on pourra par conséquent entendre dans tous sens. C’est en cela que consiste le jeu romanesque. Dans ce sens où l’impossibilité d’écrire une certaine lettre oblige à l’usage de la synonymie ou de la néologie (forme minimale de la fabulation).
Nous est ainsi montré ce qui se déplace dans le roman. Le roman fait partie intégrante du fabuleux univers des substituts : 1 mot ou n mots sont pris pour un autre avec, comme lipo-contrainte, qu’elle ne retienne rien qui rappelle sa source. Le mot- substituant (ou traduisant d’un autre idiome, ou trans-crivant dans un autre dialecte) est alors véritablement un lipo-gramme.
Conclusion
C’est dire que le roman déplace l’absence dans une présence fictive. L’objectif de ce jeu mimétique est de masquer le manque au point d’amener le narrataire à prendre ce qui lui dit/donné pour argent comptant et de ne pas voir ce qui est homophoniquement et synonymiquement crypté dans « la lettre » du texte. De manière donc à ne faire que pressentir la potentialité instituant le littéraire (comme pour dire imaginaire).
La critique, qui accomplit dès lors une tâche éminente, laisse libre cours dans le roman traditionnel, à la signifiance. Dans la logique de la signifiance le texte n’est pas représentation : le texte n’est pas reproduction mais pur lieu de pro-duction (mot qui renvoie à une herméneutique heideggerienne). Le texte, au hasard des associations poétiques qui, même potentialisées dans le texte classique, continuent à lui imprimer son rythme, fait sens. Le texte se met à signifier littéralement et dans tous les sens. En ouvrant l’horizon de l’Encyclopédie (du sens), le texte fait déjouer la langue au profit de la Langue. Les hallucinogèmes qui naissent de la rêverie poétique (romanesque) surgissent de la Langue (le Logos).
A tout pendre, exister, vivre, c’est s’exercer au jeu de contraintes : Comment vivre sans écrire telle lettre ? Comment vivre en n’utilisant que telle lettre ? Comment vivre dans la nostalgie de quelque W. Cette lettre sera prise, exactement comme une étiquette mathématique : la marque d’une absente.
Elle est en effet bien étrange la logique récurrente (différante) du nom propre. En s’élucidant (en mirages) l’énigme ne fait que se démultiplier. Il ne sait pas pourquoi ─ ignorance savante et qui constitue le fonds du savoir à l’œuvre dans le roman ─ l’énigme (ce que nous avons identifié comme la potenttialité) depuis le lointain d’où il se dresse tient la plume, devient le thème privilégié de l’œuvre.
Bibliographie
- BURGELIN, Claude. Georges Perec. Paris : Éditions du Seuil collection Les Contemporains, 1990.
- DERRIDA, Jacques. « Economimesis » publié dans dans l'ouvrage collectif Mimesis des articulations (Paris : Aubier-Flammarion, 1975, pages 57 à 93), et auquel ont participé Sylviane Agacinski, Sarah Kofman, Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy et Bernard Pautrat.
- DERRIDA, Jacques. Introduction (et traduction) à L'origine de la géométrie de E. Husserl. Paris : PUF, 1962.
- DERRIDA, Jacques. De la grammatologie. Paris : Les Éditions de Minuit, 1967.
- DERRIDA, Jacques. La dissémination. Paris : Seuil, 1972.
- DERRIDA, Jacques. Ulysse gramophone. Paris : Galilée, 1987.
- DERRIDA, Jacques. Limited Inc. Paris : Galilée, 1990.
- DERRIDA, Jacques. Le monolinguisme de l'autre. Paris : Galilée, 1996.
- JABÈS, Edmond. In Le Livre des ressemblances. Paris : Gallimard (L’imaginaire), 1991 (1e édition en 1976)
- KRISTEVA, Julia. Semeiotike. Recherches pour une sémanalyse. Paris : Seuil, 1969.
- LEJEUNE, Philippe. Le Pacte autobiographique. Paris : Seuil/Poétique, 1975.
- LEJEUNE, Philippe. La Mémoire et l'Oblique. Georges Perec autobiographe. Paris : P.O.L., 1991.
- MAGNÉ, Bernard. « De l’écart à la trace. Les avatars de la contrainte ». Études littéraires, volume 23 n° 1-, été-Automne 1990.
- MAGNÉ, Bernard. Georges Perec. Paris: Fernand Nathan, collection 128, 1999.
- MAGOUDI, Ali. La Lettre fantôme. Paris : Éditions de Minuit, collection Critique, 1996.
- MARTEAU, Frédéric dans son article « L’obsession grammatographique : Ponge, Perec, Jabès » Paru dans la revue d’étude du dialogue texte-image Textimage. Le numéro 3 de 2009 (intitulé A la lettre) est accessible à l’dresse suivante (page par nous consulté le 29 décembre 2012) : http://www.revue-textimage.com/04_a_la_lettre/marteau1.html
- PEREC, Georges . La Disparition. Paris : Denoël, 1969.
- PEREC, Georges . Les Revenentes. Paris : Julliard, 1972.
- PEREC, Georges. Espèces d'espaces . Paris : Galilée, 1974.
- PEREC, Georges. W ou le Souvenir d'enfance . Paris : Denoël, 197
- TEL QUEL. Tel Quel. Théorie d'ensemble. Paris : Le Seuil, 1968 ; rééd. coll. « Points » en 1990.
* Maître de conférences et Docteur d’État en littérature française, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal
[1]Ce néologisme a été définie comme suit dans la conférence éponyme prononcée à la Société française de philosophie, le 27 janvier 1968 et repris dans Théorie d’ensemble (Paris :Le Seuil, 168)) : « Ce qui s’écrit différance, ce sera donc le mouvement de jeu qui «produit», par ce qui n’est pas simplement une activité, ces différences, ces effets de différence. Cela ne veut pas dire que la différance qui produit les différences soit avant elles, dans un présent simple et en soi immodifié, in-différent. La différance est 1’«origine» non-pleine, non-simple, l’origine structurée et différante des différences. Le nom d’ «origine» ne lui convient donc plus. »
[2] Ce néologisme proposé par Jacques Derrida reprend les principes de la généalogie nietzschéenne et se fixe comme programme de mettre à jour la métaphysique occidentale et d’annuler ses effets qui réduisent l’écriture à un redoublement de la parole.
[3] Ce matériau s’inscrit dans un des quatre horizons de l’écriture perecquienne : « (…) En fait, me semble-t-il, au-delà de ces quatre pôles qui définissent les quatre horizons de mon travail -le monde qui m'entoure, ma propre histoire, le langage, la fiction-, mon ambition d'écrivain serait de parcourir toute la littérature de mon temps sans jamais avoir le sentiment de revenir sur mes pas ou de remarcher dans mes propres traces, et d'écrire tout ce qui est possible à un homme d'aujourd'hui d'écrire : des livres gros et des livres courts, des romans et des poèmes, des drames, des livrets d'opéra, des romans policiers, des romans d'aventures, des romans de science-fiction, des feuilletons, des livres pour enfants… » Penser/classer, Georges Perec, La librairie de XXI° siècles, [Seuil
[4] Paru dans la revue d’étude du dialogue texte-image Textimage. Le numéro 3 de 2009 (intitulé A la lettre) est accessible à l’adresse suivante (page par nous consulté le 29 décembre 2012) : http://www.revue-textimage.com /04_a_la_ lettre/ marteau1.html
[5] Voir bibliographie
[6] Voir Jacques Derrida. De la Grammatologie. Paris : Minuit, 1967.
[7] Voir les rechreches d’OULIPO.
[8] Voir Philippe Lejeune. Le Pacte autobiographique. Paris : Seuil/Poétique, 1975.
[9] Paris : Seuil/Coll. Librairie du XXe siècle, 1990. Voir également « Une autobiographie sous contrainte » de Philippe Lejeune (paru dans le Magazine littéraire n° 316, de décembre 1993 consacré à Georges Perec – pages 18-21).)
[10] « Quand on établit un système de contraintes, il faut qu’il y ait aussi de l’anticontrainte dedans. Il faut – et c’est important – détruire le système des contraintes. Il ne faut pas qu’il soit rigide, il faut qu’il y ait du jeu, comme on dit, que ça grince un peu, il ne faut pas que ça soit complètement cohérent : un clinamen, c’est dans la théorie des atomes d’Epicure ; le monde fonctionne parce qu’au départ il y a un déséquilibre. » dans l’entretien avec Ewa Pawlikowska, dans le numéro n° 7 de Littératures (1983) publié par Toulouse-le Mirail.
[11] « "[…] tout texte se construit comme mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation d'un autre texte. A la place de la notion d'intersubjectivité s'installe celle d'intertextualité, et le langage poétique se lit, au moins, comme double." Julia Kristeva, "Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman", Critique, avril 1967. Ce texte est repris dans Semeiotike. Recherches pour une sémanalyse. Paris : Seuil, 1969.
[12] Voir Bernard Magné. « De l’écart à la trace. Les avatars de la contrainte ». Études littéraires, volume 23 n° 1-, été-Automne 1990.
[13] Infini qui se trouve être l’espace appelé littérature.
[14] Ce rêve d’un espace sans fonction est formulé dans Espèces d’espace. Paris : Galilée, 1974.
[15] In Le Livre des ressemblances. Paris : Gallimard (L’imaginaire), 1991 (1e édition en 1976).
[16] Voir l’article « Economimesis » de Jacques Derrida publié dans l'ouvrage collectif Mimesis des articulations (Paris : Aubier-Flammarion, 1975, pages 57 à 93), et auquel ont participé Sylviane Agacinski, Sarah Kofman, Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy et Bernard Pautrat.
[17] Op. cit., p. 26.
[18] Op. cit.,p. 21.
[19] Voir Marcel Bénabou. « Perec et la judéité » in Colloque de Cerisy. Paris : P.O.L, 1984.
[20] Nous faisons ici référence à la nouvelle d’Henry James (« L’image dans le tapis ») dans ses Nouvelles traduites de l’anglais par Michel Gauthier, John Lee, et Benoît Peters et publié, pour l’édition française, chez Les Éditions de l’Équinoxe à Paris en 1984.
[21] Paris : Galilée, 1987.
[22] Ce néologisme apparaît dans Les revenentes. Paris : Julliard, 1972. Dans ce roman Georges Perec renversant la contrainte de ne pas utiliser la voyelle e qu’il s’était fixé dans la Disparition (Paris : Denoël, 1969), s’impose de n’utiliser d’autre voyelle que la voyelle e.
[23] Paris : Denoël, 1969.
[24] Le "paraphe" est un signe manuscrit, consistant le plus souvent dans l'apposition la signature partielle (initiales des nom et prénoms) des personnes parties à un contrat qu'elles apposent au bas de chacune des pages. Le paraphe a deux fonctions, la première est d'assurer que chacun des signataires ne s'est pas contenté de signer la dernière page mais qu'il a lu l'acte en entier, la seconde est d'éviter l'ajout ou la destruction des pages intermédiaires après la signature de l'acte.
![]() Télécharger l’article en version PDF
Télécharger l’article en version PDF
Résumé
L’importance de l’analyse du discours pour la traduction peut certainement se mesurer à l’aune des facteurs textuels. Ceux-ci constituent, en effet, des aspects transversaux véhiculaires du sens et de la mission d’un texte, lesquels en déterminent les types et le niveau de récurrence. Dans le cas des textes spécialisés, le traducteur dispose sans doute de bien de leviers utiles pour la quête du vouloir-dire.
Cette contribution propose une étude traductologique des facteurs textuels à travers le discours spécialisé et tente de démontrer, sur fond d’un corpus de traductions, le rôle essentiel de ces derniers dans l’appréhension du sens.
Mots clés : facteurs textuels, linguistiques textuelle, sens, analyse du discours, traduction spécialisée
Abstract
The importance of discourse analysis for translation can be measured through textual factors. These are, indeed, crosscutting aspects likely to help uncover the mission and meaning of the text, two main parameters which determine their types and level of recurrence. In the case of specialized discourse, the translator has certainly some useful levers for the quest of the intended meaning.
This paper proposes a translatological study of textual factors through specialized discourse, and attempts to demonstrate, using a corpus of translations, the key role of the latter in the apprehension of meaning.
Key words: textual factors, text linguistics, sense, discourse analysis, specialized translation
Introduction
La grande percée de la théorie dite interprétative dans le domaine de la traductologie, ces dernières décennies, n’a pas empêché, pour autant, le renforcement des rapports de convergence entre linguistique et traduction. En considérant le texte comme matériau principal de l’étude scientifique, il est de plus en plus admis que, autant sur la théorie que sur la pratique, ces deux disciplines ont véritablement besoin l’une de l’autre[1].
En effet, dans le vaste champ pluridisciplinaire de ses centres d’intérêt, la linguistique fait souvent montre d’un domaine dynamique et innovant, essentiellement orienté vers l’étude, la construction et l’amélioration des performances en langue. C’est ainsi que, étant donné qu’en matière d’analyse du discours, le processus de quête du sens s’avère bien souvent complexe et variable d’un texte à l’autre, la linguistique contemporaine en est arrivée, notamment à travers le projet grammatico-textuel[2], à mettre au point une théorie du texte.
L’objectif principal, entre autres, de ce projet consiste en l’étude systématique de ce qu’il est convenu d’appeler les facteurs textuels, afin de voir comment et en quoi ces derniers peuvent affecter ou faciliter la compréhensibilité d’un texte. C’est surtout en tout cela que les méthodes et résultats de la linguistique sont plus que jamais d’un grand apport pour la traduction en tant que processus.
Aujourd’hui, vu l’importance que revêt une telle approche dans le cas de la traduction en général, et plus particulièrement de la traduction spécialisée, il nous semble fort utile de considérer les rapports entre traduire un texte de spécialité et analyser les facteurs qui en font et déterminent la textualité.
Le présent article s’attache à démontrer comment les facteurs textuels interviennent comme leviers essentiels d’appréhension du sens dans le processus de traduction des textes de spécialité. Pour ce faire, nous en dégageons, dans un premier temps, puis analysons les différents types récurrents à travers le discours spécialisé, en nous appuyant notamment sur un corpus constitué de deux textes du genre suivis de leurs traductions respectives.
I. Les facteurs textuels : un objet d’étude de la linguistique contemporaine
Comme la plupart des sciences humaines, la linguistique a aussi connu, dans son évolution, un certain nombre de phases d’innovations ayant souvent abouti à l’émergence de nouvelles tendances globalement inspirées de son orientation classique.
En effet, aux premières années de sa naissance, la linguistique se reconnaissait à une seule position fondamentale (Hymes : 1991) : l’étude spécialisée de la structure et de l’histoire de langues particulières, de groupes de langues et de familles de langues. Beaucoup plus tard, précisément au début de la seconde moitié du siècle dernier, sous l’impulsion des idées de N. Chomsky, elle a connu un élargissement à la psychologie cognitive et à la nature psychologique de l’être humain : ce furent alors les prémices de l’actuelle psycholinguistique.
De nos jours, la discipline a opéré une sorte de retour à la source, non pour reconsidérer les mécanismes d’évolution ou d’utilisation de la langue, mais justement pour analyser la structuration de celle-ci dans son cadre de manifestation concrète : le discours, oral ou écrit. Né à la suite et, dans une certaine mesure, en réaction aux idées chomskyennes, sous les plumes d’éminents linguistes et psycholinguistes tels que Sperber, Hymes, Van Dijk, Charolles, etc., le courant de la linguistique textuelle a lui aussi connu des ramifications internes ayant donné naissance à des sous-domaines comme l’étude des facteurs de compréhensibilité et de lisibilité textuelles :les notions de cohésion ou de continuité, de cohérence, de pertinence, de situationalité, d’intentionnalité, etc.
Il s’agit essentiellement, pour cette linguistique textuelle, telle qu’entendue par Beaugrande ou Charolles, de procéder à l’identification et à la description des différents systèmes de marques contribuant à la cohésion du discours ou encore à l’étude des propriétés constitutives du texte ainsi que leurs différents emplois dans un contexte communicationnel. C’est en somme mener une étude ayant pour but de voir comment la langue fournit à ses utilisateurs un ensemble de moyens leur permettant d’indiquer certains rapports qu’ils établissent entre les différentes choses qu’ils expriment, notamment par le repérage des facteurs textuels à même de conférer au discours une certaine homogénéité ou continuité. Ceci reviendrait, d’après Rastier, à mettre en lumière les propriétés de cohésion et de cohérence qui font qu’un texte n’est pas réductible à une simple suite de mots !
I.1. Approches définitoires
Afin de mieux cerner et aborder les différents types de facteurs textuels, il convient ; en premier lieu, de tenter d’en dégager une définition sur la base de quelques approches assez édifiantes.
I.1.0. Préliminaires
Bien qu’une étude systématique des facteurs textuels soit une orientation assez nouvelle de la linguistique contemporaine, pourtant leur emploi, ou du moins leur évocation, dans les domaines pédagogique et docimologique ne date pas du tout d’aujourd’hui[3] ! En vérité, on ne peut ignorer l’existence, dans la plupart des copies d’élèves ou d’apprenants en langues, des remarques du genre « manque de cohérence », « manque de pertinence » ou parfois même « manque de cohésion dans les idées »… ! Mais toujours est-il qu’une définition exacte de ces termes est souvent sujette à controverses, notamment quant à leur applicabilité dans le cadre textuel.
Alors que les dictionnaires, tels que le Robert et le Hachette, définissent par exemple la cohérence respectivement comme le rapport étroit d’idées qui s’accordent entre elles et le rapport de logique et d’adhérence entre les idées d’un discours, les spécialistes de la question, eux, s’adonnent à des spéculations assez généralistes mais plutôt édifiantes !
I.1.1. L’approche psycholinguistique
L’approche psycholinguistique sur les facteurs textuels s’intéresse essentiellement aux notions de cohérence, de cohésion et, dans une moindre mesure, de pertinence du discours, et a connu ses véritables premières théories entre la fin des années soixante-dix et le début des années quatre-vingt.
C’est Van Dijk qui, par exemple, à partir de l’étymologie textus (tissé), met en relief le caractère indissociable des notions de cohésion, de cohérence et de texte. Dans son célèbre ouvrage intitulé « Le texte », il tente d’expliquer, entre autres, que la cohérence d’un texte se trouve dans les liens qui se forment entre ce qu’il appelle la microstructure (niveau des phrases) et la macrostructure (le sujet développé d’une phrase à l’autre pour constituer un tout homogène). Pour Van Dijk et Kinstch, la cohérence du discours réside en grande partie dans la reprise d’un argument dans la structure propositionnelle.
Parallèlement, Johnson-Laird (1983), abordant la question sous un autre angle, note que « dans un discours, chaque phrase doit référer explicitement ou implicitement à une entité à laquelle il a déjà été fait référence (ou qui a été introduite) dans une autre phrase, car seule cette condition permet d’intégrer les phrases dans un modèle unique » (p. 371). Pour lui, la cohérence et la cohésion du discours représentent des facteurs clés permettant au lecteur d’enregistrer les informations suivant leur fil d’apparition et à les intégrer dans un schéma mental. C’est là un principe fondamental de la compréhensibilité du discours.
Dans le même ordre d’idée, Sperber et Wilson (1989), considérant les notions de cohérence et de pertinence, soutiennent que l’interprétation de tout énoncé ou de toute séquence d’énoncés est gouvernée par un principe unique qu’ils appellent pertinence optimale. Contrairement à ce que défendent certains théoriciens en linguistique textuelle, ce principe s’applique même quand il n’y a pas d’infraction au critère de cohérence. Selon eux, l’interprétation du langage est en effet fondamentalement contextuelle et inférentielle : elle suppose l’élaboration d’hypothèses contextuelles qui assurent la manifestation des informations en situation. Le contexte, ici, n’est pas conçu comme donné, il ne se réduit en particulier pas à des savoirs latents supposés partagés (cf. Moeschler, 1994), il est construit par l’interprétant et peut se modifier au fur et à mesure qu’il avance dans la découverte du texte.
Afin de mieux saisir les notions de cohérence et de pertinence selon l’approche psycholinguistique, prenons un cas d’illustration :
Exemple1 : le lundi matin dernier, la circulation automobile était presque impossible dans la banlieue dakaroise parce qu’il avait abondamment plu la veille au soir.
Cet énoncé fait à la fois montre d’une cohérence (présence du marqueur de causalité) et d’une pertinence (logique relation de cause à effet entre la proposition principale et la proposition subordonnée) indiscutables !
Mais,
Exemple2 : avant-hier il a beaucoup plu sur l’île, suite à l’envahissement de Saint Louis par des touristes venus de toutes parts.
On note dans cet exemple, certes une certaine cohérence (utilisation du connecteur temporel suite à), mais quant à la pertinence, elle brille par son absence (en effet, on conviendra aisément qu’il n’existe a priori aucun rapport entre l’abondance de pluie et l’affluence de touristes sur l’île). La cohésion de l’énoncé, par contre, se manifeste à travers la référence cataphorique établie entre les termes île et Saint Louis pour éviter la répétition.
En outre, on ne saurait passer sous silence deux autres facteurs clés dont le repérage te l’analyse permettent un approfondissement de la compréhension du texte : l’intentionnalité et la situationalité.
En effet, telle que définie par Searle dans son ouvrage ainsi intitulé, « l’intentionnalité est la propriété en vertu de laquelle toutes sortes d’états et d’événements mentaux renvoient à ou concernent ou portent sur des objets et des états de choses du monde » (1985 :15). En d’autres termes, l’intentionnalité d’un texte qui n’est autre que celle de son auteur, renvoie à l’ensemble des intentions ayant présidé à sa mise en forme. Sa détermination doit donc constituer une étape préalable à la traduction, du moins théoriquement.
Quant à la situationalité, elle joue un rôle, sans doute pas des moindres, dans l’appréhension objective du sens d’un texte. On entend par situationalité, ou encore contexte, la relation intrinsèque qui lie un texte à une situation donnée. La compréhension, précisément en vue d’une éventuelle traduction d’un texte passe nécessairement par sa contextualisation ou situationalisation, c’est-à-dire son cadrage systématique dans une situation de communication ayant motivé sa production.
I.1.2. L’approche linguistique
I.1.2.1. Cohésion et cohérence chez M. Charolles
De façon générale, la notion de facteurs textuels passe pour une initiative premièrement linguistique. Même si l’ensemble des approches s’appuie sur la vision propre de leurs auteurs respectifs, il existe toutefois des conceptions transversales entre les unes et les autres.
Avec Charolles (1978, 1988), la notion de cohérence textuelle est un principe très général d’interprétation du langage en contexte, tandis que la cohésion, plus ou moins externe à la structure sémantique du texte, est marquée par des éléments lexico-grammaticaux qui permettent sa lisibilité comme corps homogène.
Pour donner une représentation assez visuelle de cohésion, il propose le schéma général suivant :
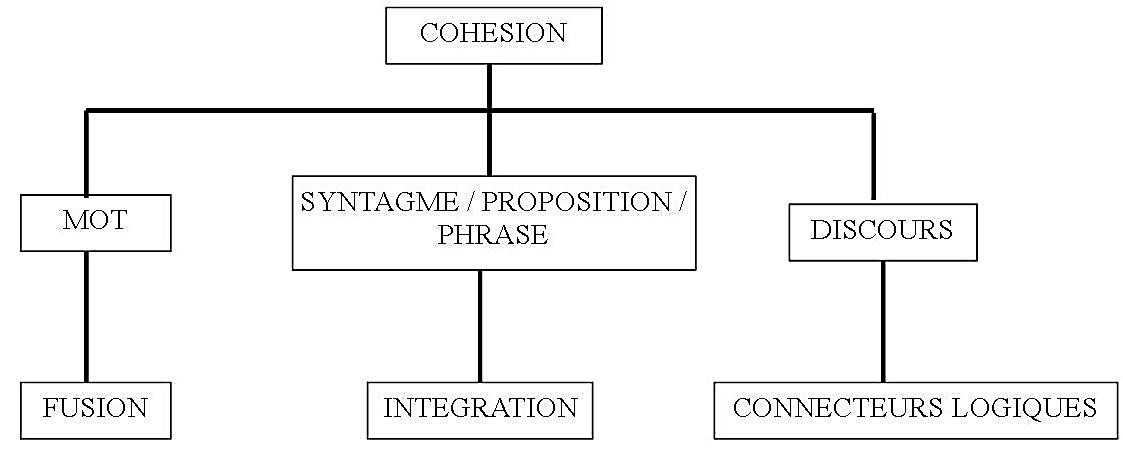
Figure 1 : représentation schématique des relations de cohésion
Source : Charolles (1988)
On relèvera dans ce schéma deux faits importants :
─La cohésion d’un texte commence par sa microstructure et s’étend progressivement à la macrostructure, au fur et à mesure que les phrases se succèdent.
─La cohésion d’un texte n’inclut pas nécessairement sa cohérence, mais il est aussi à noter qu’un discours peut être cohérent sans faire montre d’une quelconque cohésion.
Prenons deux exemples pour illustrer ce qui précède :
Exemple1 : Mass a échoué. Il n’a pas eu l’UE de traduction, où l’on remarque une cohérence sans cohésion.
Mais,
Exemple2 : Mass a échoué parce qu’il n’a pas eu l’UE de traduction, où l’on note à la fois cohérence et cohésion.
Outre que l'étude du fonctionnement de ces marques amène déjà, selon les propos de Charolles (1988) aux confins de la pragmatique linguistique, elle ne permet pas de rendre compte des nombreux cas où une séquence paraît parfaitement cohérente quoiqu’elle ne comporte aucun indicateur relationnel. L'occurrence d'un connecteur et/ou d'une anaphore et/ou d'une quelconque autre marque de cohésion n'est en effet ni une condition nécessaire ni une condition suffisante pour que par exemple une suite de deux énoncés paraisse former une séquence cohérente intelligible en tant que tout.
Partant de ce point de vue et s’inspirant de travaux en grammaire du texte, Charolles propose quatre règles de bonne formation textuelle, permettant de concilier ces facteurs textuels clés et la pédagogie.
Règle 1, la répétition : elle consiste principalement en l’observation et l’utilisation des multiples procédés de rappel (anaphore, cataphore…)
Règle 2, la progression : elle concerne l’utilisation des connecteurs logiques, des marqueurs de texte, des types de progression thématique…
Règle 3, la relation : c’est la prise en considération de la situation de communication (aspects contextuels, intention de l’énonciateur, type de texte…)
Règle 4, la non-contradiction : cette dernière règle signifie qu’aucun élément sémantique ne doit contredire un contenu posé ou présupposé.
Par ailleurs, Charolles relève également la syntaxe comme un puissant facteur textuel d’intégration des données verbales, et qui repose sur des relations entre des textes appartenant à des catégories grammaticales déterminées et susceptibles d’occuper des positions prédéterminées. A cet égard, il faudrait préciser que les connexions structurales qui sont des systèmes de solidarité[4] à même de conférer au texte une certaine continuité ou homogénéité, relèvent essentiellement du dispositif syntaxique.
I.1.2.2. L’approche de Beaugrande et Dressler (1981)
L’évolution de la linguistique textuelle a connu un tournant décisif avec la publication en 1981 de ce qu’on pourrait qualifier de chef-d’œuvre dans ce domaine : la célèbre Introduction to Textlinguistics de R. de Beaugrande et W. Dressler. Les auteurs y exposent de façon scientifique sept facteurs textuels qui passent pour des standards en la matière : la cohésion, la cohérence, l’intentionnalité, l’acceptabilité, l’informativité, la situationalité et l’intertextualité.
Vu l’aspect assez restreint de la présente étude et la nature du corpus y afférant, nous proposons de n’en considérer que quatre, non des moins significatifs : la cohésion, la cohérence, l’intentionnalité et l’informativité.
- La cohésion
La notion de cohésion chez Beaugrande et Dressler recouvre ‘‘les voies et moyens par lesquels les composants superficiels du texte, c’est-à-dire les mots entendus ou vus, sont reliés les uns aux autres dans une séquence où ils dépendent les uns des autres suivant les formes grammaticales et les règles d’usage’’ (p. 3). En d’autres termes, un texte manifestera une certaine cohésion lorsque l’ensemble des idées qui le constituent se présentent sous une forme d’interconnexion assurée par des marqueurs logiques tels que les connecteurs de causalité, de conséquence, de concession ou d’opposition, etc. Cette conception, loin de s’ériger en exception, recoupe nettement, dans une large mesure, avec les précédentes.
- La cohérence
Alors que la cohésion se manifeste à la surface du texte, la cohérence, elle, se rattache plutôt au contenu propositionnel du discours. Ces auteurs la définissent, en substance, comme la façon dont les composants de ce qu’ils appellent Univers Textuel, c’est-à-dire la configuration des concepts et les rapports qui sous-tendent le ‘texte-surface’, entretiennent entre eux de l’homogénéité et font montre d’une certaine pertinence. C’est dire que ce qui fait la cohérence d’un discours n’est pas à chercher à la surface mais au fond caractérisé par une pertinence claire.
- L’intentionnalité
De tous les facteurs textuels, l’intentionnalité paraît être d’une conception plus consensuelle. En effet, psycholinguistes (Teun Van Dijk, Kinstch), linguistes (Beaugrande et Dressler, Charolles) et même philosophes (Searle, 1985) s’accordent à dire que le terme désigne la somme des intentions ayant motivé la production du discours. Sa détermination est censée permettre de pouvoir entamer la traduction du texte en question.
- L’informativité
L’informativité est un facteur peu récurrent en linguistique textuelle. Beaugrande et Dressler la conçoivent comme le niveau auquel l’information convoyée par le texte peut paraître inattendue et nouvelle chez le récepteur. Même s’ils admettent qu’elle s’applique généralement au contenu, ils soulignent toutefois que tout dans le corps textuel, à la surface comme au fond, peut être porteur d’information.
I.2. Synthèse
A la suite de ce bref survol de quelques approches sur la notion de facteurs textuels, se dégagent un certain nombre de positions transversales, lesquelles convergent parfaitement dans le même sens que le modèle de Graesser (cf. Charolles, 2000) : la compréhension d’un texte se construit au fur et à mesure de sa lecture en une représentation cohérente de son contenu. Pour ce faire, l’on doit impérativement déterminer les relations entre les différents mots et phrases du texte (cohérence locale) ainsi que celle qui relient les différentes parties du texte (cohérence globale) ; l’établissement de ce dernier type de cohérence s’appuiera sans aucun doute sur les relations qui unissent les phrases et les paragraphes, notamment les relations de cause à effet, de contraste, de similitude, etc. Celles-ci peuvent être indiquées explicitement dans le texte par des marqueurs linguistiques ou connecteurs logiques tels que parce que, afin que, de sorte que, bien que, à cause de, etc. Mais lorsqu’elles sont laissées implicites par l’auteur, le lecteur doit pouvoir les inférer en sollicitant son bagage cognitif général !
C’est en substance à ce niveau que les textes spécialisés se distinguent, puisque le lecteur ne dispose pas souvent de ces connaissances externes à l’abord du texte, vu le caractère spécifique et nouveau du thème traité en général.
II. Illustration en traduction de textes spécialisés
II.0. Préliminaires
Il nous semble important, avant d’entrer dans le vif de cette partie, d’examiner d’abord ce que recouvre les notions de traduction spécialisée, et par-delà, texte spécialisé ou encore langue spécialisée.
En effet, la notion de langue spécialisée ou langue de spécialisation s’oppose terminologiquement à celle de langue commune. Si l’on entend par cette dernière l’ensemble des mots et expressions qui, dans leur contexte d’utilisation, ne se réfèrent à aucun domaine spécifique (Rondeau, 1984), par langue de spécialisée c’est justement le contraire qu’il faut envisager ; elle désigne un ensemble lexical déterminé, conçu par et pour les spécialistes d’une activité ou d’un domaine donné en vue de faciliter la communication entre eux. On peut alors l’appeler de l’extérieur, sans risque d’exagérer, langue ésotérique !
Ainsi, un texte spécialisé sera une succession de concepts, termes ou encore notions propres à un domaine bien précis dans un tout cohérent et homogène.
Par ailleurs, il convient de noter la relation de synonymie entre texte spécialisé et texte technique, comme démontré par Durieux (1988). Un texte, dans la mesure où il véhicule une information précise, particulièrement propre aux domaines technique et scientifique, et s’abstrait de l’aspect esthétique peut être assimilé à un texte technique…
Contrairement au texte général ou commun, englobant une multiplicité d’éléments intertextuels qui déterminent en grande partie sa teneur et, ipso facto, aident à sa compréhension, le texte spécialisé semble bien plus restreint. C’est le plus souvent un discours spécifique conçu de façon ponctuelle pour une utilisation ponctuelle par un type de lectorat bien précis !
Cette particularité, en plus du caractère plus ou moins univoque du lexique employé, fait que les facteurs textuels sont assez souvent implicites ou rendus accessoires à la compréhension. En effet, l’insouciance de l’esthétique et le souci constant de ne dire que ce qui doit être compris et, le cas échéant, applicable dans l’immédiat, ôtent au texte spécialisé, dans une certaine mesure, toute cette rigueur dans la syntaxe ou le style. Ceci pourrait participer, en général, à inhiber les facteurs textuels, du reste plus visibles dans un texte général.
En revanche, les notions de temps et d’aspect, constituant des paramètres importants du facteur cohésion, apparaissent souvent sous leurs formes les plus claires et simples…
Dans cette seconde partie, l’objectif principal est de tenter une application, ou peut-être même procéder à une vérification, des approches précédemment analysées sur les réalités textuelles en traduction spécialisée.
Suivant la méthodologie adoptée, nous essayerons ainsi de voir, sur fond de textes illustratifs, le rôle des facteurs textuels dans la traduction de textes de spécialité. L’analyse qui s’en suivra va s’appuyer sur quelques facteurs dignes d’intérêt en rapport avec le contenu spécifique des textes choisis. Il s’agit de textes techniques traitant de domaines scientifiques et dont nous avons recueilli quelques traductions qui serviront de support à notre analyse.
II.1. Exemples de traductions de textes spécialisés.
Les deux extraits de textes suivants, suivis de leurs traductions respectives, vont nous servir de support dans l’analyse des différents facteurs textuels souvent caractéristiques du discours spécialisé. Il convient de préciser, avant tout, que la présente analyse ne nourrit pas la prétention de traiter de façon exhaustive tous les facteurs textuels généralement connus ; elle ne portera que sur quatre, comme énoncé ci-haut, vu leur rôle prépondérant dans la structure des textes spécialisés en présence.
Par ailleurs, le choix de ces deux traductions, tout comme des textes originaux, obéit globalement, au-delà de leur caractère purement spécialisé, à ce critère essentiel : la présence, en amont, des quatre facteurs textuels étudiés ici et leur réapparition systématique, en aval, notamment à travers le processus de réexpression des diverses unités sémantiques.
Τexte1 : La fabrication du pain[5]
La fabrication du pain repose sur l’action d’un champignon microscopique, la levure et éventuellement de bactéries lactiques dans le cas du pain au levain, sur les composants du blé.
Pour mieux comprendre ce qui se passe
Dans la pâte, en absence d’oxygène, les microorganismes naturellement présents dans la farine ou apportés sous forme de levure de panification dégradent les sucres naturellement présents dans la farine au cours du processus de fermentation pour produire l’énergie qui est nécessaire à leur vie.
Lorsque la pâte est fermentée à l’aide de levain, on laisse se développer les microorganismes présents dans la farine. Dans 100 g de farine, vivent naturellement un million (106) de levures, essentiellement du genre Saccharomyces et 10 millions (107) de bactéries, essentiellement lactiques.
Lorsque la pâte est fermentée à l’aide de levure de boulangerie, un apport de 2,5 g de levure de boulangerie pressée pour 100 g de farine fournit 25 milliards (25 x 109) de cellules. Leur action prédomine au cours de la panification.
Au cours du pétrissage, à partir des sucres, les bactéries produisent de l’acide lactique ou de l’acide acétique et de l’alcool selon les genres en présence ; la levure fabrique de l’alcool et du gaz carbonique.
Les sucres naturellement présents dans la farine sont le glucose et le saccharose. Ils représentent au maximum 0,5 g pour 100 g de farine auxquels s’ajoutent au plus 25 g de maltose libérés par kg de pâte sous l’action d’enzymes naturellement présentes dans la farine. (…)
Traduction: (publiée sur le même site : www.inra.fr et mise à jour à la même date)
The manufacture of bread
The manufacture of bread rests on the action of a microscopic mushroom, the yeast and possibly of lactic bacteria in the case of bread to leaven, on the components of wheat.
To better understand what happens
In the dough, in absence of oxygen, the naturally present micro-organisms in flour or brought as yeast of panification damage the naturally present sugars in flour during the process of fermentation to produce the energy that is necessary to their life.
When the dough is fermented with the help of leaven, one lets develop itself the present micro-organisms in flour. In 100 g of flour, live a million naturally (106) of yeasts, essentially of the Saccharomyces kind and 10 millions (107) of bacteria, essentially lactic.
When the dough is fermented with the help of yeast of bakery, a contribution of 2,5 g of hurried bakery yeast for 100 g of flour provides 25 billions (25 x 109) of cells. Their action predominates during the panification.
During kneading, from sugars, the bacteria produce the lactic acid or the acetic acid and the alcohol according to the kinds in presence; the yeast manufactures the alcohol and the carbon dioxide.
The naturally present sugars in flour are glucose and sucrose. They represent to the maximum 0,5 g for 100 g of flour to which are added to the more 25 g of maltose freed by kg of dough under the action of naturally present enzymes in flour. (...)
Par J. M. Salmon
Τexte2 : A propos de l’énergie solaire[6]
II.2. Des constats
Dans ces textes, quatre facteurs essentiels, à savoir la cohésion, la cohérence, l’informativité et l’intentionnalité, vont intéresser notre analyse d’autant plus que d’autres tels que l’acceptabilité, la situationalité et l’intertextualité paraissent ici plus ou moins accessoires.
Dès l’abord des textes originaux, une porte s’ouvre sur un facteur sine qua non à la compréhension : l’intentionnalité ; celle-ci transparaît, en effet, à travers les titres, et le lecteur-traducteur n’aura pas alors à passer par quatre chemins, comme c’est souvent le cas ailleurs, pour la débusquer. C’est justement ce qui explique la correspondance établie entre les termes des titres de départ et d’arrivée (Texte1 : » manufacture » pour « fabrication », « of » pour « de », « bread » pour « pain » ; texte2 : « con respecto a » pour « à propos de », « l’énergie solaire » pour « la energía solar »). Ainsi, le fil conducteur saisi avec une certaine certitude, le traducteur, dans sa traduction, a pu suivre, sans égarement à quelque niveau que ce soit, la description conceptuelle du processus de fabrication de pain, tout comme l’explication de l’origine et de l’utilité de l’énergie solaire, de la nature aux fonctions de l’aliment et de la ressource en question, ce qui fait par ailleurs le fond des textes. C’est là une manifestation claire de la règle dite de relation de Charolles.
Ensuite, du point de vue informatif, c’est-à-dire l’effet de l’information donnée sur le lecteur, un constat général s’impose : en effet, vu la nature du texte en soi, le lecteur-traducteur reste plus ou moins confronté à un déluge d’informations tout de même interconnexes et convergentes ; car, en dépit de leur diversité, elles ont toutes pour fonction d’expliciter davantage les thèmes traités (ici, les titres) et ne s’en écartent en aucune façon. De ce point de vue, l’informativité du texte, déterminée par la nouveauté de l’information convoyée chez le lecteur, se trouve renforcée ; le lecteur-traducteur ne découvre pas qu’une chose nouvelle, mais tous les éléments internes et externes qui la caractérisent, et ce, dans les moindres détails scientifiques. C’est ce qui explique la présence massive de chiffres à travers les textes, notamment au niveau du texte1.
En outre les facteurs de cohésion et de cohérence, manifestes soit explicitement (syntaxe ou aussi structure de surface[7]) soit implicitement (séquentialité, temps et aspects), se présentent ici, comme d’ordinaire d’ailleurs, de façon indissociable. En fait, sur le plan de la cohésion, par exemple, trois facteurs la mettent en relief :
▬Le temps : vu la fonction descriptive du texte, le temps utilisé, à juste titre, est le présent simple (Texte1 :‘rests’= ‘repose’, ligne1, ‘happens’=’se passe’, ligne4 ; texte 2 : ‘travels’=’voyage’, ligne1, etc.)
▬L’aspect : en fonction du temps employé, l’aspect essentiel des idées élaborées fait état de vérité générale scientifique ou d’actions à exécution évidente. Ce sont généralement des faits impassibles de toutes sortes d’interprétations (Texte1 : Les sucres naturellement présents dans la farine sont le glucose et le saccharose, paragraphe7 ; texte2 : les applications les plus fréquentes ont trait au chauffage de l’eau et des locaux, paragraphe2).
▬La récurrence de facteurs temporels (lorsque=when, au cours de=during…) ainsi que l’interconnexité des idées développées…
Quant au facteur de cohérence, il paraît plus ou moins inclus dans la cohésion globale du texte. La cohérence est parfois notable à travers la succession des informations dans une logique qui fait sens et corroborée par la présence d’éléments quantitatifs qui viennent renforcer la crédibilité du discours (ligne 5, texte1).
II.3. Analyse des constats
Il n’est pas surprenant, au regard des différents constats notés dans les deux textes, de voir que la spécificité des textes spécialisés par rapport à ceux de diffusion générale s’accentue au niveau des quatre facteurs essentiels énumérés plus haut. Vu les circonstances de sa production, le plus souvent subordonnée à des besoins d’un moment donné où à un type de destination prédéfini, ce genre de textes ne peut, à notre sens, constituer un cas d’ étude idéal pour faire ressortir tous les facteurs textuels omniprésents dans n’importe quel discours ‘‘grand public’’, littéraire ou journalistique.
En effet, un facteur, tel que la situationalité par exemple, n’apporte pas grand-chose ici qui puisse aider le lecteur-traducteur à mieux appréhender le sens du texte. Il n’existe aucun indice paratextuel encore moins contextuel à cet égard. Les seuls détails dont dispose le traducteur dès la découverte du texte se ramènent au titre et à l’auteur. Voilà pourquoi l’essentiel de l’opération compréhension-traduction ne doit se jouer que sur des facteurs comme la cohésion, la cohérence, l’intentionnalité et l’informativité, lesquels peuvent éclairer sur l’orientation exacte du texte.
C’est ainsi que pour l’intentionnalité, une analyse méthodique ou même terminologique du texte en vue de la dégager paraît bien accessoire ici : celle-ci est en effet, comme démontré précédemment, explicitée dès l’abord du texte (Texte1 : La fabrication du pain ; texte2 : A propos de l’énergie solaire), en d’autres termes dans ce type de communications dites scientifiques et techniques (C.S.T.), comme le fait remarquer G. Rondeau (1981 :27), ce sont bien plus des styles particuliers, qui caractérisent la structuration des idées émises, que des formules stylistiques assez impénétrables propres aux autres types de discours. Le seul fait d’être produites par et à l’intention des spécialistes d’un domaine ou d’une activité donnés leur épargne toute cette pédanterie au niveau du style.
La lecture d’un texte de type journalistique permet de confirmer ce qui précède. Dès les premières phrases de lecture, le lecteur-traducteur est en général mentalement assailli par diverses interrogations telles : qui parle ? Où ? Quand ? A qui ? Pourquoi ? Comment ? Sans oublier d’autres questions pragmatiques relatives aux personnages, aux temps verbaux et aux aspects qui en découlent. des questions dont le traducteur spécialisé pourrait pourtant se passer ; ce qui importe à ce dernier, ce sont les renseignements multiples que le texte, à travers ses différentes structures (macro et micro), lui apportent sur le sens du message communiqué, et peu importe comment, car les termes et les concepts, ainsi que les phrases qu’ils constituent, sont très peu sujets à interprétation : il faut juste les entendre tels qu’ils apparaissent ; et cela, c’est la notion d’univocité terminologique[8] qui le garantit !
Au demeurant, si nous considérons avec Politis (2000) que les facteurs textuels, pris dans leur globalité, jouent un rôle non négligeable dans l’interprétation des référents pragmatologiques, force est de souligner qu’en matière de traduction spécialisée ce sont surtout la cohérence et l’informativité du texte sur lesquelles le traducteur devra davantage s’appuyer afin d’aboutir à un discours intelligent et intelligible. Sur le niveau de la cohérence textuelle, on ne dira jamais assez que la structuration raisonnée des idées en dépend, notamment en conjonction avec la notion de pertinence citée plus haut.
Enfin, dans la mesure où un texte, de quelque type qu’il soit, constitue, selon les termes de Beaugrande et Dressler, un système cybernétique régulant de façon continuelle les fonctions principales des occurrences qui le composent, on conviendra alors que dans les discours spécialisés cette régulation semble un peu plus claire et accessible, eu égard à la simplicité du style et de la syntaxe, importants facteurs de cohésion.
Conclusion
Au terme de cette étude plus ou moins synthétique, donc loin d’être exhaustive, sur les mécanismes de fonctionnement et les rôles des facteurs textuels en traduction de discours spécialisés, nous pouvons dégager un certain nombre de constats quelque peu globaux :
- Premièrement, il est à souligner qu’il existe une différence notoire relative au fonctionnement et à la structuration des facteurs textuels entre discours spécialisés et discours général. Comme nous l’avons précédemment noté, cette réalité est due en grande partie à la différence stylistique de part et d’autre, et aussi au type de mission spécifique à chaque texte.
- Deuxièmement, contrairement aux textes de diffusion générale, les textes spécialisés ne constituent généralement pas un champ d’exploration et d’exploitation idéal des facteurs textuels dans leur globalité, tels qu’ils sont énumérés par Beaugrande et Dressler (1981). Ce constat s’explique en partie par les mêmes raisons que le précédent (différence de style et de mission des textes).
- Enfin, l’analyse des facteurs textuels présents dans un texte, en vue de sa traduction, révèle une fois de plus qu’entre la traductologie et la linguistique, en dépit des divergences d’approches relevées çà et là, il n’existe véritablement pas de cloison étanche.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
-BEAUGRANDE R.-A. et DRESSLER W. U. Introduction to Text Linguistics. London: Longman, 1981.
-BOISSEAU, M. et CHUQUET, H. « Linguistique et traduction : réflexions théoriques et applications », Revue française de linguistique appliquée. XIV-1 (5-9), 2009.
-CHAROLLES, M. « Enseignement du récit et cohérence du texte » dans Langue française. no 38, Larousse, 1978.
-CHAROLLES, M. «Les études sur la cohérence, la cohésion et la connexité textuelles depuis la fin des années 1960». Modèles linguistiques. Tome X, Fasc. 2, 1988.
-DUBUC, R. Manuel Pratique de Terminologie. Montréal: Linguatech, 1978.
-DURIEUX, C. Fondement didactique de la traduction technique. Paris : Didier Erudition, 1988.
-ECO, U. Limites (Les) de l’interprétation. trad. Par Myriem Bouzaher. Paris : Grasset, 1990.
-HACHETTE. Dictionnaire Encyclopédique. Paris : Hachette, 1998.
-HYMES, D. H. Vers La Compétence de Communication. Paris : Edition Didier, 1991.
-JAKOBSON, R. Essais de Linguistique Générale. Paris : Editions de Minuit, 1963.
-JOHNSON-LAIRD, P.-N. Comprehension as the construction of mental model. In H.-C. Longuet-Higgins, J. Lyons & D.-E. Broadbent (Eds.), “The psychological mechanisms of language”, London: The Royal Society, 1983.
-KINSTCH, W. & VAN DIJK, T.A. Strategies of Discourse Comprehension. New York: Academic Press, 1983.
-LADMIRAL, J.-R. Traduire: théorèmes pour la traduction. Paris: Payot, 1979.
-MAINGUENEAU, D. Nouvelles tendances en analyse du discours. Paris: Hachette, 1987.
-MAINGUENEAU, D. Les Termes clés de l’analyse du discours. Paris : Seuil, 1996.
-MAINGUENEAU, D. L’analyse de discours. Paris : Hachette, 1997.
-MOESCHLER, J. Dictionnaire encyclopédique de pragmatique / J. Moeschler et A. Reboul.- Paris : Seuil, 1994.
-PERGNIER M. « Traduction et linguistique : sur quelques malentendus », La linguistique. Vol. 40, pp.15-24. DOI: 10.3917/ling.401.0015, 2004.
-POLITIS, M. « Le Sort des Référents Pragmatologiques dans le Texte d’arrivée en Traduction Juridique », Communication présentée au colloque internationalTraduction juridique : Histoire, Théories et Pratique, organisé par l’École deTraduction et d’Interprétation de l’Université de Genève du 19 au 21 février 2000.
-RASTIER, F. Sens et textualité. Paris : Hachette, 1989.
-RASTIER, F. Sémantique Interprétative. Paris : Presses Universitaires de France, 1984.
-RONDEAU, G. Introduction à La Terminologie. 2e Edition. Québec : Gaëtan Morris Editeur, 1984.
-SEARLE, J. L’intentionnalité. Paris : Les Editions de Minuit, 1985.
-SELESKOVITCH, D., & LEDERER, M. Interpréter pour traduire. Paris : Didier Erudition, 1984.
-SPERBER, D. et WILSON, D. La pertinence: communication et cognition. Paris: Editions de Minuit, 1989.
-VAN DIJK, T. A. « Le texte » in Dictionnaire des littératures de langue française. tome III, Bordas, 1981.
* Enseignant/Chercheur, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal/ Laboratoire du CRISCO, Université de Caen, France
[1]Maurice Pergnier (2004),Maryvonne Boisseau et Hélène Chuquet (2009), etc. sont, en particulier de ceux qui prônent une transdisciplinarité naturelle et féconde entre Linguistique et Science de la Traduction.
[2] Les principaux tenants de ce nouveau courant linguistique, qui refuse qu’un texte soit réduit à une simple suite de mots et propose, de facto, une analyse plus profonde de sa structure en vue de sa compréhension objective, sont M. Charolles, Beaugrande et Dressler, Van Dijk, Sperber, etc.
[3] En effet, c’est précisément dans les années « quatre-vingt », période glorieuse pour la linguistique textuelle, que l’on note les premières études approfondies sur l’importance des facteurs textuels, notamment à travers les travaux de Beaugrande et Dressler (1981), Charolles (1988), etc.
[4] Terme propre à la terminologie de M. Charolles (1995)
[5] Texte publié sur le site de l’INRA, http://www.inra.fr . Date de création : 25 février 2005. Date de dernière mise à jour : 02 Mai 2010.
[6] On trouvera l’original et la traduction de ce texte en annexe
[7] Cf. Beaugrande et Dressler (1981)
[8] L’un des postulats en terminologie repose sur la thèse selon laquelle chaque terme à l’intérieur d’un discours spécialisé ne doit renvoyer qu’à un et un seul concept (Rondeau : 22).
![]() Télécharger l’article en version PDF
Télécharger l’article en version PDF
Résumé
Cet article est une analyse des significations symboliques de l’imagerie animale dans Age of Iron de John-Maxwell Coetzee. Il démontre que les figures animales sont, d’un côté, utilisées comme éléments de caractérisation des oppresseurs blancs sous l’apartheid, dont les habitudes culturelles peuvent être considérées comme cause profonde de la discrimination ; et d’un autre, elles servent de symbole de leurs politiques répressives. Cette étude montre, également, que ces métaphores animales, combinées à la satire et à l’allégorie, constituent des signifiants qui assurent une critique acerbe de tout exclusivisme racial et culturel.
Mots clés: bestiaire, imagerie, image, symbolisme.
Abstract
This article is an analysis of the symbolical meanings of animal imagery in John-Maxwell Coetzee’s Age of Iron. In this way, it shows that some animal figures are used by the she-narrator to highlight some physical and moral features of her community that could be taken as the root cause of racial violence but also to draw a symbolical image of the corrosive nature of apartheid. Ultimately, this article demonstrates that animal metaphors, combined with satire and allegory, are eloquent signifiers that allow a caustic indictment of any racial or cultural sectarianism.
Keys words: bestiary, imagery, image, symbolism.
Introduction
John-Maxwell Coetzee est l’un des écrivains sud-africains qui dénoncent toute forme de sectarisme racial et culturel. Dans ses textes, Coetzee favorise moins une représentation réaliste qu’un traitement allégorique des maux qui gangrènent la nation sud-africaine. Cet aspect allégorique des productions romanesques de Coetzee incite à les analyser dans un contexte social qui transcende les barrières de l’Afrique du sud au temps de la discrimination raciale. En réalité, l’écrivain sud-africain ne prend pas l’histoire de l’apartheid comme unique et incontournable matériau de base de son œuvre. Pour Coetzee, si l’œuvre d’art cherche à critiquer et à instaurer un monde meilleur, elle doit être conçue de manière à ce qu’elle puisse dépasser le contexte social ou l’épistémè culturelle et historique qui a motivé sa création.
Dans Age of Iron[2], l’auteur s’engage dans une déconstruction de toute pensée ou visée sectaire et de toute politique arbitraire à partir de la situation de violence raciale qui a longtemps prévalu dans son pays. Un tel engagement passe par des techniques de détournement de sens qui assurent une représentation caustique des horreurs de la discrimination raciale. L’imagerie animale est une des techniques de comparaison codée qui expriment l’engagement de l’auteur à ébranler la prétendue supériorité des Blancs.
Comme l’affirme Gilbert Durand dans une analyse pointue des structures de l’imaginaire (qui déconstruit la conception classique de l’image[3] et qui appelle à une approche plus axée sur l’aspect figuratif de la structure), « de toutes les images (…) ce sont les images animales qui sont les plus fréquentes et les plus communes. »[4] C’est le cas dans Age of Iron où, par le « bestiaire de l’imagination », l’auteur s’inspire à fond du monde des animaux pour assimiler les abus de l’espèce humaine aux sournoiseries de certains animaux comme le crabe, ou à la répugnance du porc ou encore à la férocité du sanglier et du taureau.
Ainsi, par une analyse du symbolisme des images animales dans Age of Iron, qui s’appuiera largement sur l’analyse de Durand, cet article montre que les métaphores animales, combinées à l’ironie et la satire, servent de toile de fond à une représentation imagée de la barbarie d’un système d’oppression et de répression tel que l’apartheid, dépeint comme agonisant dans l’œuvre. Le décodage de quelques-unes des nombreuses métaphores animales devrait aider à une interprétation plus profonde de la position de Coetzee quant à la responsabilité des populations sud-africaines face à leur histoire.
1. La nature corrosive de l’apartheid par le symbolisme des crustacés et des acridiens.
Age of Iron raconte, dans un style épistolaire, l’histoire d’une femme, Mrs Curren, atteinte d’un cancer en phase terminale, et qui relate les derniers moments de sa vie à sa fille exilée aux Etats Unis. Elizabeth Curren se sent affligée par la maladie qui ronge de plus en plus son corps et, comme elle le répète à plusieurs reprises dans l’histoire, plus que la douleur physique c’est de la honte qu’elle ressent. En réalité, Mrs. Curren prend sa maladie comme une image allégorique des maux dont souffre la nation sud-africaine, maux qui ont comme noms racisme et discrimination et qui transforment le quotidien des populations en un véritable enfer. Ce symbolisme de la maladie est davantage expliqué dans ce passage de la lettre d’Elizabeth Curren :
For twenty years I have not bled. The sickness that now eats at me is dry, bloodless, slow and cold, sent by Saturn (…) To have fallen pregnant with these growths, these cold, obscene swellings ; to have carried and carried this brood beyond any natural term, unable to bear them, unable to sate their hunger : children inside me eating more everyday, not growing but bloating, toothed, clawed, forever ravenous. (…) Monstrous growths, misbirths: a sign that one is beyond one’s term. This country too: time for fire, time for an end, time for what grows out of ash to grow. (Age, 64-65)
Dans cette séquence, l’affliction de Curren est dépeinte comme étant une force sournoise, nuisible, enfouie dans son organisme et qui, à l’instar de l’Apartheid, dévore patiemment toute force vive – “The sickness eats at me is dry, bloodless, slow and cold ”. L’analogie est d’abord suggérée par ce qui peut être considéré comme une isotopie de la naissance :
Mrs Curren considère les tumeurs en métastase dans son corps comme une multitude d’embryons infects, froids et voraces qui provoquent un gonflement anormal de son abdomen, – “children inside me eating more everyday, not growing but bloating”.
Tout comme les tumeurs cancérigènes qui la dominent, les tentacules néfastes du racisme envahissent l’environnement interne et externe des citoyens noirs et blancs qui sont profondément affectés par une telle calamité. Le symbolisme de ce passage de la lettre du personnage se lit dans la structure phrastique assez suggestive du passage (à l’allure explicative insinuée par l’utilisation des deux points), qui accentue la représentation de l’aspect hideux de l’Apartheid.
Ainsi, reprenant Susan Sontag, Marek Pawlicki affirme à juste titre : «the cancer is presented in terms of a monstrous child, a predatory parasite. It is (…) the barbarian within.»[5]. Enfin, Mrs. Curren ne dit-elle pas avec force aux policiers venus envahir son espace familial ceci: « I have cancer from the accumulation of shame I have endured in my life » (Age, 145) ; ce qui insinue une corrélation implicite entre sa souffrance et la turpitude politique et sociale qui fait la honte de son pays. Une telle analogie se voit renforcée par ces propos de Coetzee, tenus lors d’une interview, et qui suggèrent que sous le régime nationaliste, il y a une généralisation de la souffrance physique et mentale :
in South Africa it is not possible to deny the authority of suffering and therefore of the body ; it is not that one grants the authority of the suffering body : suffering body takes the authority : that is its power.[6]
La narratrice homodiégétique recourt également au monde des crustacés pour présenter autrement la nature affligeante de sa maladie. Elle révèle:
Grief past weeping. (…) To each of us fate sends the right disease. Mine a disease that eats me out from inside. Were I to be opened up they would find me hollow as a doll, a doll with a crab sitting inside licking its lips, dazed by the flood of light. (…) Gnawing at my bones now that there is no flesh left. Gnawing the socket of my hips, gnawing my backbone, beginning to gnaw at my knees. (…) Only this creature is faithful to the end. My pet, my pain. (Age, 112)
S’il est vrai, comme l’affirme Durand dans son étude du régime nocturne de l’image, que « les insectes et les crustacés, les batraciens et les reptiles avec leurs métamorphoses bien tranchées ou les longues latences hivernales (sont) également (…) des symboles lunaires privilégiés »,[7] le crabe, dans l’extrait, peut être pris pour symbole de la latence de la maladie et surtout de son évolution à visages différents. Autant le crustacé/cancer corrode certaines parties du corps de Mrs Curren, autant les politiques et pratiques du régime raciste rongent la nation sud-africaine.
Par ailleurs, en latin – cette langue moribonde dont les vestiges sont incarnés par Mrs Curren, elle-même ancien professeur de latin – ‘cancer’ veut dire ‘crabe.’ Donc, cette signification mourante du mot connote, d’une certaine façon, le trépas inévitable de la narratrice mais surtout du système. En vérité, Age of Iron fait allusion de manière plus ou moins explicite à la fin prochaine de l’Apartheid.[8]
En outre, l’image animale est d’à-propos car elle suggère la tendance de la communauté blanche à vivre en retrait, séparée des autres groupes raciaux. En effet, les crabes sont connus pour être une espèce qui vit et marche sur les côtés et donc en solitaire. Coetzee fait référence à cette attitude grégaire dans son discours de remerciement pour le prix Jérusalem: «The masters, in South Africa, form a closed hereditary caste. Everyone born with a white skin is born into the caste.»[9]Par conséquent, cet analogon qu’est l’image du crabe n’est pas un signe arbitraire mais est intrinsèquement motivé par la volonté de l’auteur de dénoncer, par un langage encodé, toute forme de séparation sur des bases raciales fondée sur quelque idéologie injustifiée.
Le symbolisme du crustacé est plus que pertinent : il fait allusion à l’isolement de la vieille dame dans sa maison, une solitude qui, en fin de compte, constitue un symptôme de la situation sociale qui prévaut autour d’elle. Mrs. Curren présente l’endroit en ces termes:
A house built solidly but without love, cold, inert now, ready to die. Whose walls the sun, even the African sun, has never succeeded in warming as though the very bricks, made by the hands of convicts, radiate an intractable sullenness. (Age, 15)
L’analogie entre la maison de Curren et la nation tout entière est soulignée lorsqu’elle insinue le manque d’amour qui a accompagné la construction du bâtiment. On le sait, tout comme la maison, le pays de Coetzee a connu une expansion économique fulgurante mais au prix du racisme et de la violence. Du coup, un sentiment général de tristesse caractérise la maison et la société. L’espace interne de la maison, il faut le dire, est un reflet symbolique dont la configuration iconographique participe beaucoup du diagnostic psycho-social.[10]
Ce manque extraordinaire de fraternité et d’élan de compassion a fortement suscité l’utilisation d’une imagerie animale comme expression de l’égocentrisme des Afrikaners et de l’impact dévastateur de leur action politique et sociale sur l’Afrique du sud qu’ils prétendent pourtant aimer.
C’est une telle motivation qui est à la base de l’utilisation des acridiens comme autre matériau de base des métaphores animales dans Age of Iron. A travers son personnage, l’auteur s’inspire des habitudes des insectes, principalement des locustes, pour signifier l’instinct grégaire et les actions ravageuses des communautés blanche et noire de son pays:
Television. Why do I watch it? The parade of politicians every evening: I have only to see the heavy, blank faces so familiar since childhood to feel gloom and nausea. The bullies in the last row of school desks, raw-boned, lumpish boys, grown up now and promote at the rule of the land. They with their fathers and mothers, their aunts and uncles, their brothers and sisters: a locust horde, a plague of black locusts infesting the country, munching without cease, devouring lives. Why, in a spirit of horror and loathing do I watch them? Why do I let them into the house? Because the reign of the locust family is the truth of South Africa and the truth is what makes me sick!(Age, 28-29)
Les locustes sont une catégorie de criquets pèlerins qui, par leur nombre, peuvent devenir d’insatiables conquérants et de redoutables ravageurs. Le symbolisme de ce type de bestiaire est à trouver dans le fait qu’il constitue une image du Blanc d’Afrique du Sud.
Parallèlement aux locustes qui envahissent des zones ciblées et qui détruisent tout sur leur passage, les colons et figures politiques racistes sont, selon Mrs Curren, une horde de locustes confisquant sans cesse des terres fertiles et bouleversant ainsi (par une ségrégation géographique) la vie des populations locales. En outre, le régime progressif des verbes du passage (“infesting the country, munching without cease, devouring lives”) expriment cet assaut continu des Blancs-locustes que fustige Coetzee à travers son personnage. Elizabeth Curren a raison de se sentir gênée devant tant d’orgueil, d’intolérance et de boulimie de la part de sa communauté ; une gêne insinuée par le monologue construite autour de questions rhétoriques et qui laisse entrevoir l’agitation interne du personnage. Qui plus est, qui dit criquet dit parasite, et c’est donc de cet aspect métaphorique de l’image animale que Mrs Curren s’inspire pour davantage insister sur la force destructrice des Blancs, une image qui rappelle bien celle de la tique dans Time of the Butcherbird d’Alex La Guma. Cependant, force est de reconnaître avec elle, que c’est le fanatisme racial de tout bord qui est la racine du mal qui fragilise l’Afrique du Sud : « because the reign of the locust family is the truth of South Africa, and this truth is what makes me sick ! »
C’est dire donc que par le symbolisme des acridiens, Coetzee pourfend non seulement l’hypocrisie et la force nuisible des artisans de l’Apartheid, mais surtout de tout régime arbitraire et exclusiviste qui bafoue les droits et valeurs de quelque communauté au profit d’une autre. Et il est à affirmer, sans risque de se tromper, que par cette configuration du bestiaire de l’imagination dans ce passage d’Age of Iron, il existe « une homogénéité du signifiant (l’image des locustes) et du signifié (la violence des partisans de l’Apartheid) au sein d’un dynamisme organisateur »[11], qu’est le contexte narratif.
Cette orientation thériomorphe de l’imagination du prosateur sud-africain revêt d’autres contours dans la représentation métaphorique des réalités politiques et sociales ainsi que de la violence aveugle que peut engendrer tout égocentrisme racial ou culturel, par une allusion exhaustive au monde des canidés, des bovidés et de bien d’autres encore qu’il convient d’analyser.
2. Le symbolisme des canidés et des bovidés.
Si l’imagerie animale est un symbole qui, comme le dit Bachelard, « possède plus qu’un sens artificiellement donné, mais détient un essentiel et spontané pouvoir de retentissement »[12], force est de reconnaître que les images construites autour des canidés et des bovidés, dans Age of Iron, constituent une expression très éloquente de la répression sur laquelle s’appuie toute forme d’oppression. S’étalant sur cet aspect du symbole, Durand en arrive à cette conclusion :
En dernière analyse on peut constater, avec Langston, que la croyance universelle aux puissances maléfiques est liée à la valorisation négative du symbolisme animal. (…) Mais la plupart du temps l’animalité, après avoir été le symbole de l’agitation et du changement endosse plus simplement le symbolisme de l’agressivité, de la cruauté. (…) Il ne faut pas s’étonner si au bestiaire de l’imagination certains animaux, mieux doués en agressivité sont évoqués plus fréquemment que d’autres.
Fort de cette croyance sur la crainte que suscite le monde animal chez l’homme, Coetzee s’inspire de l’espèce des canidés comme signifiant de la violence des partisans de la discrimination politique et sociale, qui n’hésitent pas à sauter sur leur proie (les groupes défavorisés). Les nombreuses actions répressives contre les populations locales sont assimilées à la persécution de bêtes sauvages telles que le chien ou le loup. Arrêtons-nous sur ce segment du récit:
In silence we waited in the car, Vercueil and I, like a couple married too long, talked out, grumpy. I am even getting used to the smell, I thought. Is this how I feel towards South Africa: not loving it but habituated to its bad smell? Marriage is fate. What we marry we become. We who marry South Africa become South Africans: ugly, sullen, torpid, the only sign of life in us a quick flash of fangs when we are crossed. South Africa: a bad-tempered old hound snoozing in the doorway, taking its time to die. And what an uninspired name for a country! Let us hope they change it when they make their fresh start. (Age, 70)
Par la métaphore animale, Mrs Curren lève le voile sur l’irascibilité et l’animosité des favorisés de l’apartheid – “the only sign of life in us a quick flash of fangs when we are crossed”–, mais surtout sur la situation de dégradation morale et de paupérisation du pays qu’elle considère comme étant un vieux chien dangereux – “South Africa: a bad-tempered old hound snoozing in the doorway, taking its time to die.” En prélude à cette comparaison tacite, nous avons une métaphore sensorielle, qui fait sentir au lecteur les émanations infectes de la pauvreté des marginalisés et du cadre social délétère engendré par les politiques de discrimination. Une telle combinaison d’une imagerie animale et sensorielle, renforcée d’une suite d’adjectifs appréciatifs (“ugly, sullen, torpid ”), assez expressifs de toute la laideur et la turpitude des Blancs, suggère le côté répulsif et dangereux du régime politique. En fait, le symbolisme animal est très prisé dans les civilisations universelles pour la représentation des systèmes iniques et oppressifs. Durand écrit à ce propos :
L’animal se présente, donc, en de telles pensées, comme un abstrait spontané, l’objet d’une assimilation symbolique, ainsi qu’en témoigne l’universalité et la pluralité de sa présence tant dans une conscience civilisée que dans la mentalité primitive.[13]
Par conséquent, l’image du chien, utilisée ici comme signifiant par Elizabeth, est plus qu’expressive. A l’instar de son doublet le loup, plus sauvage, ce canidé est un animal féroce qui symbolise le trépas.[14] Mais ce qui est à signaler dans le passage est que l’analogon évoque non seulement la violence des Blancs sur les populations opprimées mais tout autant la fin prochaine de leur prétendue supériorité raciale.
Toujours dans sa représentation de la situation innommable qui prévalait dans cette partie de l’Afrique, Coetzee, par la plume d’Elisabeth, puise à loisir dans le symbolisme des bovidés. Très souvent, dans la longue correspondance à sa fille, Elizabeth s’inspire de l’image du taureau pour accentuer la caractérisation des membres de sa communauté mais aussi des autres couches raciales du pays. Le symbolisme taurin, à l’instar du symbolisme équestre, fait ressortir, selon Durand, une certaine crainte suscitée par quelque bouleversement de l’ordre des choses ou par quelque force (ou contre-pouvoir) qui viendrait ébranler un ordre ou régime préétabli. La force symbolique des bovidés est ainsi appréhendée par Durand :
Le taureau joue le même rôle que le cheval (…) Nous constatons donc l’étroite parenté du symbolisme taurin et du symbolisme équestre. C’est toujours une angoisse qui motive l’un et l’autre, et spécialement une angoisse devant tout changement, devant la fuite du temps, comme devant « le mauvais temps » météorologique. C’est ce qui explique que ces symboles soient facilement interchangeables et qu’ils puissent toujours, dans le Bestiaire, se donner des substituts culturels ou géographiques.[15]
Dans Age of Iron, les images autour du taureau ainsi que leur portée symbolique ont certainement un lien avec le sentiment d’angoisse des personnages, angoisse des autorités causée par la percée fulgurante de la résistance des populations opprimées, angoisse de ces mêmes communautés provoquée par « le mauvais temps » installé par la ligne politique discriminatoire du régime de l’Apartheid. A ce titre, examinons de plus près cette partie de l’histoire pour mieux comprendre les contours du symbolisme taurin :
Sitting in a circle, debating ponderously, issuing decrees like hammer blows: death, death, death. Untroubled by the stench. Heavy eyelids, piggish eyes, shrewd with the shrewdness of generations of peasants. Plotting against each other too: slow peasants plots that take decades to mature. The new-Africans, pot-bellied, heavy-jowled men on their stools of office: Cetshwayo, Dingane in white skins. Pressing downward: their power in their weight. Huge bull testicles pressing down on their wives, their children, pressing the spark out of them. In their own hearts no spark of fire left. Sluggish hearts, heavy as blood pudding.(Age, 29)
Cet extrait de la lettre d’Elizabeth laisse entrevoir le côté primitif et rustre de ses compatriotes blancs. Il se caractérise par une ribambelle d’adjectifs composés aux relents satiriques. Les mots composés sont des éléments syntaxiques qui autorisent une expression à la fois lapidaire et éloquente de la nature et des habitudes culturelles des Afrikaners. Ces mots composés, constitués d’une juxtaposition de deux lexèmes libres, (“pot-bellied ” ; “heavy-jowled ”) et contenus dans des structures phrastiques nominales, retentissent dans l’esprit du lecteur qui découvre à loisir ce groupe racial conservateur et endogame et qui, pourtant, se prend pour évolué.
Cependant, le passage est ironique parce que Mrs. Curren les assimile à des rois Zoulou (Cetshwayo et Dingane) que ces mêmes Blancs considéraient jusque-là comme barbares. Ainsi, autant les tournures composées disent, dans un espace textuel réduit, l’aspect répulsif des Afrikaners autant l’image du taureau, qui fait allusion à la violence physique et sexuelle, (“bull testicles pressing down on their wives”) de ces derniers, constitue un signe de la nature ubuesque de l’Apartheid. En effet, le symbole thériomorphe qu’est le taureau est le pilier d’une représentation qui démontre que la racine du mal qui afflige la nation sud-africaine est à trouver dans les comportements vils des Afrikaners. Les actions bestiales de ces derniers sont davantage soulignées dans cette autre séquence de l’œuvre :
I, a white. When I think of the whites what do I see? I see a herd of sheep. (not a flock: a herd) milling around on a dusty plain under the baking sun. I hear a drumming of hooves, a confusion of sound that resolves itself, when the ear grows attuned, into the same bleating call in a thousand different infections: “I!” “I!” “I!” And, cruising among them, bumping them aside with their bristling flanks, lumbering, saw-tooted, red-eyed, the savage unreconstructed old-boars grunting “Death!” “Death!” (Age, 80)
Par ce qui peut être considérée comme une isotopie construite autour de l’image d’un autre bovidé (le mouton), Mrs. Curren s’évertue à dévoiler l’égoïsme (“I!” “I!” “I!”) des Blancs, qu’elle prend pour un harpail de moutons. En effet, la vieille dame, en tant que blanche, se considère comme un mouton du même troupeau, qui, bravant soleil et sécheresse, font «des sabots et des mains » pour envahir l’espace sud-africain et occuper les terres les plus fertiles au détriment des communautés locales. Une telle visée hégémonique est davantage exprimée par la forme progressive des verbes dans la séquence, (“And, cruising among them, bumping them aside with their bristling flanks, lumbering”), mais surtout par le ton satirique qui entoure le dénigrement de cette harde raciale qu’elle identifie à de vieux et sauvages sangliers, parce qu’inspirant frayeur et mort à leurs proies (“Death!” “Death!”)
La comparaison des Blancs au sanglier (“old-boars ”), dans ce passage, nous permet de nous intéresser aux significations du symbolisme des ongulés dans la déconstruction des idéaux de l’Apartheid entreprise par Coetzee. Tout comme les autres animaux féroces qui façonnent l’imagerie dans Age of Iron, l’image du sanglier parachève la représentation de l’environnement de jungle qui prévalait sous le régime nationaliste.
Le sanglier est un animal très sournois et de plus en plus présent. S’il est essentiellement nocturne, le sanglier signale sa présence par les ravages qu’il occasionne. C’est certainement le caractère conquérant de cet animal féroce qui justifie son utilisation considérable comme technique de caractérisation dans Age of Iron. Considérons à cet effet l’exemple suivant :
We watch as birds watch snakes, fascinated by what is about to devour us. Fascination: the homage we pay to our death. Between the hours of eight and nine we assemble and they show themselves to us. A ritual manifestation, like the procession of hooded bishops during Franco’s war. A thanatophany: showing us our death. Viva la muerte! Their cry, their threat. Death to the young. Death to life. Boars that devour their offspring. The Boar War. (Age, 29-30)
Dans cette partie du récit, Mrs. Curren s’accuse et accuse ses compatriotes, Blancs et Noirs, d’être complices de l’irrationnelle cruauté aux effets corrosifs sur la nation tout entière. Par la métaphore animale par laquelle elle souffle, d’un côté, l’hégémonie du système (comparée aux pouvoir dévastateur du serpent) et, d’un autre, la séparation qui existe entre la classe dominante et les groupes marginalisés, le passage accentue la fascination incroyable que la mort suscite chez les oppresseurs.
Cette omniprésence de la mort est le résultat de l’âge de fer qui envahit toute la nation dont l’avenir semble hypothéqué par le trépas des jeunes résistants noirs (“Death to the young. Death to life”). Cette ère politique et sociale impitoyable est comparée aux beaux jours de la dictature franquiste en Espagne. L’isotopie de la mort atteint son paroxysme avec l’assimilation de l’esprit de conquête des Blancs à celui du sanglier. En effet :
[si dans le] monde indo-européen le sanglier a souvent été symbole d’autorité spirituelle, (…) dans la tradition chrétienne, au contraire, il symbolise le démon : goinfre, lubrique et impétueux. Il incarne surtout la férocité débridée de l’animal sauvage et le règne des forces diaboliques.[16]
Ainsi la barbarie et la force destructrice d’un système inique et sadique tel que l’Apartheid et la confrontation entre communautés dans un cadre social marqué d’inégalités sont symboliquement représentés par l’image de cet ongulé.
L’anagolon du sanglier est également utilisé par la narratrice pour suggérer la guerre des Boers qui avait opposé les colons néerlandais et britanniques alors qu’ils étaient à couteaux tirés à propos de l’occupation de cette partie de l’Afrique. Une telle confrontation, qui rappelle celle d’animaux sauvages tels que le sanglier, est insinuée de manière ironique par la figure du métaplasme qui procède par substitution de lettres, ce qui donne “the Boar war” (la guerre des sangliers) au lieu de “the Boer War”, (la guerre des Boers).
Par conséquent, cette page noire de l’histoire de l’Afrique du Sud, dont le prolongement semble être l’opposition violente entre la police politique et la résistance de jeunes rebelles tels que Bheki et son ami John dans Age of Iron, est reconfigurée par l’image du sanglier pour aboutir à une belle expression de la sauvagerie qui peut aller avec le règne de l’arbitraire et de l’impunité. Dans ce roman, tout comme dans les autres, Coetzee a, pour le dire avec Barthes, abordé radicalement le pourquoi des maux d’une nation en ébullition, où les jeunes sont obligés de verser dans une violence qui n’est pas de leur âge (« Children of iron »), dans un comment écrire (une poétique) qui se fortifie d’une archétypologie imaginaire satirique qui sous-tend la représentation de la réalité de l’Apartheid.
Ce régime politique, avons-nous dit, est l’âge de fer, c’est-à-dire l’époque où ne règnent ni solidarité ni compassion et qui n’augure point de lendemains meilleurs :
The age of iron. After which comes the age of bronze. How long, how long before the softer ages return in their cycle, the age of clay, the age of earth? (Age, 50)
Le symbolisme de ces propos d’Elizabeth réside dans l’image du fer, autre signifiant de l’outrage qu’est l’exploitation d’un groupe par un autre. Une telle image est inspirée du mythe des cinq races ou âges d’Hésiode[17] qui permet de faire un survol ambulatoire de l’évolution des communautés sud-africaines, de la bonté et de la solidarité originelles à l’agressivité et à l’injustice. Tout autant, le mythe retrace l’histoire coloniale et la longue exploitation des populations locales, ce qui a abouti à l’âge de fer.[18] Cette réappropriation du mythe d’Hésiode par le champ fictionnel constitue « un système de communication (…) un mode de signification»[19] qui se fonde sur une écriture métaphorique pour suggérer la décadence physique et morale de l’Afrique du sud du temps de la discrimination raciale. Cette étape de l’histoire du pays de Coetzee où les communautés sont soumises aux pires atrocités et où elles semblent ne plus trouver de remède aux maux qui les affligent, est ainsi décrite par Mareck Pawlicki : « a time when such humanistic principles as mercy, charity, are no longer of any values.»[20]
Quant à Marais, il propose cette lecture de l’utilisation du mythe dans Age of Iron :
Alluding as it does to the violence which, […] is a feature of ‘the age of the iron race’, this novel’s very title indictates a concern with the damaged nature of life in apartheid society.[21]
Par cette image du fer, Mrs Curren a une vision plus claire des réalités ubuesques générées par les politiques d’exclusion raciale, et de la responsabilité et des oppresseurs et des populations délaissées dans une telle tragédie. C’est ce qu’elle semble suggérer, lorsque, très souvent dans sa correspondance, elle utilise le pronom collectif “we” (nous).
L’analyse de Laurence Thornton corrobore ce sentiment de la narratrice: «Understanding the true meaning of this metaphor allows Mrs Curren to open her eyes to the struggle and see it whole for the first time. »[22]Une fois consciente de la nécessité d’accepter l’autre dans sa différence pour l’instauration d’une ère de tolérance et de solidarité, Mrs. Curren s’engage, par sa correspondance, à faire le procès du mal qu’est l’Apartheid par des métaphores animales aussi diversifiées qu’éloquentes, à situer les responsabilités et surtout à avertir ses concitoyens contre un éventuel retour de l’âge de fer, après la « mort » de la discrimination raciale. C’est ce qu’elle insinue dans ces propos-ci qu’elle tient à sa fille :
Let me tell you, when I walk upon this land, this South Africa, I have a gathering feeling of walking upon black faces. They are dead but their spirit has not left them. They lie there heavy and obdurate, waiting for my feet to pass, waiting for me to go, waiting to be raised up. Millions of figures of pig iron floating under the skin of the earth. The age of iron waiting to return. (Age, 125-126).
Malgré cette note de pessimisme qui se dégage de cette affirmation du personnage, il est à noter que le bestiaire de l’imagination chez Coetzee, en exposant la brutalité sous l’Apartheid, vise, en réalité, à combattre et à vaincre progressivement le racisme et le règne de l’arbitraire.
Conclusion
Dans Age of Iron, l’imagerie animale est, donc, une astuce narrative qui autorise, une peinture symbolique très expressive de la situation de détresse politique et sociale qui affligeait les communautés sud-africaines sous les beaux jours de l’Apartheid. S’appuyant largement sur les postulats de Durand, cette analyse des métaphores animales chez Coetzee a démontré que le symbolisme des crustacés et des acridiens laisse suinter la force corrosive et les fourberies du système raciste et de ses affidés dans l’exploitation continue des ressources humaines et naturelles de cette partie de l’Afrique. Par le symbolisme des canidés et des bovidés c’est toute leur inhumanité qui est suggérée.
Alliant tournures satirique et allégorique et s’inspirant à fond de la mythologie grecque, Age of Iron constitue une représentation captivante des horreurs qui peuvent naître de tout système d’exploitation aux fondements arbitraires et une critique acerbe, de la part de l’auteur, de tout exclusivisme racial ou culturel. Les métaphores animales sont, en dernière analyse, un signifiant éloquent de l’ère de fer à la citadelle de pierre que fut l’Afrique du sud sous le régime nationaliste.
Références bibliographiques
-Attwell, David. J.M. Coetzee: South Africa and the Politics of Writing. Berkeley: University of California Press, 1993.
-Bachelard, Gaston. Poétique du récit. Paris : PUF, 1957.
-Barthes, Roland, « Le mythe aujourd’hui ». Œuvres complètes, Tome 1, Paris : Seuil, 1993.
-Chevalier, Jean & Alain Gheerbrant. Dictionnaire des symboles. Paris: Editions Robert Laffont, 1992. (http://jfo.chez-alice.fr/symbolisme_du_sanglier.htm). Consulté le 07/12/2011.
-Coetzee, John-Maxwell. Age of Iron. New York: Penguin Books, 1990.
-----------. Doubling the Point. Cambridge: Harvard University Press, 1992.
-Durand, Gilbert. Les structures anthropologiques de l’imaginaire. Paris : PUF, 1992.
Encyclopédie de l’Agora. (http://agora.qc.ca/Documents/Hésiode--Mythe_et_doctrine_des _races). Consulté le 01/12/2011.
-La Guma, Alex. Time of the Butcherbird. London: Heinemann, 1987.
-Marais, Micheal. “From the Standpoint of Redemption: Aesthetic Autonomy and Social Engagement in John-Maxwell Coetzee’s Fiction of the late Apartheid period”. Journal of Narrative Theory. (http://muse.jhu.edu/journals/jnt/summer/v038/38.2.marais.html). Consulté le 12/11/2011.
-Pawlicki, Marek. Embracing the Unknowable. Suffering and Death in John-Maxwell Coetzee’s Age of Iron. (www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2010/02/pawlickipaper.pdf). Consulté le 05/12/2011.
-Thornton, Laurence. Apartheid’s Last Vicious Gaps. Book Review. New York Times. Le 23 septembre 1990.
[1] Expression empruntée de l’analyse de Gilbert Durand des Structures anthropologiques de l’imaginaire. Paris : Dunod, 1992.
*Enseignante/Chercheur, Université Gaston Berger de Saint Louis, Sénégal.
[2] John-Maxwell Coetzee. Age of Iron. New York: Penguin, 1990. [Les références à l’œuvre sont tirées de cette édition. Nous utiliserons désormais l’abréviation (Age : page) pour Age of Iron dans le texte.]
[3] Telle qu’étudiée par Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, et autres.
[4] Gilbert Durand. Les structures anthropologiques de l’imaginaire, op.cit., p.71.
[5] Marek Pawlicki, Embracing the Unknowable. Suffering and death in John-Maxwell Coetzee’s Age of Iron.www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2010/02/pawlickipaper.pdf). Consulté le 05/12/2011
[6] John-Maxwell Coetzee, in an interview with David Attwell in J.M. Coetzee: South Africa and the Politics of Writing, Berkeley: University of California Press, 1993, p. 122.
[7] Gilbert Durand, op.cit, p. 362.
[8] Mareck Pawlicki, op.cit, p.3 [“Age of Iron makes more or less explicit allusions to the final and turbulent stages of apartheid.”]
[9] John-Maxwell Coetzee. Jerusalem Prize Acceptance Speech, in Doubling the Point, Cambridge: Harvard University press, 1992, p.96.
[10] Gilbert Durand, op.cit, p.77.
[11] Gilbert Durand, op.cit, p.25.
[12] Gaston Bachelard. Poétique de l’espace. Paris : PUF, 1957, p.6.
[13] Gilbert Durand, op. cit., p.73.
[14] Ibid, p.92.
[15] Gibert Durand, op.cit., p.88.
[16]Jean Chevalier & Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Paris: Editions Robert Laffont, 1992. (http://jfo.chez-alice.fr/symbolisme_du_sanglier.htm). Consulté le 07/12/2011.
[17] « Le mythe des âges successifs de l’humanité, avec le symbole des métaux qui les figurent, vient, dans le poème des Travaux et des Jours d’Hésiode. […] l’origine des hommes y est reprise à nouveau, et ils y sont présentés comme fait par Zeus en plusieurs races qui se succèdent sans se reproduire les unes les autres. », Charles Renouvier, « Mythe et doctrine des races chez Hésiode », Encyclopédie de l’Agora, (http://agora.qc.ca/Documents/Hésiode--Mythe_et_doctrine_des _races)
[18] L’âge de fer où, selon Hésiode en référence à Zeus, les hommes ne cesseront d’être accablés de travaux et de misères pendant le jour, ni d’être corrompus pendant la nuit, durant lequel les dieux leur prodigueront d’amères inquiétudes.
[19] Roland Barthes, « Le mythe aujourd’hui », dans Œuvres complètes, Tome 1, Paris : Seuil, 1993, p. 823.
[20] Mareck Pawlicki, op.cit.
[21] Michael Marais, “From the Standpoint of redemption: Aesthetic Autonomy and Social Engagement in John-Maxwell Coetzee’s Fiction of the late Apartheid period”, Journal of Narrative Theory, (http://muse.jhu.edu/journals/jnt/summer/v038/38.2.marais.html). Consulté le 12/11/2011.
[22] Laurence Thornton. Apartheid’s Last Vicious Gaps. Book Review, New York Times. Le 23 septembre 1990.
![]() Télécharger l’article en version PDF
Télécharger l’article en version PDF
Résumé
Le genre romanesque connaît en Afrique des mutations diverses et constantes. Les romanciers des nouvelles générations explorent avec l’intergénéricité, la transgression des normes et des codes romanesques de multiples voies dans la quête d’une véritable identité scripturaire. Ainsi, le souci de déconstruction du texte narratif informe à terme des modalités de formalisation de théories genrologiques. Dans l’ordre de production des œuvres, Maurice Bandaman, Ahmadou Kourouma et Jean-Marie Adiaffi sont ces écrivains qui tentent de formaliser le Conte romanesque, le Donsomana et le N’zassa. Ces œuvres spécifiques révèlent que le roman africain peut être évalué sur de nouveaux canons ; car appelant à des esthétiques nouvelles.
Mots clés : Genres narratifs, Théorisation, Esthétique, Conte romanesque, Donsomana, N’zassa
Abstract
The romantic kind knows in Africa the diverse and constant transfers. The novelists of the new generations investigate with the intergénéricité, the malpractice of the standards and the romantic codes of multiple ways in the collection of a real writing identity. So, the concern of demolition of the narrative text informs eventually modalities of formalization of genrologiques theories. In the order of production of the works, Maurice Bandaman, Ahmadou Kourouma and Jean-Marie Adiaffi are these writers who try to formalize the romantic Tale, the Donsomana and N’zassa. These specific works reveal that the African novel can be estimated on new rules; because calling up to new aesthetics.
Key Words: Narrative kinds, Theorization, Aesthetics, Romantic tale, Donsomana, N’zassa
Introduction
Les débats sur la nouvelle identité de l’écriture romanesque africaine s’emploient à relever les transgressions des normes occidentales et la tendance d’une esthétique singulière qui se forge par l’audace de certains écrivains. Le roman africain s’efforce à l’innovation en amplifiant sa perspective du mélange des genres, expression caractéristique revendiquée comme une identité. Dans cet esprit de recherche des formes expressives, les romanciers s’évertuent à déconstruire les formes génériques classiques en forgeant de nouvelles.
Dans leurs œuvres, Le fils de-la-femme-mâle[1], En attendant le vote des bêtes sauvages[2] et Les naufragés de l’intelligence[3], Maurice Bandaman, Ahmadou Kourouma et Jean-Marie Adiaffi tentent de théoriser des genres traditionnels en leur donnant une dimension nouvelle. Invitant à de multiples interrogations sur la pratique du genre romanesque, ces différentes théorisations attestent de la flexibilité et de la malléabilité des normes classiques du roman. Du coup, la création romanesque africaine s’enrichit de genres à travers la perspective audacieuse de création et de recréation. Comment s’identifie et s’organise la théorisation des genres du Conte romanesque, du Donsomana et du N’zassa ? En quoi leur adhésion aux systèmes génériques traditionnels insuffle-t-il un élan nouveau à leur création ?
Cette réflexion s’évertue sous la bannière des théories narratives de relever la modernité de l’esthétique scripturaire du nouveau roman africain, d’identifier les genres théorisés chez Bandaman, Kourouma et Adiaffi et, d’interroger la tendance de renouveau liée au développement romanesque dans l’apparition de nouvelles formes d’écritures littéraires.
1. Le renouveau romanesque : un challenge !
L’affranchissement de l’écriture romanesque africaine procède des styles novateurs. Ces formes nouvelles d’écriture s’appuient pour la plupart sur l’enrichissement du récit par une volonté d’intégration d’outils narratifs qui transforment considérablement les œuvres. Ainsi des choix déterminants s’offrent-ils pour une écriture plus ouverte à des transformations structurelles et narratives.
2. Les romanciers africains face au défi de la réécriture
La réappropriation du genre romanesque par les romanciers africains suscite un intérêt grandissant depuis les indépendances. Le roman africain a longtemps été dominé par l’aspect thématique. Mais progressivement, comme le souligne Jacques Chevrier, «…les aspects formels et esthétiques de la création littéraire semblent désormais prioritaires aux yeux des écrivains de la nouvelle génération.»[4] Ainsi, les nouvelles techniques romanesques serviront d’emblée à briser les structures des genres classiques occidentaux pour leur intégrer d’autres répondant mieux à une africanité de multiples expressions. C’est donc la composition du roman, en tant qu’œuvre d’art et esthétique, qui intéresse finalement les écrivains. En plus de vouloir transmettre leur message, ils s’activent à une recherche de formes pouvant contenir le tissu narratif.
Le roman devient un espace d’expérimentation pour des auteurs prêts à montrer leur maîtrise de techniques scripturales et modernes capables de leur permettre de faire des fantaisies novatrices, originales. Ils transcrivent, transposent, collent, mélangent les genres, en construisent de nouveaux par association ou par travestissement. Une lecture de ce nouveau roman africain attesterait de ses aspects protéiformes et hybrides. Au sens où Claude Caitucoli parle « de dynamique d’appropriation littéraire du français par les écrivains négro-africains »[5], il peut également être mentionné la dynamique de la réappropriation de théories du genre romanesque. Ainsi, une telle vision de l’émergence d’une écriture nouvelle doit postuler à la fixation de ses principes novateurs dans la pratique du roman.
A travers l’esthétique tirée des nouvelles pratiques du roman, l’écriture romanesque africaine peut être étudiée dans son évolution et non seulement dans ses perspectives transgressives, car ce qui est vu comme transgression démontre certainement une esthétique évolutive de l’activité du roman. Jean Dérive, présentant la notion de genre, atteste qu’ « il s’agit d’une réalité relative qui naît, vit, évolue et meurt ».[6] C’est dire que les formes multiples du roman africain sont des réalités du temps exprimant des réalités ponctuelles.
L’activité scripturaire actuelle part de l’intergénéricité pour construire des œuvres harmonieuses. Les écrivains sont conscients de la dynamique de leur entreprise de sorte qu’ils s’efforcent à pousser la créativité dans tous les sens en gardant à l’idée que l’écriture est une expression de la multiplicité, de la diversité. Depuis l’affirmation d’une véritable identité littéraire africaine, les écrivains n’ont fait que s’engager à cette recherche de formes. Trop souvent, l’actualité thématique fait si vite de noyer les techniques d’écriture visibles dans la narration, la structure, le discours, le langage et le style. Comme bien d’autres écrivains qui s’emploient à ce travail important de renouvellement de l’écriture, Ahmadou Kourouma, Jean-Marie Adiaffi et Maurice Bandaman se sont attachés à donner à leurs textes de nouveaux codes. Leur théorisation de genres s’établit ainsi comme une nouvelle norme pouvant ouvrir à d’autres.
3. Du monolithisme thématique militant à l’authenticité pure du discours romanesque
Dans la période qui a suivi les indépendances, il a été révélé la présence de nouvelles écritures dans le champ romanesque africain. Les études critiques de Dabla Sewanou, de Guy Ossito Midiohouan entre autres ont exposé les différentes articulations de cette tendance pour les écrivains dits de la seconde génération :
Malgré les premières déceptions de nombre de critiques, il existe donc des innovations et une préoccupation esthétique évidente que les nouveaux romanciers d’expression française illustrent admirablement dans un espace littéraire élargi, témoignage éloquent de l’état d’esprit neuf qui anime nombre d’écrivains.[7]
De même, «Il va de soi que les romanciers négro-africains d’aujourd’hui n’ont plus les mêmes préoccupations et n’écrivent plus de la même manière que leurs prédécesseurs des années 20.»[8]
L’expression de « seconde génération » devrait supposer, en principe, qu’il n’y ait plus de génération. Mais, l’évolution de l’écriture a conduit à des générations nouvelles se distinguant des précédentes par d’autres caractéristiques. Ainsi, les esthétiques se multiplient avec la propension de la culture de l’audace créatrice des écrivains. Dans cette vague de réappropriation des stratégies narratives, les genres de l’écriture donnent des indices de leur repérage dans les textes. Les motifs de la formalisation des genres se rendent visibles par les réflexions critiques sur la réfection des œuvres. L’interpénétration des genres est caractéristique d’une sacrée perspective « du donner et du recevoir » laissant exploser une intergénéricité débordante.
De ce point de vue, l’écriture romanesque africaine postmoderne rend visible ses choix, et loin de faire de l’enracinement l’idiome capital, elle s’appuie sur les valeurs enrichissantes procédant de l’esthétique traditionnelle. Les œuvres sont ainsi envahies des modes de l’expression métaphorique et ironique ; lesquels dans la narration sous-tendent la discursivité critique du texte. Les expériences progressives des romanciers africains, à partir de leurs productions, ont fini par démontrer que l’écriture comme la création peuvent s’envisager autrement. Cette clé ouvre à de nombreuses entrées qui convoquent à d’autres perspectives dans l’écriture et d’autres thématiques. Cette option, qui fait surgir ce que Josias Semujanga nomme « la transculturalité »[9], démontre en même temps que l’écriture africaine est fortement irriguée par des techniques d’autres continents :
La critique transculturelle est alors la méthode d’analyse qui vise à montrer comment une œuvre dévoile la culture de « Soi » et de l’«Autre» par des coupes transversales sur les genres artistiques et littéraires. Elle étudie les relations qu’une œuvre particulière établit avec la macro-sémiotique internationale, qui est trop riche et variée pour être envisagée dans le seul cadre national.[10]
Du reste, évoquer les enjeux des multiples esthétiques du genre romanesque africain semble a priori dévoiler les couleurs de la modernisation de l’écriture. L’activité constante de la critique jugeant de l’évolution et de la fécondité créatrice traduit le phénomène de peau neuve de l’art romanesque en Afrique. Observateurs de l’activité, les critiques semblent mieux aguerris aux tendances transgressives et novatrices des écrivains. Si dans la mesure de la pratique scripturaire, les écrivains eux-mêmes se mettent à la théorisation, c’est qu’un âge nouveau vient de naître. Lisant aussi les critiques, les écrivains ont pu remarquer le souci de ceux-ci de voir des genres propres à l’Afrique qui feront son identité romanesque.
Ainsi, définir une spécificité africaine dans les nouvelles pratiques scripturaires du roman reviendrait manifestement à interroger l’évolution de l’écriture elle-même en vérifiant si elle s’est affranchie et libérée de principes pouvant annihiler son autonomie. Aujourd’hui, la littérature africaine a fait peau neuve dans la pratique des genres. Le roman ne fait plus de l’articulation thématique le seul champ de gestion méticuleuse. « A une écriture du politique succède donc aujourd’hui une politique de l’écriture …» (Jacques Chevrier : 1999, p.121). Cette politique de l’écriture et du style, qui procède d’une façon générale de l’épuisement des grandes thématiques, se pratique dans une perspective d’exprimer une postmodernité de l’écrit africain.
Au nouveau contexte de production romanesque se fixent la nouveauté du corps du récit. Celui-ci, loin de se figer, se laisse remodeler. A ce niveau, l’on peut en juger de la véritable esthétique mise en œuvre, vu la cohérence inhérente à la composition d’ensemble des œuvres. Ce qui fait la nouveauté des œuvres, c’est une écriture se présentant comme l’apanage d’écrivains jouant à faire des modalités narratives une fusion de l’oralité et de l’écriture. Cette approche n’est autre qu’une immixtion comme le dit Chevrier, car la nouvelle écriture reste transgressive des principes de l’oralité :
…[les] tentatives des écrivains africains de récupérer et d’exploiter une tradition orale qui constitue une obsession permanente (…) Cette obsession se manifeste à l’évidence au niveau des stratégies d’écriture, dont on peut dire qu’elles sont allées en se complexifiant au fil des années, au point de nous demander si cette immixtion croissante de l’oralité dans l’écrit ouvre une nouvelle voie vers une modernité textuelle africaine.[11]
Avec la modernité de l’écriture des romanciers africains, le roman tente de se pratiquer, se lire sous un regard autre.
Ces nouvelles voies qui réinventent les formes scripturaires déterminent une pratique efficace du genre romanesque africain. Ainsi, les romanciers de la nouvelle génération conscients de la subversion qu’ils font du genre romanesque présentent, à travers certaines théorisations, des œuvres inédites.
4. De la conceptualisation des genres novateurs
Les innovations dans la pratique du genre romanesque chez les écrivains africains ne passent pour une spécificité dans le domaine de la littérature. Les différentes littératures du monde ont connu leurs moments de mutations et de véritables interrogations sur l’émulation des genres. Ce qui paraît novateur aujourd’hui en Afrique demeure en effet la spécification formelle des œuvres, avec de nouvelles formes qui viennent bousculer les contraintes du genre romanesque. L’espace narratif du roman se substitue à un champ de théorisation. En même temps qu’il écrit, l’auteur définit sa démarche procédurale, explique ses choix stylistiques et rhétoriques. Maurice Bandaman dit faire un conte romanesque, quand Ahmadou Kourouma trouve dans le Donsomana l’expression d’un genre qui contiendrait l’histoire du personnage Koyaga. Quant à Jean-Marie Adiaffi, il appelle son style « N’zassa », « genre sans genre ». Si ces trois genres affirmés donnent lieu qu’on les considéra comme de nouveaux genres, il faut en élaborer les différentes définitions et caractéristiques pouvant juger de leur réception et leur inscription dans le cadre d’une pratique théorique consacrée.
5. Le conte romanesque comme un récit transgénérique dans Le fils de-la-femme-mâle de Maurice Bandaman
L’entreprise de Maurice Bandaman dans Le fils de-la-femme-mâle est de vouloir tisser sur les ressources du conte un genre s’enracinant dans celui-ci et se donnant les moyens d’être ouvert à d’autres styles. Ainsi, par cette résurgence de l’oralité africaine, Bandaman exprime son identité et son attachement à la culture locale (Pierre N’Da : 2010, p.48). Procédant à la fois du conte et du roman, le conte romanesque relève une ambigüité dans la saisie de cette définition. Dans la formule de préambule du récit, une définition semble se dessiner : « Cette histoire est un conte / Cette histoire est comme un conte…»[12] L’auteur ne donne pas lui-même une définition claire du genre qu’il veut introduire. Certainement par manque de véritables bases théoriques pour rendre explicite sa création, Maurice Bandaman s’attèle donc dans la pratique à démontrer ce qu’il a conçu. En effet, même s’il ne s’attache pas à définir, comme les autres, les orientations du conte romanesque, il laisse apprécier le mélange des genres qui s’y confirme.
Pour Pierre N’Da, l’écriture de Maurice Bandaman est innovante, car s’inscrivant dans l’écriture postmoderne :
L’intérêt de son [Maurice Bandaman] écriture réside précisément dans l’adoption hardie et l’intégration des nouveaux procédés romanesques qui caractérisent le nouveau roman et l’écriture postmoderne. Or ces nouvelles écritures se remarquent par le parti pris de la rupture, de la transgression et de la subversion des codes littéraires canoniques ainsi que par des expériences de création et d’écritures inédites […][13]
Le conte romanesque de Bandaman repose en grande partie sur les caractéristiques du conte. Dans sa structure d’ensemble, il s’agit effectivement d’un conte. Les trois grandes parties sont des éléments composites d’un conte qui s’ouvre avec une formule initiale et se referme sur une formule finale bien visibles : « …Gens d’ici / Gens d’ailleurs ! / Ecoutez ma voix ! Il était une fois[14] […] Gens d’ici / Et Gens d’ailleurs ! Voilà le mensonge sorti cette nuit de mon ventre marécageux…[15] »
Dans ce récit, s’imbriquent sept autres contes initiatiques qui tiennent le fil thématique de l’ensemble de l’œuvre. Aussi la fiction de l’histoire contemporaine rejoint-elle, dans une narration éclatée, des micro-particules de genres intégrés au conte, faisant du décloisonnement générique (Pierre N’Da : 2010, p.54) une caractéristique fondamentale où le conte romanesque devient matière des matières narratives. Ainsi, les artifices du conte romanesque s’imposent comme une esthétique reposant « essentiellement sur le jumelage harmonieux de l’oralité et de l’écriture, sur le mélange des techniques et des genres. »[16]. C’est dans cette même perspective que Jacques Chevrier parle de polyphonie de l’écriture romanesque africaine :
Cette écriture polyphonique a pour effet, d’une part, de briser la linéarité de l’intrigue, et, d’autre part, de favoriser l’éclatement du texte en une multitude de fragments, anecdotes, réflexions philosophiques, digressions, séquences lyriques, dialogues, collages de tous ordres, etc., qui marquent jusqu’à satiété une esthétique délibérée du mélange des genres.[17]
A travers Le fils de-la-femme-mâle, l’écriture de Maurice Bandaman, façonnée dans une esthétique du mélange des genres, donne à lire une œuvre nouvelle, en phase certes avec une théorisation moins explicite, mais qui fait du conte romanesque un genre singulier recourant dans la tradition africaine baoulé, comme Kourouma extrait de la culture malinké le Donsomana.
6. Entre écriture et thérapie : le Donsomana dans En attendant le vote des bêtes sauvages d’Ahmadou Kourouma
L’exhumation de la culture malinké dans son œuvre depuis Les soleils des indépendances atteste que Kourouma connaît quelques engrenages de cette culture. L’exploitation de la tradition enrichit son œuvre avec les effets de l’oralité et du genre Donsomana. Partant du discours du narrateur principal, Bingo, « le récit purificatoire est appelé en malinké un Donsomana. C’est une geste. Il est dit par un sora accompagné par un répondeur cordoua »[18]. Cette annonce de définition est renforcée plus loin par la prise en considération du caractère de genre que revêt le Donsomana :
Le Donsomana, le genre littéraire Donsomana exige qu’on parle du héros dès l’instant où son germe a été placé dans le sein de sa mère.[19]
Le Donsomana est une parole, un genre littéraire dont le but est de célébrer les gestes des héros chasseurs et de toutes sortes de héros.[20]
Comme une chanson de geste, le Donsomana a pour « fonction de chanter les hauts faits de héros que leur nom rattache à l’histoire »[21]. Ainsi, le griot dès l’incipit compare Koyaga à Ramsès II et Soundiata : « Vous êtes chasseur ! Vous resterez avec Ramsès II et Soundiata l’un des trois plus grands chasseurs de l’humanité »[22].
Dans le récit, il est des évocations de Donsomana qui s’enchâssent les uns dans les autres. Le narrateur s’arrêtera sur le Donsomana des parents de Koyaga, sur ceux de Bokano, Maclédio, des guerriers vietnamiens et ceux des différents Chefs d’États que Koyaga aura rencontrés lors de ses voyages initiatiques.
Singulièrement, le degré de considération accordé au Donsomana de Koyaga centralise toute la révélation du genre, surtout qu’il s’inscrit dans un rituel. Le Donsomana n’est pas que simple genre. Selon les différentes significations- récit purificatoire, Donsomana cathartique, geste purificatoire – ce genre traditionnel est également une forme de thérapie dont l’efficacité tient à la réparation, à la purification d’un fauteur. Aussi le Donsomana comme un rituel brise-t-il les interdits, dénonce-t-il les malversations. C’est la remarque de Marie-José Hourantier sur le rituel dans le théâtre : « Il s’imposera aussi de lever l’interdit sur certains problèmes sociaux et existentiels. Tout ce que la société tait, refuse, il se propose de l’exposer, de l’analyser. »[23] Et pour reprendre, les termes de Tiécoura, le répondeur, s’adressant à Koyaga : « -Nous dirons la vérité. La vérité sur votre dictature. La vérité sur vos parents, vos collaborateurs. Toute la vérité. » [24]
En partant de ces différentes définitions, le constat est établi que, chez Kourouma, la conscience de la théorisation reste très nette. Ainsi, au centre d’une manifestation continue, la définition du Donsomana ne s’épuise pas, mais s’enrichit de caractéristiques. A travers une détermination de ses aspects fondamentaux, le genre cathartique du Donsomana peut s’expliquer par les éléments que sont les célébrants, les personnages sujets de la séance, le déroulement et la finalité. Ces indices éclairent sur le privilège de restituer l’essence d’une telle manifestation. En effet, pour officier la cérémonie, le Donsomana exige un sora et un cordoua. Termes malinké, « Un sora est un chantre, un aède qui dit les exploits des chasseurs et encense les héros chasseurs »[25], quant au cordoua, il est un répondeur :
un cordoua est un initié en phase purificatoire, phase cathartique. Tiécoura est un cordoua et comme tout cordoua, il fait le bouffon, le pitre, le fou. Il se permet tout et il n’y a rien qu’on ne lui pardonne pas.[26]
Ces deux officiers de la cérémonie s’engagent à restituer dans ses menus détails la vie d’un héros, car « le donsomana, le genre littéraire donsomana exige qu’on parle du héros dès l’instant où son germe a été placé dans le sein de sa maman. »[27]. Comme autre exigence faisant lieu de caractéristique, il y a que :
avant d’introduire un héros dans un donsomana, le genre exige qu’on dise au préalable son panégyrique. Le héros est une haute montagne et le sora qui conte est un voyageur. De très loin, avant de s’en approcher, de la côtoyer, de fréquenter, le voyageur aperçoit la montagne[28]
On peut donc retenir que le donsomana est soit une célébration complète par des louanges, soit une célébration intégrant la phase purificatoire. Pratiquement, cette phase présente les torts en toute vérité avec pour aboutissement leur réparation. Koyaga devient ainsi un accusé. Il ne doit garder aucune ombre dans ses aveux sur son parcours. Du reste, pour que la cérémonie tienne sa valeur, des assistants – sept chasseurs – sont associés comme témoins aux côtés des célébrants. Dans ses principes, le donsomana inclut un objet autour duquel s’organisent les veillées dans leur déroulement. Le recouvrement du pouvoir pour Koyaga, symbolisé par la météorite et le coran, constitue le fait central du récit purificatoire.
En effet, leur présence symbolique est fonction d’une régulation du tempérament et des actes posés, car ni la férocité, ni l’iniquité ne sont tolérées. Ainsi, le donsomana, loin de s’éloigner de cette orientation trouve une légitimité, une autonomie que justifie le référencement à la source traditionnelle. Ahmadou Kourouma permet au genre donsomana une résurgence particulière dans l’optique de donner force à une pratique culturelle. L’œuvre arrache au silence de la tradition ce genre qui présente nombre d’affinités avec l’épopée, le mythe et dont la spécificité intégrée de la catharsis le rapproche encore du théâtre rituel. Le Donsomana rend compte efficacement de la force verbale du texte en tant que récit associant différentes formes expressives.
Au total, dans En attendant le vote des bêtes sauvages, l’intérêt principal du discours, centré en grande partie sur le conte et le Donsomana que soutient l’oralité, montre que l’écriture d’Ahmadou Kourouma évolue jusqu’à s’imposer des modalités propres. La technique du Donsomana est bien élaborée, et par elle, Kourouma montre que le roman peut être remodelé dans ses articulations. Jean-Marie Adiaffi se donne également le temps de voir qu’il peut partir de plusieurs genres pour élaborer le N’zassa.
7. Le N’zassa adiaffien : de l’émotion d’écrire à la mixture genrologique dans Les naufragés de l’intelligence
En définissant le N’zassa comme le « genre sans genre », Adiaffi le promeut ainsi genre de tous les genres. La préface de l’éditeur précise les grands traits de la spécificité du style d’Adiaffi qu’il n’a point de mal à définir lui-même :
L’Ecrivain doit constamment répondre à la grande question : pour qui écrit-on. Pourquoi écrire ? Et la réponse du « comment écrire » s’impose naturellement : elle est la solution des deux premières questions.
Pour ma part, je garde de la tradition orale les traits esthétiques de nature à innover, à réinventer un nouveau langage. Il y a des moments où la tradition est plus révolutionnaire que la modernité déjà radotante.
C’est ainsi que de la tradition j’ai créé mon style appelé « N’zassa » « genre sans genre » qui rompt sans regret avec la classification classique, artificielle de genre : romans, nouvelles, épopée, théâtre, essai, poésie.
En effet, dans mes romans, on trouve tous les niveaux de langage. Selon l’émotion, je choisis « le genre », le langage qui m’apparaît exprimer avec plus de force, plus de puissance ce que je ressens intimement dans mon rapport érotique-esthétique avec l’écriture […] Voici donc le « N’zassa », « genre sans genre » qui tente de mêler harmonieusement épopée, poésie et prose, donc essai.[29]
En partant de ces orientations de Jean-Marie Adiaffi, il reste nommément indiqué qu’il veut s’inscrire dans la logique novatrice des traits esthétiques du roman africain. Il part d’inquiétudes qui lui permettent de théoriser le style N’zassa. Les questions relatives à la réception de l’œuvre, à la finalité de l’écriture et à celle de la façon d’écrire détermine la démarche d’Adiaffi. La justification étant de l’ordre de l’innovation, de la réinvention d’un langage nouveau, Adiaffi traduit sa conception, montrant qu’il part de la tradition qui recèle des ressources à exploiter. Il s’accroche surtout au principe proverbial que :
C’est au bout de la vieille corde qu’on tisse la nouvelle » : « C’est ainsi que de la tradition j’ai créé mon style appelé « N’zassa » « genre sans genre » qui rompt sans regret avec la classification classique, artificielle de genre : romans, nouvelles, épopée, théâtre, essai, poésie.
La logique de création d’Adiaffi est donc l’enracinement et la rupture. Il se sert du premier élan pour façonner un langage nouveau qu’il allie à l’émotion et au rapport étroit établit avec l’écriture. Le rapport à l’écriture évoque le rapport à la liberté créatrice chez Adiaffi. Pour lui, la liberté de recourir au genre voulu pour mieux s’exprimer n’obéit point à des canons, mais plutôt à l’émotion. Sur cette émotion, qui n’est autre que le style d’écriture, s’agencent des genres, des faits, des thèmes répondant au besoin de l’harmonie. Il est à constater dans Les naufragés de l’intelligence, bien que l’écriture relève de nombreux aspects traumatisants, l’harmonie narrative de l’ensemble de l’œuvre : « Voici donc le « N’zassa », « genre sans genre » qui tente de mêler harmonieusement épopée, poésie et prose, donc essai. »
Adiaffi a théorisé le N’zassa en l’élaborant et en le mettant en pratique. Dans l’œuvre, le mélange des genres est même débordant et rend complexe la compréhension qui ne se donne pas a priori. A ce sujet, Rangira Béatrice Gallimore souligne à propos de l’œuvre d’Adiaffi :
En abolissant les limites imposées par les règles traditionnelles du récit, Adiaffi a pris ses distances à l’égard du roman à forme rigide pour produire un récit pluriel à la manière des récits oraux africains.[30]
Cette même vision, relative au mélange des genres qui fait la richesse de l’écriture postmoderne, Roger Tro Deho la reprend tout marquant la mutation du nouveau roman caractérisé par sa souplesse :
…le mélange des genres tels que le roman, la poésie, l’épopée, le conte etc. et le dialogue de textes de diverses natures et de différentes époques créent, au niveau de la structure des romans, une certaine hétérogénéité qui apparente l’art des romanciers à l’écriture postmoderne. Désormais, le roman est un genre éclaté dont la souplesse autorise la présence, en son sein, d’autres genres et d’autres types de récits.[31]
Du conte romanesque au roman n’zassa en passant par le donsomana, se dessine une ferme volonté des romanciers de remodeler l’esthétique de la culture traditionnelle. Les nouveaux modèles des intrigues se veulent ouverts à plus de créativité. Dans le fond, ces écrivains étudiés restent des « théoriciens » qui transforment l’espace narratif par la transgression mais en travaillant à une meilleure variété des structures discursives de sorte à produire des œuvres littéraires dynamogènes, expressionnistes et vivaces.
8. Le jeu de convergences : la canonicite du Conte romanesque du Donsomana et du N’zassa
L’analyse des styles narratifs de Bandaman, Kourouma et Adiaffi appelle à une théorisation conséquente fondée naturellement sur un jeu de convergences qui établit des liens à la fois entre le conte romanesque, le donsomana et le n’zassa. L’exploitation d’une généricité singulière dans les différentes œuvres donne la mesure d’une esthétique transformatrice dans la pratique du genre romanesque. Ces genres mis en avant sont non seulement en lien avec le substratum qui les tient : l’oralité, mais demeurent constamment fécondés par des techniques narratives qui se moulent comme de nouveaux canons.
S’inscrivant dans la même décennie de production, de 1990 à 2000, la récurrence et la constance de théorisation des formes employées dans les œuvres de Bandaman, Kourouma et Adiaffi traduisent leur volonté de donner au roman africain des traits spécifiques, expressifs de leurs sensibilités. Ces derniers élaborent et édictent les traits et principes des genres pratiqués. Ainsi, de leur expérience commune de la pratique de l’écriture romanesque, ils parviennent à faire du décloisonnement générique un principe qui oriente fondamentalement leur création.
Il est vrai qu’un genre bien élaboré expose clairement les axes majeurs le régissant. Le roman, ayant favorisé la révélation du conte romanesque, du donsomana et du n’zassa, permet à ceux-ci de souscrire et s’inscrire résolument dans l’ordre du genre romanesque vu sa dimension protéiforme. De cette façon, la reconnaissance et l’acceptation de ces différentes pratiques scripturales doivent être acquises. Partant, tout écrivain peut ainsi dire faire du conte romanesque, du donsomana ou du n’zassa comme il ferait du théâtre ou de la poésie.
Ayant déterminé leurs caractéristiques, arrachées à la tradition de l’oralité ou au brassage intergénérique, le conte romanesque, le donsomana et le n’zassa doivent être reconnus sur les bases de la représentativité des indices qui les composent. L’opérativité de ces théories romanesques dont les articulations n’ont été faites qu’à travers une démarche expérimentale guide en effet l’émergence de nouveaux procédés d’écriture. La pratique de tels genres enrichit le champ littéraire dans la mesure où leur élaboration conceptuelle convoque des principes connus par la plupart des écrivains et des critiques.
Conclusion
La nouvelle expérience de la création romanesque africaine reste un affranchissement progressif de la pratique scripturaire qui l’a fait naître et que les écrivains veulent dépasser. Bien qu’ils réactualisent certains fondements esthétiques, les écrits de la nouvelle génération transfigurent le romanesque en en faisant le berceau de théorisations nouvelles. Ainsi, la mesure et l’évidence du renouvellement scripturaire s’imposent comme principes d’évolution et de développement. En se donnant les moyens de faire du récit un champ d’expérimentations théoriques, certains écrivains y cultivent une dynamique intergénérique. Ne militant pas pour la fixité des théories du roman, ils restituent, bien au contraire, de nouveaux cadres théoriques. En effet, l’idée n’est plus de reconduire les indices du roman africain moderne, mais de s’engager dans la postmodernité de la pratique romanesque. Ce que Kourouma, Adiaffi et Bandaman ont établi comme théories spécifiques dans la mise en route de nouveaux genres se greffe à des subversions de formes. Désormais, le récit africain affiche des indices du romanesque tout en affirmant la primauté d’autres genres, qui dans le jeu intergénérique, œuvrent pour la créativité narrative.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
I-Corpus
ADIAFFI, Jean-Marie. Les naufragés de l’intelligence. Abidjan: CEDA, 2000.
BANDAMAN, Maurice. Le fils de-la-femme-mâle. Paris : L’Harmattan, 1993.
KOUROUMA, Ahmadou. En attendant le vote des bêtes sauvages. Paris: Seuil, 1998.
II-Autres ouvrages de référence
BARONI, Raphaël. « Généricité ou stéréotypie ? ». Cahiers de Narratologie, N°17, mis en ligne le 22 décembre 2009, URL : http://revel.unice.fr/cnarra/index.html?id=1090.
BAYARD, Caroline. « Le genre et le postmodernisme », La mort du genre 2, Actes du colloque tenu à Montréal en octobre 1987, Québec, La nouvelle Barre du jour (nbj), 1989, p. 49.
CAITUCOLI, Claude. « Ahmadou Kourouma et l’appropriation du français : Théorie et pratique ». Actes des journées scientifiques des réseaux de chercheurs concernant la langue et la littérature, « Appropriation de la langue française dans les littératures francophones de l’Afrique subsaharienne, du Maghreb et de l’Océan indien », Dakar (Sénégal), 23-25 mars 2006, pp.65-79.
CHEVRIER, Jacques. Littérature d’Afrique noire de langue française. Paris: Nathan Université, 1999.
COMPAGNON, Antoine. «La notion de genre», cours d’Antoine Compagnon, Fabula, URL: http:www.falula.org/compagnon, 2000. Page consulté le 15 octobre 2010.
DERIVE, Jean. « Vie et évolution des genres dans l’oralité africaine aujourd’hui ». Notre Librairie, N°78, Janvier-Mars 1985, pp.57-63.
EWANOU, Dabla. Nouvelles écritures africaines, romanciers de la seconde génération. Paris : L’Harmattan, 1986.
GALLIMORE, Rangira Béatrice. L’œuvre romanesque de Jean-Marie Adiaffi, le mariage du mythe et de l’histoire : fondement d’un récit pluriel. Paris : L’Harmattan, 1996.
HOURANTIER, Marie-José. Du rituel au théâtre rituel. Paris : L’Harmattan,1984.
MIDIOHOUAN, Guy Ossito. «Bref aperçu du roman négro-africain d’expression française». Recherche Pédagogie et culture, N° 68, 1984, pp.81-84.
N’GAL, Georges. Création et rupture en littérature africaine. Paris : L’Harmattan, 1994.
N’DA, Pierre. « Le roman africain moderne : pratiques discursives et stratégies d’une écriture novatrice. L’exemple de Maurice Bandaman ». En-quête, N° 23, 2010, spécial hommage au Professeur, pp.48-66.
SAINTGELAIS, R. (dir.). Nouvelles tendances en théories des genres. Québec : Nota bene, 1998.
SCHAEFFER, J.M. Qu'estce qu'un genre littéraire? Paris : Seuil, 1989.
SEMUJANGA, Josias. Dynamique des genres dans le roman africain. Éléments de poétique transculturelle. Paris : L’Harmattan, 1999.
SEMUJANGA, Josias. « De l’Africanité à la transculturalité : éléments d’une critique dépolitisée du roman ». Etudes françaises, Vol 37 n° 2, Montréal, Presses Universitaires de Montréal, 2001, pp. 133-156.
TRO, Deho Roger. Création romanesque négro-africaine et ressources de la littérature orale. Paris : L’Harmattan, 2005.
* Département de Lettres Modernes, Université de Bouaké, Côte-d’Ivoire
[1] Maurice BANDAMAN. Le fils de-la-femme-mâle. Paris : L’Harmattan, 1993.
[2] Ahmadou KOUROUMA. En attendant le vote des bêtes sauvages. Paris : Seuil, 1998.
[3] Jean-Marie ADIAFFI. Les naufragés de l’intelligence. Abidjan : CEDA, 2000.
[4] Jacques CHEVRIER. Littérature d’Afrique noire de langue française. Paris : Nathan Université, 1999, p. 108.
[5] Claude CAITUCOLI. « Ahmadou Kourouma et l’appropriation du français : Théorie et pratique ». Actes des journées scientifiques des réseaux de chercheurs concernant la langue et la littérature, « Appropriation de la langue française dans les littératures francophones de l’Afrique subsaharienne, du Maghreb et de l’Océan indien ». Dakar (Sénégal), 23-25 mars 2006, pp.65-79.
[6] Jean DERIVE. « Vie et évolution des genres dans l’oralité africaine aujourd’hui ». Notre Librairie, N°78, Janvier-Mars 1985, p.58.
[7] Dabla SEWANOU. Nouvelles écritures africaines. Paris : L’Harmattan. 1986, p.19.
[8] Guy Ossito MIDIOHOUAN. « Bref aperçu du roman négro-africain d’expression française ». Recherche Pédagogie et culture, N° 68, 1984, p.82.
[9] Josias. SEMUJANGA. « De l’Africanité à la transculturalité : éléments d’une critique dépolitisée du roman ». Etudes françaises, Vol. 37 n° 2, Montréal : Presses Universitaires de Montréal, 2001, pp.133-156.
[10] Ibidem, p.144.
[11] Jacques CHEVRIER. op.cit., p.96.
[12] Maurice BANDAMAN. op.cit., p.6.
[13] Pierre N’DA. « Le roman africain moderne : pratiques discursives et stratégies d’une écriture novatrice. L’exemple de Maurice Bandaman ». En-quête, Spécial hommage au Professeur Pierre N’DA, N°23, 2010, pp.54-55.
[14] Maurice BANDAMAN. op.cit, p.6.
[15] Ibidem, p.169.
[16] Pierre N’DA. op.cit, p.53.
[17] Jacques CHEVRIER. Littérature d’Afrique noire de langue française. Paris : Nathan Université, 1999, p.110.
[18] Ahmadou KOUROUMA. En attendant le vote des bêtes sauvages, p. 10.
[19] Ibidem, p.22.
[20] Ibidem, p. 32.
[21] Dictionnaire des littératures française et étrangère, Larousse, p.1985.
[22] Ahmadou KOUROUMA. op.cit, p.10.
[23] Marie-José HOURANTIER. Du rituel au théâtre rituel. Paris : L’Harmattan, 1984, p.13.
[24] Ahmadou KOUROUMA. op.cit, p.10.
[25] Ibidem, p. 9.
[26] Ibidem, p.10.
[27] Ibidem, p.22.
[28] Ahmadou KOUROUMA. op. cit, p.32.
[29] Jean-Marie ADIAFFI. Les naufragés de l’intelligence. Préface de l’Editeur, p.5.
[30] Rangira Béatrice GALLIMORE. L’œuvre romanesque de Jean-Marie Adiaffi, le mariage du mythe et de l’histoire : fondement d’un récit pluriel. Paris : L’Harmattan, 1996, p.113.
[31] Deho Roger TRO. Création romanesque négro-africaine et ressources de la littérature orale. Paris : L’Harmattan, p.172.
![]() Télécharger l’article en version PDF
Télécharger l’article en version PDF
En littérature, une longue tradition, de Maître Eckhart aux symbolistes en passant par Nicolas Boileau, Thérèse d’Avila et Angelus Silesius, établit une certaine liaison entre l’écriture et la non-transparence du signe, l’hermétisme et l’énigme, c’est-à-dire ce qui est mysticus ou caché. C’est sans doute ce que Stéphane Mallarmé voulait faire ressortir dans un de ses textes de jeunesse en reconnaissant dans le même mouvement la sacralité de l’art littéraire : «[…] toute chose sacrée et qui veut demeurer sacrée s’enveloppe de mystère. Les religions se retranchent à l’abri d’arcanes dévoilés au seul prédestiné : l’art a les siens[1]».
C’est pour tenter de montrer la représentation de ces mystères propres à l’art littéraire que je m’intéresse à l’écriture mystique dans L’Aventure ambiguë et Les Soleils des indépendances, deux récits qui, pour figurer l’inaccessible, mettent en scène l’expérience d’un sujet qui a vécu un événement avec une force transcendantale ou qui en fait essentiellement sa quête. La question sera abordée à partir du triptyque suivant : le syncrétisme caractéristique de la représentation mystique dans ces deux romans africains (1), lequel syncrétisme donne à voir une structuration binaire de l’espace-temps[2] (2) créée fondamentalement à partir de la parole d’un sujet en crise[3] (3).
I. Le syncrétisme mystique africain
L’Aventure ambiguë et Les Soleils des indépendances s’illustrent clairement par une représentation du mystique sous la forme de la postulation d’un Autre (inaccessible?). À travers cette quête, il s’agit essentiellement d’assurer la médiation de l’ordre des choses (entre le monde nouménal et le monde phénoménal) dans le syncrétisme d’un mouvement qui conjoint deux composantes : une mystique musulmane qui intègre des croyances traditionnelles païennes.
Si, dans les analyses du roman de Cheikh Hamidou Kane, on a beaucoup insisté sur la place de la tradition théosophique islamique – idéal vers lequel on cherche à conduire le personnage principal –, très souvent on a survolé cette dernière forme de croyance pourtant bien existante dans les sociétés peul selon Amadou Hampathé Bâ (même si tout contribue à minorer la place dans le récit) et qui est diversement plus présente dans le roman d’Ahmadou Kourouma (à travers les fétiches, les génies, les mânes, la magie, la sorcellerie).
Dans L’Aventure ambiguë, la première occurrence de ce syncrétisme est donnée dès l’incipit à travers la souffrance graduelle que le maître des Diallobé fait subir à son disciple Samba Diallo devenu un véritable souffre-douleur pour avoir altéré la Parole de Dieu. Cette souffrance du corps qui, dans la mystique musulmane, constitue un médium pour accéder à Dieu, est aussi une forme de mortification héritée des rites païens et animistes d’initiation africaine.
Chez le maître Thierno comme dans l’imaginaire de la pensée traditionnelle africaine, il y a une homologie de sens entre la souffrance (corporelle et morale) pour la quête de Dieu et le sacrifice. Priant plus tard sur la tombe de son maître, Samba Diallo reconnaît substantiellement l’idée que Dieu «avait de grands desseins dans les souffrances et les infirmités du corps […] et qu’il s’unit à l’âme par les douleurs bien plus parfaitement que par les grandes délectations»[4] : «Ton Ami, Celui qui t’a appelé à Lui, ne s’offre pas. Il se conquiert. Au prix de la douleur. Cela je le comprends encore.» (AA[5], 186)
Pour le dire autrement, le début de ce roman d’initiation (à la mystique musulmane) présente une grande similitude avec les épreuves de l’initiation (aux rites africains). L’idée se trouve magistralement exprimée de la manière suivante par Louis Gardet dans La Pensée religieuse d’Avicenne :
La souffrance est toujours liée au sacrifice, sacrifice de la parole pour le tout, de ce qui a une valeur inférieure au profit de ce qui a une valeur supérieure, qu’elle est inséparable de la mort et de l’amour : de la mort, puisque si la partie meurt, c’est pour que le tout soit sauvé; de l’amour puisqu’une valeur supérieure ne peut nous commander l’immolation d’une valeur inférieure parce que nous l’aimons davantage. Ainsi la souffrance nous oblige à subordonner notre vie à une activité spirituelle.[6]
Il y a dans l’idéologie traditionnelle des foyers ardents une pensée justificative des supplices infligés aux disciples qu’on retrouve également dans L’Aventure ambiguë : tant que le sang ne coule pas, le savoir ne peut pas être acquis et assimilé. C’est dans la continuité de cette idée de sacrifice avec écoulement de sang comme disposition préalable à tout succès que, dans Les Soleils des indépendances, la réussite et l’acceptation des funérailles malinké, après le récital de coran par les musulmans, sont assujetties à la condition que le sang soit abondamment versé :
Les prières coraniques et même le paradis sont insuffisants pour contenir les morts malinkés, surtout les restes de grands Doumbouya. Leurs djas, leurs doubles sont fougueux, indomptables. Des sacrifices, beaucoup de sang ; les sacrifices sont toujours et partout bénéfiques. (SDI, 119)
Dans ce dernier roman qui s’ouvre par la disparition de Koné Ibrahima dans la capitale de la République des Ébènes, c’est l’importance que l’imaginaire malinké accorde aux funérailles qui plonge le lecteur dans diverses expériences mystiques : deux colporteurs qui rencontrent l’ombre du défunt retournant au village mettre de l’ordre dans ses biens, le sorcier du cortège funèbre qui voit cette ombre du défunt Koné Ibrahima de retour du village; la même ombre – une véritable force agissante au sens sémiotique du terme – étant partout présente durant tous les obsèques mais uniquement visible par les personnages mystiques. Comme tout malinké musulman, Ahmadou Kourouma aborde la question mystique dans son roman sous l’angle syncrétique:
Les malinkés ont la duplicité parce qu’ils ont l’intérieur plus noir que leur peau et les dires plus blancs que leurs dents. Sont-ce des féticheurs? Sont-ce des musulmans? Le musulman écoute le coran, le féticheur suit le koma; mais à Togobala, aux yeux de tout le monde, tout le monde se dit et respire musulman, seul chacun craint le fétiche. (SDI, 108)
C’est sans doute pourquoi, jusque dans la conception des personnages de son roman, il conjugue avec cette idée en mettant, par exemple, à côté du marabout Abdoulaye les féticheurs et figures de cafre, Tiékoura et Balla. D’ailleurs, ce dernier personnage – ennemi public d’Allah (SDI, 115) –, dans ses moments de vacuité où il se sent oublié par Allah (SDI, 115), rappelle irrésistiblement l’étape brumeuse du séjour parisien de Samba Diallo qui craint lui aussi que «Dieu ne [l’] ait abandonné» (AA, 176). On voit donc comment, par un art subtil de la combinaison onomastique qui oppose des noms musulmans à des noms traditionnels africains, le romancier ivoirien réussit encore à refléter, sur le plan esthétique, le syncrétisme mystique dans son roman. Mieux, il reproduit, par le moyen d’une réduplication interne, ce syncrétisme chez un même personnage en conférant, par exemple, trois sortilèges divinatoires au marabout sorcier Hadj Abdoulaye qui « cassait et pénétrait dans l’invisible comme dans la case de sa maman et parlait aux génies comme à des copains » (SDI, 66):
Il usait de trois pratiques : traçage de signes sur sable fin (évocations des morts), jets des cauris (appel des génies), lecture du coran avec observation d’une calebasse d’eau (imploration d’Allah). (SDI, 68-69).
Cependant, ces forces mystiques sont hiérarchisées chez lui, car s’il écoute les génies et les mânes des anciens, il accorde quand même la précellence à l’omnipotence divine qui, pour lui, est chargée d’exaucer les prières par la médiation des premiers. L’incantation ci-dessous permet d’en rendre compte :
Génies des forêts sombres et calmes et des montagnes accouchant des nuages, des éclairs et des tonnerres ! Mânes des prestigieux aïeux, vertèbres de la terre nourricière, acceptez, attrapez ce sacrifice dans la grande volonté d’Allah le tout puissant et éloignez de nous tous les malheurs, pulvérisez tous les mauvais sorts ! Oui, tous les mauvais sorts : ceux montant du sud, ceux descendant du nord, ceux sortant de l’Est, ceux souffrant de l’ouest. (SDI, 74)
La même vision syncrétique de l’ordre des choses se retrouve aussi chez Fama qui, en dehors de sa profonde foi au Coran, en Allah et en Mahomet, accepte, sur recommandation du féticheur et sorcier Balla, de passer sa première nuit à Togobala, non pas dans la chambre patriarcale qui a accueilli tous les grands aïeux Doumbouya, mais dans une petite case, recroquevillé entre de vieux canaris et un cabot galeux pour exorciser les mauvais esprits. Pour être coopté par le pouvoir des soleils des indépendances, il use aussi de toutes les alchimies pensables : «prier Allah nuit et jour, tuer des sacrifices de toutes sortes, même un chat noir dans un puits». (SDI, 23)
Par l’entremise des pouvoirs de Balla, le récit d’Ahmadou Kourouma réalise la jointure entre le mythe et la mystique avec le combat que lui, l’homme-savant, livre avec l’animal-génie, le buffle. Combat mythique de l’homme et de la bête (intertexte présent aussi chez Léopold Sédar Senghor dans Éthiopiques) durant lequel, et grâce à ses incantations, il balance son arme qui se maintient à une certaine hauteur, se transporte à une autre inatteignable par le buffle, se transforme en aiguille, en brindille puis se métamorphose en rivière pour éteindre l’incendie déclenchée par l’animal-génie qui s’est aussi transformé en aigle, en fil et en flamme.
Après avoir conclu un pacte avec ce même génie, il redouble les sacrifices et les consultations mystiques jusqu’à ce qu’il trouve le «kala», le grain de crottin du chevrotain aquatique, seul objet capable de mettre fin à la vie de l’animal-génie. Balla en fait quatre doigts de poudre qu’il allume sur le dos de ce dernier pour lui porter le coup fatal. Cette conception africaine qui associe chaque vie humaine à un objet se retrouve aussi chez d’autres écrivains : Amadou Hampaté Bâ dans L’Étrange destin de Wangrin lie la fin de son héros à la perte de son «borofin» occasionnant ainsi la rupture du pacte avec le «gongoloma soké » de la même manière que Djibril Tamsir Niane, dans le célèbre geste de Soundjata Keita, fait de l’ergot de coq blanc le secret de l’arme fatale qui emporte le personnage.
Dans l’ontologie africaine, tout est conscience et tout vit car le « kala », objet chargé d’éteindre la vie dans le corps, peut se cacher n’importe où. C’est la raison pour laquelle les rapports de l’Homme noir avec le cosmos, sur lesquels je reviendrai plus tard quand il sera question de l’espace-temps mystique, sont fondés sur ce qu’Aimé Césaire appelle la « communion ». Makhily Gassama l’exprime comme suit :
On sait donc qu’aucun élément du monde africain n’est isolé dans son espèce et qu’aucune espèce ne se trouve au ban de la Création dont l’homme n’est qu’un élément, qui ne prétend ni l’organiser ni la domestiquer, mais participer à la vie, au vaste mouvement permanent du Cosmos[7] […]
Si dans Les Soleils des indépendances la mystique traditionnelle tient plus précisément des fétiches, des génies, des mânes, de la magie, etc., dans L’Aventure ambiguë elle procède d’une forme de paganisme incarnée principalement par la Grande Royale à travers les valeurs princières de l’idéal de noblesse Diallobé; lesquelles, proscrites par le soufisme, sont littéralement combattues par Thierno. Au nom de la vénération de Dieu, la seule constante qui vaille selon lui, voilà comment il récuse de la manière la plus ferme cette « infirmité morale » (AA, 33) qu’il considère comme des oripeaux dont il faut systématiquement débarrasser son disciple Samba Diallo :
Approche, fils de prince, je jure que je réduirai en toi la morgue des Diallobé. (AA, 32).
Le maître croyait profondément que l’adoration de Dieu n’était compatible avec aucune autre exaltation de l’homme. Or, au fond de toute noblesse, il est un fond de paganisme. La noblesse est l’exaltation de l’homme, la foi est avant tout humilité, sinon humiliation. Le maître pensait que l’homme n’a aucune raison de s’exalter, sauf précisément dans l’adoration de Dieu. (AA, 33)
Le maître rejette ces valeurs qu’il ne partage pas jusque dans les meilleurs cadeaux qu’on lui offre, à l’image de « Tourbillon », le magnifique pur-sang arabe (encore une allusion à la noblesse de sang) que Samba Diallo lui donne en signe de reconnaissance lors de son départ et qu’il éconduit sagement au profit du directeur de la nouvelle école.
« Prince de l’esprit » (AA, 28), Samba Diallo, très en phase avec son maître, refuse de se faire à l’idée qu’il est « prince de sang ». Mieux, contre toute l’idéologie qui fonde son origine patricienne, il problématise de nouveau la notion de noblesse qui rappelle en partie ce que Marguerite Yourcenar appelle dans la préface de son Coup de grâce le caractère « factice » de l’« idéal de noblesse de sang»[8]. La nouvelle valence qu’il lui confère lui permet d’opérer un déplacement sémantique qui enlève à la notion toute idée de déterminisme biologique pour lui donner une forte teneur spirituelle, le tout dans une démarche qui emprunte beaucoup à la perspective constructiviste : «Il [Samba Diallo] désirait la noblesse, certes, mais une noblesse plus discrète, plus authentique, non point acquise [par le sang] mais conquise durement [par la vénération de Dieu] et qui fut plus spirituelle que temporelle.» (AA, 27)
Ici, il est l’exact contraire de Fama qui s’enorgueillit de son statut de dernier descendant des princes Doumbouya avec les pas souples de son totem panthère, des gestes royaux et des saluts majestueux (SDI, 106).
Finalement, le maître et son disciple ont tous compris que le plaisir à être loué (fond de tout paganisme) constitue un véritable obstacle à la communion de Dieu avec l’âme du croyant (quête spirituelle). C’est pour dire que, dans L’Aventure ambiguë et Les Soleils des indépendances, la cohabitation entre mystique musulmane et croyances traditionnelles peut être diversement interprétée : si elles peuvent paraître inconciliables selon une certaine logique (point de vue du maître des Diallobé), il est évident qu’elles dessinent, selon une autre (celle de la société malinké par exemple), une complémentarité qui participe de ce syncrétisme à l’œuvre. Ces deux logiques peuvent trouver une explication sur le plan géographico-historique: la côte des Ébènes (dans Les Soleils des indépendances), proche des forêts, est plus ancrée dans les pratiques traditionnelles et fétichistes que le Fouta (dans L’Aventure ambiguë) par où est passée la percée de l’islam au nord du Sénégal.
En interrogeant aussi la manière par laquelle les héros des deux romans se donnent la mort, on voit encore mieux comment les croyances mystiques guident leurs actes: Fama, en se jetant dans le fleuve, était convaincu que les caïmans sacrés du Horodougou n’oseront jamais s’attaquer au dernier descendant des Doumbouya; Samba Diallo aussi, musulman pratiquant très au fait de ce que sa religion dit de la mort volontaire, se prête aux mains du fou – être insensé et non responsable de ses actes – pour ne pas donner à sa fin les allures d’un suicide.
Mais quelle que soit cette diversité d’appréciation, les deux composantes mystiques ont une conception binaire de l’espace-temps fondée sur une opposition entre intérieur et extérieur qu’il convient maintenant d’analyser.
II. L’espace-temps mystique : une structuration binaire
En dehors de la tripartition traditionnelle de l’espace en fonction de l’itinéraire que suit le héros (Afrique/Europe/Afrique pour Samba Diallo et Togobala/La capitale/Togobala pour Fama Doumbouya), il est possible, avec l’opposition visible/invisible, extérieur/intérieur propre à toute écriture mystique, d’entrevoir une structuration binaire du chronotope « espace-temps»[9] dans les deux romans en faisant la somme des deux pôles extrêmes qui donne, schématiquement, l’opposition suivante : Afrique+Afrique/Europe ou Togobala+Togobala/La capitale. Si j’aborde la question sous l’angle de la conjonction de ces deux catégories, c’est eu égard à leur corrélation qui montre, sur la base du principe de l’indissolubilité, comment la réalité et « les indices du temps [mystique] se découvrent dans l’espace [mystique] et comment « celui-ci est perçu et mesuré d’après le temps»[10].
Dans L’Aventure ambiguë, cela aboutit à la distribution suivante : l’Occident du côté de la surface et de l’extérieur; le pays Diallobé du côté de la profondeur, du mystique et de l’invisible. À partir de cette opposition qui reproduit le principe de la double causalité de Marcel Mauss (l’Occident identifié à la causalité physique et l’Afrique à la causalité mystique), le roman propose, sur le plan de l’organisation, une géodésie duelle qu’on peut retrouver à plusieurs niveaux et sur une certaine étendue du texte, à la manière d’une métaphore filée.
Si l’aristocratie diallobé a finalement décidé de faire entrer Samba Diallo à l’école des Blancs, c’est, selon son père, pour « arrêter l’extérieur » (AA, 92) qui envahit et détruit lentement l’intérieur mystique des Diallobé constitué des « secrets de l’ombre ». D’ailleurs le héros du roman de Cheikh Hamidou Kane interprète cette entrée à l’école comme une extirpation des profondeurs de la spiritualité : «Progressivement, ils me firent émerger du cœur des choses et m’habituèrent à prendre mes distances du monde ». (AA, 173) Son père, le chevalier, en discutant avec son collègue de bureau Paul Lacroix, exprime comme suit ce déni de profondeur mystique à la science occidentale : « L’évidence est une qualité de surface. Votre science est le triomphe de l’évidence, une prolifération de la surface » (AA, 90) De la même manière, le fou identifie l’Occident et sa mécanique à l’extérieur de la conque : « J’ai vu les mécaniques. Ce sont des coquilles. C’est l’étendue enroulée, et qui se meut. Or, tu sais que l’étendue n’a point d’intérieur; elle n’a donc rien à perdre.» (AA, 104)
Pour revenir sur l’inséparabilité des indices du chronotope de l’art littéraire, cet intérieur mystique caractéristique de l’espace diallobé est daté par un temps qui tient ses instruments de mesure des éléments mystiques de la nature. La preuve, le scintillement des étoiles, lors de la « Nuit du coran » que Samba Diallo dédie à son père, participe de cette valse générale de l’espace mystique : «Cette nuit-là, il sembla que la nature avait voulu s’associer à une délicate pensée du garçon, car le lumineux crépuscule s’était à peine éteint qu’au ciel un millier d’étoiles avait germé. » (AA, 83)
Le narrateur, en usant de sa compétence actualisante, en donne l’interprétation suivante qui relève vraisemblablement du point de vue de Samba Diallo : « Car, cette nuit, lui semblait-il, marquait un terme. Le scintillement d’étoiles au-dessus de sa tête, n’était-il pas le verrou constellé rabattu sur une époque révolue? » (AA, 84). Ici, c’est un trait culturel fondamental qui ressort du roman de Cheikh Hamidou Kane : l’Africain entretient des rapports symbiotiques avec la nature qui lui communique les choses par chocs sensoriels, à la différence de l’homme occidental qui procède à une lecture analytique et critique du livre de la nature[11], une nature avec laquelle il entretient plutôt des rapports d’assujettissement. Samba Diallo le signifie plus explicitement à Lucienne de la manière suivante :
- Tu ne t’es pas seulement exhaussée de la nature. Voici même que tu as tourné contre elle le glaive de ta pensée; ton combat est pour l’assujettir. N’est-ce pas? Moi, je n’ai pas encore tranché le cordon ombilical qui me fait un avec elle. La suprême dignité à laquelle j’aspire, aujourd’hui encore, c’est d’être sa partie la plus sensible, la plus filiale. Je n’ose pas la combattre, étant elle-même. (AA, 153)
Que l’homme africain soit capable d’entrer dans ce « vaste temple»[12] pour saisir instinctivement la transparence des signes de l’«alphabet des grandes lettres d’ombre»[13], fait potentiellement et naturellement de lui un sujet mystique. Cette nature, dans la cosmogonie africaine, comme du reste dans l’imaginaire poétique occidental, est cette autre voix, après les textes sacrés (la Bible, le Coran, la Thora) par laquelle Dieu s’adresse aux hommes à travers la médiation de figures traversières (les féticheurs, les marabouts, etc. en Afrique; les poètes en Occident)[14]. D’ailleurs, dans le roman d’Ahmadou Kourouma, si les républiques des soleils des indépendances ont échoué, estime Fama, c’est parce qu’il leur manque ces éléments de la nature qui se donnent à voir comme des mécanismes de contrôle et d’alerte propres au pouvoir coutumier : ce sont, pour Togobala, les deux oracles, l’hyène appelée « L’Ancienne » dont les hurlements annonçaient le malheur et le sacrifice à faire pour conjurer le mauvais sort ou encore le serpent boa appelé « Le Révérend du marigot » qui ne quittait ce dernier pour le village que quand il pressentait un danger et le Koma, ce fétiche qui « prédisait plus loin que le coran » : « Oui, tout tomberait inévitable, pour la simple raison que les républiques des soleils des indépendances n’avaient pas prévu d’institutions comme les fétiches ou les sorciers pour parer les malheurs. » (SDI, 154)
À propos de ce pouvoir fonctionnel de la nature, Xavier Garnier note :
[…] tout dérèglement de l’ordre de la création a ses répercussions au niveau cosmique et, comme le théâtre shakespearien suit la musique des sphères, la nature résonne des destins avortés, des dynasties finissantes et des perturbations humaines. La mort de Fama, dans Les Soleils des indépendances, est un évènement dont les animaux se font messagers […] Les animaux, caisse de résonance, inscrivent les actions humaines dans l’ordre du cosmos[15]
À travers cette caisse de résonance, il faut entendre une double dimension qui, dans la portée perceptive des sens, combine, par exemple dans le roman d’Ahmadou Kourouma, l’ouïe et la vue. Ainsi, pour porter au Horodougou la nouvelle de la mort funeste du dernier Doumbouya, les animaux sauvages se positionnent en véritables sujets préfigurateurs à travers des signaux sonores (les gazouillis et les piaillements des tisserins, les cocoricos des coqs, les aboiements des chiens, etc.) et des signaux visuels (des charognards et des hirondelles qui sillonnent le ciel, les crocodiles sacrés qui sortent de l’eau pour occuper les bancs de sable, etc.).
De la même manière que l’espace de l’intérieur mystique diallobé est conjointement lié au temps qui le date et le mesure, l’extérieur de l’Occident est aussi marqué par un temps qui écrase l’homme. Comme le dit le chevalier, « l’extérieur est agressif. Si l’homme ne le vainc pas, il détruit l’homme et fait de lui une victime de tragédie ». (AA, 91) C’est le vers contenu dans le fruit de la révolution industrielle qui consacre l’ère du travail frénétique sur la base de laquelle Nietzsche, contemporain de cette même époque, parle de la «mort de Dieu ». L’Occident tue Dieu par le travail qui le tue à son tour. Le chevalier la rejette cette morale accumulatrice du travail qui éloigne en même temps l’homme occidental de Dieu:
L’homme n’a jamais été aussi malheureux qu’en ce moment où il accumule tant. Nulle part, il n’est aussi méprisé que là où se fait cette accumulation. C’est ainsi que l’histoire de l’Occident me paraît révélatrice de l’insuffisance de garantie que l’homme constitue pour l’homme. Il faut au bonheur de l’homme la présence et la garantie de Dieu. (AA, 114)
En quittant l’intérieur pour cet extérieur – forme de métaphorisation de son itinéraire qui le conduit en France où il est confronté aux forces du mal et des ténèbres cristallisées chez Nietzsche –, Samba Diallo perd son mode d’investigation et de connaissance privilégié des choses, c’est-à-dire la mystique des profondeurs. De ce point de vue, la vacuité qui l’habite procède moins d’un sentiment nostalgique à l’endroit de la matérialité extérieure de son milieu d’origine que d’une absence spirituelle. Plus loin que le culturel, sa quête est donc mystique : « Ce n’est pas l’absence matérielle de votre terroir qui vous tient en haleine. C’est son absence spirituelle », lui dit Pierre-Louis. (AA, 163). C’est pourquoi il me parait tout à fait juste d’interpréter son passage en métropole comme une mort symbolique. C’est d’ailleurs ce que suggère la métaphore ci-dessous de l’instrument de musique crevé : «Ici, maintenant, le monde est silencieux, et je ne résonne plus. Je suis comme un balafon crevé, comme un instrument de musique mort. J’ai l’impression que plus rien ne me touche. » (AA, 163)
Il ne lui reste qu’à implorer la grâce de son maître pour se ressusciter à « la tendresse mystique » qui montre encore, si besoin en était, comment il reste attaché à la quête mystique de la substantifique moelle des choses, c’est-à-dire ce qu’il y a de plus profond, de plus éloigné de l’erreur et de plus proche de Dieu:
Maître, appela-t-il en pensée […]. Les ténèbres me gagnent. Je ne brûle plus au cœur des êtres et des choses. […] J’implore en grâce ta clameur dans l’ombre, l’éclat de ta voix afin de me ressusciter à la tendresse secrète. (AA, 174)
Ce passage révèle à quel point la représentation de l’espace-temps mystique permet à Cheikh Hamidou Kane d’opérer un renversement paradigmatique à travers lequel l’extérieur où se situe Samba Diallo, habituellement caractérisé par la clarté, devient une zone brumeuse et ténébreuse, échangeant ainsi ses attributs avec l’intérieur désormais nimbé de « lumière singulière des profondeurs » (AA, 189).
Dans l’analyse que fait Amadou Ly[16] du chapitre X de L’Aventure ambiguë, il apparaît encore, à travers les sept étapes de l’initiation mystique de Samba Diallo qu’il relève, que la quête du héros reste liée à l’ombre et à l’intérieur. On sait aussi comment, dans la symbolique de la numérologie mystique musulmane, le chiffre 7 reste lié à ces dites étapes que l’on peut réinterpréter comme suit dans le cas du héros de L’Aventure ambiguë: (1) l’âme inclinée vers le mal (contact avec la philosophie athée occidentale), (2) l’âme repentante (ressaisissement dans l’évocation pensive de son maître), (3) l’âme inspirée (retour à la source spirituelle diallobé), (4) l’âme apaisée (espoir d’une ataraxie proche), (5) l’âme satisfaite (retrouvailles avec le goût du lait maternel et avec les siens), (6) l’âme reconnaissante (renaissance de Samba Diallo), (7) l’âme parfaite (achèvement de la reconquête spirituelle et contact avec l’infinité de la mer qui symbolise l’éternité et l’immortalité, deux attributs divins). La voix du texte[17] figure cette dernière étape comme suit dans les ultimes lignes du roman:
La mer! Voici la mer! Salut à toi, sagesse retrouvée, ma victoire! La limpidité de ton flot est attente de mon regard. Je te regarde, et tu durcis dans l’Être. Je n’ai pas de limite. Mer, la limpidité de ton flot est attente de mon regard. Je te regarde, et tu reluis, sans limites. Je te veux, pour l’éternité. (AA, 191)
Dans le roman d’Ahmadou Kourouma également, la représentation de l’espace-temps mystique est marquée par la dureté des soleils des indépendances. L’espace étouffé, qu’il s’agisse de celui extérieur (la capitale et Togobala, les deux extrêmes où se meut le héros) ou de celui intérieur (la chambre du marabout Abdoulaye, les fétiches de Balla, etc.), est semblable au temps non évolutif dominé par l’image accablante du soleil et de l’harmattan :
Le soleil dominateur donnait toujours, appliquait sur les épaules et les membres quelque chose comme des pierres brûlantes, et étouffait.
C’était midi d’une entre-saison. Allah même s’était éloigné de son firmament pour se réfugier dans un coin paisible de son grand monde, laissant là-haut le soleil qui l’occupait et l’envahissait jusque dans les horizons.
Fama se récriait : « Bâtard de bâtardise ! Gnamokodé ! » Et tout manigançait à l’exaspérer. Le soleil ! le soleil ! le soleil des indépendances maléfiques remplissait tout un côté du ciel, grillait, assoiffait l’univers pour justifier les malsains orages des fins d’après-midi. (SDI, 9)
En opposant l’extérieur (l’Occident, la capitale, etc.) à l’intérieur (les lieux de retraite mystique du pays des Diallobé et de Togobala), l’écriture mystique dans L’Aventure ambiguë et Les Soleils des indépendances réussit en même temps le tour de force de confondre la représentation de l’espace et du temps dans des caractéristiques tangentielles qui montrent comment l’art littéraire africain continue, sur le plan esthétique, le combat à la fois idéologique et poétique de la déconstruction du mythe impérial et de l’affirmation de la littérarité de son texte.
Puisque l’écriture mystique met en scène un sujet en quête de transcendance, il va de soi que son oraison figure une unité à la fois «double» (Freud) et «clivée» (Lacan), c’est-à-dire partagée entre le conscient et l’inconscient, un manque et une quête. Pour le dire autrement, la quête de cet Autre (problématique de l’altérité) suscite des effets de lévitation, de transport et de sensations fortes qui finissent par désintégrer son intégrité.
III. Le sujet mystique comme être de rupture et de crise
Dans L’Aventure ambiguë et Les Soleils des indépendances, il y a une floraison de paroles mystiques respectivement à travers les litanies (récitées les disciples de Thierno) et les incantations (des féticheurs et autres personnages mystiques). En même temps qu’elles peuplent l’univers sonore des romans, elles emplissent aussi le cœur des personnages mystiques. Quand la Parole de Dieu s’énonce à travers l’écho des voix juvéniles ou quand s’élève la flamme du foyer (qui « embrase les disciples et éclaire le foyer»[18], (AA,: 75), l’être du maître se dissout. Il perd l’ordre et l’unité de son discours pour se retrouver dans le domaine des songes, de la méditation et de la contemplation extatique. Dès lors, il n’est plus lui-même : «La pensée du maître, lentement et comme à regret, se détacha des cimes qu’elle contemplait. Le maître, à la vérité, revenait de loin. » (AA, 41).
C’est la preuve, comme le note Michel de Certeau, que l’écriture mystique est l’effet d’une soustraction opérée par la séduction de l’Autre qu’il appelle « Ravissement[19] » (on sort physiquement d’un lieu ou symboliquement à travers l’abstinence, la privation). Le sujet mystique, en entrant ainsi dans l’oubli de ce que la langue formule, opère une « mise à distance de tous les contenus possibles [pour se faire] un chemin à travers les positivités historiques ou linguistiques»[20]. L’énonciation mystique pose alors la problématique du discours, car l’intériorité qui exile le sujet laisse voir une certaine manière de parler. Dans Les Soleils des indépendances, par exemple, les délires et les incantations des personnages mystiques en contact avec les forces transcendantales les confinent dans un discours intérieur :
Le marabout bégaya des paroles incantatoires. […] « Mânes des aïeux! Grands génies des montagnes aux sommets toujours verts! Génies des biefs insondables! Allah le magnanime qui couvre et contient tout! Tous! Tous! (SDI, 72)
Samba Diallo aussi, en contact avec le mystique lors de l’ultime étape de son initiation, connaît une césure de son unité en deux hypostases : «Je suis deux voix simultanées. L’une s’éloigne et l’autre croît », dit-il. (AA, 190) S’il en est ainsi, c’est fondamentalement parce que la présence en Dieu de l’individu crée l’absence de l’individu en lui-même. Entre cette présence matérielle et cette absence spirituelle, le rapport, asymétrique, conclut à l’impossible combinaison. C’est sans doute ce que le héros du roman de Cheikh Hamidou Kane veut signifier en opposant, dans un premier temps, prière (présence en Dieu) et vie (absence de Dieu) : « Mon père ne vit pas, il prie… » (AA, 106). Mais ce dernier lui rétorque qu’« il n’y a pas d’antagonisme entre l’ordre de la foi et l’ordre du travail » (AA, 117) dès lors que le travail se justifie de Dieu.
Il apparaît aussi, dans Les Soleils des indépendances et L’Aventure ambiguë, que les personnages qui s’essaient à la conciliation de ces deux postulations contradictoires sont voués à un sort particulier : visiblement, le marabout Abdoulaye échoue lamentablement en voulant posséder Salimata venue solliciter ses prestations mystiques. Plus profondément, Samba Diallo, en voulant en même temps rester en Dieu (objet de sa quête) et habiter ce qu’il appelle l’extériorité du monde occidental, vit un drame intérieur qui traduit toute l’ambigüité de son aventure :
Je ne suis pas un pays des Diallobé distinct, face à un Occident distinct, et appréciant d’une tête froide ce que je puis lui prendre et ce qu’il faut que je lui laisse en contrepartie. Je suis devenu les deux. Il n’y a pas de tête lucide entre deux termes d’un choix. Il y a une nature étrange, en détresse de n’être pas deux. (AA, 164)
Il ressort, à travers le mouvement d’exil du sujet en posture de quête, que la parole mystique favorise un mouvement de déhiscence par lequel l’âme se détache de l’emprise du corps où elle est assignée en résidence surveillée pour habiter l’être d’un autre type de langage. Chez le sujet parlant comme chez celui écoutant, le résultat est le même. On le constate lors de la Nuit du coran que Samba Diallo prélude pour son père :
Progressivement, il sentit que l’envahissait un sentiment comme il n’en avait jamais éprouvé auparavant. […] Le chevalier d’abord nonchalamment étendu, s’était dressé à la voix de Samba Diallo et il semblait maintenant qu’en entendant la Parole il subît la même lévitation qui exhaussait le maître. […]
Progressivement se dissolvait, dans le bourdonnement de cette voix, quelque être qui était tout à l’heure encore Samba Diallo. Insensiblement, se levant de profondeurs qu’il ne soupçonnait pas, des fantômes l’envahissaient tout entier et se substituaient à lui. Il lui sembla que sa voix était devenue innombrable et sourde comme celle du fleuve certains soirs. (AA, 83-85)
Mais derrière cette dissolution de l’être consécutive à son ascension spirituelle, il faut voir la tentative de posséder et d’incarner cette Parole dont l’ampleur est présentée comme la totalité organique du monde : «elle était l’architecture du monde, elle était le monde même ». (AA, 15) Bien plus, elle montre comment la question de l’écriture mystique rencontre la problématique du corps sur le chemin de la quête de l’Autre.
Chez Cheikh Hamidou Kane, elle se donne à voir à travers la métaphore de la pesanteur qui est très présente dans son roman. Il faut oublier son corps pour accéder à Dieu. C’est pourquoi, au foyer ardent, « ce qu’on apprend [c’est-à-dire Dieu] vaut plus que ce que l’on oublie [soi-même]. (AA, 44) Avec cette même question, le romancier reproduit une deuxième opposition interne aux Diallobé : le rachitisme et la misère qui les caractérisent (donc absence de poids) et qui devraient faciliter leur ascension vers Dieu, contrastent avec la lourdeur du poids du maître qui a tendance à plomber son ascension. L’idée est rendue par le moyen de la translation métaphorique – modus loquendi caractéristique de l’écriture mystique – qui figure leurs aspirations de manière antinomique:
Pendant que le maître niait la rigidité de ses articulations, le poids de ses reins, niait sa case et ne reconnaissait de réalité qu’à Ce vers Quoi sa pensée à chaque instant s’envolait avec délice, les Diallobé, chaque jour un peu plus, s’inquiétaient de la fragilité de leurs demeures, du rachitisme de leur corps. Les Diallobé voulaient plus de poids. […] Le poids! Partout il rencontrait le poids. Lorsqu’il voulait prier, le poids s’y opposait […].
- La courge est une nature drôle, dit enfin le maître. Jeune, elle
n’a de vocation que celle de faire du poids, de désir que celui de se coller amoureusement à la terre. Elle trouve sa parfaite réalisation dans le poids. Puis, un jour, tout change. La courge [c’est-à-dire les Diallobé acquis à la cause de l’école nouvelle] veut s’envoler. (AA, 43)
Mais c’est cette question de l’école nouvelle qui creuse davantage l’insularité du maître et montre à quel point l’Autre qu’il postule l’obsède. Ici, le personnage de Cheikh Hamidou Kane s’inscrit dans la lignée du mystique érémitique isolé dans la multitude d’une collectivité (les Diallobé) à défaut d’avoir le désert (symbolique de l’isolement) comme site.
L’écriture mystique, abordée sous l’angle de la question de l’altérité (fréquentation de l’Autre), révèle donc une analogie troublante de fonctionnement avec la psychanalyse : le sujet clivé (le maître des Diallobé, le marabout Abdoulaye, les féticheurs Balla et Tiécoura, etc.), en quête de spiritualité, s’exile alors dans l’intériorité de son âme rompant ainsi avec l’extériorité de son corps (ruine de la tradition philosophique où, de René Descartes à Emmanuel Kant, le sujet était maître de son corps) et évolue dans un espace-temps où le discours intérieur qu’il tient, tout autant qu’il est évocation ou invocation, oraison ou transfert, échappe à la logique des énoncés (délires symptomatiques des registres de l’inconscient).
Conclusion
À la lumière de cette analyse, on s’aperçoit que l’écriture mystique dans L’Aventure ambiguë et Les Soleils des indépendances, en partant d’une vision syncrétique (théosophie islamique et traditions africaines), propose une mystique de l’écriture qui met en scène, dans un espace-temps binarisé entre intérieur et extérieur, visible et invisible (à la place d’une conception tripartite), des protagonistes de l’interaction verbale (énonciateur et co-énonciateur) divisés au contact de forces transcendantales (en lieu et place d’un narrateur puissant, ange narratif et maître de son discours). Avec cette scénographie nouvelle qu’elle dessine, elle constitue sans doute une entrée à partir de laquelle on peut envisager la spécificité d’un art qui cherche à « dire le littéraire » (Jean Bessière) à partir de ses propres instruments mystiques.
Références bibliographiques
- BACHELARD, G. La Psychanalyse du feu. Paris : Gallimard, 1994.
- BAKHTINE, M. «Formes du temps et du chronotope dans le roman» in Esthétique et théorie du roman. Paris : Gallimard, coll. « Bibliothèque des Idées », 1978.
- DE CERTEAU, M. La Fable mystique, I XVIe-XVIIe,. Paris : Gallimard, 1982.
- GARDET, L. La Pensée religieuse d’Avicenn. Paris : Librairie philosophique J. Vrin, 1951.
- GARNIER, X. «Écrire avec les animaux» in À l’école des animaux, Notre librairie 163, décembre 2006.
- GASSAMA, M. La Langue d’Ahmadou Kourouma. Karthala-ACCT, 1995.
- HUGO, V. Les Contemplations. Paris : Librairie Générale Française, 2002.
- KANE, CH.H. L’Aventure ambiguë. Paris : Julliard, 1961.
- KOUROUMA, A. Les Soleils des indépendances. Paris : Seuil, 1970.
- LY, A. «Le soufisme dans le chapitre X de L’Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane», Éthiopiques n°66-67, 2001, URL http://ethiopiques.refer.sn.
- MALLARMÉ, S. « Hérésies artistiques. L’art pour tous » in Poésies. Anecdotes. Pages diverses, édition critique de Daniel Leuwers, Paris, Librairie Générale Française, 1977.
* Université du Québec à Montréal
[1] S. Mallarme. « Hérésies artistiques. L’art pour tous » in Poésies. Anecdotes. Pages diverses. Édition critique de Daniel Leuwers. Paris : Librairie Générale Française, 1977, p.139.
[2] Le roman africain de la première génération a souvent obéi à une « structure triadique » : Afrique – Europe – Afrique dans Kocoumbo l’étudiant noir de Gérard Aké Loba, Louga – Dakar – Louga dans Maïmouna d’Abdoulaye Sadji, Saint-Louis – Dakar – Saint-Louis dans Karim d’Ousmane Socé Diop, pour ne citer que ceux-là. On verra, avec le propre de l’écriture mystique, comment cette structuration peut être binarisée dans les deux romans de mon corpus d’analyse. On sait aussi que certains romans de cette même veine (Ville cruelle d’Éza Boto et Le Vieux nègre et la médaille de Ferdinand Oyono, par exemple) consacrent une partition de l’espace en cité des Blancs et cité des Noirs. Mais ce n’est pas cette perspective qui m’intéresse ici.
[3] Je tiens ces deux dernières caractéristiques de l’ouvrage de Michel DE CERTEAU, La Fable mystique, I XVIe-XVIIe (Paris, Éditions Gallimard, 1982), sur lequel je m’appuie dans cette analyse.
[4] Extrait de la lettre de Jean Joseph Surin (1630) adressée au Père Louis Lallemant cité par Michel DE CERTEAU, op.cit., p. 283.
[5] Désormais, j’abrège ainsi, dans le corps du texte, L’Aventure ambiguë (Paris, Julliard, 1961) et Les Soleils des indépendances (Paris, Éditions du Seuil, 1970) par SDI.
[6] Louis Gardet. La pensée religieuse d’Avicenne. Paris : Librairie philosophique J. Vrin, 1951, p. 175.
[7] Makhily Gassama. La Langue d’Ahmadou Kourouma. Paris : Karthala-ACCT, 1995, p.74.
[8] Voir mon article « Contre la binarité : la pensée du continuum contre forme de transgression dans l’écriture de Marguerite Yourcenar », Bulletin n°31, Société Internationale d’Études Yourcenariennes (SIEY), décembre 2010, pp.125-143.
[9] Mikhaïl Bakhtine. « Formes du temps et du chronotope dans le roman » in Esthétique et théorie du roman. Paris : Gallimard, coll. « Bibliothèque des Idées », 1978, p. 237.
[10] Mikhaïl Bakhtine, op.cit., p. 237.
[11] La nuance apparaît dans ce poème de Victor HUGO : « Je lisais. Que lisais-je? Oh! Le vieux livre austère, / Le poème éternel! – La Bible? – Non, la terre. / Platon, tous les matins, quand revit le ciel bleu, / Lisait les vers d’Homère, et moi les fleurs de Dieu. […] / Et j’étudie à fond le texte, et je me penche. Les Contemplations, Livre Troisième (Les luttes et les rêves), Paris, Librairie Générale Française, coll. « Le livre de poche », 2002, p. 192.
[12] Dans le sens latin de templum, espace carré que les augures délimitaient dans le ciel et sur la terre pour y observer des signes pouvant renvoyer à des présages.
[13] C’est ainsi que Victor HUGO figure la métaphore récurrente de la nature-livre dans le Livre Premier (Aurore) de ses Contemplations, ibid., p. 78.
[14] On sait, en littérature française, qu’une longue tradition, depuis l’Antiquité, (d’ailleurs fortement mise en question aujourd’hui par la modernité littéraire) fondée sur l’édifice DIEU-MUSE-ROI-POETE-LECTEUR définit le statut de poète en rapport avec l’inspiration transcendantale qu’il tient du roi, représentant de Dieu sur terre, par la médiation des muses. C’est cette corrélation entre activité poétique et dimension mystique que Nicolas Boileau fait ressortir en empruntant la métaphore de la hauteur (le Parnasse) qui montre la posture d’élection du poète : « C’est en vain qu’au Parnasse un téméraire auteur pense de l’art des vers atteindre la hauteur. S’il ne sent point du ciel l’influence secrète, si son astre en naissant ne l’a formé poète. Dans son génie captif il est toujours étroit », Art poétique (1674), Chant I.
[15] Xavier Garnier. « Écrire avec les animaux » in À l’école des animaux. Paris : Notre librairie 163, décembre 2006, pp.13-14.
[16] Amadou Ly. « Le soufisme dans le chapitre X de L’Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane », Éthiopiques n°66-67, 2001, URL http://ethiopiques.refer.sn
[17] Je préfère l’appeler ainsi pour échapper à la contrainte de l’identité de la voix narrative surtout quand on sait qu’à cette étape le personnage principal, plongé dans l’extase, ne fait plus partie de la scène romanesque en tant qu’actant.
[18] Il y a ici un intertexte manifeste entre Cheikh Hamidou KANE et Gaston BACHELARD pour qui le feu « brille au Paradis [et] brûle à l’Enfer ». Voir La psychanalyse du feu, 1938, éd., Paris, Gallimard, 1994, p. 23.
[19] La Fable mystique, op.cit., p. 48-49.
[20] La Fable mystique, op.cit., p. 243.



