Sur le fil...
Safara n°22 est désormais disponible...
 Télécharger l’article en version PDF
Télécharger l’article en version PDF
Introduction
Il appartient à chaque génération de dire son époque en inventant l’art qui lui convient le mieux. De l’antiquité à l’ère moderne en passant par le XIXème, le XVIIème et le XVIème siècle entre autres, les genres artistiques se sont constamment renouvelés pour mieux exprimer les réalités et les préoccupations essentielles de ces différentes périodes.
C’est sous ce rapport que la fin du XXème siècle, marquée notamment par le fulgurant essor de la ville, la prolifération des banlieues et surtout l’émergence d’une nouvelle génération se réclamant les portes étendards de la « rue » qui ne se retrouve plus tout à fait dans les genres classiques, a vu naître de nouvelles formes d’expression plus à même de véhiculer ces nouvelles réalités urbaines. En effet, dans ce nouveau contexte marqué par de nouvelles réalités, où les salons et les cours, avec leurs convenances, sont remplacés par les galléries, les bars, où les ghettos centralisent toutes les préoccupations artistiques, de nouveaux genres artistiques s’imposent sur les formes traditionnelles. Il s’agit essentiellement de trouver des moyens plus efficaces de dire la « rue » par les mots et les arts propres à la « rue ». Parmi ces nouvelles formes d’expression, nous pouvons citer le graffiti, le rap et le slam entre autres.
Ce dernier genre mérite toute notre attention dans la mesure où il oscille entre tradition et modernisme : autant il implique les caractéristiques majeures de la poésie classique, autant il présente des innovations importantes fortement imprégnées des réalités urbaines. C’est la raison pour laquelle d’ailleurs les grandes figures qui constituent les acteurs majeurs de l’essor du mouvement sont de grands poètes qui ont tenté, à travers ce genre nouveau et dynamique, d’insuffler à leur art un souffle nouveau pour une meilleure perception et une meilleure réceptivité. Dans le fond, il s’est agi pour eux de donner la parole à tous ceux qui en ont besoin, de démocratiser la poésie en assouplissant ses normes pour la rendre accessible aux gens de la rue. Cette stratégie artistique répond aux exigences d’une époque post-moderne où la liberté d’expression et de ton constitue une exigence majeure dictée par la « rue ». Parmi les précurseurs de ce mouvement dont la naissance est située dans les années 80 aux Etats-Unis d’Amérique, nous pouvons citer, entre autres, Marc Kelly Smith[1] qui inventa le slamming, la poésie contre les conventions. En France, le mouvement a été impulsé par la sortie en 1998 du film de Daniel Levin intitulé Slam couronné au festival de Cannes.
Aussi, avons-nous choisi, de porter notre réflexion sur ce genre nouveau qui connait un succès considérable dans les grands centres urbains. Cette réflexion tournera notamment autour de deux axes essentiels : quelle est la part d’héritage que le slam a pu tirer de la poésie traditionnelle ? Quelles sont les innovations majeures qui permettent de spécifier ce genre nouveau par rapport à cette poésie traditionnelle ?
Loin de mener une réflexion aux relents axiologiques menant vers une nouvelle « bataille entre anciens et modernes », il s’agira pour nous d’adopter un point de vue scientifique ancré sur une perspective purement stylistique. Nous allons notamment utiliser un corpus exhaustif, composé des textes de qualité du grand slameur français Grand Corps malade[2], de son vrai nom Fabien Marsaud, qui a été promu Chevalier des arts et des lettres avec son compère Abd Al Malick. Pour mieux délimiter notre objet, nous allons travailler sur les seize textes constitutifs de Midi 20[3] qui est son premier album studio.
Notre argumentaire s’appuie sur l’hypothèse selon laquelle le slam s’inspire des fondamentaux de la poésie traditionnelle dont il reprend les caractéristiques majeures, mais également il met en œuvre des innovations importantes sur bien des aspects esthétiques qui permettent de le spécifier, faisant ainsi descendre la poésie du mont parnasse pour l’implanter au cœur de la rue.
Nous allons, de ce fait, voir, à travers des entrées fondamentales, comment ces textes s’ancrent, dans une certaine mesure, dans la longue tradition poétique française, ensuite étudier, au-delà de ces aspects canoniques, les éléments stylistiques qui spécifient le slam et qui font toute son originalité. Nous nous proposons de travailler sur les entrées suivantes : d’abord le système énonciatif pour étudier les entités impliquées par le discours et le sens qu’il révèle, ensuite nous nous pencherons sur la dynamique du lexique, en dernier lieu, nous aborderons l’étude des procédés stylistiques très riches en enseignements.
Cette double perspective liée pourrait notamment déboucher sur une question incontournable : Peut-on parler, avec le slam, de la naissance d’un nouveau genre, généré par la « rue » pour mieux dire la « rue » ?
1.Un cadre énonciatif dynamique
S’inscrivant dans la grande tradition de la poésie lyrique française, les slameurs ont une forte tendance à utiliser la première personne je, véhicule privilégié de la subjectivité du moi. En effet, ce mode énonciatif permet au slameur, à l’image des grands poètes lyriques du romantisme tels que Hugo, Lamartine ou encore Musset d’exprimer son malaise social. Anticonformiste par nature, le slameur s’inscrit souvent en rupture avec la société dans laquelle il évolue, ou du moins avec certains aspects dégradants de cette dernière. Ainsi, l’utilisation du je exprime, comme qui dirait, une sorte de « mal du siècle » moderne, à l’image du mal de vivre qui a frappé la génération des romantiques : « venu trop tard dans un monde trop vieux »[4]. Les chansons « Il a fait nuit toute la journée » et « j’ai oublié » ou « encore je dors sur mes deux oreilles » sont des exemples concrets de ce manque de repère social qui caractérise l’auteur du texte :
Dîtes moi d'où vient ce phénomène qui mène tout droit à l'impasse
Qu'est-ce qui se passe, je vois plus les traces, je reconnais plus mon espace
Espacez-vous, écartez-vous, dîtes moi où est la lumière
J'ai besoin d'aide encore une fois et ce sera pas la dernière
Je ne vois plus où je mets les pieds, ne me dîtes pas que c'est normal
Tout ce que je respire est inquiet, je sais plus ce qu'est bien et ce qu'est mal
« Il a fait nuit toute la journée »
Mais il faut aussi remarquer que ce romantisme est marqué par l’empreinte du modernisme, certains éléments négatifs dans le contexte du XIXème siècle sont valorisés. C’est ainsi que le cadre urbain, la rue, constitue le lieu d’épanouissement privilégié de ce nouveau lyrisme au même titre que la nature a constitué le cadre d’évasion favori du « moi » au XIXème. Grand corps malade exprime bien cette conception dans son album. Les textes « Enfant de la ville » ou encore « Je connaissais pas Paris le matin » et « Saint Denis » en sont des illustrations parfaites :
Mais la nature nourrit l'homme et rien que pour ça faut qu'on l'estime
Donc la nature je la respecte, c'est peut-être pour ça que j'écris en ver
Mais c'est tout sauf mon ambiance, j'appartiens à un autre univers
Si la campagne est côté face, je suis un produit du côté pile
Là où les apparts s'empilent, je suis enfant de la ville
Je sens le cœur de la ville qui cogne dans ma poitrine
J'entends les sirènes qui résonnent mais est-ce vraiment un crime
D'aimer le murmure de la rue et l'odeur de l'essence
J'ai besoin de cette atmosphère pour développer mes sens.
« Enfant de la ville »
Cependant, ce cadre énonciatif peut rapidement dépasser le je pour intégrer l’interlocuteur tu et même parfois une troisième entité, il, symbole de l’autre, porteur de la vision extérieure au cadre du discours. Cette exhaustivité du système énonciatif obéit d’abord à une volonté de rendre vivant le texte slamesque en l’actualisant dans un cadre dynamique où sont en interaction différents actants. En effet, la finalité absolue du slam constitue la représentation sur scène, l’artiste cherche à théâtraliser son texte pour le rendre vivant. Ainsi, Il s’agit avant tout pour le slameur de faire de son interlocuteur (l’auditeur, le spectateur), qui est un maillon essentiel au niveau de la performance, plus qu’un simple spectateur passif, un véritable acteur, Co-créateur de sens. Cette théâtralisation constitue, à bien des égards, une caractéristique majeure des textes slamesques. Dans les chansons de Grand Corps malade, on retrouve cette interactivité constante entre destinateur et destinataire. C’est le cas notamment du texte « Chercheur de phrases » qui met en scène de façon très symbolique les trois entités du discours :
Lui il a traversé tout le pays pour atteindre le Grand Ouest
Equipé d'un vieux fute, d'un gros sac et d'une veste
Il se prend pour un aventurier, à raison ou à tort
Il est parmi tant d'autres un simple chercheur d'or
Il retourne toutes les rivières en secouant son tamis
Il traque la moindre lueur, il en rêve même la nuit
Il soulève chaque caillou pour voir ce qu'il y a en dessous
Il lui arrive même de chercher jusqu'à s'en rendre saoul
Il ausculte tous les grains de sable pour dénicher la pépite
Il sait prendre son temps, ne jamais aller trop vite
[….]
Moi j'ai traversé toute la pièce pour atteindre mon petit bureau
Equipé de ma main droite, une feuille et un stylo
Je me prends pour un poète, p't'être un vrai, p't'être un naze
Je suis parmi tant d'autres un simple chercheur de phrases
Je retourne toutes les phrases en secouant mon esprit
Je traque la moindre rime et j'en rêve même la nuit
Je soulève chaque syllabe pour voir ce qu'il y a en dessous
Il m'arrive même de chercher jusqu'à m'en rendre saoul
J'ausculte tous les mots pour dénicher la bonne terminaison
Je sais prendre mon temps, la patience guide ma raison
[…]
Son Grand Ouest, c'est mon petit bureau, t'as vu le parallèle frérot
Et si tu pars à Lille, t'es zéro, car ça se passe là dans ton petit bistrot
Moi je fais le pari que tu te tapes des barres dans tous les bars de Paris
Mais si tu ris pas et que tu te barres dans ta barre, oublie mon pari
Car si je viens juste dire des mots, tu peux pas me maudire
Même si je fais ni du Rimbaud ni du Shakespeare, j'sais qu'y a pire
Je te jure, respire ! Je pourrais faire du Britney Spears
Te faire kiffer toi même tu sais que c'est à ça que j'aspire…
« Chercheur de phrases »
Le style du parallélisme permet de dévoiler ce cadre énonciatif à trois entités. Nous voyons clairement comment le destinataire est constamment interpellé par le destinateur en vue de susciter une action physique ou morale (adhésion, prise de conscience, témoignage…). Nous pouvons noter à ce propos le texte « les voyages en train » où le « je » interpelle et interroge le « tu » en permanence :
Je crois qu'les histoires d'amour c'est comme les voyages en train,
Et quand je vois tous ces voyageurs parfois j'aimerais en être un,
Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare ?
Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard ?
« Les voyages en train »
D’autre part, ce système tripartite révèle, au plan thématique, la posture du slameur face à la société et son interlocuteur. En effet, si le slameur (anticonformiste) traduit sa subjectivité avec le je, le il réfère le plus souvent aux autres, à la société, reflet de la condition humaine. En guise d’exemple prenons le texte « Vu de ma fenêtre ». Le tu renvoie à l’interlocuteur, la cible du slameur, situé entre les deux entités précitées, qu’il essaie d’attirer à sa cause. Nous sommes à peu près dans le schéma suivant :
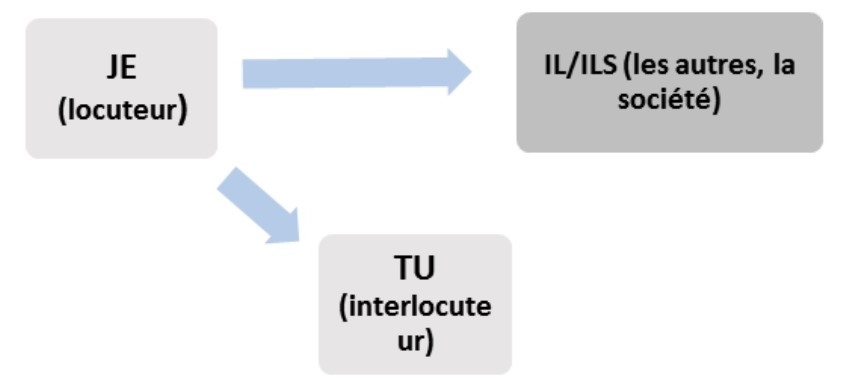
Cependant, ce schéma peut rapidement évoluer vers un cadre bipartite quand notamment il intègre dans sa subjectivité son interlocuteur avec qui il se solidarise dans sa cause. Dans ce cas de figure, le je cède la place à un nous ou un on englobeur. Nous pouvons à ce propos prendre l’exemple du texte « le jour se lève » :
Le jour se lève sur notre grisaille, sur les trottoirs de nos ruelles et sur nos tours
Le jour se lève sur notre envie de vous faire comprendre à tous que c'est à notre tour
D'assumer nos rêves, d'en récolter la sève pour les graver dans chaque mur de pierre
Le jour se lève et même si ça brûles les yeux, on ouvrira grand nos paupières
« Le jour se lève »
Cela permet parfois au slameur d’instaurer un véritable duo entre le je et le tu représentant son interlocuteur pour faire face au il référant à sa société avec qui il entretient souvent des rapports souvent conflictuels (volonté de changer les choses, refus de se conformer). Ainsi, nous aboutissons au schéma suivant :
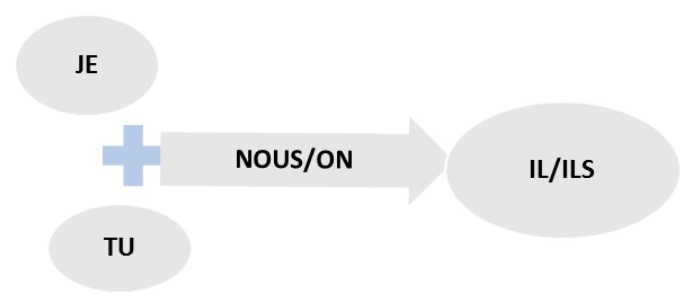
En somme, nous pouvons retenir que dans les textes de Grand corps malade, le système énonciatif met en interaction les trois entités du discours : je, tu, le il, chaque entité exprimant une posture spécifique : celle du slameur, celle de son interlocuteur (le public ou l’auditeur) et celle des autres (la société).
Mais nous avons remarqué dans certains textes que les deux premières entités, le je et le tu, peuvent se solidariser pour donner un nous ou un on exprimant une parfaite symbiose de point de vue entre le slameur et son auditeur.
Ce regard sur le cadre énonciatif révèle tout le sens contenu dans le jeu énonciatif avec un système tantôt monovalent, tantôt bivalent et parfois trivalent. Partant du lyrisme personnel exprimé par la première personne je, le slameur élargit le cadre du discours en intégrant le tu à savoir l’interlocuteur et la troisième personne il renvoyant à l’autre (la société) dans un nouvel espace de prédilection que constitue la rue ou encore la cité urbaine. Cet éclatement du système énonciatif procède de la mutation du cadre énonciatif. En effet, le surgissement d’un nouvel espace d’interlocution induit logiquement dans la poésie-slam de nouvelles stratégies stylistiques qui permettent de mieux exprimer cet espace urbain fortement marqué par de nouvelles réalités méconnues de la poésie traditionnelle. Ainsi, le slameur, intégrant la variante pragmatique du discours, met en jeu une nouvelle redistribution énonciative pour une meilleure expressivité de cet espace et une meilleure réceptivité de la part de cette nouvelle génération.
L’impact pragmatique notoire de cet espace de prédilection que constitue-la rue, la cité urbaine, se reflète aussi, à bien des égards, dans le lexique utilisé dans les textes.
2. Un lexique dynamique entre purisme, renouvellement et innovation
Le lexique utilisé dans les textes de Grand Corps malade reflète en profondeur le caractère hybride du slam qui est écartelé entre la pureté de la langue poétique et le nouveau langage en vogue dans la rue, qui reflète le mieux possible les nouvelles réalités urbaines. En effet, le slam est un genre ambivalent, paradoxal, qui s’inscrit dans la grande tradition poétique, dans sa pureté et son élitisme, tout en s’ancrant dans un contexte social très marqué avec l’émergence des cités urbaines, des banlieues, d’une nouvelle génération se réclamant les porte-étendards de la rue et qui font de la liberté de ton un vade-mecum. Ceci fait que dans l’album midi 20 de Grand Corps malade, le lexique utilisé est loin d’être homogène. Nous avons un mélange hétérogène comportant des termes très classiques, que l’on retrouve dans les textes des grands poètes français du XIXème par exemple et des termes nouveaux, propres à la rue, révélateurs des nouvelles réalités urbaines et qui sont parfois très crus et même proches de l’obscène.
De ce fait, le lexique utilisé peut être catégorisé en plusieurs rubriques quasi distinctes qui mettent en évidence les influences diverses qui marquent ce genre.
Tout d’abord, nous avons un lexique que l’on peut qualifier de classique, qui illustre dans une certaine mesure l’héritage que le slam a pu tirer de la tradition poétique. Ainsi, par exemple, les termes utilisés dans certains textes de GCM reflètent à bien des égards quelques fondamentaux de la poésie sentimentale des romantiques et des poètes de la pléiade. Nous avons relevé beaucoup de mots ayant trait aux sentiments, à la sensibilité : émotion, attendri(ront), caresserait, sens… qui nous plongent dans le vaste univers de la poésie lyrique et sentimentale. Nous retrouvons des termes exprimant des sentiments graves tels que impasse, inquiet… corroborés par les mots qui connotent l’alternance clair/obscur comme pénombre, soleil, lueur, nuit, jour… bien présents notamment dans la chanson « Il a fait nuit toute la journée ». Ce genre de lexique illustre un certain mal être ou mal de vivre justifié sans doute par le contexte, la posture du slameur face à la société.
Comme dans beaucoup de textes sentimentaux, la nature est à l’honneur dans les textes de GCM. Les termes relevés comme nuages, hiver, verdure, vent, forêt, herbe, nature, mer, campagne… reflètent bien l’omniprésence de la nature qui peut être un lieu de refuge du slameur sentimental. Cependant, contrairement à la poésie traditionnelle telle que la poésie romantique, dans les textes de GCM, la nature est fortement concurrencée voire dominée par l’espace urbain. Il s’agit d’une première rupture isotopique entre le slam et la poésie traditionnelle qui a longtemps minoré l’espace urbain (cf. V. HUGO, « A Villequier »). Ce constat est bien mis en exergue par le lexique dans certaines chansons qui sont saturées de termes ayant trait à la cité urbaine. Dans des textes comme « Saint Denis », « Enfant de la ville » ou encore « Le jour se lève », nous avons une floraison de termes référant aux caractéristiques fondamentales de l’univers citadin, nouvel espace de prédilection du poète slameur : ruelles, tours, mur de pierre, asphalte, agglomération, béton, trottoirs. Loin de chercher la quiétude de la nature sauvage à l’image des poètes romantiques, le slameur retrouve sa plénitude dans cet espace vivant qui l’a vu naître et grandir comme l’affirme GCM dans Enfant de la ville :
Mais la nature nourrit l'homme et rien que pour ça faut qu'on l'estime
Donc la nature je la respecte, c'est peut-être pour ça que j'écris en vers
Mais c'est tout sauf mon ambiance, j'appartiens à un autre univers
Si la campagne est côté face, je suis un produit du côté pile
Là où les apparts s'empilent, je suis enfant de la ville
Je sens le cœur de la ville qui cogne dans ma poitrine
J'entends les sirènes qui résonnent mais est-ce vraiment
« Enfant de ville »
Cet espace dynamique est spécifié par le mouvement et l’ambiance comme l’atteste le champ lexical du bruit relevé dans les chansons citées plus haut : bruit, rires, cris, agitation, fourmilière, cohue, grouille. De toute évidence, cette domination du cadre urbain marque de façon nette la rupture entre la poésie traditionnelle et le slam. Cette rupture est plus accentuée quand le slameur tend à imposer le langage utilisé au niveau de ces centres urbains dans ses textes. En effet, le discours utilisé par GCM est fortement imprégné du langage de la rue aussi bien dans sa relative vulgarité que dans ses multiples facettes de création comme entre les anglicismes ou l’utilisation du verlan. En effet, nous remarquons d’abord dans l’album de GCM un niveau de langue très familier, reflété par la présence dans le discours de termes relativement vulgaires : mecs, cannibale, naze, pète, égo-trip, brêle, potes, coche(rater le coche), truc, taffer, blaze, frérot, kiffer, se barrer, taré, bordel, pagaille, déconner, meufs, chialer, mettre à poil, con, rencard, gueule, cartonne, connard, putain, péter un câble, chambres (chambrer), flippe, cul, con, couilles, bordel, bourre, foutais, cool, grande gueule, clandos, zen, vachement, ghetto, triment. Cette longue liste révèle l’intrusion manifeste du langage de la rue, de l’argot dans le discours slamesque, accentuant davantage la distance entre poésie traditionnelle et slam. En effet, si dans la poésie classique, l’esthétique du langage la correction et la beauté du discours sont exploitées à fond, chez les slameurs tels que GCM, la crudité du texte est presque recherchée, ils font usage des mêmes termes et expressions utilisés dans la rue, les cités urbaines, pour une meilleure réceptivité au sein de cette nouvelle génération qui constituent en fin de compte leur principale cible. C’est sans doute ce souci de mieux toucher cette nouvelle génération qui fait qu’on retrouve dans les textes de GCM des mots nouveaux, référant à des réalités urbaines très modernes. Nous pouvons citer des termes comme : Attentat, RER C, a capella, soliste, égo-trip, rap, slam, slalomer, états-unien, radars, périphérique, hip-hop, péage, crèche, droit de véto, taf, éboueurs, JT, (mon) ex, SNCF, antiquaires, clandos, gos, tramway, Yougos, Roms, zouk, Hallal, Nirvana, skate, télé-réalité, sitcom, ghetto. Ce lexique nous plonge directement dans une ère nouvelle, au cœur des grandes cités urbaines, des banlieues. Les nouvelles réalités de cet univers moderne sont exploitées par l’auteur : les nouveaux moyens de transport, de nouvelles réalités sociales et politiques, de nouveaux concepts musicaux et artistiques.
Dans ce même ordre d’idées, GCM n’hésite pas à intégrer toutes les virtuosités et innovations lexicales notées dans le parler de la rue. Nous notons d’abord beaucoup d’anglicismes, francisés ou non, dans son album: Squares, lyrics, freestyle, huskies, shaker, hip-hop, melting-pot, baggys, flow, stress, checker, parking, love story, jet-set, skate, DVD. Cette forte présence des anglicismes dans les chansons de GCM révèle en filigrane cette forte tendance des jeunes des centres urbains à saturer leur discours de mots anglais avec une dominance des termes ayant trait à la musique.
Par ailleurs, il y a la forte présence des mots abrégés dans les différents textes de l’album de GCM, une tendance très en vogue au sein des nouvelles générations : Occaz, apparts, écolo, mytho, instru, petit dej', taf, Rép', McDo, clandos, RER, Yougos, Roms, mat', démo. L’usage de ce phénomène de raccourci lexical ancre davantage le slam dans l’univers urbain où il a vu le jour.
Ce point de vue est corroboré par le procédé du verlan fortement utilisé dans l’album. En effet, cet autre phénomène lexical que l’on pourrait appeler inversion lexicale constitue une autre tendance urbaine très représentative dans les textes de GCM : Chelous, geon-pi, chémar, bébar, relou, Ris-Pa, pé-cho, tebê, tho-my, re-noi, sique-phy.
Au bout du compte, tous ces phénomènes lexicaux intégrés dans le slam constituent des traces d’urbanité qui marquent une rupture notoire du slam avec les conventions de la poésie traditionnelle. Ces innovations lexicales obéissent à la volonté du slameur d’adapter sa poésie au milieu qui l’a fait germer, les cités urbaines ; il s’agit pour lui de faire de la poésie avec les mots de la rue.
Au-delà du lexique, cette démarcation du slam avec les normes conventionnelles de la poésie traditionnelle peut être visible aussi à travers certains procédés stylistiques.
3. Regard sur quelques procédés stylistiques : Comparaison et métaphore au cœur du renouvellement des images.
Les procédés stylistiques constituent des éléments majeurs de la littérarité d’un texte. Ils font partie des outils incontournables qui font la poéticité d’un discours. Dans cette présente étude, il ne s’agit pas d’en faire l’inventaire exhaustif dans l’album de GCM, mais d’étudier un échantillon assez représentatif pour voir si leur usage dans les textes slamesques s’inscrit dans la logique de la tradition poétique ou s’ils impliquent des innovations importantes pouvant même induire une rupture par rapport aux normes conventionnelles de cette tradition poétique. De ce point de vue, nous avons choisi de nous pencher sur la comparaison et la métaphore, deux procédés incontournables dans les textes poétiques, qui offrent une matière d’analyse abondante. En effet, comparaison et métaphore sont au cœur du processus de création et de renouvellement du langage. Elles permettent de révéler en toile de fond les réalités qui marquent une époque. Ainsi, il s’agit pour nous de voir dans quelle mesure ces deux procédés, en s’inscrivant dans la tradition poétique, permettent de révéler les caractéristiques d’une nouvelle époque et d’un nouveau contexte, en un mot les références d’une nouvelle génération.
Tout d’abord, il convient de remarquer que les textes de GCM sont très riches en images véhiculées par la comparaison et la métaphore. Ces dernières reflètent bien la vision du monde du slameur en rapport avec les réalités de son époque, mais aussi, parfois, elles sont fondées sur des réalités traditionnelles déjà très bien exploitées par les poètes traditionnels.
En effet, GCM a souvent recours à des images très classiques pour véhiculer sa pensée, des images certes toujours d’actualité dans son époque, mais qui remontent loin dans le temps. Prenons à cet effet cette comparaison tirée de la chanson « Attentat verbal » :
Les mots sont nos alliés, on les aime comme maître Capello
Puis on les laisse s'envoler en musique ou a capella
Et comme des flèches ils tracent, lancés par nos cordes vocales.
« Attentat verbal »
L’assimilation des paroles à des flèches pour évoquer leur impact, est une image très classique très connue comme l’illustre ce proverbe russe : « Les flèches, comme les paroles, une fois lancées, ne reviennent plus. »
Ces genres d’images très connues sont assez très fréquents dans l’album Midi 20 :
Une route pleine de virages, des trajectoires qui dévient
Un chemin un peu bizarre, un peu tordu comme la vie
« Rencontre »
On a trempé notre plume dans notre envie de changer de vision
De prendre une route parallèle, comme une furtive évasion
« Toucher l’instant »
J'attends que le soleil se lève à nouveau dans mon espoir
Mais je n'oublie pas qu'il est possible que ce soit l'hiver toute l'année
« Il a fait nuit toute la journée »
C'est un parcours fait de virages, de mirages, j'ai pris de l'âge
Je nage vers d'autres rivages, d'une vie tracée je serai pas un otage
Un auteur de textes, après un point je tourne la page
« Je connaissais pas Paris le matin »
Que les demoiselles nous excusent si on fait des trucs chelous
Si un jour on est des agneaux et qu'le lendemain on est des loups
« Ma tête, mon cœur »
Ces comparaisons et métaphores montrent bien comment GCM fait usage assez régulièrement d’images déjà bien intégrées dans la langue comme leitmotive de sa pensée : la vie, le soleil, nager vers d’autres rivages, tourner la page, agneau/loup. Ce genre d’image a l’avantage de permettre un accès facile au contenu et une certaine universalité au niveau de l’interprétation.
Cependant, au-delà de ces références traditionnelles, la grande originalité des textes de GCM constitue sans nul doute l’insertion, en toile de fond des comparaisons et métaphores, d’images fortement inspirées des nouvelles réalités urbaines. En effet, genre populaire, issu de la rue, le slam intègre aisément et sans détour des images puisées directement des réalités citadines, du langage de la rue dans sa crudité et son obscénité parfois.
Dans L’album midi 20, nous avons une floraison d’images inédites qui obéissent à ce principe. Nous pouvons les sérier en fonction de la nature des réalités urbaines qu’elles véhiculent. On a ainsi des comparatives et métaphores qui véhiculent des images ayant trait au cadre urbain dans laquelle évolue le slameur :
J'ai traversé les années plus vite qu'on passe un péage
« Il a fait nuit toute la journée »
Pour le moins inattendu alors je tourne mais j'ai la rage
Je me suis pris un éclair comme un coup d'électricité
« Midi 20 »
A toutes les prisons du paraître j'ai mis un retourné facial
Aviez-vous remarqué que l'ascenseur social est bloqué
Et qu'les experts ont bien mieux à faire que de le réparer
Sur ma lancée je devais poursuivre alors j'ai pris les escaliers
Mais à ma grande surprise, y'avait plus de marches après le premier palier
« Ça peut chémar »
Je trempe ma plume dans l'asphalte, il est peut-être pas trop tard
Pour voir un brin de poésie même sur nos bouts de trottoirs
Le bitume est un shaker où tous les passants se mélangent
« Enfant de la ville »
Je t'offre une invitation pour cette grande fourmilière
Je suis allé à New York, je me suis senti dans mon bain
Ce carrefour des cultures est un dictionnaire urbain
« Enfant de la ville »
Si tu le supportes pendant une heure, j'te jure t'es costaud
C'est le mec qu'on appelle la cerise sur le ghetto
« Vu de ma fenêtre »
Fortement influencé par l’univers dans lequel il évolue, le slameur s’appuie fondamentalement sur les éléments caractéristiques des cités urbaines pour une meilleure expressivité. Ainsi, il place son discours au niveau de sa cible, les jeunes générations, en utilisant des références tirées des réalités de son époque, de son monde : péage, électricité, ascenseur, escaliers, ghetto, dictionnaire urbain…
C’est dans ce même ordre d’idées que le slameur convoque en guise de référence d’autres réalités modernes, correspondant à la vie dans les cités urbaines ayant trait par exemple au sport ou à la médecine moderne :
Dans mon prochain texte, je vous ferai croire que je courre plus vite que Carl Lewis
« Il a fait nuit toute la journée »
A ce putain de texte, j'ai oublié de trouver une chute
Comme un cascadeur qui saute d'un avion sans parachute
« Il a fait nuit toute la journée »
J'ai dû slalomer pieds nus et sans skis
Il m'a fallu traverser la toundra et plus sans huskies
« Ça peut chémar »
Evidemment on marche sur un fil, chaque destin est bancal
Et l'existence est fragile comme une vertèbre cervicale
« Je dors sur mes deux oreilles »
J'ai pas que des séquelles physiques, je vais pas faire le tho-my Mais y'a des cicatrices plus profondes qu'une trachéotomie
« Midi 20 »
Moi je crois bien que c'est le vent qui est venu me la souffler
Et ça m'a fait l'effet d'un sédatif car à vrai dire ça m'a troublé
« Parole du bout du monde »
Pour montrer qu'elle décide et que si elle veut elle nous malmène
Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie
« Sixième sens »
Ces différents exemples révèlent bien comment le slameur fait recours à des images simples, tirées de son environnement immédiat, le sport, la médecine, pour passer un discours simple. En usant de références à la portée de sa cible, Carl Lewis, athlète contemporain, le ski, sport connu de tous, quelques aspects de la médecine moderne compréhensibles pour le profane, le slameur rend sa poésie accessible aux masses. Il s’agit d’une véritable opération de démythification de l’art poétique qui passe par le procédé « déshermétisme ».
Cette stratégie stylistique est poussée à l’extrême quand le poète slameur utilise des images vulgaires ou violentes, propres au langage de la rue, en guise de comparant ou de phore pour les comparaisons et métaphores.
Le principe est clair : lâcher des textes là où et quand tu t'y attends pas
Claquer des mots un peu partout et que ça pète comme un attentat.
« Attentat verbal »
Puis on les entend résonner comme une bombe dans un bocal
On arrive comme un accident dans des endroits insolites
« Attentat verbal »
Et le train ralentit, c'est déjà la fin de ton histoire,
En plus t'es comme un con tes potes sont restés à l'autre gare
« Les voyages en train »
C'est vrai Rouda mais l'important c'est peut-être juste qu'elle soit belle
Ça leur paraîtra peut-être bête encore plus con que deux poètes
« Parole à bout du monde »
On retrouve en toile de fond de ces différentes comparatives des images inédites en poésie, qui connotent dans une certaine mesure la violence qui règne dans les cités urbaines : attentat, bombe, accident pour exprimer dans les textes l’inattendu ; mais également des termes assez vulgaires qui s’inscrivent dans le parler de la rue : pète, con.
En définitive, en saturant ses textes de comparaisons et de métaphores, GCM s’inscrit dans la tradition poétique où ces deux procédés font figure de proue dans la peinture des réalités contextuelles. Cependant, dans le fond, il imprime une touche particulière à ces deux procédés en convoquant en guise de références des images inédites, banales et crues, tirées de son environnement immédiat, l’univers urbain.
Conclusion
Pour nous résumer, ce bref aperçu sur ce genre urbain que constitue le slam à travers l’album midi 20 de GCM révèle un genre hybride qui tire son héritage de la tradition poétique tout déployant une large panoplie d’innovations esthétiques qui en font un véritable genre urbain. Les trois entrées sur lesquelles a porté notre étude à savoir le système énonciatif, le lexique et les procédés stylistiques mettent en évidence l’empreinte de taille de la rue, des cultures urbaines sur le slam poétique. Cette empreinte des cultures urbaines confère à ce genre une grande originalité en marquant davantage sa ligne de démarcation avec la poésie traditionnelle. De ce point de vue, on peut parler, avec l’émergence de ce genre nouveau, d’une véritable révolution esthétique, qui fait descendre la poésie, élitiste, du mont parnasse pour l’installer dans la rue au sein des masses populaires. Passant par la démystification et la démythification du genre poétique, cette révolution esthétique marque ainsi l’avènement de la « rue », la prise de parole de la nouvelle génération :
Le jour se lève sur notre grisaille, sur les trottoirs de nos ruelles et sur nos tours
Le jour se lève sur notre envie de vous faire comprendre à tous que c'est à notre tour
Notre futur est incertain, c'est vrai que ces deux mots-là vont toujours de pair
Mais notre jour s'est bien levé, dorénavant il sera difficile de nous faire taire.
« Le jour se lève »
BIBLIOGRAPHIE
Discographie
- Grand Corps malade, Midi 20, Label Anouche Productions/AZ/Universal, 2006
Ouvrages généraux et critiques
- De Bellissen, Héloïse Guay, Au coeur du slam : Grand Corps Malade et les nouveaux poètes, Alphée-Jean-Paul Bertrand, Monaco, 2009
- DRAME, Mamadou, « Procédés de création du lexique argotique dans les textes de Rap au Sénégal: dérivation sémantique et emprunts », ANADISS n° 10, 2010, ,pp 100-114
- DUBOIS Camille, Travailler l’écrit grâce au slam Une expérience didactique au sein d’un Pôle d’Insertion, Mémoire de master 2 professionnel, Université Stendhal, Grenoble, 2013
- GABIN Christine, Collectif, Slameur des villes, slameur des champs : poésies nomades, Castor astral, Paris, 2000
- HAENTJENS, Marc, « Cette génération qui (nous) pousse » Liaison, n° 144, 2009, pp. 26-27
- MARTINEZ, S., Slam entre les mots : Anthologie, La Table Ronde, Paris, 2007
- MASSOT, Florent, Blah ! : une anthologie du slam, 1997-2007, Spoke, Paris, 2007
- VERHAEREN, Emile, Les Villes tentaculaires : précédées des Campagnes hallucinées, Mercure de France, Paris, 1949
Vidéographie
- LEVIN, Marc (avec Saul Williams, Lawrence Wilson, Bonz Malone), Slam, (Bonus : interview de Marc Levin et Saul Williams, historique du slam, poèmes), Offline entertainment, 1998
- TESSAUD, Pascal, Slam, ce qui nous brûle, France télévisions distribution, 2008
Webographie
- DRAME, Mamadou, « L'obscène pour exorciser le mal en disant l’interdit : Enjeux et signification des injures employées dans le Rap au Sénégal », Revue électronique internationale des sciences du langage Sudlangues N°5 www.sudlangues.sn, décembre 2005
- Site officiel de Grand Corps Malade, http://www.grandcorpsmalade.com/slam.html
- Site E.L.C. - Slam Productions, http://www.slameur.com/rencontres/frameindex.html
* Université Gaston Berger de Saint-Louis
[1] Poète americain, né en1950, il a initié les premiers spectacles de slam aux Etats-Unis.
[2] Pour le reste du texte, nous allons utiliser l’abréviation GCM
[3] Grand Corps malade, Midi 20, Label Anouche Productions/AZ/Universal, produit par S Petit Nico, Seb Mo, Baptiste Charvet, sorti le 27 mars 2006,
[4] MUSSET, Alfred, La Confession d’un enfant du siècle, 1836
 Télécharger l’article en version PDF
Télécharger l’article en version PDF
« La ville est le lieu de l’hétérogène et du singulier qui résument l’essentiel du langage, tant au niveau des dynamiques internes que des facteurs externes qui concourent à la prise de parole, à l’échange »
(Auguste Moussirou-Mouyama, 2008 :324-325).
« (…) la ville plurilingue est aussi un lieu de conflit de langues, conflit que l’on peut lire à différents niveaux, celui des familles ou celui des groupes sociaux plus larges, des associations, des écoles, des quartiers, etc. »
(Louis-Jean Calvet, 1994 :12).
Résumé
Vivant dans un milieu multilingue (13 langues), la communauté mancagne de Goudomp représente moins de 10% de la population totale. Cette situation de groupe minoritaire fait que les membres de cette communauté font face à une double contrainte : lutter pour la survie de leur langue tout en restant des polyglottes « accomplis » devient dès lors leur objectif premier. En procédant dans ce texte d’une double approche (l’observation participante et l’entretien semi-directif), notre but est ici de montrer comment, à travers leur parler, ce peuple négocie son identité quotidienne dans un tel environnement.
Mots clés : langue, contacts, multilinguisme, hétérogénéité, représentations, identité.
Abstract
Living in a multilingual area (13 languages), the Mancagne community of Goudomp represents less that 10% of the whole population. This situation of minority group makes the members of this community face a double constraint: fighting for the survival of their language while remaining full polyglots becomes their principal target. In using a double approach (participant observation and a semi-directed survey), our objective here is to show how, through their way of speaking, these people negotiate their daily identity in such an environment.
Keywords: language, contacts, multilingualism, heterogeneity, representations, identity.
Introduction
La ville a toujours été perçue dans certaines disciplines (géographie, sociologie…) comme un lieu privilégié d’observation des phénomènes sociaux en « tension permanente ». Sur le plan sociolinguistique par exemple, elle peut être considérée comme étant « plus qu’un lieu de coexistence des langues », (Calvet, 1994 : 16). En effet, selon Lorenza Mondada « laprésence de la ville en linguistique est paradoxale : à la fois potentiellement et implicitement centrale, la ville y joue un rôle qui est rarement traité comme un objet de recherche pleinement reconnu » (2000 : 59). Partant de là, nous pouvons dire qu’analyser les Voix ou Paroles de Ville nous ramène inévitablement à discuter du contact entre les différents groupes sociaux qui la peuplent et au-delà, des langues et des représentations ou imaginaires qui les sous-tendent.
En sociolinguistique urbaine, l’accent est principalement mis sur les flux langagiers dans la ville ainsi que les discours sur la ville. Ici, on s’interroge sur le rôle que pourrait jouer la langue tout comme le discours dans les configurations de l’urbain, à différents niveaux d’échelle. A travers les deux types de discours (dans et sur la ville), l’individu territorialise et catégorise l’espace dans lequel il vit. Cet acte de l’agir par le verbe (acte performatif), lui permet de s’approprier le territoire qu’il investit. Voilà pourquoi lorsqu’on mène une étude sur les Paroles de Ville, il est nécessaire de prendre en compte un certain nombre de paramètres pour « décrire et expliquer les rapports existant entre, d’une part, la société et, d’autre part, la structure, la fonction et l’évolution de la langue », (Boukous, 1999:15).
Dans les pages qui suivent, le but fixé est de présenter une étude de cas qui porte sur la communauté mancagne de Goudomp, un groupe minoritaire vivant dans un milieu pluriethnique, donc multilingue. Pour ce faire, nous commencerons par décrire le cadre d’étude ; à savoir la ville et son paysage sociolinguistique. Ensuite, nous exposerons les différentes techniques utilisées pour recueillir les données sur lesquelles se fonde notre analyse. La troisième section sera entièrement consacrée à l’analyse de l’ « ambivalence » de la situation dans laquelle vit cette communauté qui, de par son comportement langagier, semble être partagée entre le désir de rester « elle-même » (par le conservatisme) et l’ouverture par l’appropriation des autres langues.
I. Présentation générale
I.1. Présentation de la zone d’étude
La ville de Goudomp, actuel chef-lieu de département du même nom, est érigée en commune le 08 octobre 1990 par le décret n° 90/1135 du 08 octobre 1990. Situé dans la région de Sédhiou (sud du Sénégal), la commune de Goudomp couvre une superficie de 12.5 km². Elle est limitée à l’Est par le Baconding, à l’Ouest par le Ponta Dos, au sud par Akintou et au Nord par la rive gauche du fleuve Casamance[1]. Elle est divisée en quatre (4) quartiers administratifs que sont Hamdallahi, Sansancono, Diolacounda 1 et Diolacounda 2. La ville de Goudomp comptait en 2012 une population de 21475 habitants[2]. Cette population est composée en majorité de mandingue (40%), de balante-mané (18%), de diola (12%), de manjack (7,8%), de mancagnes (8,2%), de peulhs (7%) et les autres groupes (8%). Sa densité est de 2095 habitants au km². Les jeunes de moins de 20 ans représentent 65% de la population totale[3].
I.2. Paysage sociolinguistique
Grâce à sa position géographique de ville carrefour[4], à ses activités économiques, Goudomp attire quotidiennement des populations et/ou commerçants des autres régions du pays ainsi que ceux des pays voisins (Mali, Guinée Bissau et Guinée Conakry). Le plurilinguisme se manifestant concrètement là où ses monolinguismes convergent, sur les pistes, les marchés, les ports et, de façon plus générale, dans la ville à laquelle aboutissent les pistes et où se trouvent les marchés et les ports (Calvet, 1994 : 11), Goudomp se présente donc aujourd’hui comme un véritable « marché aux langues » (Calvet, 2002), un véritable laboratoire linguistique. Et, « du fait d’une concentration progressive de la population d’origines variées, un plurilinguisme de contact apparaît, se transmet et se développe en ville » (Juillard, C., 2007 : 236).
En effet, comme la plupart des villes de la Casamance naturelle (Kolda, Sédhiou, Ziguinchor…), Goudomp est une ville plurilingue. On y dénombre 13 ethnies[5] correspondant aux 13 langues qui y sont pratiquées[6]. De là, nous pouvons légitimement nous demander qu’est-ce qui se passe au quotidien lorsque ces gens de différentes premières langues se rencontrent ? A quelle(s) langue(s) vont-ils recourir pour communiquer ? Telles sont entre autres questions que nous allons tenter d’apporter une réponse ci-dessous. Avant de répondre à ces questions, voyons d’abord qui sont les Mancagnes.
I.3. Le peuple mancagne
Tout comme la plupart des populations vivant dans la région naturelle de la Casamance (les balantes nagas, les pépèles, les manjacks, …), les mancagne de la commune de Goudomp sont originaires de la zone connue aujourd’hui sous le nom de la République de Guinée Bissau (Trincaz, J., 1979 ; Juillard, C., 1995, Dreyfus, M. & Juillard, C., 2004). Venant principalement des régions de Bula et de Cô (en Guinée Bissau) ; ils fondèrent plusieurs villages le long de la frontière entre ces deux pays et parmi lesquels on peut mentionner Akintou, Bindaba, Bantancountou, Kaneupar, Unjiw, St-Paul, etc.).
Les raisons de cette émigration furent principalement économiques. En effet, selon Trincaz (1981, 211) : « économiquement, l’essor de la culture de l’arachide en Casamance attira ces populations acharnées à la tâche et à qui le territoire de Guinée, relié à une métropole pauvre était incapable d’offrir des débouchés suffisants ». Et citant Amilcar Cabral, l’auteur nous informe que pour cette raison, « […] des milliers de paysans abandonnent leurs foyers et cherchent dans les pays voisins la paix et les moyens indispensables à leur entretien. C’est ainsi que les Balantes entrent en République de Guinée, tandis que les cultivateurs d’arachide (Mancagne, Pépèle et Manjacks) s’installent en République du Sénégal » (ibid).
Cette idée se trouve ici renforcée davantage par celle de Pélissier cité par Trincaz lorsqu’il déclare que : « c’est paradoxalement la fixation artificielle d’une frontière politique entre zones d’influences française et portugaise qui est à l’origine de ces mouvements. Cette frontière a créé entre des populations naguère dotées des mêmes ressources et vivant dans un climat humain comparable, des déséquilibres qui expliquent son franchissement par des effectifs croissant de travailleurs originaires de la Guinée Bissau ». (1981 :210)
Après la deuxième guerre mondiale, l’immigration reprit vigoureusement. Mais une fois que la guerre a éclaté en Casamance sous l’impulsion du MFDC[7], ils furent obligés d’abandonner les villages installés le long de la frontière entre ces deux pays. Une bonne partie a regagné alors sa terre d’origine (Guinée Bissau) tandis que l’autre préféra se réfugier dans la plupart des villes (dont Goudomp) où il y avait plus de sécurité. Depuis lors, ils cohabitent avec plusieurs autres groupes ethnolinguistiques.
D'après les chiffres avancés par l’UNESCO dans son rapport de 2002, leur population totale était de 68 955 personnes, dont 40 855 en Guinée-Bissau et 26 450 au Sénégal. A Goudomp, ils représentent moins de 10% de la population totale. Cette situation de minorité est l’une des raisons qui vont les pousser à créer une association dénommée Pkumel[8] et dont le but premier est de lutter pour la survie de la langue, principal véhicule de la culture du groupe.
II. Méthodologie d’enquête
L’enquête sur le comportement langagier de la communauté mancagne de Goudomp a été conduite en deux temps distincts mais à la fois complémentaires. Basée sur la méthode ethnographique à visée qualitative, nous avons d’abord procédé au recueil, in situ, de la parole dans différentes situations de communication avant de passer ensuite à des entretiens semi-directifs. L’objectif ici est de cerner le processus d’identification et de différenciation repérable à la fois dans les comportements langagiers et les discours de ce peuple sur leur expérience vécue du contact de langues dans cet environnement pluriel.
II.1. L’observation participante
Malgré le fait d’être membre de la communauté étudiée, nous étions convaincu que le temps passé en France faisait de nous un « étranger goudompois[9] ». Nous n’étions plus le même fils ou neveu qu’on n’a vu naître et grandir, ni moins ce frère, cousin ou simple ami d’enfance avec qui on a eu à partager aussi bien des moments de joie que de peine. Dès lors, l’« accès au terrain »[10] (Ndecky, à paraître) devenait un impératif pour nous. Et, la réponse affirmative que nous apportions aux invitations à déjeuner ici et là était pour nous une manière de réintégrer à nouveau nos anciens réseaux et profiter de la même occasion pour accéder à la « parole vive », c’est-à-dire le discours de tous les jours. Les données recueillies sont enregistrées dans différentes situations de communication allant du partage du repas familial aux discussions ouvertes sur des thèmes variés et avec des personnes de tout âge. Au final sur les seize (16) discussions enregistrées, nous avons finalement retenu douze (12) d’une longueur moyenne d’une heure et trente minutes (1h30), soit dix-huit (18) heures au totale.
II.2. L’entretien
De type semi-directif, l’objectif de l’entretien est de nous permettre de comprendre les attitudes et représentations de ce peuple mancagne. En d’autre termes, le but ici est de comprendre la façon dont les locuteurs de ce groupe catégorisent et se représentent leur propre langue et pratiques qu’ils en font. Il s’est agi donc, dans cette enquête, de vérifier l’hypothèse selon laquelle les Mancagnes de cette ville sont partagée par la peur de voir un jour leur langue disparaître et la nécessité de ne pas se sentir « étrangers » dans la ville en restant des « polyglottes accomplis ». Un guide structuré en trois principaux points correspondant aux objectifs visés (représentations, usage quotidien de la langue et biographie du répondant) avait été élaboré à l’avance. Toutes les questions ont été mémorisées, ce qui fait que l’interview était finalement une simple conversation. Au nombre de vingt-quatre (24) personnes, nous avons finalement retenu dix-huit (18), soit six (6) femmes et douze (12) hommes. Leur âge varie entre dix-sept (17) à soixante-seize (76) ans. Chaque entretien a duré en moyenne quarante (40) minutes, ce qui nous fait un total de douze (12) heures. L’analyse de ces données collectées nous permet de voir davantage l’ambivalence de la situation dans laquelle vit ce peuple.
III. De l’ambivalence dans le vécu quotidien
Certains chercheurs s’intéressant au comportement langagier des minorités linguistiques ont montré que dans les milieux de fort brassage ethnolinguistique, « relations between groups do not occur in a vacuum but rather are influenced by a range of sociostructural and situational factors that can fundamentally affect the nature and the quality of intergroup contact between speakers of contrasting ethnolinguistic groups » (Bourhis et al, 1994 :167). Mieux encore, poursuivent Bourhis et al. « Being a member of disparaged low-status linguistic group can take its toll on the collective will of members to survive or maintain themselves as a distinctive linguistic community in the intergroup structure » (1994 :170). Dès lors, nous comprenons l’ambivalence de la situation dans laquelle vivent les Mancagne de cette ville. Situés entre deux pôles, ils se voient obligés de mener, à longueur de journée, une rude bataille qui pourrait se résumer en ces deux termes contraires : fermeture (pour sauver leur langue) et ouverture (aux autres langues par leur maîtrise).
Dans une telle situation, les langues sont mises en avant car elles sont loin d’être considérées par ceux qui les parlent comme de simples instruments de communication devant permettre la rencontre et l’échange entre individus. Bien au contraire, elles sont souvent utilisées (surtout dans des situations de fortes tensions/conflits linguistiques) comme des instruments permettant de briser la communication entre des groupes de personnes qui avaient pendant longtemps su gérer les différences linguistiques. Nous voyons donc là que la notion de frontière est au cœur du problème : où finit le même, où commence le différent ? Comment le discours sur la langue permet-il d’intérioriser le rapport à sa langue ainsi qu’à sa propre pratique de ladite langue ? Comment tout cela se traduit-il dans leur parler ? A ces questions, Sériot nous répond que les positionnements subjectifs nous permettent « […] de comprendre en quoi le discours sur la langue pouvait être une voie d’accès à des mouvements d’opinion et des sensibilités très profondément ancrées, non pas dans une ‘mentalité’, mais dans des circonstances historiques et géographiques particulières, dans des luttes d’idées spécifiques », (2010 :15).
III.1. Lorsque s’identifier à « sa langue » devient la norme
Aujourd’hui, même si on pourrait remonter à des dates beaucoup plus anciennes[11], nous souhaiterions ici partir de l’année 2001 pour rendre compte de ce que nous appelons désormais le réveil de la conscience linguistique[12] des « minorités » sénégalaises. Rappelons que jusqu’en janvier 2001 et, en plus du français utilisé comme langue officielle, seules six (6) langues locales[13] étaient encore reconnues par la Constitution sénégalaise ; ce qui leur donnait ainsi le statut de langues nationales du Sénégal. Mais lorsque Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir en mars 2000, il a fait adopter en janvier 2001 par voie référendaire une nouvelle Constitution qui stipule dans son article n°1 que « La langue officielle de la république du Sénégal est le français. Les langues nationales sont le diola, le malinké, le peul, le sérère, le soninké, le wolof et[14] toute autre langue nationale qui sera codifiée ».
L’occasion fut donc donnée aux autres groupes sociaux comme les mancagnes et dont la langue n’a pas encore jusqu’ici été codifiée de voir leur langue obtenir un jour le statut de langue nationale. C’est ainsi que regroupés autour de l’association Pkumel, les Mancagne codifieront leur langue deux mois plus tard ; c’est-à-dire en mars 2001 comme huitième langue nationales après le balante. Aujourd’hui, on est passé de six (6) à vingt-et-une (21) langues ayant le statut de langues nationales du Sénégal. Or nous savons tous qu’« à partir du moment où une langue a un nom [donc codifiée][15], elle devient un objet homogène, non plus un ensemble dans un diasystème, mais un objet de politique linguistique, d’éducation, enjeu de la constitution d’un Etat-nation. Elle devient aussi, et surtout, objet de discours, qu’il est si facile de confondre avec un objet du monde » (Sériot, 1997 :167). Codifier ou donner un nom à une langue revient finalement à faire exister une réalité qui n’était pas auparavant. En d’autres termes, cela signifie homogénéiser, clôturer un ensemble de réseaux ou d’éléments à l’origine en relation les uns aux autres de manière hétérogène. Alors, si nous partons de l’idée que « […] les langues ne sont pas des choses, mais bien des objets de passion aux frontières aussi multiples et mouvantes que la quantité de discours qu’elles engendrent ; si l’on admet par ailleurs que leurs définitions procèdent parfois de l’expression du fantasme et des représentations propres à générer de la souffrance identitaire […], il nous faut questionner avec soin les catégories de discours que nous employons à leur sujet. », (Préface de Symaniec, dans Sériot, 2010 :11). C’est ce que nous allons voir dans les pages qui suivent.
III.2. Quand nommer « c’est instituer socialement »
La codification de la langue mancagne lui donne désormais un nom reconnu par l’Etat du Sénégal. Or, comme nous le rappelle Canut (2001 :446), « les noms, d’où qu’ils viennent dans le champ social, sont créés pour instituer, légitimer soit une volonté politique (langue nationale à imposer), soit une réalité linguistique occultée (langues exclues du domaine publique et non reconnues par les politiques) ». Et cela ne va jamais sans conséquences lesquelles pouvant se situer d’une part, au niveau des représentations et d’autre part, au niveau des pratiques langagières. Examinons cet extrait tiré du corpus. A la question de savoir ce que pense le locuteur du mancagne parlé à Goudomp, il nous répond ceci :
15[16] R: hum ? ah ! uhula ici à Goudomp + uŋkita kahoţ +
Comment ? ah ! le mancagne ici à Goudomp + il n’est pas mauvais +
16 uŋkita kahoţ ţi Goudomp ţi + uhula uŋkita kahoţ ţi Goudomp +
il n’est pas mauvais ici à Gpudomp + le mancagne n’est pas mauvais à
Goudomp +
17 pabia iyale katoh ki iyaŋ ţi Goudomp ţi + on parle mancagne +
parce que dans n’importe quelle maison ici à Goudomp + on parle mancagne+
18 baţini uhula et la force de + de la communauté mancagne est que +
on parlent mancagne et la force de + de la communauté mancagne est que +
19 nous parlons mancagne ++ mais ŋëpënle ţuŋ bëlay ţuŋ +
nous parlons mancagne ++ une fois sortis de la cours de maison +
20 ŋëţini uţup wi bukundi bankaţiniŋ +
nous parlons la langue que parlent les autres +
Nous avons ici une belle illustration du phénomène de représentation que le locuteur a lui-même de la langue qu’il parle dans ce milieu pluriel. On perçoit vite (lignes 15 & 16) et à travers les trois négations successives (« le mancagne n’est pas mauvais ici ») que, pour ce témoin, sa langue « vit » bien à Goudomp malgré la position de minorité ethnolinguistique que constitue son groupe social. L’usage généralisé du mancagne au sein de la famille semble être la norme. Et c’est d’ailleurs ce qui explique l’affirmation que fait Juillard (1995) dans son analyse de l’évolution des répertoires des mancagne et manjaque de la ville de Ziguinchor. En effet, parlant du maintien de la langue première de ces deux groupes, cette chercheuse avoue que cela peut être vu comme « un fait particulièrement significatif de la résistance et de l’homogénéité de ces deux groupes » (p.79). Poursuivant son idée, elle nous informe que « les Mancagnes sont les plus résistants. Leur tendance au cloisonnement provient de l’attachement qu’ils ont aux valeurs et cultes ancestraux lesquels répondant à une conception non hiérarchique des fétiches : chacun a son fétiche familial pour faire face à ses angoisses » (p.70). Il n’est donc pas question d’accepter qu’une autre langue vienne troubler cet ordre au sein de la sphère familiale. Mais conscient que « sa » langue est réservée au milieu familial, le Mancagne s’adapte tout de suite au monde extérieur (Lignes 19 et 20). Cette ouverture est peut-être l’une des raisons qui font qu’ils font partie des plus polyglottes[17] de la ville.
Mais qu’en est-il alors des pratiques réelles ? Reflètent-elles vraiment le discours tenu par le locuteur aussi bien sur sa propre pratique de la langue que sur la langue elle-même ? Dans la section qui suit, notre objectif sera d’analyser la mise en scène pratique de la « parole vive » de ces mêmes locuteurs telle qu’elle est actualisée dans différentes situations de communication quotidienne.
III.3. Quand le dire n’est pas ce qui est réellement
La plupart des recherches portant sur le contact de langues (Weinreich, 1953 ; Labov, 1966 ; Milroy, 1980 ; Gumperz, 1982 ; Scotton, 1993, etc.) ont tenté de montrer que dès que deux ou plusieurs langues sont en contact, il y a influence réciproque donnant ainsi plusieurs phénomènes dont les emprunts, l’alternance de code, etc. Mais la récente fréquentation des milieux fortement plurilingue (le terrain africain par exemple) a amené certains chercheurs (Canut, 2001 ; Dreyfus & Juillard, 2004 ; Juillard 2007 ; etc.) à remettre en cause cette notion de contact de langues. Pour Canut (2001), « l’expression même de ‘langues en contact’ (opposée à ‘langues sans contact’ ?) est ambigüe. Elle suppose des systèmes homogènes coupés de la réalité des pratiques langagières mouvantes » (p. 452). Se basant sur le caractère plastique, fluctuant et à la fois mouvant de la parole du locuteur, Canut cherche là à nous démontrer que c’est un phénomène difficile à appréhender. Et partant de là, on s’aperçoit aussitôt que les notions de « la langue, identité ethnique ou culturelle » se voient vite inopérantes.
Pour s’en convaincre, examinons cet extrait d’une discussion entre un reporter de la radio Pkumel fm et son chef des programmes. La discussion porte sur une liaison téléphonique qu’ils souhaiteraient faire afin de permettre aux auditeurs de suivre la messe du pèlerinage annuel à travers les ondes de la radio. Les conventions de transcription restent les mêmes que celles utilisées ci-dessus.
25 R : parce que normalement + wol ŋë ŧaar la ame damëţën dan +
parce que normalement + si nous l’avions su un peu plus tôt +
26 c’est au ni + au niveau de la SONATEL + c’est facile +
c’est au ni + au niveau de la SONATEL + c’est facile +
27 D : heureusement aujourd’hui + ţi pëşe comme ça que +
heureusement aujourd’hui + c’est en essayant comme ça que +
28 bajakin + désolé connexion impossible
on m’a dit + désolé connexion impossible
29 avec ces gens-là + donc + ëh + aujourd’hui +
avec ces gens-là + donc + euh + aujourd’hui +
30 R : c’est des bandits + c’est des bandits + sinon inme nţa do vendredi
C’est des bandits + c’est des bandits + sinon tu sais aujourd’hui c’est vendredi
31 vendredi + faan do vendredi + samedi + c’est le week end…
vendredi + demain c’est vendredi + samedi + c’est le week end…
Il est difficile voire impossible dans cet extrait, de dire en quelle langue exactement se tient l’échange entre les deux locuteurs. En d’autres termes, « the point is that there is no monolingual ‘area of security’ to which we linguists can turn in order to describe and make sense of these bilingual data » (Auer, 2007 :325). Le corpus est structuré de telle sorte qu’il est difficile de vouloir partir d’une des langues en présence pour déterminer ce qu’on appellerait « langue matrice » afin de rendre compte de ce phénomène. C’est ce qui amène Canut à affirmer que « la dynamique linguistique observable en ville tout comme dans les villages se constitue par une multitude d’agencements, de formes qui s’entremêlent, se croisent, se transforment jour après jour » (2007 :24). Voilà pourquoi, « lors du moindre déplacement, la rencontre avec autrui implique la rencontre avec d’autres expériences de la parole, plus ou moins éloignées de la sienne […] » (ibid).
Faisons-nous face à un mélange de langues ou un parler type qui serait celui des personnes vivant dans un milieu urbain, c’est-à-dire les Paroles de ville ? Ou au contraire, fait-on face au changement ou évolution de la langue mancagne ? Selon Calvet (1994 :13), tout ceci n’est rien d’autre que « […] le résultat d’un foisonnement d’innovations dont certaines vont rester dans la langue et d’autres seront abandonnées ». Dès lors peut-on/doit-on, dans un tel contexte, parler du bon ou mauvais mancagne ? En effet, dans des milieux pluriels et à fortes tensions linguistiques comme c’est le cas ici, les occupations quotidiennes, le déplacement d’une maison ou d’un quartier à un autre « font de la variation langagière une expérience d’une grande banalité : au mouvement du corps est littéralement associé le mouvement du langage » (Canut, 2007 :26). Alors, que reste-t-il de cette « objet langue » et à travers laquelle s’identifie la communauté mancagne de Goudomp?
Loin d’être une chose dont le chercheur en Sciences du Langage serait à mesure de saisir les contours, le parler pluriel (ou parler des villes) pourrait être vu comme un simple « entrelacs de paroles et de discours qui, au bout du compte, conduisent à la mise en cause de notions fondatrices de la linguistique telles que celles de la langue ou du système », (Canut, op.cit :22). A partir de là, nous pouvons définir le parler pluriel non plus comme un mélange de langues mais comme étant l’ensemble des connaissances éparses acquises puis intériorisées par tout locuteur, et qu’il ne fait qu’actualiser selon la situation de communication, le thème sur lequel porte son discours ou encore la personne à qui il fait face.
Cela revient donc à dire, en d’autres termes, que l’expérience de la parole plurielle ne résulte pas d’une accumulation de langues au sein d’un parcours dans l’espace et le temps. Bien au contraire, elle semble plutôt surgir dans la spontanéité de l’expérience du langage.
Conclusion
Nous avons essayé dans ce texte de montrer comment mener une étude sociolinguistique sur le comportement langagier d’une minorité vivant dans un milieu plurilingue n’est pas facile. Pour cela, le chercheur se doit, afin de bien cerner son objet d’étude, de tenir compte des deux principales choses que sont : les discours que les locuteurs ont sur leurs propres pratiques de la langue et les pratiques réelles qu’ils en font. Le travail de mise en opposition entre les représentations linguistiques (discours sur la langue encore appelés discours épilinguistiques) et l’actualisation concrète de la parole du locuteur (parole vive) est dû au fait que nous restons convaincus que si l’usage de la langue n’existe pas sans les représentations que le locuteur en fait, l’interaction entre ces deux niveaux reste ou constitue un ensemble lié, indissociable. Voilà pourquoi l'appréhension des seules marques de subjectivité (l’analyse des discours épilinguistiques) ne doit pas donner lieu à des interprétations ou conclusions générales. Bien au contraire, elles (ces marques de subjectivité) restent des métaphores révélatrices des fluctuations intersubjectives qui ressortent de l'activité individuelle. Ainsi, seule leur mise en rapport entre les deux pôles nous a permis d’avoir une vue d’ensemble sur comment le mancagne est aujourd’hui utilisé à Goudomp.
En même temps, ce constat nous a permis de comprendre que, loin d’être une chose dont le chercheur en Sciences du Langage serait à mesure de saisir les contours, le parler pluriel du langage pourrait être vu comme un simple « entrelacs de paroles et de discours ».
Références bibliographiques
ACHDEV, Itesh & BOURHIS, Richard Yves. « Multilingual Communication », in ROBINSON, Peter W. & HOWARD, Giles (Eds), The New Handbook of Language and Social Psychology. California: California University Press, 2001.
AUER, Peter, « The monolingual bias in bilingualism research, or: why bilingual talk is (still) a challenge for linguistics? », in HELLER, Monica (Eds.). Bilingualism: A Social Approach. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
BOUKOUS Ahmed. « Le questionnaire » in CALVET Louis-Jean & DUMONT Pierre (dirs), 1999, L’enquête sociolinguistique. Paris: L’Harmattan, 1999.
BOURHIS, Richard Y., HOWARD, Giles & HOWARD, Jake (1994). « The genesis of vitality theory: historical patterns and discoursal dimensions », in International Journal of the Sociology of Language, in REAL, Allard & LANDRY, Rodrigue (Eds). Berlin – New York : Mouton de Gruyter, n°108, 167-206.
CALVET, Louis-Jean. Les voix de la ville. Introduction à la sociolinguistique urbaine. Paris : Payot, 1994.
CALVET, Louis-Jean. Le marché aux langues. Les effets linguistiques de la mondialisation. Paris : Plon, 2002.
CANUT, Cécile. « A la frontière des langues », in Cahiers d’Etudes Africaines, 163-164, XLI-3-4, 2001, pp. 443-463.
CANUT, Cécile. Une langue sans qualité. Limoges : Lambert-Lucas, 2007.
CANUT, Cécile. Le spectre identitaire : entre langue et pouvoir au Mali. Limoge : Lambert-Lucas, 2008.
DREYFUS, Martine & JUILLARD, Caroline (2004). Le plurilinguisme au Sénégal. Langues et identités en devenir. Paris : Karthala.
GUMPERZ, John J. Discourse Strategies. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
JUILLARD, Caroline. La vie des langues à Ziguinchor, Sociolinguistique urbaine. Paris : Presses du CNRS, 1995.
JUILLARD, Caroline. « Le plurilinguisme, objet de la sociolinguistique descriptive », Langage et société, 3-4, n°121/122, 2007, pp. 235-245
JULLARD, Caroline. « L’évolution des répertoires linguistiques des minorités ethniques en milieu urbain : les Manjacks et Mancagnes de Ziguinchor », in Sciences et Techniques du Langage, n°1, février 1995, pp. 65-90.
LABOV, William. The social stratification of English in New York City. Washington: Center for Applied Linguistics, 1966.
MILROY, Lesley. Language and social networks. London : University Park Press, 1980.
MONDADA Lorenza, 2000, Décrire la ville. La construction des savoirs urbains dans l’interaction et dans le texte. Paris: Economica, 2000.
MYERS-SCOTTON, Carol. Social Motivations for Code-switching, Evidence from Africa. Oxford : Clarendon Press, 1993.
NDECKY Albinou. Pratiques et representations des parlers mancagnes de Goudomp. Thèse de doctorat de l’Université de Picardie Jules Verne d’Amiens, octobre 2011.
NDECKY Albinou. « Enquêter dans un milieu de fortes « tensions linguistiques » : le chercheur au centre du processus de collecte des données ? », in LEONARD Jean Léo (Eds), à paraître.
SERIOT Patrick. « Faut-il que les langues aient un nom ? » in Andrée TABOURET-KELLER (Dir.). Le nom des langues, Vol. II. Montpellier : Presses de l’université de Montpellier, 1997, pp.167-190.
SERIOT, Patrick. Les langues ne sont pas des choses. Discours sur la langue et souffrance identitaire en Europe centrale et orientale. Paris : Petra, 2010.
TRINCAZ, Jacqueline. Colonisation et religion en Afrique noire, l’exemple de Ziguinchor. Paris : L’Harmattan, 1981.
TRINCAZ, Pierre-Xavier. Colonisation et régionalisme, Ziguinchor en Casamance. Paris : ORSTOM, 1984.
* Université Gaston Berger de Saint-Louis
[1] Précisons ici que le fleuve doit son nom à cette partie sud de la République du Sénégal connue sous le nom de la Région Naturelle de Casamance. Formée d’une seule région après l’indépendance du Sénégal en 1960, la Casamance sera divisée à partir de 1984 en deux régions administratives que sont Kolda et Ziguinchor. A partir de mai 2007, la région de Kolda se verra à nouveau scindée en deux autres régions administratives ; à savoir Kolda et Sédhiou.
[2] cf: Rapport UNICEF de 2012, p. 213.
[3] Ndecky, A., Pratiques et représentations des parlers mancagnes de Goudomp (Sénégal), thèse de doctorat unique de l’Université de Picardi Jules Verne d’Amiens, 2011, p. 42.
[4] La commune est à une distance de 50 km de Ziguinchor, 135 km de Kolda sur la route nationale N°6, à 50 km de Sédhiou et seulement à 11km de la frontière avec la Guinée Bissau (soit moins de 20km de Ingoré, ville située au nord de la Guinée).
[5] Notre objet n’est pas ici de discuter cette notion d’ « ethnie ». Nous voudrions tout simplement rappeler que même si certains chercheurs occidentaux (Poutignat, P. et al. [1995], 2005 ; Amselle, J.-L., 1999 ; 2001 ; etc.), ont beaucoup théorisé sur cette question d’ethnie en essayant de remettre en cause sa validité, la plupart des peuples africains que nous connaissons, les mancagnes plus précisément, continuent encore de s’identifier à travers cet ensemble autour duquel chaque membre du groupe se retrouve et qu’ils appellent « l’ethnie mancagne ».
[6] baïnounk, balante mané, balante naga, créole portugais, diola, mancagne, mandingue, manjaque, mansoké, peul, soussou, toucouleur et wolof.
[7] Le MFDC signifie Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance. Le conflit a commencé en décembre 1982, mais c’est dix ans après (début des années 90) que les régions administratives de Sédhiou et de Kolda ont été affectées.
[8] Il est difficile aujourd’hui de parler de la communauté mancagne sans mentionner le rôle de l’association Pkumel. Le terme mancagne Pkumel désigne ce piquet qui, planté au milieu de la case, sert de support à la toiture. Nom donné à l’association regroupant tous les Mancagnes où qu’ils soient, Pkumel se présente donc comme une source où les mancagne de tout bord peuvent aller se ressourcer. Créée à Ziguinchor en décembre 1993, Pkumel va très tôt implanter ses bases à Goudomp. Elle se fixa donc comme objectifs premiers la revalorisation de la langue et la culture mancagne. Cela conduira plus tard à la codification de la langue mancagne (en mars 2002) et l’implantation à Goudomp d’une station radio (Pkumel fm) en septembre 2007.
[9] A notre arrivée pour les besoins de l’enquête de terrain, nous étions à la fois étranger et goudompois. Etranger parce que les relations n’étaient plus les mêmes que celles qui nous liaient à notre communauté avant notre départ pour la France. Mais malgré la présence de cette petite distance qui nous séparait, nous restions tout de même un goudompois à part entière puisque nous pouvions entrer dans n’importe quelle maison, y manger et prendre le temps de discuter avec les membres de la famille comme nous l’avons toujours fait, participer à toutes les activités des jeunes de notre âge… En somme, rien ne nous empêchait d’aller vers l’autre et de coopérer avec lui/elle.
[10] Nous entends par « accès au terrain » la période de deux semaines qui a précédé le début de notre enquête et que nous avons consacrée à la réintégration de nos différents réseaux de connaissance au sein de la communauté mancagne de cette ville.
[11] Vu le nombre limité de pages dont nous disposons, il nous est impossible de retracer ici l’histoire des politiques linguistique du Sénégal. Nous nous contentons tout simplement de synthétiser en disant que trois phases correspondant aux trois Présidents qui se sont succédé à la tête de l’Etat sénégalais peuvent être distinguées. Ainsi, de 1960 à 1980 L. S. Senghor n’acceptera jamais qu’on lui parle de l’introduction d’une quelconque langue nationale comme médium d’instruction au Sénégal. Il exposa sa vision des choses dans le décret de 1971 comme suit : « […] remplacer le français, comme langue officielle et comme langue d'enseignement, n'est ni souhaitable, ni possible. Si du moins nous ne voulons pas être en retard au rendez-vous de l'An 2000… ». Abdou Diouf (1980-2000), sous la pression de la Société Civile, initiera en janvier 1981 ce qu’on appela les classes expérimentales. Mais comme les moyens n’ont pas suivi cette volonté, on finira par renoncer à cette politique. Abdoulaye Wade (2000 à aujourd’hui), crée, dès son arrivée au pouvoir des classes pilotes dans chaque région où les langues nationales sont utilisées comme médium d’instruction.
[12] Nous faisons ici écho à notre travail de thèse intitulé « Pratiques et représentations des parlers mancagnes de Goudomp (Sénégal) », soutenue le 18/10/2011 à l’Université de Picardie Jules Verne d’Amiens.
[13] Il s’agit du wolof, du sérère, du mandingue, du peul, du diola et du soninké.
[14] L’italique est de notre fait.
[15] Les crochets et italiques sont de notre fait.
[16] Les conventions de transcription sont les suivantes : pause simple (+), pause longue (++), interrogation ( ?), exclamation ( !), transcription du mancagne (en caractères normaux) et la traduction en français (en italique).
[17] Le moins polyglotte de mes témoins parle quatre (4) langue et le plus polyglotte douze (12)
![]() Télécharger l’article en version PDF
Télécharger l’article en version PDF
Résumé
L’existence de la ville est liée à celle de la parole. Ainsi, la parole et les interactions verbales, produites à divers lieux urbains, construisent la ville, de même que les identités et les postures des uns et des autres en tant qu’habitants. La ville est le véhicule privilégié des cultures collectives ou à imposer, des produits de consommations à faire accepter, ainsi que de toutes les valeurs ou antivaleurs venant d’horizons divers et entretenues à travers les canaux de la communication et de la publicité. Les discours de la ville, à savoir les divers énoncés détachés ou non, les slogans, les déclarations politiques, institutionnelles ou religieuses, ont un pouvoir constructiviste. La ville apparaît comme l’espace propice qui les rend efficaces. Cet article cherche à montrer comment se fait cette construction discursive au sein de la ville.
Mots clés : discours, énonciation, formule, identité, positionnement, interdiscours
La ville est consubstantielle à la parole, c’est-à-dire aux différents discours qui y sont produits. Véhicule privilégié des cultures collectives ou à imposer, des produits de consommations à faire accepter ainsi que de toutes les valeurs ou antivaleurs venant d’horizons divers et entretenues à travers les canaux de communication, la ville apparaît comme l’espace de leur fabrication par le truchement du discours mais également de l’interdiscours. En ce sens, Claudine Moïse affirme : « La réalité sociale naît et se construit par les discours et dans l’interaction. »[1]
Nous savons que le langage à plusieurs fonctions que la linguistique a définies (Roman Jakobson, Halliday, etc.). Mieux, les mots ont un pouvoir, selon la linguistique pragmatique, ainsi que celle de l’énonciation plaçant les activités du sujet parlant et du récepteur du message au cœur de la production-réception verbale. Ils ont la capacité de faire agir autrui engagé dans une interaction, de servir d’intermédiaire ou de relation entre les individus, mais surtout ils ont un pouvoir constructiviste, celui de forger diverses images, postures, etc. La parole permet de produire des actions qui, concrètement, organisent et structurent la réalité et la vie sociale.
Suivant une perspective discursive et interactionnelle, au sein de la ville, la parole sert à fabriquer les valeurs communes et les postures identitaires. En effet, en tant que lieu délimité et organisé dans l’espace, la ville où se concentrent des personnes, ne peut se concevoir sans la parole individuelle ou collective. Pour être en relation avec l’autre, le voisin ou simplement l’inconnu rencontré, il faut lui adresser la parole, interagir avec lui. Notre réflexion nous permettra de montrer comment les positionnements, les identités, et les différentes valeurs souhaitées ou non sont construites en ville au moyen du discours. Nous nous appuierons sur un corpus de productions verbales diverses, des mots et des phrases, mais également des expressions, recueillis à partir d’espaces typiquement urbains. Ces formes langagières comportent une visée explicite ou cachée qui dit la ville et forge les cultures dans le contexte du « vivre ensemble » que constitue la ville, stigmatisant les uns, imposant des idées, poussant à telle ou telle action, etc. Nous les analyserons en recourant aux énoncés verbaux ou écrits produits au sein de la ville, d’où émergent des croyances, des dispositions intellectuelles et des identités propres au citadin. Cette étude ne porte donc pas sur la langue elle-même en milieu urbain, travail que d’éminents sociolinguistes ont déjà fait, mais plutôt, sur les discours, sur ce que les paroles orales ou écrites, ainsi que les situations d’interactions disent sur la ville. Elle cherche à analyser, en s’appuyant sur les pratiques langagières, les processus sociaux à l’œuvre, la catégorisation urbaine, la perception de l’autre, la construction verbale des identités.
I. Production de discours et autorité de la parole urbaine
Le terme de discours peut être compris suivant plusieurs acceptions (sur lesquelles nous ne reviendrons pas dans cet article). Dans le cadre d’une analyse des productions verbales urbaines, nous retiendrons l’acception selon laquelle le discours est l’activité verbale de sujets inscrits dans différents « contextes mondains »[2] au sein de la ville, produisant des énoncés d’un autre ordre que celui de la phrase. Le discours urbain est produit dans un contexte d’énonciation déterminé (la ville dans notre étude), et en interaction. Notre approche des discours de la ville s’appuie sur l’idée que tout discours est pris dans un interdiscours[3]. En d’autres termes, le discours « […] ne prend sens qu’à l’intérieur d’un univers d’autres discours à travers lequel il doit se frayer un chemin. Pour interpréter le moindre énoncé, il faut le mettre en relation avec toutes sortes d’autres. »[4] Ce point de vue rencontre celui de Bakhtine pointant, depuis longtemps, le caractère non homogène de tout énoncé à travers les concepts de polyphonie et de dialogisme. Cependant, nous ne nous limitons pas, ici, à l’analyse des seuls énoncés au-delà de la phrase, qui sont produits au sein de la ville soit en interaction soit en discours monologal, nous considérons également les mots-énoncés ou expressions-énoncés produits verbalement ou inscrits çà et là dans l’espace urbain, tels que les formules au sens de Krieg-Planque[5] (slogan, écriture d’affiche ou d’enseigne, etc.), les « phrases sans texte »[6] ou détachées au sens de Dominique Maingueneau (2012). Autant de petits énoncés que l’on rencontre un peu partout en ville, sur les voitures, les magasins commerciaux, les journaux de presse, les affiches publicitaires, les pancartes, etc. La notion de « formule », selon Krieg-Planque[7], signifie un ensemble de formulations qui, du fait de leurs emplois à un moment donné et dans un espace public donné, cristallisent des enjeux politiques et sociaux que ces formulations contribuent dans le même temps à construire. Plus exactement, elle en donne la définition suivante :
Le terme « formule » arrive avec son acception journaliste quelque peu péjorative : un énoncé concis, supposé porteur d’effet, souvent prononcé à des fins provocatrices ou polémiques, voire démagogiques, et susceptible d’être mémorisé donc reproduit, cité. Le terme « formule » arrive enfin avec une multitude d’acceptions circonscrites : la formule sera un énoncé joliment tourné et apte à retenir l’attention ; elle sera un adage, un proverbe, un dicton, une sentence […].[8]
Le corpus d’énoncés est ainsi composé de cet ensemble de discours produits au sein de la ville, de « phrases sans texte », de « formules » et parfois d’unités linguistiques transphrastiques ayant la forme d’un texte homogène.
L’énonciation même (ou les théories de l’énonciation) s’est élaborée avec la notion d’espace. Elle renvoie à un sujet parlant situé dans un lieu qu’indexent des déictiques qui le décrivent. Et ce sujet s’adresse à un « tu » interlocuteur au sein du même lieu. L’espace urbain n’échappe pas à la règle ; au contraire, il est un lieu par excellence d’énonciation, où interagissent verbalement de multiples locuteurs utilisant une multitude de langues. Les sciences du langage ont largement montré combien les catégories linguistiques permettent de structurer l’espace et donc la pensée du citadin. C’est précisément ce caractère fonctionnel, dans l’espace urbain, des productions langagières qu’étudient Mondada (2000)[9] et Barbéris (1987)[10] parlant de la « deixis spatiale ». Celle-ci est à la fois une structuration du discours et une perception même de l’espace. Elle est contrainte par l’environnement physique et par les opérations cognitives en œuvre. Les marques spatiales en discours (Klein, 1994)[11], déictiques, prépositions et adverbes locatifs, sont donc, d’une part, au centre des descriptions d’itinéraires urbains, dans leur délimitation, leur point de vue et d’autre part, de la place occupée par le locuteur dans l’espace (le « je-ici-maintenant » de l’énonciation).
L’espace urbain constitue le lieu privilégié pour légitimer le discours et lui garantir son efficacité en lui assurant une plus grande réception par un auditoire plus large. Il est le lieu où se concentrent les symboles et institutions les plus vivants d’une nation, à savoir les partis politiques, les grandes églises et mosquées, les entreprises, les universités, les grands, hôpitaux, les organes de presse, les pouvoirs exécutifs et législatifs, etc. C’est également un lieu souvent très cosmopolite où cohabitent diverses ethnies utilisant plusieurs langues en interaction et en présence d’une ou de plusieurs langues intermédiaires comme langue(s) de communication dans les échanges interindividuels les plus variés.
L’efficacité discursive varie selon l’espace d’énonciation dans lequel se trouve le locuteur : elle est plus élevée lorsqu’on parle à partir de la ville, non seulement parce que les canaux (presse écrite, radio, télévision, etc.) de la communication se trouvent souvent en ville, mais également parce que l’auditoire y est plus hétérogène et plus averti. Par exemple, une parole proférée par une personne habilitée comme celle d’un président d’une République africaine, à naturellement plus de portée lorsqu’elle est dite à partir d’un espace d’énonciation urbain très populaire comme la ville de Paris. C’est ce que font souvent les présidents africains qui veulent toucher un plus large public et créer ainsi un effet perlocutoire plus accru.
Ainsi, les différents Présidents de la République du Sénégal, depuis Léopold Senghor jusqu’à Macky Sall, en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, ont toujours préféré parler à leurs peuples et au monde entier à partir de Paris comme lieu d’énonciation, à l’occasion de leurs différents voyages. La situation discursive du locuteur, selon qu’il se trouve dans une chambre, dans un village reculé, une petite ville ou une grande ville, et selon le type de canal de la communication qu’il utilise, participe bien à rendre le discours plus efficace.
C’est à partir de la ville que se construisent les identités urbaines, que se crée la mode, que se forge l’idéologie politique ou religieuse, etc., à travers le discours qui a un pouvoir constructiviste notoire. A force de parler d’une chose, en recourant à un code langagier précis, à un espace d’énonciation donné et à des locuteurs ciblés, on finit par faire exister cette chose, en lui donnant un contenu et une forme. Le citadin se construit une identité et fabrique les institutions en produisant et en consommant des discours au sein de l’espace urbain. Ainsi, la figure du président de la République se construit par les mots : l’expression, « Monsieur le Président de la république… » à laquelle on ajoute, selon la personne, le nom de famille et le prénom, est utilisée de façon redondante et répétitive dans tous les discours des institutionnels de l’Etat à toutes les occasions officielles ou non, pour faire vivre et exister l’institution. Il en va de même de la figure des différents ministres et de toutes les identités politiques, sociales ou autres qu’il faut construire. Les paroles produites en ville, du fait de leur efficacité, constituent des discours d’autorité ; il suffit que ceux qui les énoncent soient socialement habilités à les proférer, et discursivement compétents.
II. Construction de positionnements et d’identités urbaines
Les différentes interactions verbales urbaines, ainsi que les divers énoncés transmis à partir de la ville, construisent sans cesse des positionnements et des identités. En effet, « La communication, dans l’espace public, est l’ensemble des pratiques par lesquelles s’instituent les identités dont nous sommes porteurs et qui nous permettent de nous reconnaître dans l’indistinction constitutive de la sociabilité. »[12] Ces identités sont d’ordre politique, social, culturel et professionnel et se construisent à partir d’un positionnement des acteurs, par lequel s’instaure une identité énonciative. Celle-ci se manifeste par l’emploi d’un code langagier caractéristique de l’instance énonciative. Le locuteur pointe un positionnement précis en recourant à un registre de langue donné, une variété dialectale et un genre de discours. S’inscrivant ainsi dans une idéologie, une manière d’être et de faire et en conférant à son discours une vocalité liée à un corps, le locuteur urbain construit un positionnement identifiable. En fait, la ville est découpée en plusieurs champs discursifs : le champ religieux, politique, littéraire, culturel, professionnel, etc. Au sein de chaque champ discursif le positionnement permet de dessiner les frontières entre plusieurs identités discursives. Ainsi, on peut avoir comme identité un courant dans le champ discursif littéraire, un parti politique dans le champ discursif politique, un corps de métier dans le champ discursif professionnel, etc.
II.1. Positionnement dans le champ politique urbain : images véhiculées à Dakar
Les acteurs politiques produisent divers discours à travers divers canaux de communication pour marquer leur territoire et définir leur positionnement. Ils évoluent dans des espaces d’énonciation et de regroupement, qui constituent ce qui structure une partie de l’action politique (meeting, débats, affichages de slogans, réunions, rassemblements, défilés, cérémonies, déclarations télévisuelles, etc.). Ils construisent des imaginaires d’appartenance communautaire, mais surtout au nom d’un comportement commun plus ou moins ritualisé. Leurs discours politiques s’attachent à construire des images d’acteurs et à user de stratégies de persuasion et de séduction. Cela fait dire à Marc Augé : « Qu’il soit langage du consensus ou langage de terreur, le langage politique est langage de l’identité. »[13]
Exemple :
Extrait de la déclaration à la télévision RTS/Sénégal, du Président de la République du Sénégal, Abdoulaye WADE (candidat du PDS et des Forces Alliées), lors des élections présidentielles, entre les deux tours, après sa déconvenue du 16 Février 2012.
[…] Le scrutin du 26 février confirme ainsi que notre pays reste solidement ancré dans le cercle restreint des démocraties modernes majeures et apaisées. […]
Notre pays est resté fidèle à sa réputation et nous devons tous être fiers d’avoir relevé avec bonheur tous les défis liés à l’élection.
D’abord, le défi du respect du calendrier républicain en tenant le scrutin sans changement, à date échue ;
Ensuite, le défi de la transparence et de la maîtrise du processus électoral, avec un fichier électoral contradictoirement contrôlé avec assistance internationale et offrant toutes les conditions de la fiabilité ;
Un système de contrôle commun fiable, accompagné par un mécanisme indépendant d’observation nationale et internationale,
Un défi de l’organisation, en mettant à disposition dans tous les bureaux de vote, tout le matériel électoral dans les délais requis.
Enfin, le défi de l’organisation d’un scrutin transparent, démocratique et pacifique.
Nous en sommes à présent au dépouillement au recensement des votes par les structures compétentes au niveau départemental, en attendant la publication prochaine des résultats provisoires.
Je tiens, à ce stade, à féliciter chaleureusement le Gouvernement pour avoir été à la hauteur de la tâche que je lui avais confiée : c’est-à-dire organiser un scrutin dans les meilleures conditions de transparence, de liberté et de quiétude pour les électeurs et d’égalité des candidats. […]
En même temps, je salue et je respecte les autres candidats et les compatriotes qui ont porté leurs choix sur eux. C’est là l’expression normale du pluralisme démocratique pour lequel je me suis toujours battu dans les moments difficiles que j’ai passés à l’opposition.
A tous mes militants, alliés et sympathisants, je demande de rester mobilisés parce que les tendances lourdes dégagées par le recensement qui, à l’heure actuelle porte sur 282 collectivités locales sur 551, soit la moitié, me classe en tête avec 32,17% et 25,24% pour mon suivant. Tout est donc possible : victoire ou second tour.
Dans la perspective d’un second tour, le PDS et ses Alliés dont le candidat reste en tête de la compétition vont naturellement explorer toutes les possibilités d’entente avec d’autres forces politiques, selon des modalités à convenir ensemble pour élargir notre électorat et nous assurer les conditions d’une victoire finale.
Ensemble, nous relèverons le défi. Vous avez ma confiance. Et je sais pouvoir compter sur la vôtre. […]
Ce discours du Président Wade, prononcé à Dakar, l’espace le plus urbanisé du Sénégal, a comme « scénographie »[14] une personne morale s’adressant à un groupe d’individus hétérogène composé de partisans et d’opposants, du monde diplomatique et de la diaspora sénégalaise. C’est une scène d’énonciation dont le lieu est la présidence de la république et, par extension, la ville de Dakar.
La visée illocutoire du locuteur Wade, dans ce discours, est de prononcer une annonce motivante de sa victoire finale au deuxième tour des élections présidentielles, dans le but de remobiliser ses troupes. C’est une allocution à travers laquelle le locuteur construit l’identité du futur vainqueur. Il s’agit de l’ethos du gardien consciencieux de la constitution, des lois et règlements : « Notre pays est resté fidèle à sa réputation et nous devons tous être fiers d’avoir relevé avec bonheur tous les défis liés à l’élection. »[15] A cette citation succède l’énumération de tous les défis que le Président de la république a eu le mérite d’avoir relevé. Le locuteur construit ainsi l’ethos du président de la république soucieux de la validité des élections ; c’est l’ethos du démocrate et celui du rassembleur. Il se positionne comme un président modèle, persévérant et cultivé, qui s’associe au destinataire-citoyen en recourant dans son énonciation à la première personne du pluriel, qui est inclusive : « ensemble, nous relèverons le défi.»[16] En même temps, par cette affirmation, il se montre pourvoyeur d’un rêve, exprimant la capacité à relever tous les défis sans exclusive.
On le voit, l’ethos discursif est sans cesse construit par le discours prononcé à partir de la ville, lieu privilégié d’énonciation et d’efficacité de la parole. Il lui est possible de forger cette image institutionnelle au-delà de sa personne, sa parole s’autorisant par ce que Bourdieu appelle le statut social, qui constitue selon une approche d’analyse du discours, son ethos extradiscursif. Mais en même temps, en parlant à partir de la ville et, plus exactement du palais présidentiel, il libère une image de soi à la mesure de l’idée du mérite, du démocrate et du travail bien fait, qu’il entend construire et faire accepter.
Cet ethos double, légitimé par la société sénégalaise et par sa Constitution, se trouve en interaction avec les discours d’autres politiciens situés dans l’opposition. Il s’agit, le plus souvent, de déclarations politiques, de débats télévisés, de slogans qui circulent et contredisent les discours du pouvoir ou y répondent. La ville est précisément le lieu de fabrication, de circulation et de diffusion des slogans[17] et des petites phrases de toutes sortes destinés à construire les identités.
Nous avons recueilli quelques slogans produits lors des élections présidentielles de 2012, quelques mois après l’investiture de l’actuel Président du Sénégal.
Examinons ces deux slogans complémentaires : « Contre la violation de la Constitution, Debout » et « Contre la vie chère, Debout »
Formule anonyme, le slogan a pourtant un énonciateur, le peuple, saisi globalement. Ce peuple s’adresse anonymement par le slogan au pouvoir et à ses détenteurs ou à ses détracteurs. Il intervient dans la manifestation en proférant des actes de langage. Les slogans ci-dessus équivalent aux énoncés performatifs suivants : « Nous affirmons que nous sommes debout contre la violation de la Constitution. Nous sommes debout contre la vie chère. » Ce sont des énoncés interjectifs qui ont la forme des slogans exprimant de façon percutante la révolte populaire. Leur performativité est implicite, sur le mode de la modalité assertive. Ils incitent à l’action et libèrent chez le parti politique émetteur un ethos du refus et de la révolte. Ils montrent l’identité discursive d’un parti politique en état de veille constant sur les biens publics et la garantie du coût de la vie accessible à tous les citoyens. Ils affichent la posture d’un parti politique éveilleur de conscience, et qui s’érige en gardien de la Constitution et des richesses nationales.
A côté de ces slogans, nous avons relevé d’autres comme le suivant : « ma carte, mon arme » « daas fananal » (Ce dernier slogan est une expression wolof du Sénégal qui signifie « affûter son couteau pour être prêt à se battre »). En disant « je déclare que ma carte est mon arme. », le locuteur politique montre qu’il est un citoyen averti qui connaît bien ses devoirs et ses droits. Il sait que sa carte lui permet de changer de régime politique quand il le souhaite. Le verbe « être » qui devait s’insérer entre les deux mots « carte » et « arme » fonctionne, ici, comme une ellipse provoquée volontairement pour rendre le slogan plus concis et plus percutant. C’est l’identité discursive du citoyen conscient de son pouvoir de destitution du régime politique, mais également celui du citoyen menaçant de sévir ou de sanctionner négativement, en cas de mauvaise gestion de la cité, comme dans un combat à mains armées.
Beaucoup d’autres énoncés, les uns produits par des opposants politiques, d’autres par des partisans du pouvoir en place, ont été relevés à Dakar et analysés comme des discours urbains producteurs d’images en interaction.
Ainsi, pour construire, à tort ou à raison, une identité repoussante attachée au Président de la République du Sénégal, on fait circuler beaucoup de petites formules comme «Macky Sall = Hitler », « Macky Sall = Bokassa », « non à la dynastie Faye-Sall », etc. Telle est l’intention que révèlent ces discours. Ceux qui les tiennent sont-ils légitimement habilités à les tenir ? Véhiculent-ils des images fausses ou vraies du Président de la République ? Autant de questions qu’on peut se poser ? Cependant, notre propos n’est pas de répondre à ces questions ou de chercher à donner raison ou non aux auteurs de ces énoncés. Nous ne nous préoccupons que de l’analyse discursive des énoncés, des intentions et de leurs effets pragmatiques. Les figures d’Hitler et de Bokassa déjà bien caractérisées par leur capacité de nuisance et par l’exercice de la dictature sont utilisées pour caractériser le Président de la République. Du même coup, les auteurs des énoncés, qui sont des opposants politiques, cherchent à faire passer dans l’imaginaire populaire, l’image d’un président dictateur et autoritaire. Les mots proférés à tout bout de champ fonctionnent pour construire continuellement cette mauvaise image. Telle est la visée du locuteur. Ces deux formules, «Non à une justice sélective» ou «Macky Sall milliardaire illicite » comportent la même visée illocutoire, celle de dire que Macky doit aussi être poursuivi, pour détournement de deniers publics. Le locuteur n’ignore pas que le Président ne peut pas être poursuivi aussi longtemps qu’il exerce sa fonction présidentielle, même après, sauf exceptionnellement en cas de haute trahison. Or, il sait bien qu’on est loin de ce cas de figure, comme de toutes les images négatives fabriquées à l’encontre du Président. Pourtant, son propos tend à le nier pour mieux le disqualifier et l’exposer à une poursuite judiciaire au sujet de l’enregistrement illicite. L’accusateur, le peuple opposant, qui profère les propos, construit l’image du Président illégitime quant à la poursuite contre les « biens mal acquis ». Ces slogans fonctionnent, ici, comme une stratégie politique des opposants pour construire de mauvaises images, que la ville fait circuler le mieux.
Contrairement à ces discours, d’autres locuteurs urbains, du même peuple, construisent l’image d’un Président de la République moralement exemplaire et progressiste. Parmi ces énoncés, nous avons relevé les suivants : « yoonu yokkuté» ou « la voie du développement », « ligeey sooga fab » ou « travailler pour avoir de l’argent », « jëf sooga jël » ou « paiement après service fait », etc. On le voit, ces slogans montrent une image valorisante attachée aux citoyens qui les énoncent, en l’occurrence le peuple approuvant le pouvoir et son détenteur, le Président de la République et son programme. Leurs locuteurs s’adressent au peuple tout entier, chez qui ils suscitent l’espoir d’être hissé, par le régime politique, sur la voie du développement durable. Aussi lui dit-il que le Président de la République l’exhorte à travailler pour une rémunération méritée à la suite d’un service fait. Ce slogan, « travailler pour avoir de l’argent » est formulé par opposition au laxisme, au désœuvrement, à l’enrichissement illicite et au détournement de deniers publics. On met en exergue une image du Président qui met en valeur l’éthique et la probité dans la gestion du bien public. On nous montre un Président soucieux du mieux-être du peuple et adepte du travail, source de progrès.
La ville est ainsi le lieu où circulent des énoncés, où l’on construit, à tort ou à raison, diverses images en interaction, parfois en contradiction, selon les divers positionnements des locuteurs et des interlocuteurs.
II.2. Identité de l’homme « branché » dans l’espace social urbain
Par le truchement des mots, on rencontre des énoncés à Dakar, comme « camon town » (broussard par opposition au citadin) « nandité sonnul » (l’homme branché est tranquille et avisé) « dëkk ba la joggée » (habitant de la brousse). En effet, la ville apparaît aux yeux de la population, comme le lieu de construction des comportements de références relativement à la modernité et au savoir vivre.
Il se construit en ville une culture au quotidien, dans le bruissement incessant, par divers discours. La culture considérée est comme constituée, ici, de savoirs, de pratiques, de règles, de normes, de stratégies, de valeurs, de mythes qui se transmettent par le discours de génération en génération ; elle se produit en chaque individu et, tout en entretenant la complexité sociale, donne vie au « vivre ensemble » qui caractérise la ville.
La mode est suivie à la lettre par les discours. Lieu principal de l’accumulation du capital, la ville est le point de convergence de toutes les misères. Elle est l’espace de construction de toutes les mentalités vouées à la consommation effrénée des produits du marché industriel, politique, etc. En France en 2006, la récurrence du terme « jacquerie » employé à propos des émeutes de la banlieue fait paradoxalement référence à une société rurale. Le mot « zone » témoigne également de la difficulté à exprimer la réalité sociale contemporaine. Les « zones de non droit » fréquemment évoquées dans le discours des journalistes ou des responsables politiques renvoient à des mots empruntés au vocabulaire parisien de la fin du XIXe siècle. A l’époque, la zone est une bande de terrain non constructible, frappée de servitude militaire, qui jouxte les fortifications qui entourent la capitale (fortifications érigées en 1841-1845 sous l’impulsion de Thiers). C’est un lieu d’habitat précaire et illégal. La population y est ouvrière et peu qualifiée. Dans l’imaginaire collectif, elle devient un espace mythique, peuplé de « zoniers », d’Apaches, de prostituées et de marginaux. Cette même image est d’ailleurs fournie par la littérature : de la masure du corbeau des Misérables de Victor Hugo au Jésus la Caille de Francis Carco dans les années 1920, la boucle est bouclée.
L’identité du banlieusard est construite par opposition à celle du branché de la ville. La banlieue fait peur. Cette crainte est partie intégrante d’un discours anti-urbain qui s’est affirmé dès le XIXe siècle, en France comme en Grande Bretagne. La parole urbaine est descriptible en termes de stigmatisation, de code langagier de la banlieue, de violence, de mots ou d’expressions empruntés au monde arabe, comme l’expression « intifada des banlieues », de mots violents tels que « front » utilisés par les étudiants, notamment ceux de l’université de Cheikh Anta Diop de la ville de Dakar. En somme, il y a une « banlieurisation » du discours sur la ville, phénomène qui fait du malaise des banlieues celui des villes.
Aussi la ville est-elle un espace d’écriture et de lisibilité des enseignes et des affiches, signalétiques commerciales et institutionnelles. Ces écritures participent à dire la ville, à la décrire et à transmettre toutes les informations utiles aux citadins.
II.3. Identités politiques, sociales et culturelles
Comment le citadin arrive-t-il à construire son identité par la parole en interaction ?
Tout acte de langage émane d’un sujet qui ne peut se définir que par sa relation à l’autre. Et cette relation se manifeste par un processus d’influences mutuelles, les interactions verbales, et selon un principe d’altérité (sans l’existence de l’autre, point de conscience de soi). A travers cette relation, chaque acteur urbain cherche à influencer l’autre de sorte qu’il fasse les choses ou parle selon son intention à lui, ou mieux qu’il pense comme lui.
Cependant, chacun ayant son propre projet d’influence, les interactants[18] (les deux locuteurs agissant mutuellement par la parole l’un sur l’autre) sont amenés à gérer leur relation, selon un principe de régulation guidé par les lois de la politesse linguistique. Patrick Charaudeau (2005) apporte des précisions à cette idée en disant :
Mais agir sur l’autre ne peut en rester à une simple visée de faire faire, de faire dire ou de faire penser. La visée s’accompagne d’une exigence, celle de voir l’intention suivie d’effet. Cette exigence complète la visée communicationnelle par un but d’action qui consiste à mettre l’autre dans une position d’obligation à s’exécuter, c’est-à-dire dans une relation de soumission à la position du sujet parlant.[19]
Les identités politiques (ou parfois religieuses) prennent, dans l’espace de la ville, la forme des médias et des institutions de communication et d’information qui y naissent et y sont diffusés. Si la ville est l’espace où naît la politique, c’est que c’est dans l’espace de la ville que les acteurs politiques, leurs discours, leurs modes de représentation, se confrontent les uns aux autres. L’espace urbain est l’espace où se donnent à voir les manifestations et les défilés institutionnels ou politiques (manifestations revendicatives, mais aussi manifestations de visibilité des acteurs institutionnels) qui donnent à voir les identités politiques de ceux qui en sont porteurs en les donnant à voir aux habitants. Défilés, cortèges, manifestations rituelles et protocolaires de toutes sortes donnent dans la ville une visibilité matérielle réelle aux institutions et aux acteurs politiques de la cité. L’espace de la ville est également l’espace où se diffusent et se propagent les représentations symboliques des identités politiques, en particulier sous la forme des journaux, des affiches et de toutes les inscriptions publiques, ou encore sous la forme des emblèmes (drapeaux, inscriptions diverses) qui caractérisent les édifices publics dans de la ville.
On trouve en ville des activités culturelles et des identités professionnelles : la ville se fait le siège et le lieu de visibilité des métiers, des tableaux signalétiques des boutiques, l’ « épigraphie commerciale urbaine», la publicité, etc. Les affiches publicitaires, mais aussi les différents types de publicité lumineuse ou de panneaux mobiles qui jalonnent l’espace urbain, constituent autant de discours et de représentation lisibles et identifiables des activités professionnelles, qui se déroulent dans la ville et font de l’espace urbain un espace d’échange et d’activité économique. Il s’agit également des activités professionnelles consistant dans une certaine forme d’occupation de l’espace. On peut en énumérer les crieurs publics, les vendeurs de journaux, les marchands ambulants, les auteurs de spectacles de rue, etc., se déplaçant en permanence dans l’espace de la ville et en s’y proposant des activités. Ces différents acteurs urbains contribuent, par leur activité symbolique, à faire de l’espace de la ville un espace de communication et de représentation identitaire.
III. Discours et contextes de la ville
C’est par la langue que l’espace, les lieux, les activités et politiques de la ville se mettent en discours : d’abord par la description physique : les cartes de la ville, les figures géométriques, les repères, les points cardinaux, etc. Ensuite, on observe également une forme de mise en discours touchant la formation, le recrutement, l’audit, la traque des biens mal acquis, mais également les politiques sociales telles que « le développement durable », « la scolarisation universelle », « la bourse de sécurité familiale », « la couverture maladie universelle », etc. Ce type de discours construit une image du projet social urbain ou national plus largement, et des aspirations des gouvernants.
L’utilisation massive des sigles, qu’affectionne l’administration (ZEP[20], PDEF[21], etc.), a pour effet de « bien parer » la réalité et de rendre invisibles certaines catégories sociales. On ne dira pas « ménages immigrés », mais « population défavorisées ». De nouveau zonages (zones sensibles, zones franches, zones d’éducation prioritaires, zones d’aménagement concertées) sont ajoutés aux découpages administratifs et politiques existants. Les mots associent l’image de danger social et/ou de pauvreté voire de promiscuité, aux classes populaires. Le vocabulaire désigne la différence, signale la dangerosité, souligne la marginalité par rapport à la loi commune.
On observe de multiples écrits sur les murs de la ville, les panneaux, les affiches, les pancartes, les véhicules, en somme toutes les surfaces sur lesquelles on trouve de l’écrit. Cela implique l’idée de plurilinguisme de la ville. C’est également le signe d’un recours à la toponymie pour dire la ville. En effet, la nomination des lieux est le premier acte de prise de possession de la ville par un pouvoir politique. L’on se rappelle au Sénégal, il y a quelques années, sous le régime du Président Abdou Diouf, l’Etat s’était systématiquement mis à rebaptiser les rues, les écoles et lycées des grandes villes, surtout ceux de Dakar. C’est ainsi qu’entre autres, le lycée Van Vollonoven et l’avenue William Ponty de Dakar sont rebaptisés respectivement Lycée Lamine Guèye et Avenue Georges Pompidou. « Découvrant » l’Amérique, qu’il croyait être les Indes et qui étaient, en fait, la mer des Caraïbes, Christophe Colomb, par exemple, est pris d’une véritable fureur baptismale : les îles, les caps, les baies, il baptise tout, sans se demander si les indigènes, Caraïbes ou Arawaks, n’ont pas déjà nommé leur environnement. Mais, les (re)nommant, il croyait se les approprier, les créer, ou simplement les découvrir. Cette prise de possession symbolique peut être réitérée par des pouvoirs successifs qui débaptisent pour effacer les traces du pouvoir précédent, puis rebaptisent pour laisser à leur tour leur marque. C’est ainsi que Saint Petersbourg est devenue avec la révolution d’octobre Leningrad puis, après la chute du régime communiste, Petersbourg. Ce sont autant de prises de possession symbolique. Aussi la toponymie apporte-t-elle un témoignage sur l’histoire linguistique de la ville. Les noms de lieux fonctionnent alors comme des fossiles et nous disent qu’ici ont vécu des locuteurs de tel ou tel pays.
Ce processus d’affectation des noms aux divers lieux de la ville relève de l’interdiscours. En effet, un des lieux où la notion d’interdiscours apparaît opératoire est le processus d’affectation d’un nom à un référent, ou à un objet de discours, comme la nomination des lieux de la ville.
Le dialogisme de Bakhtine et l’analyse du discours reconnaissent l’existence d’un ailleurs extérieur au discours. C’est précisément cet ailleurs manifestant l’hétérogénéité discursive qui rend possible la nomination des lieux urbains. Dialogisme et interdiscours réfèrent historiquement à Bakhtine (1969) et à Michel Pêcheux (1969). Pour ce dernier, « […] les mots, expressions, propositions, etc., reçoivent leur sens de la formation discursive dans laquelle ils sont produits. »[22] Bakhtine définit l’interdiscours comme suit :
Notre langue quotidienne est pleine de mots d’autrui : avec certains, notre voix se fond totalement, oubliant leur appartenance première : par d’autres, que nous considérons comme bien fondés, nous renforçons nos propres mots ; dans d’autres encore, nous introduisons nos orientations personnelles, différentes et hostiles. […] Les mots d’autrui introduits dans notre discours, s’accompagnent immanquablement de notre attitude propre et de notre jugement de valeur, autrement dit deviennent bi-vocaux.[23]
Cette bi-vocalité, mise au service d’une prise de position, s’exprime notamment dans l’acte de nomination et a été dénommée dialogisme de la nomination, type d’interdiscours que construit la ville.
Conclusion
On le voit, les paroles de la ville se comprennent comme une construction d’identités politiques, sociales, culturelles, que l’espace urbain, jouissant d’une certaine autorité discursive, rend efficace. Cela montre le caractère constructiviste des échanges verbaux, surtout dans la situation d’énonciation privilégiée que constitue la ville, lieu des interactions verbales de toutes sortes, mais également espace de production d’énoncés détachés ou de petites phrases sous forme de slogans, de manifestes ou de déclarations politiques, de courts énoncés divers présents sur de multiples supports caractéristiques de la ville ( affiches, murs, frontons de magasins, voitures, etc.).
La ville est, par ailleurs, le lieu de fabrication et de circulation de toutes les informations destinées à un large public, dont les décideurs doivent façonner d’une manière ou d’une autre le comportement. C’est en ville que la force pragmatique du discours, se manifeste au mieux. Ainsi, les discours urbains, qu’il s’agisse de la publicité ou de la mode, ou même de la politique, ne laissent pas intacts les citadins toujours tentés de se livrer à leur consommation effrénée. Le processus de transformation identitaire est facilité par le fait que la ville fait entendre, sans cesse, un interdiscours destiné, entre autres, à rendre possible la nomination des rues, des écoles, en somme de tous les lieux urbains, mais également, des évènements sociaux, des activités de développement de l’Etat, etc.
Cette nomination inhérente à la vie urbaine n’est rien d’autre qu’un discours hydrique, qui dit la ville et lui donne une identité, ainsi qu’aux différents acteurs. La ville nous est apparue à la fois comme un espace de fabrication d’une identité collective, une culture du citadin. Sur la parole urbaine se concentre la réussite (ou l’échec) de la relation d’un individu avec son entourage. Trait d’union vers l’autre, elle est un facteur non négligeable, en termes de cohésion sociale et de solidarité, et tient une place centrale dans le processus de façonnement des identités. La parole urbaine sert d’intermédiaire entre les individus ; elle est lien, expression et action au sein de la ville, espace de consommation de discours. En cela, c’est un acte au sens plein du terme, engageant dans sa profération l’individu tout entier (valeur performative). La parole urbaine permet une confrontation à l’autre et au monde, et c’est en ce sens que nous la désignons comme un «principe » actif d’expression des composantes de la ville, car d’elle naît l’échange, principe de pluralité (points de vue, valeurs…). De plus, la parole, subordonnée à la langue, est un marqueur de personnalité : elle donne à entendre une origine ; par exemple, comme nous l’avons remarqué, le parler urbain est foncièrement différent du parler rural.
Bibliographie
Augé, M., (1994), Pour une anthropologie des mondes contemporains, Flammarion, Paris.
Austin, (J.-L), Quand dire c’est faire, Paris, Edition du Seuil, 1970.
Barbéris, J.-M., « Deixis spatiale et interaction verbale », Cahiers de praxématique, n°9, pp.25-39.
Bakhtine, M., (1970), La Poétique de Dostoïevski, PARIS ? Points Essai.
Bakhtine, M., (1977), Le marxisme et la philosophie du langage, Paris, Ed. Minuit.
Bernié-Boissard, C., Des mots qui font la ville, Paris, La dispute/SENEDIT, 2008.
Bruston, A., (sous la direction de), (2005), Des cultures et des villes, mémoires au futur, L’Aube, La Tour-d’Aigues.
Bulot, T., (2002), « La double articulation de la spatialité urbaine : « espaces urbanisés » et « lieux de ville » en sociolinguistique », in Bulot T. et Beauvois, C. (sous la direction), La Sociolinguistique urbaine : une sociolinguistique de CRISE, Premières considérations, Revue électronique, Marges Linguistiques, numéro 3, mai 2002, pp. 91-105.
Calvet, L.-J., Introduction à la sociolinguistique urbaine, (2011), Paris, Editions Payot et Rivages.
Charaudeau, P., (2005), Le Discours politique. Les masques du pouvoir, Paris Vuibert.
Claudine, M., (2003), «Des configurations urbaines à la circulation des langues ou … les langues peuvent-elles dire la ville ? », in Sociolinguistique urbaines. Frontières et territoires, Rennes, Editions Modulaires Européennes (E.M.E), 2007, pp. 55-81, p43.
Dufour, F., (2004), « dialogisme et interdiscours : des discours coloniaux aux discours de développement » in Aspects du dialogisme, Revue, Cahiers de praxématiques, n°4, pp.145 – 164.
Grieg-Planque, A. 2009a), La Notion de « formule » en analyse du discours. Cadre théorique et méthodologique, Besançon, Presse Universitaire de Franche-Comté.
Grieg-Planque, A., (2010), « La formule “développement durable” : un opérateur de neutralisation de la conflictualité », Langage et Société, n°134, p. 5-29.
Julliard, J.-C., (1995), Sociolinguistique urbaine, La vie des langues à Ziguinchor (Sénégal), CNRS Editions.
KLEIN, W., (1994), « La deixis spatiale dans les indications d’itinéraires », in Barberis, J.-M. (dir.), La ville, arts de faire, manières de dire, Langue et praxis, Université Paul Valéry, Montpellier III, pp. 45-70.
Klein, W., (1994), Temps en langue, Angleterre, Routledge.
lamizet, B. et Sanson, P., (1997), Les Langages de la ville, Marseille, Parenthèses, (Coll. « Euplinos »).
lamizet, B., (2007), « Identités et territoire urbaines. La ville, espace de communication », in Sociolinguistique urbaines. Frontières et territoires, Rennes, Editions Modulaires Européennes (E.M.E), pp. 303-333.
Maingueneau, D., (2004), Le Discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris, Armand Colin.
Maingueneau, D., (2009), Les termes clefs de l’analyse du discours, Paris, Editions du Seuil. Maingueneau, D., (2012), Les Phrases sans texte, Paris, Armand Colin.
MBOW, F., « L’ordre, la question et l’assertion dans l’échange interindividuel de la parole : l’exemple de l’interaction didactique », revue LIENS, n° 11, FASTEF/UCAD/Sénégal.
MBOW, F., « Mythe de la ville, métaphore organique et énonciation dans le ventre de Paris d’Emile Zola », revue Ecritures Plurielles, n°3, FASTEF/Dakar, Décembre 2009.
MBOW, F., « interdiscours », positionnement » et champ littéraire négro-africain », revue ANADIS, n°9, Juin 2010, Suceava/Roumanie, pp. 90-124.
MBOW, F., « L’acte de refus et le fonctionnement de la politesse linguistique dans les rencontres commerciales », revue LIENS, n°14, Novembre 2011, FASTEF-UCAD, Dakar, pp.181-206.
MBOW, F., “L’acte de requête dans l’interaction verbale », revue Sudlangues, n° 16, Facultés des Lettres et Sciences Humaines, UCAD, Dakar, Décembre 2011, pp. 105-121.
Mondada, L. (2000), Décrire la ville. La construction des savoirs urbains dans l’interaction Et dans le texte, Anthropos.
Pêcheux, M., (1969), Analyse automatique du discours. Paris, Dunod.
Reboul, O., (1975), Le Slogan, Bruxelles, Complexe.
* FASTEF, ex. Ecole Normale Supérieure de Dakar
[1] Claudine Moïse, 2003, «Des configurations urbaines à la circulation des langues ou … les langues peuvent-elles dire la ville ? », in Sociolinguistique urbaines. Frontières et territoires, Rennes, Editions Modulaires Européennes (E.M.E), 2007, pp. 55-81, p43.
[2] Le « contexte mondain » est défini par opposition au contexte simplement linguistique, celui que l’on trouve au sein de la phrase ou même du mot.
[3] Suivant une première conception très simple, nous pouvons dire que l’interdiscours est au discours ce que l’intertexte est au texte.
[4] Maingueneau, D., Le Discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris, Armand Colin, 2004, p.33.
[5] Krieg-Planque, A., La Notion de formule en analyse du discours, Paris, Presse universitaire de Franche-Comté, 2009.
[6] Dans son ouvrage, Les Phrases sans texte, Paris Armand Colin, 2012, Maingueneau, D., appelle phrases sans texte les sentences, les slogans, les petites phrases, les formules, les maximes, les titres dans la presse, etc., qui prétendent tous échapper à l’ordre d’un texte.
[7] Grieg-Planque, A., La Notion de « formule » en analyse du discours. Cadre théorique et méthodologique, Besançon, Presse Universitaire de Franche-Comté, 2009a.
[8] Krieg-Planque, A., Op.cit, 114.
[9] Mondada, L. 2000, Décrire la ville. La Construction des savoirs urbains dans l’interaction et dans le texte, Anthropos, p.60.
[10] Barbéris, J.-M, « Deixis spatiale et interaction verbale », Cahiers de praxématique, n°9, pp.25-39.
[11] Klein, W., Temps en langue, Angleterre, Routledge, 1994.
[12] Lamizet, B., « Identités et territoire urbaines. La ville, espace de communication », in Sociolinguistique urbaines. Frontières et territoires, Rennes, Editions Modulaires Européennes (E.M.E), 2007, pp. 303-333, p.303).
[13] Augé Marc, Pour une anthropologie des mondes contemporains, Flammarion, Paris, 1994, p.94.
[14] La notion de scénographie, forgée par Maingueneau, renvoie à la situation d’énonciation considérée de l’intérieur du discours. L’énonciation met en place son propre dispositif de parole, dispositif différent du cadre physique. Dominique Maingueneau en parle comme suit : « Dès son émergence, la parole suppose une certaine situation d'énonciation, laquelle, en fait, se valide progressivement à travers cette énonciation même. La scénographie est ainsi à la fois ce dont vient le discours et ce qu'engendre ce discours. » (Maingueneau, D., Le Discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris, Armand Colin, 2004).
[15] Citation tirée du discours de Wade ci-dessus.
[16] Citation tirée du discours de Wade ci-dessus.
[17] Reboul, O., dans son ouvrage, Le Slogan, Bruxelles, Complexe, 1975, p.42, définit le slogan de la manière suivante : « […] une formule concise et frappante, facilement répétable, polémique et le plus souvent anonyme, destiné à faire agir les masses », et dont « le pouvoir d’incitation excède toujours [le] le sens explicite ».
[18] La notion d’interactant est empruntée à la linguistique interactionniste. A ce sujet, voir l’ouvrage de
Kerbrat-Orecchioni, C., Les Interactions verbales, Paris, Armand Colin, T1, 1990, T2, 1992.
[19] Charaudeau, P., Le Discours politique. Les masques du pouvoir, Paris Vuibert, 2005, p.12.
[20] ZEP signifie Zone d’Education Prioritaire en France.
[21] PDEF signifie Plan de Développement de l’Education et de la Formation.
[22] Pêcheux, M., Analyse automatique du discours. Paris, Dunod, 1969.
[23] Bakhtine, M., La Poétique de Dostoïevski, Paris, Points, 1970, Essai, p. 129.
![]() Télécharger l’article en version PDF
Télécharger l’article en version PDF
0. Introduction
L’objet de cet article s’appuie sur un fragment du travail de recherche fourni par un étudiant, Jean-Noël De Jaham, diplômé en Master 2 Créolistique à l’université des Antilles et de la Guyane (2013)[1]. Dans ce mémoire codirigé par Robert Damoiseau et Michel Dispagne, et qui pour titre : « Analyse d’un corpus de créole martiniquais parlé par des locuteurs haïtiens vivant en Martinique », l’auteur a privilégié la thématique du parler des locuteurs haïtiens vivant en Martinique. Jean-Noël De Jaham s’est évertué, avec un appui soutenu du Professeur émérite Robert Damoiseau, créoliste et comparatiste (1999[2], 2005[3]), à examiner le volet lexico-grammatical des productions de quelques locuteurs haïtiens en les comparant de façon presque mécanique à leurs traductions en créole martiniquais, analogues à ce qui aurait pu être utilisé par un natif du créole martiniquais.
Un segment de ma recherche a été en partie réalisé grâce au corpus constitué par Jean-Noël De Jaham (2013). Il conduit ma réflexion au thème intitulé « Langages de la ville et langages dans la ville : Impact des interférences linguistiques dans le processus d’intégration et de résistance de locuteurs haïtiens dans l’espace urbain martiniquais ».
Bien qu’il soit question de contacts linguistiques à travers des conversations et relations humaines, il ne s’agit principalement pas dans cette présente recherche d’opérer à nouveau un développement théorique et historique de cet entre-deux linguistique, appelé « Interlanguage » (Interlangue). Il n’est donc pas question de revenir sur l’article de Stephen Pit Corder, que je traduis par « la signification des erreurs des apprenants » (1967)[4] et qui marque l’acte de naissance de la notion d’Interlangue, ni non plus sur les deux articles de Larry Selinker, le premier sur « transfert linguistique » (1969)[5], le second sur « Interlangue » (1972)[6]. À cette origine didactique de la notion, je vous renvoie à l’excellent article d’Évelyne Rosen et Rémy Porquier : « Présentation. L’actualité des notions d’Interlangue et d’interaction exolingue » (2003)[7] ainsi qu’à l’article d’Hervé Adami (2011)[8] qui précise les champs théoriques dans lesquels est abordée habituellement l’intégration linguistique des migrants et où l’on constate que le champ théorique retenu s’inscrit en grande partie sous l’angle de « l’analyse du processus de construction et de structuration de l’interlangue » (2011)[9].
En revanche, dans l’article de Rosen et Porquier (2003), il y a un syntagme binaire qui a attiré mon attention, puis nourri progressivement ma réflexion. C’est celui d’« Interlanguage pragmatics », que l’on peut traduire par « Pragmatique interlangue ». De cette locution notionnelle, Gabriele Kasper & Shoshana Blum-Kulka (1993)[10], Susan Gass & Larry Selinker (1994)[11] et Anne Baron (2003)[12] y livrent toute une panoplie d’explications. Dans ces différents travaux, l’accent est mis, précisent Rosen & Porquier, « sur la compréhension et la production d’actes de parole par le non-natifs dans les contextes différenciés (remercier, s’excuser, se plaindre, demander, corriger), sur la construction d’une compétence pragmatique, sur les malentendus et sur les rôles et l’importance du transfert des règles pragmatiques même à un niveau avancé de connaissance de la langue cible ». Les auteurs cultivant une visée didactique se sont surtout préoccupés de la manière d’enseigner une compétence pragmatique.
La préoccupation de ce présent travail est autre, tout en s’enracinant dans une réflexion fondée déjà sur la notion d’interculturalité, d’une certaine manière chemin vers l’intercompréhension (2003)[13]. Certes, elle se réfère à la notion de compétence pragmatique individuelle, au sens où je l’avais exposé lors d’une communication à Brasilia en 2009[14]. Mais, je n’entends pas, à l’examen du corpus, exploré ni orienter l’observation critique sur le processus de mise en œuvre de la compétence pragmatique des locuteurs haïtiens ni non plus effectué un retour revisité sur l’analyse grammaticale réalisée par Jean-Noël. En effet, l’offre du corpus n’autorise pas ce genre d’entreprise car le contenu n’assigne pas suffisamment une photographie dynamique du processus interférentiel en acte. Il en donne simplement des états qu’il est possible de soumettre à l’analyse.
La présente approche entend revenir sur quelques productions lexicales, lexico-grammaticales et/ou morpho-grammaticales et surtout sur ce qu’il est possible d’exprimer sur ces états supposant des situations opportunes déclenchant des activités linguistiques et sociolinguistiques d’intégration, donc sur les pratiques linguistiques des locuteurs. Elle entend regarder à un autre niveau la notion d’intercompréhension au sens où la compréhension entre locuteurs de langues différentes n’est pas fondée sur la définition qu’en donnent les spécialistes et sur laquelle ils s’accordent à dire que chaque locuteur parle sa langue et comprend l’autre à travers une compétence passive de la langue de l’autre. C’est ainsi que le dialogue s’y amorce.
Le processus de compréhension qui intéresse le présent article n’est pas de cette nature. Par hypothèse, il laisse ici entendre que ce processus s’est construit plutôt en contextes informels dans un travail incessant de productions approximatives de la langue étrangère, le créole martiniquais, en sachant que le locuteur migrant, le Haïtien, partage un créole structurellement proche de celui du martiniquais mais garde malgré tout par instants une tonalité morphosyntaxique propre à sa langue. Autrement dit, les deux créoles appartiennent à la même famille linguistique. En cela, le propos rejoint la remarque de Peter Doyé (2005)[15] qui souligne ceci : « Le fait que l’on puisse classer les langues en « familles » en fonction de leur origine signifie que les langues « descendant » de la même famille peuvent être « intercompréhensibles », c’est-à-dire que si les locuteurs des langues en question parlent leur propre langue, ils peuvent être compris par les autres ».
Il s’agit d’observer dans la présente réflexion le résultat du parler créole martiniquais de locuteurs Haïtiens et d’y apposer quelques réflexions linguistiques, sociolinguistiques et anthopolinguistiques. Le locuteur haïtien parle la langue de l’autre, le créole martiniquais. En tout cas, il s’évertue à le faire sans pour autant que l’autre parle sa langue. D’où nos interrogations de facture sociolinguistique :
Quelle (s) langue (s) parlent les locuteurs haïtiens sur le territoire martiniquais ? La durée de leur présence en terre martiniquaise influe-t-elle sur leur choix linguistique ? Que livre leur choix sur la visibilité de leur culture plurilingue avec intégration ou pas à leur propre pratique linguistique de l’une des langues et/ou deux langues locales de l’environnement martiniquais (le créole martiniquais et/ou le français)?
Que révèlent donc chez ces quelques locuteurs haïtiens, en termes de pratiques linguistiques et par voie de conséquence en termes d’intégration, les mots et/ ou les chaînons lexico-syntaxiques qu’ils disent utiliser ? Autrement dit, sont-ils des indicateurs relatifs à des passerelles d’accès à un environnement autre que le leur et aussi des indicateurs éclairant sur des connexions favorisant les échanges alternatifs avec les natifs ?
Cette chaîne de questions sollicite un important travail de recherche qui ne sera pas possible d’aborder dans cet article mais malgré tout celle-ci invite à interroger au préalable une vision non classique de l’intercompréhension mettant en évidence une pratique verbale asymétrique entre migrant et natif.
De surcroît, le fait que les requêtes du chercheur aient été à l’origine du déclenchement des situations linguistiques ayant provoqué des comportements linguistiques chez les locuteurs haïtiens, ces productions linguistiques n’ayant pas été appréhendées sur le vif conduisent à dire par hypothèse que les productions linguistiques ne sont que le résultat d’une recomposition de leur pratique linguistique respective plus ou moins proche du réel. Et, celle-ci est appelée à de nouvelles observations en vue d’un nouvel examen. Ce résultat n’offre donc qu’un certain état interférentiel d’une approximation de la biographie sociolangagière de tel ou de tel locuteur haïtien se représentant agissant linguistiquement dans telle ou telle situation de vie ou dans telle ou telle expérience de la vie quotidienne. Cet état interférentiel et social ne peut être qualifié pour l’heure que de «bricolage intégratif naturel » au niveau de la pratique linguistique et/ou sociolinguistique de locuteurs vivant dans un environnement humain martiniquais non natif.
1. Matériel et méthodes
Avant d’aller plus avant, il m’apparaît utile de préciser le corpus de référence en question sans m’attarder sur la méthodologie utilisée par Jean-Noël De Jaham et les éléments retenus qui vont constituer mon propre corpus.
Le corpus de référence a été constitué à partir de données linguistiques recueillies en 2012 dans plusieurs quartiers de Fort-de-France (Martinique). Jean-Noël De Jaham ne voulait pas interviewer des intellectuels Haïtiens, mais rencontrer le Haïtien moyen vivant au sein des quartiers populaires fréquentés par des Haïtiens, par exemple le quartier des Terres Sainville ou celui de Sainte-Thérèse ou encore des Haïtiens habitués aux milieux religieux, par exemple le milieu catholique haïtien. La rencontre chez l’habitant Haïtien a été retenue également comme lieu de rencontre et d’échange.
En définitive, quatre locuteurs Haïtiens (deux hommes et deux femmes) ont été approchés et interrogés sur le choix de leur pratique linguistique par rapport à divers lieux de parole ainsi que sur leur manière d’appréhender linguistiquement le système aspecto-temporel. Le chercheur ayant pour objectif, par ses questions variées et ciblées, de conduire les locuteurs à produire du récit et/ou des micro-discours.
Le corpus de référence rassemble quelques productions énonciatives venant des quatre locuteurs qui se déclinent ainsi : la locutrice 1 âgée de 35 ans vit depuis 3 ans en Martinique ; le locuteur 2 âgé de 69 ans vit en Martinique depuis 36 ans ; la locutrice 3 âgée de 37 ans y habite depuis 7 ans et le locuteur 4 âgé de 38 ans y séjourne depuis 12 ans. L’examen des énonciations de ces différents locuteurs porteront soit sur du lexique soit sur de la morphosyntaxe ou de la sémantique en cherchant à comprendre la cartographie linguistique des locuteurs haïtiens en divers lieux et à répondre à la question formulée précédemment à savoir : comment les mots, les expressions ou encore les productions utilisés peuvent conduire à des indications significatives de la pratique de la langue cible (le créole martiniquais) ? Par ailleurs, y révèlent-ils d’autres éléments des migrants de leur visibilité respective dans l’environnement martiniquais ? Par voie de conséquence, l’analyse aboutira également à une perception non classique de la notion d’intercompréhension.
2. Résultats
À l’analyse de deux interrogations de facture sociolinguistique :
*La première interrogation :
-Question 1 (Q1) : « Lè ou ka jwenn an Matinitjè ki lang ou ka palé ? »[16]
Avec comme réponse pour chacun des locuteurs interviewés :
|
Langue Locuteur/trice |
F | CM | Remarques |
|
Locutrice 1 (installée depuis 3 ans) |
× | × | Difficile d’apprécier la fiabilité de la réponse en termes de compétence linguistique |
|
Locuteur 2 (installé depuis 36 ans) |
× | × | Difficile d’apprécier la fiabilité de la réponse en termes de compétence linguistique |
|
Locutrice 3 (installée depuis 7 ans) |
× | Difficile d’apprécier la fiabilité de la réponse en termes de compétence linguistique | |
|
Locuteur 4 (installé depuis 12 ans) |
× Avec les femmes |
× Avec les hommes |
Difficile d’apprécier la fiabilité de la réponse en termes de compétence linguistique |
Tableau 1
Légende
Q 1 : Question 1
F : Français
CM : Créole Martiniquais
*La seconde interrogation :
-Question 2 (Q2) : « Ki lang ou ka palé plis dépi ou Matnik ? »[17]
L’enquête initiale a retenu cinq situations qui n’ont pas été tronquées :
- le travail,
- la famille,
- l’administration,
- les relations avec des parents, amis et/ou des camarades haïtiens,
- les relations avec des amis et/ou des camarades martiniquais.
|
Lieu de parole Locuteur/trice |
Travail | Famille | Adminis-tration |
Relations parents, amis, camarades haïtiens |
Relations parents, amis, camarades martiniquais |
|
Locutrice 1 (installée depuis 3 ans) |
CH | CH | F | CH | CM |
|
Locuteur 2 (installée depuis 36 ans) |
PdR | PdR | F |
CH : Primo-entrants CM : autres Haïtiens (supposition) |
CM |
|
Locutrice 3 (installée depuis 7 ans) |
F | PdR | F |
CM ? Les amis sont-ils Haïtiens ? |
CM ? Les amis sont-ils martiniquais ? |
|
Locuteur 4 (installé depuis 12 ans) |
CM | CH et F | F | CH | PdR |
| variation | CH et F( ?) | 1 constante | variation | 1 constante |
Tableau 2
Légende :
Q 2 : Question 2
CH : Créole Haïtien
CM : Créole Martiniquais
F : français
PdR : Pas de Réponse
3. Discussion 1/ Question 1 & Question 2
La question 1(Q1) : « Lè ou ka jwenn an Matinikè ki lang ou ka palé ? ». De la part des locuteurs Haïtiens, la plupart des interactions, disent-ils, se font en français et en créole martiniquais. Ce que les réponses ne donnent pas, c’est la partition de cette répartition. Cet usage des deux langues, français et créole, se manifeste-t-il dans toutes les situations interactives ?
Le principe d’autonomie linguistique développé, après Joseph Vendryes (1939)[18], par André Martinet (1967)[19] conduit à dire qu’il y a choix d’une langue, créole martiniquais ou français, au détriment de l’autre dans les diverses situations interactives. Quelles sont donc ces situations ? A-t-on affaire pour l’une comme pour l’autre langue à du «bricolage linguistique » de ces langues cibles ou à des productions linguistiques à tous les niveaux de l’architecture des langues (phonétique, phonologique, lexical, syntaxique et sémantique) ?
La question 2 (Q2) portant sur la langue la plus utilisée par les locuteurs haïtiens vient affiner, par les réponses assignées, les lectures sociolinguistiques des données du premier tableau.
L’usage du français par les locuteurs haïtiens interrogés promotionne le français plutôt que le créole martiniquais dans un lieu de parole qu’est l’administration. Et, les données du premier tableau montrent que la durée d’installation dans le pays n’est pas pertinente. Autrement dit, les situations conditionnant des liens sociaux formels et codifiés imposent davantage l’usage du français que celui du créole martiniquais. En définitive, il y a tout simplement des règles linguistiques et sociolinguistiques à respecter, lesquelles vont entraîner une codification linguistique des comportements.
Le processus d’installation linguistique va-t-il de pair avec le processus d’intégration ? Et les questions sont de savoir : quelle langue use le Haïtien dans ses différentes relations soit avec ses pairs soit avec des martiniquais ? Et pour quelle(s) raison(s)?
Ces questions méritent d’être posées, mais l’examen des données révèle des réponses insuffisamment significatives d’autant plus qu’il aurait fallu recueillir les discours explicatifs à ce sujet et par voie de conséquence prendre en compte les représentations des locuteurs en jeu dans cette gestion respective de la langue et dans le sentiment identitaire des migrants (1999)[20]. De plus, l’échantillon s’avère réduit et ne permet que d’appréhender des tendances à valider en les confrontant à un échantillon plus conséquent. Toutefois, ce travail du chercheur sur une petite échelle aide déjà à corriger les insuffisances constatées. Les Haïtiens interrogés en 2012 répondent que la langue utilisée s’opère en créole martiniquais avec des martiniquais et en créole haïtien avec des Haïtiens, excepté l’un des quatre qui souligne qu’il utilise le créole haïtien avec les primo-entrants et le créole martiniquais pour les autres Haïtiens installés depuis plus longtemps.
Toutefois, à une échelle plus importante, les réponses seront-elles pour autant plus pertinentes ? Derrière la problématique du petit ou du grand nombre de locuteurs, il y a la question de la nature et de la qualité des langues cibles (français et créole martiniquais utilisés). Autrement dit, la question de la compétence linguistique, de la connaissance de ces langues cibles et de la capacité de mobiliser les ressources propres à celles-ci selon les règles et les formes de chacune d’entre elles.
-Question 3 (Q3) : De quelle compétence linguistique relevant du créole martiniquais est-il question dans le parler créole martiniquais des locuteurs Haïtiens ?
L’analyse des quelques énoncés prononcés par les différents locuteurs éclairera le propos et précisément apportera quelques éléments de réponse. En regard de chacun des énoncés, la traduction en créole martiniquais attendue sera indiquée, ainsi que la traduction française. Cette indication servira de référentiel à l’analyse de la compétence des locuteurs.
Légende
XY : le premier chiffre représente le rang assigné au locuteur et le second chiffre indique le numéro de l’énoncé.
* : L’étoile indique un exemple d’apocoque
TCM : Traduction en créole martiniquais de l’énoncé
TF : Traduction française de l’énoncé
Locutrice 1 (installée depuis 3 ans):
(1.1) Kannaval la, nou kapab gadé li, sa té bien.
TCM : Kannaval-la, nou pé gadé’y, sa té bien.
TF : Le carnaval, nous pouvons le regarder
(1.2) Pa palé an fè nwa
TCM: Pa palé an nwè-a
TF: Ne parles pas dans le noir (au sens de : ne médis pas)
(1.3): si mwen sòti tankou uitè
TCM : Si mwen sòti koté uitè.
TF : si je sors vers huit heures.
*(14) : Fanmi m
TCM : Fanmi mwen
TF : Ma famille
Locuteur 2 (installé depuis 36 ans) :
(2.1) Sa nou té konn fè Ayiti, tijwèt, tifanal
TCM : Sa nou té ni labitid fè, tijwé, tilanp
TF : Ce que nous avions l’habitude de faire en Haïti
(2.2) kounyeya la, mwen pa ka travay
TCM: Atjèlman-an, mwen pa ka travay
TF : En ce moment précisément, je ne travaille pas
(2.3)Matinik, péyi tankou Ayiti
TCM : Matinik/matnik, péyi kon Ayiti
TF : La Martinique, un pays qui ressemble à Haïti
*(24) Respekté l
TCM : Respekté’y
TF respecte-le/la
Locutrice 3 (installée depuis 7 ans):
(3.1) Mwen te renmen takiné yon lo timanmay
TCM: Mwen té enmen fè lafèt épi/ék anlo timanmay
TF : J’aimais taquiner beaucoup d’enfants
(3.2) Mwen vle sa
TCM: Mwen lé sa
TF: Je veux cela
(3.3) Mwen resi trape yon travay
TCM: Mwen rive trapé an travay (an final-di-kont)
TF: J’ai finalement réussi à trouver du travail
*I pli piti pasé m
TCM : I pli piti pasé mwen
TF : Il est plus petit que moi
Locutrice 4 (installé depuis 12 ans) :
(4.2) Kwa-dè-Boukèt pa te ø vil tankou Pòtoprens
TCM : Kwa-dè-Boukèt pa té an vil kon Pòtoprens
TF : Croix-des-Bouquets n’était pas une ville comme Port-au-Prince
(4.2) I te tankou uitè
TCM : Konsidéré i té uitè
TF : Il était environ huit heures
*Man konnèt dwa m
TCM : Man konnet dwa mwen
TF : Je connais mes droits
4. Discussion 2 / Question 3
La troisième question va dans le sens des problématiques relatives à la compétence (active ou passive) des langues cibles et les réponses qui y sont apportées par les productions linguistiques de tel ou de tel locuteur sont à examiner de plus près d’autant plus qu’elles permettront de voir à l’œuvre l’usage « correct » du double référentiel linguistique à l’œuvre dans le parler créole martiniquais des locuteurs Haïtiens. Double référentiel linguistique dans le mouvement d’échanges vers l’autre, mouvement en tension où tantôt le parler créole martiniquais du locuteur Haïtien se porte vers les ressources de la langue cible, le créole martiniquais, tantôt le parler créole martiniquais se confine dans les ressources de la langue source, la créole haïtien. L’analyse des énoncés produits par les locutrices et les locuteurs interrogés est fort instructive pour le propos.
L’observation, et l’examen des quelques énoncés relevés dans le micro-corpus linguistique et, à titre d’exemple, selon des catégories grammaticales, parleront davantage à la réflexion. Précisément, les catégories choisies pour illustrer la recherche opérée renvoient à un double niveau, lexical et morphosyntaxique.
Voici quelques exemples du corpus créole :
-Locutrice Haïtienne 1 s’exprimant en créole martiniquais (installée depuis 3 ans)
1.1 : Kannaval la, nou kapab gadé li vs Kannaval-la, nou pé gadé’y (créole martiniquais attendu (cma))
1.3 : Si mwen sòti tankou uitè vs Si mwen sòti koté uitè (cma)
-Locuteur Haïtien 2 s’exprimant en créole martiniquais (installé depuis 36 ans)
2.1 : Sa nou té konn fè Ayiti, tijwèt, tifanal vs Sa nou té ni labitid fè, tijwè, tilanp
2.3 : Matnik, péyi tankou Ayiti vs Matinik/Matnik, péyi kon Ayiti
-Locutrice Haïtienne 3 s’exprimant en créole martiniquais (installée depuis 7 ans)
3.1 : Mwen te renmen takiné yon lo timanmay vs Mwen té enmen fè lafèt épi/èk anlo timanmay
3.3 : Mwen resi trape yon travay vs Mwen rivé trapé an travay
-Locuteur Haïtien 4 s’exprimant en créole martiniquais (installé depuis 12 ans)
a. I te tankou uitè vs Konsidéré i té uitè
Du point de vue de l’une des langues-cibles du répertoire linguistique martiniquais, ici le créole martiniquais, quelques remarques opportunes s’imposent. Du point de vue structurel, le créole haïtien comparé au créole martiniquais ne présente aucune différence. Des points de vue lexical, morpho-lexical, morphosyntaxique, des variantes opèrent au niveau des productions linguistiques de chacun des locuteurs, au niveau du flux sonore ou encore des séquences lexicales, morphosyntaxiques appartenant à la langue source des locuteurs.
Chez la locutrice 1, « Kapab » et « li » dans la production : « Kannaval, nou kapab gade li » au lieu « nou pé gadé’y ».
Chez la locutrice 2, « tankou » dans la séquence : « Matinik, péyi tankou Ayiti » au lieu de « Matinik, péyi kon Ayiti ».
Chez la locutrice 3, « renmen », « takiné », « yon lo » dans la séquence « Mwen té renmen takiné yon lo timanmay » au lieu de « Mwen te enmen fè lafèt épi anlo timanmay ».
Chez le locuteur 4, « tankou » dans la séquence : « I té tankou uitè » au lieu de « Konsidiré i té uitè », l’item « tankou » étant, on le sait, inexistant en créole martiniquais.
Le phénomène de l’apocoque ou de troncation ou encore de chute phonétique et syllabique constamment à l’œuvre dans le parler créole haïtien est un indicateur, qui lorsqu’il apparaît dans les productions du parler créole martiniquais de l’Haïtien marque la prégnance de la langue créole haïtienne dans le créole martiniquais. Quelques exemples tirés du micro-corpus relevant des mêmes locuteurs :
Chez la locutrice L1, on trouve dans son parler du créole martiniquais « Fanmi m » au lieu de « Fanmi mwen ». L’indicateur « m » marque une référence à la langue source.
Chez le locuteur L2, on trouve Respekté’l » au lieu de «Respekté’y »
Chez la locutrice L3, on trouve « I pli piti pase m » au lieu de « I pli piti pasé mwen »
Chez le locuteur L4, on trouve « Man konnet dwa m » au lieu de « Man konnèt dwa mwen ».
L’espace interférentiel linguistique intégrant entre autres choses l’usage des créoles haïtien et martiniquais se construit comme un lieu à la fois d’instabilités linguistiques et de stabilités provisoires en vue de juguler l’insécurité linguistique quant à l’emploi d’un terme propre à la langue cible, mais non disponible au moment où il parle (ignorance ou oubli) et qu’il remplacera par un autre puisé cette fois-ci dans la langue source. C’est en ce sens que je parle de « bricolage linguistique dynamique » (BLD) permettant au locuteur de la langue source et en fonction de son type d’immersion de se construire un répertoire du créole martiniquais et de se fabriquer dans son système interlinguistique provisoire (Ellis, 1991)[21], à un moment donné, une certaine compétence de la langue cible, celle du créole martiniquais. Du point de vue de la pragmatique linguistique la question de la sincérité linguistique est à poser chez le migrant Haïtien. Est-ce l’ignorance voire l’oubli qui gouverne le comportement sociolangagier ? Ou est-ce une manière manifeste de signifier un aspect de son identité, son altérité ? En pareil cas, l’usage de l’expression du créole haïtien en lieu et place de l’expression du créole martiniquais est-il donc voulu ?
5. Conclusion
En essayant de comprendre en contexte informel et quotidien le fonctionnement d’un certain point de vue de l’intercompréhension dans les comportements affichés de quelques locuteurs vivant dans une nouvelle géographie sociale et linguistique, me revient une des affirmations du Professeur émérite Jean Bernabé, linguiste et créoliste. Jean Bernabé avance l’idée selon laquelle « l’intercompréhension consiste à dire : je parle ma langue, tu parles la tienne et nous nous comprenons, parce que chacun a une compétence passive de la langue de l’autre » (CORPUCA, 2008). Mais, une partie de la réflexion menée, très modeste, faut-il le dire, vient quelque peu interroger cette affirmation. Elle éclaire le fait que la symétrie entre locuteurs exprimée par Jean Bernabé ne reflète pas le travail de bricolage linguistique travaillé par des intentions voire des idéologies non déterminées dans le présent article. De fait, opère-t-il uniquement sur les deux créoles (source et cible) pour construire cette compétence d’utilisation de la langue cible (créole martiniquais) en termes de compréhension ou de production ? Compte tenu du contexte problématique de l’émigration haïtienne dans les Départements Français d’Amérique (DFA) est-il suffisant de se contenter du travail de bricolage linguistique qui conduit le locuteur Haïtien à s’évertuer d’abord à parler la langue de l’autre (langue cible), le créole martiniquais rendant en quelque sorte possible une forme d’intercompréhension puisque l’autre reconnaît sa langue et peut converser avec lui sans pour autant développer une production de la langue de celui ou de de celle qui lui parle ? Ou ne convient-il pas aussi de cerner puis de croiser les intentions et les idéologies à l’œuvre dans l’exercice des langues des migrants pour mieux comprendre la particularité de leur parler du créole martiniquais et leur positionnement dans leurs stratégies psycholinguistiques et anthropologiques de migrants en terre martiniquaise ?
Ces interrogations précédentes méritent d’être levées et demandent un élargissement du corpus en maintenant l’approche non classique préalable de l’intercompréhension des langues et de la compréhension du processus d’intégration chez les migrants Haïtiens en Martinique et appelle par conséquent à un nécessaire retour dans les différentes communautés haïtiennes. Cela fournira une somme de réponses plus fines concernant les locuteurs Haïtiens dans leur usage des langues parlées en Martinique et de leur place sociale en terre de migration.
6. Bibliographie
Adami Hervé, (2011)., Parcours migratoires et intégration langagière, In Mangiante JM. (Dir.), L’intégration et la formation linguistique des migrants: état des lieux et perspectives, Arras, Artois Presses Université.
Baron Anne, (2001). Acquisition Interlanguage Pragmatics, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
Bernabé Jean, (2008)., De l’intelligence des langues, Discours d’ouverture, Séminaire sur L’intercompréhension des langues, UAG, CORPUCA, CRILLASH & CIRECCA.
Corder Pit Stephen, (1967), The signifiance of learners’errors, in International Review of Applied Linguistics, Vol. 5, n° 4.
Damoiseau Robert, (1999)., Éléments de grammaire compare français-créole martiniquais, Ibis Rouge Éditions.
Damoiseau Robert, (2005)., Éléments de grammaire compare français-créole haïtien, Ibis Rouge Éditions.
De Jaham Jean-Noël, (2013)., Analyse d’un corpus de créole martiniquais parlé par des locuteurs haïtiens vivant en Martinique, mémoire de Master 2 Créolistique, codirigé par Robert Damoiseau & Michel Dispagne, Université des Antilles et de la Guyane.
Deprez Christine, (1999)., Les enfants bilingues : langues et familles, Paris, Didier.
Dispagne Michel, (2003)., L’interculturalité des pays créolophones, lieu d’apprentissage original à l’interculturalité, Communication au Colloque International « Cultures croisées », Université de Craiova (Roumanie).
Dispagne Michel, (2009)., L’intercompréhension, comme prémices du dialogue interculturel et plurilinguistique, Communication, Séminaire « Formation sur la Didactique des Langues et Cultures étrangère » (23 & 24 avril), Année de la France au Brésil, Université de Brasilia.
Doyé Peter, (2005)., L’intercompréhension, guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe- De la diversité linguistique à l’éducation plurilingue, Strasbourg, Conseil de l’Europe.
Ellis Rod (1991). , Understanding Second Language Acquisition, Oxford, OUP.
Gass Susan & Selinker Larry, (1994). Second Language Acquisition: An introductory Course, Hillsdale, NJ: Lawrence, Erlbaum Associates
Kasper Gabriele & Blum-Kulka Shoshana, (1993). Interlanguage Pragmatics, Académic American Encyclopedia, Vol., 12, p. 354.
Martinet André (1967). Linguistics Studies presented to André martinet on the occasion of his sixtieth birthday, Linguistic Circle of New York, p. 177. 246. 322.
Rosen Évelyne & Porquier Rémy, (2003)., Présentation. L’actualité des notions d’Interlangue et d’interaction exolingue, Revue Linx, n°49.
Selinker Larry, (1969). Language Transfer, in General Linguistics, The Pennsylvania State University Press, 10, 4.
Selinker Larry, (1972). Interlanguage, in International Review of Applied Linguistics.
Vendryès Joseph, (1939). El langaje: introduccion linguistica a la historia. Traduccion al espagnol por Manuel de Montolin [y] José M. casas; revision y adicionès de A. M. Badia Margarit y J. Roca Pons, p. 59.379.
* Université des Antilles et de la Guyane – CRILLASH
[1] J-N. De Jaham, Mémoire de master 2 Créolistique, université des Antilles et de la Guyane.
[2] R. Damoiseau, (1999)., Éléments de grammaire compare français-créole martiniquais.
[3] R. Damoiseau, Éléments de grammaire compare français-créole haïtien.
[4] S.P. Corder, The signifiance of learners’errors, in International Review of Applied Linguistics.
[5] L. Selinker, Language transfer, in General Linguistics.
[6] L. Selinker, Interlanguage, in International Review of Applied Linguistics.
[7] E. Rosen & R. Porquier, Revue Linx, n°49.
[8] H. Adami, Parcours migratoires et intégration langagière.
[9] Id.
[10] Interlanguage.
[11] S. Gass & L. Selinker, Second Language Acquisition: An introductory Course.
[12] A. Baron, Acquisition Interlanguage Pragmatics.
[13] M. Dispagne, L’interculturalité des pays créolophones, lieu d’apprentissage original à l’interculturalité.
[14] M. Dispagne, L’intercompréhension, comme prémices du dialogue interculturel et plurilinguistique.
[15]Peter Doyé, L’intercompréhension, guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe- De la diversité linguistique à l’éducation plurilingue.
[16] Q1 : « Quand tu rencontres un Martiniquais en quelle langue t’exprimes-tu ? » (Traduction française de l’énoncé créole).
[17]Q 2 : « Depuis que tu vis en Martinique laquelle des langues parles-tu le plus ? » (Traduction de l’énoncé interrogatif créole).
[18] J. Vendryès, El langaje: introduccion linguistica a la historia.
[19] A. Martinet, Linguistics Studies presented to André martinet on the occasion of his sixtieth birthday.
[20] Christine Deprez, Les enfants bilingues : langues et familles.
[21] R. Ellis, Understanding Second Language Acquisition.
![]() Télécharger l’article en version PDF
Télécharger l’article en version PDF
1. Introduction : la ville comme discours
La sociolinguistique urbaine[1], en tant que démarche visant à penser la mobilité au cœur des pratiques, a posé la nécessité de concevoir les espaces dits de ville comme des lieux de production non seulement des normes socio-spatiales, mais encore des normes langagières. Ce sont précisément les corrélations entre les discours topologiques visant à hiérarchiser les espaces et de fait les habitants qui y vivent, et les discours épilinguistiques rendant compte de la valeur sociale des différentes variétés de langues dans un même espace urbanisé qui fait sens des identités urbaines et de leur contraste. Penser ainsi la ville comme un espace plurilingue (socialement à minima) où se jouent, via les pratiques langagières, les tensions structurantes dudit espace, permet alors de la concevoir comme un processus, comme une matrice discursive de référence pour ses différents acteurs. Penser ainsi la ville permet enfin de construire une démarche interventionniste sur les tensions en cours (Bulot, 2011).
Le propos de cet article est de faire la part de la singularité de la ville d’Hanoï tout en mettant en avant la proximité des dynamiques langagières en œuvre eu égard aux situations urbaines déjà étudiées. Ainsi, nous rendons compte des représentations sociolinguistiques via leur mise en mots et particulièrement nous focalisons notre propos sur les pratiques des jeunes Hanoïens, dans la mesure où ils contribuent (au moins dans les discours épilinguistiques) à produire discursivement des normes substandard tout autant qu’à normaliser l’espace socio-langagier comme relevant d’une centralité linguistique nationale.
2. De quelques concepts en sociolinguistique urbaine
Travailler en sociolinguistique urbaine est bien entendu faire de la sociolinguistique, mais en interrogeant plus précisément en rapport avec les parlures urbaines d’une part les liens entre la production discursive des espace(s) et la mise en mots des lieux et, d’autre part les déplacements, les frontières et les limites intra-urbaines pour ce qu’ils permettent de saisir l’identité socio-langagière et les tensions et les conflits à l’intérieur de la communauté urbaine. C’est ainsi tenter de faire valoir minimalement l’opérativité tant discursive que cognitive de deux processus concomitants relatifs aux formes dites et/ou perçues comme spécifiques à un espace urbain donné : d’abord l’évaluation (hiérarchiser socialement les variétés de langues et les langues) et ensuite l’identification (attribuer les formes à des portions d’espaces) en tant qu’ils concourent à produire ledit espace, à l’organiser tout autant que ce que l’on appelle les structures socio-spatiales. Sans trop entrer dans le détail car cela a été largement exposé ailleurs (Bulot, 2009 et 2006), le chercheur peut retenir un socle conceptuel minimal visant à rendre compte de ces processus centraux à l’intelligibilité de l’espace des villes ; celui-ci tient en trois termes.
L’identité urbaine. Le concept permet de rendre compte des pratiques langagières des locuteurs urbains se représentant la tension ainsi posée entre leur indispensable identification à une communauté et leur propre différenciation par rapport à d’autres lieux communautaires de tous ordres, signalant une appartenance groupale ; par la prise en compte et l’analyse de leur mise en mots de cette tension, il s’agit de dégager la spécificité identitaire de toute ville, et partant de tout espace urbanisé.
La mobilité spatio-linguistique. L’un des effets inhérents à la mobilité spatiale est de mettre à distance les individus et les groupes, et de recomposer le lien social autour notamment des représentations que l’on s’accorde sur autrui et sur soi-même. Plus l’espace est urbanisé, plus le rapport à l’autre, le rapport à sa façon de parler, fonde les limites et frontières intra-urbaines ; de même le discours sur autrui, sur la langue ou la pratique de langue d’autrui devient par défaut autrui. Ainsi le concept ne renvoie pas au seul changement (ou la volonté mise en mots de changement) de langue ou de variété qui accompagnerait une mobilité sociale généralement ascendante, mais à la façon dont les déplacements que l’on opère et les rencontres « langagières » que l’on fait (ou croit faire d’ailleurs) déterminent la représentation que l’on croit commune de la ville que l’on habite ; il rend compte de la mise en contact différenciée temporellement et spatialement « de groupes urbains posés comme distincts par les acteurs de la mobilité spatiale » (Bulot, 1999 : 43).
Et enfin la territorialisation linguistique. La mise en mots de l’espace urbanisé (c’est-à-dire où le fait de pouvoir assumer ou non (Ripoll et Veschambre, 2006) la survalorisation de la mobilité spatiale (Rémy et Voyé, 1992) relève d’une double détermination : celle relative au territoire dans la mesure où on doit considérer l’espace comme une aire légitime de proxémie liée aux parcours, aux lieux de vie, de sociabilité et celle relative à la territorialité que l’on peut concevoir comme la représentation de ce même territoire. Ainsi le concept interroge le terrain pour savoir s’il y a juxtaposition, coïncidence entre deux univers représentationnels, entre un lieu tel qu’il est dit et les représentations topolectales de la langue. La territorialisation linguistique (Bulot, 2006) est la façon dont, en discours, les locuteurs d’une ville s’approprient et hiérarchisent les lieux en fonction des façons de parler (réelles ou stéréotypées) attribuées à eux–mêmes ou à autrui pour faire sens de leur propre identité.
3. Hanoï, une ville sociolinguistiquement singulière ?
3.1. Les terrain et questionnement sociolinguistiques
Hanoï est la capitale actuelle du Vietnam[2], et de fait une métropole, un centre politique, économique, culturel et social du pays. Comme toute ville de ce type, Hanoï est également un espace de rencontres, d’échanges des personnes venues de différentes régions du Vietnam, et dès lors un lieu de contacts de langues et de cultures de toutes sortes. En cela, elle n’est pas remarquable. Elle n’est pas davantage différente des autres villes du monde lorsque, en lien avec un accroissement de population sensible (Tableau 1), ses limites administratives évoluent vers un élargissement géographique des limites de la ville.
Elle n’est pas davantage exemplaire – sinon qu’elle constitue un laboratoire sociolinguistique manifeste des tensions en cours entre des politiques linguistiques unificatrices car persuadées des bienfaits du monolinguisme comme idéologie et les dynamiques langagières pertinemment diverses et hétérogènes – lorsqu’elle se pose comme matrice discursive[3] et impose ses catégorisations, dénominations et désignations tant des personnes, que des langues que des espaces, et que, dès lors, elle donne à penser à ses habitant-es que la ville pré-existe à leurs discours. Elle n’est pas davantage remarquable lorsqu’elle inclut des populations et des langues différentes marquées par la glocalisation (Robertson, 1995 ; Bierbach & Birken-Silverman, 2007) et les pratiques urbaines valorisantes et valorisées par les mobilités de tous ordres.
| Année | Population (habitants) | Superficie (km2) |
| 1954 | 53 000 | 152 |
| 1961 | 91 000 | 584 |
| 1978 | 2 500 000 | 2.136 |
| 1991 | 2 000 000 | 924 |
| 1999 | 2.672.122 | 924 |
| 2005 | 3 200 000 | 924 |
| 2007 | 3 398 889 | 924 |
| 2008 | 6 233 000 | 3 344,7 |
| 2009 | 6 451 909 | 3 344,7 |
| 30/10/2010 | 6 913 000 | 3 344,7 |
Tableau 1 : Hanoï : population et superficie
Ce qui la rend remarquable est un faisceau de facteurs : parce que l’élargissement n’est pas dû à un élargissement a posteriori de la population qui aurait afflué vers la ville mais une volonté de construire une ville à échelle mondiale, parce qu’il existe un discours identitaire fort sur ce qu’est être hanoïen, parce que l’identification à cet espace valorisant que constitue la figure choronymique des quartiers anciens est un enjeu identitaire d’auto-identification, le discours sur la langue d’Hanoï (le parler hanoïen) construite comme unique, distincte et mono-normée, donc, de fait, le discours épilinguistique sur leurs propres pratiques plurinormées, devient, pour les habitant-es de la ville un outil de catégorisation discriminant – mais structurant – les différents groupes sociaux qui la compose (cela en partie dû à l’élargissement mais aussi à la mobilité interne de certaines populations, notamment les étudiant-es).
3.2. Méthodes d’enquêtes et échantillon
Dans un contexte officiellement monolingue (Nguyen Xuan, 1991 ; Tran, 1991 ; Hoang, 1985), peu exploité dans et par une approche discursive[4], enquêter sur la pluralité langagière et qui plus est dans une variété autre que ce que l’idéologie impose et construit comme norme unique est plus qu’une gageure ; cela expose tant le chercheur que les enquêté-es à de réelles difficultés ; c’est pourquoi, la stratégie d’enquête retenue, somme toute pour travailler sur une situation de minoration socio-langagière – une discrimination sociolinguistique (Bulot, 2013) auto et hétéro attribuée – a été a) de choisir une population marquée par la compétence certes de la norme de référence (la langue vietnamienne enseignée à l’école) mais encore par une compétence linguistique altéritaire, en l’occurrence des étudiant-es en français de l’Université de Langues et d’Etudes Internationales de l’université nationale de Hanoï et b) de considérer que, via d’abord des entretiens semi-directifs, la langue devait permettre la pluralité des mises en mots pour recueillir des observables que l’on puisse ensuite analyser qualitativement (a priori le choix de la langue est du fait de l’enquêté-e) et ensuite via des questionnaires pour une approche plus quantitative des réponses (ĐẶNG, 2012).
Ces étudiants sont originaires de plusieurs régions du pays mais aussi de Hanoï (dans toutes ses acceptions), habitent dans cette ville depuis au moins trois ans et ont donc pu intégrer les discours dominant produit par la matrice discursive[5], ont des contacts et des échanges avec les gens vivant à Hanoï et dès lors eu des choix à faire interactionnellement devant les différentes variétés du vietnamien. Les recueils des observables ont été réalisés en deux temps[6] : la pré-enquête par entretiens semi-directifs en 2011 et l’enquête elle-même par questionnaire en 2012[7].
L’entretien est thématisé en trois temps : le territoire de Hanoï, l’identité hanoïenne et le(s) parler(s) hanoïen(s). Au total, 27 questions réparties en trois grands items : les questions concernant les représentations sur le territoire de Hanoï et l’identité hanoïenne, les questions concernant le parler hanoïen et les questions portant sur les caractéristiques sociales des informateurs. Dix entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès de 10 informateurs (6 filles et 4 garçons) de la promotion QH2007[8] fin juin et début juillet 2011[9]. Ils/elles ont entre 21 et 23 ans et déclarent habiter[10] toutes et tous à Hanoï au moment des entretiens. Parmi ces informateurs, trois sont nés dans l’« ancienne » Hanoï (avant l’élargissement de 2008), un dans Hanoï « élargie » (voir la carte ci-dessous). Les six autres sont nés ailleurs (hors Hanoï).
4. Hanoï et les mises en mots de l’espace
4.1. La pluralité des désignations de la ville : le rapport à l’identité
Les désignations d’Hanoï sont plurielles sans pour autant être exclusives les unes des autres : c’est une ville « ancienne », « vieille » « nouvelle », « élargie ». Hanoï « ancienne » ; elle est celle des livres, de la littérature, des poèmes ; l’Hanoï de leur enfance, vécue ou racontée et aussi celle d’avant l’élargissement de 2008. Les enquêté-es parlent d’un espace citadin (Bulot, 2011), « moral », « abstrait », qu’ils nomment Hanoï « Hanoï1 ». L’Hanoï « nouvelle », « élargie » est tantôt Hanoï d’avant et après 2008, tantôt seulement les nouvelles régions de Hanoï ; en fait, le terme « Hanoï2 » est utilisé de manière récurrente pour désigner les régions élargies de Hanoï.
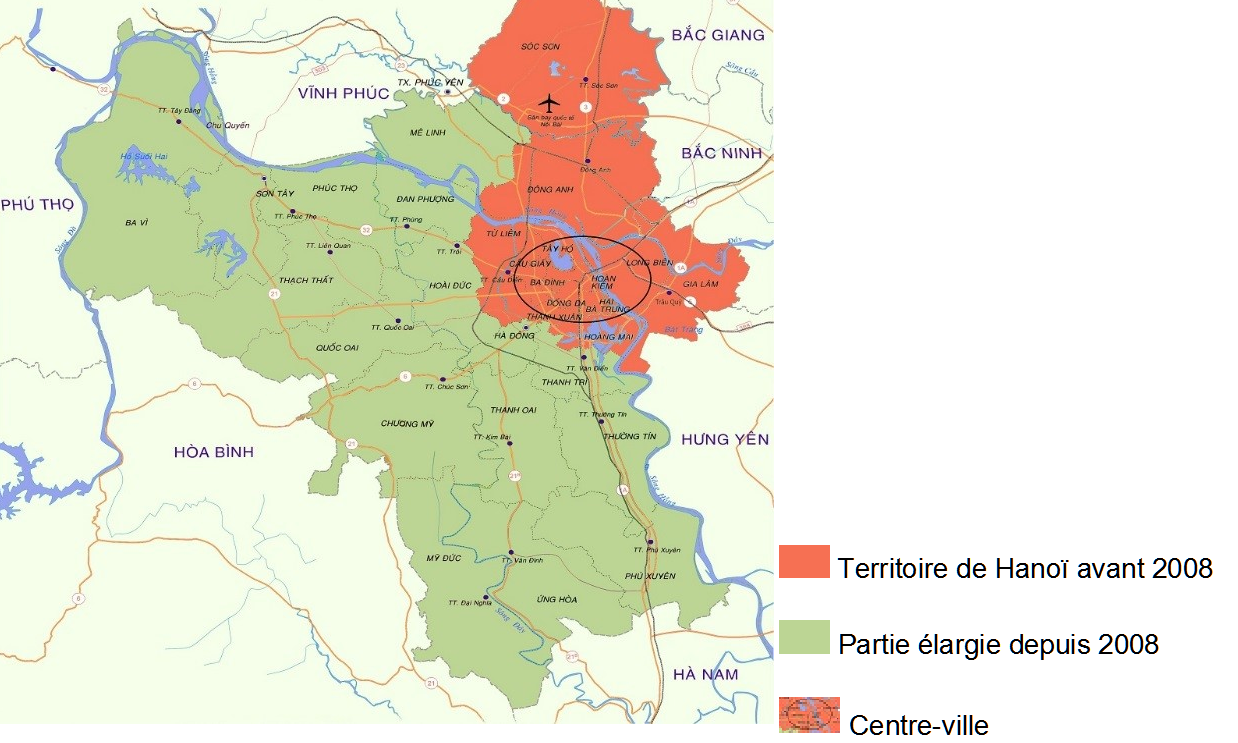
Pour ce moment d’enquête, sur les dix informateurs[11] deux garçons (M1, M3) et une fille (F6) sont nés à Hanoï1, un garçon (M2) est né à Hanoï2, un garçon (M4) et une fille (F5) sont nés dans le Centre du Vietnam, une fille (F3) est née dans le Sud et les trois autres filles (F1, F2, F4) sont nées dans le Nord. Nous appellerons les informateurs qui ne sont pas nés à Hanoï les « nés ailleurs ». Les trois nés à Hanoï y habitent évidemment depuis leur naissance. Six sur sept nés ailleurs habitent à Hanoï depuis leurs études universitaires, donc depuis 4 ans. F4 n’est pas née à Hanoï, mais y habite depuis l’âge de 10 ans.
Sur le plan politique et démographique, six informateurs sur dix sont de statut hanoïen et possèdent « le passeport intérieur (hộ khẩu)[12] de Hanoï ». En effet, M1, M3, F6 le sont évidemment, car ils sont nés à Hanoï de parents hanoïens, M2 né à Hanoï2 et l’est naturellement depuis 2008. F2, F4 (et sa famille) ont « changé de statut » et obtenu les passeports intérieurs de Hanoï. F1 est en cours de « changement de statut ». Les trois autres qui n’ont pas (encore) ce statut sont nés dans le Centre et le Sud du Vietnam.
Habitant ce lieu et possédant même le « passeport » (6/10 informateurs), les nés ailleurs et nés à Hanoï2 déclarent de fait ne pas être hanoïens. Seuls les trois nés à Hanoï1 répondent affirmativement à la question « Es-tu hanoïen-ne ? ». Pourtant selon M3 : « Je suis obligé de me présenter comme Hanoïen, mais je n’aime pas me présenter ainsi […] en effet, je veux me considérer comme Hanoïen, mais je ne le suis pas […] je ne suis pas une personne hanoïenne dans mon imagination ». Ce discours est corrélé aux attributs généraux de l’identité des Hanoïen-nes. A la question portant sur la fierté d’être un Hanoïen-ne, les réponses sont toutes affirmatives pour les informateurs nés à Hanoï, car « d’abord les Hanoïens sont souvent des gens civilisés, polis et ils ont une longue tradition culturelle » (M1) ou simplement comme F6 « le fait d’être hanoïenne, c’est agréable ». Comme Hanoï est la capitale du Vietnam, les Hanoïen-nes ont un autre motif de fierté : ce sont « des citoyens de la capitale » (M1, M2, M3, F4, F6). De même, M4 venu du Centre, déclare que les habitants des autres provinces sont aussi fiers des Hanoïen-nes, car ces derniers peuvent montrer qu’ils méritent d’être citoyens de la capitale.
L’enjeu symbolique est clair et lourd de tensions socio-spatiales : devenir hanoïen-ne signifie prendre part à une identité valorisante que par ailleurs d’autres discours vont marquer comme fracturée voire excluante; selon F1, F2 et F4, si un-e Vietnamien-ne est né-e ailleurs ou a changé de statut, il est préférable d’être fier du lieu (de la province) où on est né. Et pour F3 « S’il s’agit seulement que l’on soit citoyen de la capitale, il ne faut pas en être fier. Il vaut mieux seulement être fier quand on contribue quelque chose (au développement) à cette ville ». En regard de la survalorisation de l’identité hanoïenne, on ne peut que comprendre ces discours qu’à l’aulne d’un contre-discours, d’une quasi contre-norme socio-spatiale.
4.2. Des fractures territoriales et identitaires
À la question « Quelles sont les limites / la frontière de Hanoï dans ton imagination ? », les dix informateurs la localisent dans les arrondissements intérieurs de Hanoï1. M3 et M4 disent même que Hanoï comprend seulement les 3 « anciens arrondissements » (M3 : Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng ; M4 : Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình). Pour eux, le lieu symbolique, représentatif de Hanoï est le lac Hoàn Kiếm (lac de l’Épée restituée), les vieux quartiers (dans l’arrondissement de Hoàn Kiếm) et/ou tout cet arrondissement, car ce lieu « conserve l’âme de Hanoï ». En effet, parlant du « territoire de Hanoï », les informateurs ne citent pas davantage les communes extérieures de Hanoï1 comme : Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm. Il semble donc qu’ils soient plutôt défavorables (neuf sur dix) à l’élargissement de Hanoï en 2008, du point de vue culturel, car d’après eux : « On ne peut pas concilier les deux cultures » (M3); « Chaque région a sa façon de vivre » (F2); « [L’élargissement] crée un tableau avec les couleurs claires et sombres et les parties sombres enlaidissent la ville » (F3); « La culture de Hanoï est la norme, l’élargir à une autre culture, ce n’est plus la norme, c’est le “mélange” » (M1) ; « Dans les régions élargies, il y a des citoyens de la capitale[13] qui sont plus pauvres que ceux de l’extérieur (d’autres provinces ?), leurs conditions de vie ne peuvent pas atteindre celles d’autres provinces, ce n’est pas raisonnable » (M4) ; « Élargir, oui, mais trop élargir […], ce n’est pas raisonnable » (F2). Mais M2 (né à Hanoï2) lui en revanche apprécie ce projet sur le plan du développement économique, car c’est une chance pour que « les régions pauvres se développent ». Toujours d’après M2, « la plupart des habitants de ma « région » sont fiers de devenir Hanoïens ». Pour F1 cela va « aider la ville à décentraliser les zones industrielles et les écoles, pour que la ville ne soit pas trop peuplée, trop ‘trépidante’ »
Alors, « qu’est-ce qu’Hanoï » ? Selon les discours tenus, c’est plutôt un espace urbanisé, une grande ville, animée, peuplée, mais donc bruyante et même “trépidante”. Donc si l’on veut éviter ces inconvénients, on va habiter « dans ses environs où il y a encore des rizières, mais ces régions appartiennent peut-être aussi à Hanoï » (M2). Hanoï est aussi le lieu où on trouve plus facilement du travail et où l’on gagne mieux la vie : « La formation m’oblige à rester ici, je ne peux pas trouver un emploi avec la formation d’enseignant de français dans ma province » (F1) ; « C’est une ville au-delà de fleuve, un lieu où il y a de grands centres et qui offre des possibilités d’être en contact avec les progrès scientifiques du monde » (F2, F6, M2). Selon F4, c’est son deuxième pays natal, car « il y a ici ma famille, mes amis et mon travail ». Quant à M1, « c’est encore le lieu où je suis né ». À cette question même, nos informateurs/trices rapportent et renvoient à une ville idéalisée comparant le passé au présent : Pour eux/elles, la ville d’autrefois est à la fois Hanoï1 et Hanoï « dans les livres » (M3) : plus belle, moins peuplée, plus tranquille, plus paisible, avec plus de contacts humains ; c’est une ville jolie avec les gens qui pédalent et font du petit commerce.
La question identitaire se pose ainsi en termes de légitimité. En fait existent en discours, mais aussi dans les pratiques sociales de relégation, de vrais Hanoïens[14] – ce qui suppose qu’il y en ait de faux – opposés à des gens de toutes les classes sociales, venus de partout – étudiants, ouvriers, paysans saisonniers, employés et nationaux ou étrangers – qui veulent travailler et habiter dans cette ville. Quels sont les attributs de cette identité urbaine mise en mots et renvoyant à une norme fantasmée dont nous verrons les effets sur les pratiques et représentations liées aux langues, à la langue ? Elle relève de plusieurs traits congruents :
« personne dont la racine est à Hanoï d’autrefois, dont la famille, les parents, les grands-parents sont là […], depuis au moins 3 ou 4 générations qui y habitent » (F1, F3, F5, F6, M1) ;
« Ce ne sont pas les gens venus ailleurs et qui ont changé de statut » (F1) ;
« une personne de Tràng An[15]» polie, élégante (F2, F4, F5) ;
« Une personne hanoïenne est souriante, douce, calme, conviviale » (F2, F5, F6).
« Les Hanoïens utilisent des petits bols, ils mangent par une petite quantité à chaque fois, ils mangent lentement » ; ils sont « civilisés, polis » (F4) ;
« Ils ont une longue tradition culturelle » (M1) ;
« Ils s’intéressent à l’apparence, les vêtements, les moyens de transport sont luxueux (…) ils ont tout ce qui est de meilleur, ils sont plus intelligents que les gens des provinces » (M2).
L’incarnation de cette identité renvoie également à une modélisation de l’espace marquée par la présence d’une population respectueuse des valeurs confucéennes. Concernant la question des personnes représentant le mieux cette identité, les réponses données vont vers les vielles personnes, comme gardiennes des traditions culturelles, à ces personnes âgées qui font de la gymnastique ou qui marchent autour des lacs, à ces jeunes intellectuels, dynamiques, intelligents, à ce vieux monsieur assis sur le banc au bord du lac de l’Épée restituée. C’est aussi une image féminine d’une commerçante dynamique, entreprenante, ou l’image d’une jeune fille en tunique traditionnelle, d’une jeune fille élégante qui sait bien faire la cuisine, de bons plats pour les fêtes et au quotidien, et sait aussi jouer d’un instrument ... De fait, « de nos jours il reste très peu de vrais Hanoiens » (F3, F5), car ils sont « métissés avec des gens venus ailleurs » (M4) ou « ils partent à l’étranger ou vont habiter à HoChiMinh-ville » (F3). Les vrais Hanoïens « existent, mais en petite quantité » (F3, F5, M4) : « Ce sont les vieux dans les vieux quartiers ou les jeunes qui vivent pour cela (les valeurs humaines) (M3) » et selon F3 : « Les caractéristiques des Hanoïens ont disparu depuis longtemps, ils n’existent plus ».
Idéalisée, cette identité est pourtant marquée à son tour a) par la proximité relationnelle, sans doute à comprendre comme un trait de désirabilité sociale (i.e. « je côtoie les vrai-es Hanoïen-es et cela me valorise »). « Ma tante est une vraie Hanoïenne […] ses frères et sœurs, sa mère aussi […] c’est agréable quand on est en contact avec eux » (F2) ; « C’est une dame, vendeuse de café dans les vieux quartiers […] et bien que je sois étudiant, elle m’a servi comme un client riche » (M4) ; « Je connais des filles dans les vieux quartiers, leurs parents leur apprennent la façon de cuisiner […], elles savent jouer des instruments » (F5). Et b) par une mise à distance fondée sur le refus d’accepter la mixité des pratiques sociales effectives : « les gens de Hanoï d’aujourd’hui sont plus indifférents (M4)», que « ce sont les gens de tous les coins du pays » (F2, F3) et qu’« ils font perdre les beautés de l’ancienne Hanoï » (F3). Toujours pour F3 : « La différence entre une personne hanoïenne d’autrefois et d’aujourd’hui, c’est la pérennisation des caractéristiques culturelles ».
5. Le parler hanoïen ou la territorialisation des pratiques sociales
5.1. La norme de référence : le parler des « vieux »
La question de langue est centrale à Hanoï dans la mesure où le vietnamien qui est dit y être parlé est censé être la norme. On retrouve cette configuration dans tous les Etats centralisateurs et de ce point de vue le Vietnam n’échappe pas à ce principe : la langue de la capitale doit être la langue de l’Etat et, partant de la nation cependant que les pratiques langagières de ladite capitale sont tout autant hétérogènes que dans les autres parties du territoire linguistique.
En discours, un parler hanoïen de référence existe. C’est un parler « facile à entendre, à comprendre » (F3, F6, M1, M4), avec « une bonne prononciation […] les mots utilisés sont les plus normés trouvés dans le dictionnaire » (M1), « il n’y a pas de mots des provinces » (F2, M1), ses locuteurs et locutrices « …prononcent légèrement / plus agréable à entendre / pas trop lourd/vite comme les autres provinces » (F1, F4, M2), ou « la voix est légère » (thanh, nhẹ) (F1, F2, F3, M2), « ils prononcent bien avec clarté (ils ne confondent pas l et n, ils parlent doucement, pas trop fort », (F2) « ils parlent lentement, pas trop vite comme dans ma province » (F4), « ils font des phrases avec tous les éléments sujet, prédicat » (F1, F4), « les sons sont assez faciles à entendre […] séduisants » (F3). Selon nos informateurs, le parler hanoïen doit être considéré comme une norme car c’est « le parler de la capitale » (F5) » et que « être capitale signifie être lieu des normes » (M3), ce parler est aussi valorisé comme un « parler avec une voix représentative, typique et intéressante » (F1) du Nord, voire « la langue norme du Vietnam » (F5) sans pour autant être la norme de tous, même si par ailleurs c’est le parler des médias, des journalistes de la chaîne télévisée nationale. Langue de la modernité, ce parler est aussi celui de la tradition (on retrouve les attributs précédents) dans la mesure « [les vieux[16]] sont des musées […] avec des expériences de vie » (F5); « La voix des vieux sont plus légère, plus agréable/intéressante que celle d’autres provinces » (F1), « Ils sont gardiens de la tradition culturelle […] ce sont eux qui apprennent aux descendants les valeurs traditionnelles » (F5) et, conséquemment incarnent la pureté linguistique« Le parler des vieux Hanoïens est le plus conforme à la norme » (F4). Paradoxalement – mais de fait c’est inhérent aux modalités de minoration sociolinguistique, où une façon de parler, une langue, peut être identitaire et en même temps partiellement ou totalement rejetée ; le parler hanoïen semble avoir des défauts : les Hanoïen-nes ne prononcent pas correctement la langue : « Ils ne roulent pas le r » et « Ils confondent entre r et d, entre tr et ch » (M4, F5). Ou selon M3, « le parler hanoïen n’a pas d’âme ».
5.2. Et le parler des jeunes Hanoïens ?
Nous avons récemment (Bulot et Feussi, 2012 : 18) rendu compte d’une typologie complexe des parlers dits de jeunes – donc générationnels – en situation urbanisée. Les parlers des jeunes Hanoïen-es n’échappent bien entendu pas à cette typologie. Leurs pratiques sont diasporiques (Simonin, 2010) par la dimension novatrice des contacts de langues mis en jeu (l’anglais s’impose comme langue de modernité) dans un contexte fort d’échanges médiés via les TIC, plurilingues car ils procèdent de compétences relevant du plurilinguisme (Coste, Moore, Zarate, 1999) tant entre variétés nationales que par les apports des autres langues, urbanisés (Rémy et Voyé, 1992) car liés aux mobilités et motilités (Kaufmann, 2008) autant des langues, des parlures que des personnes, des cultures…, hiérarchisés puisqu’ils renvoient à des pratiques où se jouent la stigmatisation et la discrimination (Doytcheva, 2007 ; Bulot, 2006b et 2013), identitaires par la dynamique des marquages spatiaux (Ripoll, 2006 ; Bulot, 2011), langagiers pour ce que cela suppose des espaces publics, énonciatifs, où de telles pratiques deviennent la norme, glottogénétiques pour ce qu’ils illustrent de la glottogénèse des langues au sens sociolinguistique du terme (Feussi, 2008), et enfin politiques (Lamizet, 2002) dans la mesure où ils questionnent le lien social et les discours glottonomiques actifs dans la société vietnamienne où le parler des jeunes hanoïen-nes font prescription des relations à engager entre groupes sociaux qui s’opposent symboliquement et/ou économiquement.
Les discours ne distinguent plus le parler des jeunes vrais Hanoïen-nes ou le parler des gens d’ailleurs. En ce sens, l’espace langagier hanoïen tend à fusionner : « Il n’y a pas un parler propre des jeunes Hanoïens, c’est le parler des jeunes en général » F3. Et du point de vue des jeunes eux-mêmes, ce parler compose avec des langues étrangères (anglais, français, chinois…), utilise des mots grossiers, les mots d’argot, des contrepèteries, des insultes en langue étrangère « Il y a des jeunes qui ajoutent souvent des gros mots, ce n’est pas dans le but d’insulter les autres, mais parce que c’est leur habitude de parler » (F1) ou « l’utilisation des gros mots est naturelle, car c’est difficile de se maîtriser quand on est jeune, donc ils disent des gros mots » (F3) ou encore « il semble que quand on utilise les mots d’insultes en langue étrangère, ça devient plus léger » (M4). Ils utilisent aussi le langage du chat, écrivent avec des signes, remplacent des lettres (h pour k ; j pour gi[17] ; y pour i (roy au lieu de roi[18] ; đai au lieu de đay[19]) ; p pour b). Ils prolongent et/ou raccourcissent les mots, ils les détournent aussi. Ils font des changements dans le vocabulaire et aussi la façon de parler : pour parler des unités de monnaie, ils emploient củ[20] pour dire million, ou quand les parents leur donnent de l’argent ils disent qu’ils sont chargés[21].
Comme les autres pratiques juvénalophones (Bulot, 2001), l’innovation et la connivence de l’endogroupe y sont permanentes « Je suis 8X et je me sens vieille devant ces jeunes sur le plan langagier, je ne peux pas comprendre » (F1) ou « Je ne peux pas toujours comprendre ce que les jeunes disent, c’est seulement entre leur groupe. Je suis jeune, mais en écoutant les 9X ou 0X je ne peux pas comprendre » (F2) ou encore « Ils ne peuvent se comprendre qu’entre eux » (M4). Et, par ailleurs, elles gardent une valeur dépréciée « Je l’utilise, mais au bas niveau, les autres peuvent toujours comprendre, ce n’est pas comme les jeunes » (F2), mais néanmoins active interactionnellement « Entre amis on l’utilise, mais je n’aime pas, j’ai l’impression que l’on perd quelque chose […] la perte de la langue vietnamienne » (F5), M1 affirme qu’il peut tout comprendre ce que les jeunes disent, mais « (je) n’utilise jamais le parler des jeunes, je veux garder les valeurs/identités culturelles ».
Se déclarer locuteur / locutrice d’une forme finalement stigmatisée parce que le statut que l’on s’accorde n’est pas en adéquation avec la valeur de ladite forme sur le marché linguistique renvoie là encore à la complexité des espaces. Il ne faut en effet pas oublier que les discours rapportés ici sont ceux de la dominance (les enquêté-es sont sinon Hanoïen-nes du moins en situation de pouvoir accéder à ce statut via leur mobilité sociale ascendante. Leur identité locative (être hanoïen-ne pour réussir sa mobilité) est prégnante sur leurs stratégies non seulement socio-spatiales, mais discursives et encore identitaire : c’est le discours sur la ville d’Hanoï qui structurent leur appréhension de la diversité des pratiques de tous ordres.
6. Pour conclure : une circulation des normes ?
Les différents discours topologiques et épilinguistiques ont montré que les représentations de Hanoï viennent ou de ce que ses usagers ont lu ou entendu dire (les discours circulants, les discours dominants) ou de leurs propres expériences (leur mémoire sociolinguistique visant à inscrire dans les usages individuels des pratiques collectives plus ou moins perçues mais pleinement vécues). Sur le plan sociolinguistique – on peut alors parler de territorialisation active –, il apparaît que le centre de la ville est discursivement constitué comme un modèle, mais en quoi y a-t-il circulation des normes ?
Les discours sur la langue et ses pratiques n’ont de pertinence qu’en lien avec leur spatialisation. Construites comme hanoïennes (avec ses modalités), comme vietnamiennes, comme urbaines, comme jeunes, les pratiques en question relèvent autant de pratiques différenciées normées que de stratégies identitaires. Comme toutes pratiques – fussent-elles décrites comme seulement générationnelles – elles sont de fait les indices et traces urbaines des nouvelles formes d’exclusion où la connaissance de la langue – en fait de la variété dominante spatialisée – pour réussir son intégration sociale reste en discours la condition indispensable et quasi-rédhibitoire ; mais où, en pratique, cette connaissance renvoie conjointement à une connaissance dévalorisée et surtout frustrante de la langue dominante quasi-exogène.
Références bibliographiques
BIERBACH C., BIRKEN-SILVERMAN G., 2007, « Bergers siciliens et hiphoppeurs new-yorkais. Le parler « glocal » des jeunes immigrés italiens à Mannheim », dans Les codes de la ville (Cultures, langues et formes d’expression urbaines), L’Harmattan (Collection Espaces Discursifs, Paris, 233-266.
BULOT T., 1999, « La production de l’espace urbain à Rouen: mise en mots de la ville urbanise », dans Langue urbaine et identité (Langue et urbanisation linguistique à Rouen, Venise, Berlin, Athènes et Mons), Paris, L’Harmattan, 39-70.
BULOT T., 2001, « Réactions sur l’article de Gudrun Ledegen », dans Les « parlers jeunes » à La Réunion, Travaux et Documents 15, Service des Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l'Université de la Réunion, La Réunion, 113-118.
BULOT T., 2006, « La production discursive des normes : centralité sociolinguistique et multipolarisation des espaces de références », dans French Language Studies Vol 16 / 3, Cambridge University Press, Cambridge, 305-333.
BULOT T., 2006b, « Discrimination et processus discursifs de fragmentation des espaces urbains. Signalétique et bilinguisme », dans Mots, traces et marques (Dimensions spatiale et linguistique de la mémoire urbaine), Paris, L’Harmattan, 97-122.
BULOT T., 2009, « La territorialisation sociolinguistique de la migrance (Propositions pour modéliser la discrimination des espaces en contexte plurilingue) », dans Formes & normes sociolinguistiques (Ségrégations et discriminations urbaines), L’Harmattan (Collection Espaces Discursifs), Paris, 15-28.
BULOT T., 2010, « Normalisation et normaison des espaces et des langues : la ville comme matrice discursive », dans Langues et espaces, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Pessac, 177-188.
BULOT T., 2011, « Espaces urbanisés durables et/ou espaces vulnérables en situations plurilingues. Mesures et questionnements sociolinguistiques », dans Sociolinguistique urbaine - Identités et mise en mots, Martin Meidenbauer Verlag, München, 73-92.
BULOT T., 2013, « Discrimination sociolinguistique et pluralité des normes identitaires (Linguicisme de référence et linguicisme d’action) », dans Cahiers Internationaux de Sociolinguistique 4, L’Harmattan, Paris, 7-26.
BULOT T., FEUSSI V., 2012, « Parlers (de) jeunes en situations urbaines francophones (Circulation des normes partagées et émergences de normes spécifiques) », dans Normes, urbanités et émergences plurilingues Parlers (de) jeunes francophones, L’Harmattan (Collection Espaces Discursifs), Paris, 5-21.
COSTE D., MOORE D., ZARATE G., 1999, Compétence plurilingue et pluriculturelle, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 70 pages.
ĐẶNG Thị Thanh Thúy, 2012, « Le parler jeune hanoïen : le cas des étudiants francophones à l’Université de langues et d’études internationales de Hanoi – UNH », dans Normes, urbanités et émergences plurilingues (Parlers (de) jeunes francophones), L’Harmattan (Collection Espaces Discursifs), Paris, 219-236.
DOYTCHEVA M., 2007, Une discrimination positive à la française ? (Ethnicité et territoire dans les politiques de la ville), La Découverte, Paris, 225 pages.
FEUSSI V., 2008, Parles-tu français ? Ça dépend … Penser - Agir - Construire son français en contexte plurilingue - Le cas de Douala au Cameroun, Paris, L’Harmattan, Espaces Discursifs, 288 pages.
HOANG Tue, 1985, « Évolution sociolinguistique du Vietnam », dans Cahiers de linguistique sociale 7, Publications de L`Université de Rouen, Mont-Saint-Aignan, 225-234.
KAUFMANN V., 2008, Les paradoxes de la mobilité (Bouger, s’enraciner), Presses Polytechniques et universitaires romandes (coll. Le savoir suisse), Lausanne, 115 pages.
LAMIZET B., 2002, Politique et identité, Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 350 pages.
NGUYEN XUAN Tu Huyen, 1991, « Les aspects polynomiques du vietnamien », dans PULA 3, Université de Corte, Corte, 344-354.
REMY J., VOYÉ L., 1992, La ville : vers une nouvelle définition ?, L’Harmattan, Paris, 173 pages.
RIPOLL F., VESCHAMBRE V., 2006, « L’appropriation de l’espace : une problématique centrale pour la géographie sociale », dans Penser et faire la géographie sociale, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 296-304.
ROBERTSON R, 1995, « Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity », dans Global Modernities, London, Sage Publications, 25-44.
SIMONIN J., 2010, « Diasporisations langagières : nouveau (?) défi sociolinguistique », dans Cahiers de Linguistique 36/1, EME et Intercommunications, Bruxelles et Fernelmont, 15-38.
TRAN Dinh Nghia, 1991, « La normalisation de la langue vietnamienne », dans PULA 3, Université de Corte, Corte, 396-401.
ZONGO B., 2004, Le parler ordinaire multilingue à Paris : Ville et alternance codique, L’Harmattan, Paris, 284 pages.
* PRES Université Européenne de Bretagne-Rennes 2 / EA 4246 PREFics / GIS Pluralités Linguistiques et Culturelles.)
[1] A poser comme une sociolinguistique de l’urbanisation (donc marquée par le spatial turn), posant la prégnance de la culture urbaine sur les pratiques de tous ordres et notamment les pratiques langagières.
[2] Et mise en mots comme une capitale millénaire. En 2010, Hanoï a fêté mille ans d’accession au statut de capitale du Vietnam (1010-2010).
[3] Les discours tenus sur la ville et qui sont considérés dans les pratiques sociales comme étant la ville, constituent la matrice discursive des normes et des espaces en relevant. La ville ne se réduit pas à ses discours, mais les discours sur la ville deviennent la ville perçue et se confond de la sorte avec le vécu (voir Bulot)
[4] Car il existe, au Vietnam, nombre de travaux sur la description linguistique de la norme, à l’instar de ceux qui existent en linguistique française en France, entre autres.
[5] Ce point a déjà été démontré sur d’autres villes comme Rennes, Rouen, Alger, Douala, etc. Voir http://www.sociolinguistique-urbaine.com/spip.php?article122
[6] Nous ne relaterons ici que le premier moment d’enquête (les entretiens).
[7] L’enquête par questionnaire est réalisée en mai 2012 avec les étudiants de la promotion suivante mais aussi en quatrième année ; ils ont terminé leurs études universitaires au moment de l’enquête. Le questionnaire est composé d’échelles d’attitudes non-prescriptives (Voir Bulot 1999) et de questions ouvertes qui ont à donner des exemples des situations précises où le parler jeune est utilisé et aussi à exprimer leurs représentations vis-à-vis des thèmes principaux de notre enquête : l’identité hanoïenne et le parler (jeune) hanoïen. Sur un total de 80 étudiants 75 questionnaires (cinq étudiantes absentes le jour de l’enquête) ont été recueillis (94 %). Sur cet échantillon global, 20 étudiants sur 75 sont nés dans l’« ancienne » Hanoï, 3 étudiants sont nés dans Hanoï « élargie », 46 sont nés dans les provinces du Nord du Vietnam et 6 dans les provinces du Centre du Vietnam.
[8] QH est le sigle de Quoc Gia Ha Noi (Université Nationale de Hanoï) et 2007 : l’année de l’entrée à l’Université selon la promotion.
[9] Cela représente plus de 10 heures d’enregistrements.
[10] De nombreuses enquêtes en sociolinguistique urbaine ont montré que l’identité locative (le lieu que déclarent les habitant-es comme le leur) est essentiel à la construction des discours de tous ordres. Cela a été montré une première fois sur la ville de Rouen (France) (Bulot, 1999).
[11] Pour anonymer les entretiens semi-directifs, ils sont codés selon le sexe et l’ordre chronologique de passation. M1 désigne le premier garçon interviewé et F1 lapremièrefille, etc. ce chiffre certes restreint a permis une saturation des données significative.
[12] Ho khau est « à la fois un livret familial et passeport intérieur utilisé dans les pays d’Extrême-Orient » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Huji)
[13] Le lexème « capitale» (la capitale, les citoyens de la capitale) est mentionné en moyenne quatre fois par tous les informateurs.
[14] Selon les discours sociaux dominants également repris dans les discours recueillis, une personne vraiment hanoïenne est originaire (sic) de Hanoï, a des qualités humaines effectives et sa famille habite là depuis au moins 3 générations.
[15] Dans les discours sociaux, il s’agit sans conteste d’une personne de la capitale.
[16] Le terme người già (les vieux) n’est pas un terme péjoratif. Il est souvent employé pour exprimer le respect des jeunes vis-à-vis des personnes âgées, car vieux signifie aussi expérimenté. Sur ce point retrouvons Bernard Zongo (2004 : 239) pour qui « ce terme ne possède pas la connotation péjorative que lui attribue le contexte européen, il est au contraire synonyme de sagesse et d’expérience » dans le contexte vietnamien.
[17] Gi= gì en vietnamien signifie en français quoi
[18] Roi = rồi pour dire en vietnamien que c’est réglé/fini/terminé.
[19] đai = đái (pisser); đay = đấy (voilà) / đâu đấy = où/quelque part
[20] Củ est une unité-quantité pour compter les légumes racines comme pommes de terre, patate douce, carotte
[21] Dans le sens où les fusils sont chargés.



