Sur le fil...
Safara n°22 est désormais disponible...
 Télécharger l’article en version PDF
Télécharger l’article en version PDF
Résumé
L’habitant d’une ville, lorsqu’il joue parfaitement le jeu de cette ville, est une parole que prononce cette ville. Toute ville en effet a du jeu et donne du jeu définissant son identité. Se mouvoir dans une « ville » comme Saint-Louis du Sénégal (Ndar guedj dans la langue locale) c’est en vivre et en exprimer le rythme si particulier. Étudier la forme de cette ville c’est en comprendre à la fois la grammaire et la forme de vie si particulière à laquelle cette ville-palimpseste donne lieu.
Mots-clés : discours, forme de vie, grammaire, jeu, lenteur, rythme, sémiotique, ville.
Abstract
The inhabitant of a city, when he plays perfectly the game of this city, is a word uttered by that city. Any city indeed has a game and gives the game that defines its identity. Moving in a "city" like St. Louis, Senegal (Ndarguedj in the local language) is living and expressing its so particular rhythm. To Study the shape of this city is to understand both the grammar and the particular form of life that this palimpsest-city engenders.
Keywords: discourse, form of life, grammar, slowness, rhythm, semiotic, city.
Introduction
À travers cet article, qu’on peut verser dans le cadre d’une sémiotique[1], nous voulons montrer que l’habitant d’une ville est celui qui se soumet au rythme de cette ville, c'est-à-dire qui parvient, comme dans un jeu d’échecs à réussir des coups dans cet échiquier comprenant des zones de sens. Ces zones de sens sont des plans d’expression jouant, comme nous le verrons, sur des substances variées (toute la panoplie constituant la sémiosphère). Mieux cette ville peut être considérée comme l’élément d’une partie d’échecs plus grande comprenant les autres villes avec lesquelles Saint-Louis entre en concurrence. C’est dans ce cadre que la fierté saint-louisienne prend tout son sens. Le citoyen défend la marque saint-louisienne, l’exemplifie. Nous voudrons dire cette ville après avoir réglé quelques éléments de protocoles épistémologiques (en 1) en insistant d’abord sur son caractère (section 2), sur son discours politique (section 3) avant de magnifier son art de vivre dans l’ultime chapitre.
1. Prémisses épistémologiques
En se comportant en Saint-Louisien le citadin énonce de ce fait des énoncés (comportements, habillements, cuisines (le fameux thiébou Ndar), démarche, intonation, Grand Récits…) bref des performances qui sont fidèles à l’essence, à la grammaire d’une ville comme Saint-Louis, ancienne capitale du Sénégal sise à l’ouest de l’Afrique. C’est l’occasion évidemment d’interroger toute la réputation qu’on prête à cette ville classée patrimoine mondial par l’Unesco. Les traits quasi anthropologiques qu’on lui prête expliquent la forte affluence de touristes[2] et les nombreux témoignages, il est vrai intuitif, que les ethnologues et romanciers ont fait sur la grammaire de cette ville. Ce discours sur le discours de cette ville est très juste pour sa compréhension dans la mesure où la ville, se faisant, se théorise par la voix de ses utilisateurs. Nous voudrions ici montrer, dans une perspective évidemment sémiotique, que Saint-Louis est un espace d’écriture, ou pour parler comme les théoriciens de la littérature, un texte dans lequel se déploie un horizon de sens, une revendication de signifiance, bref des valeurs de civilisation que l’on appelle depuis Wittgenstein une forme de vie[3], ici saint-louisienne (ndar ndar).
De la même manière qu’on parle de raison graphique, de raison orale, de raison numérique, de la même manière on pourrait parler d’une raison urbanistique. Cette forme de vie dicte sa loi, comme nous le verrons, à l’énonciateur par une certaine pression diffuse qui permet de repérer les conduites (ou énonciations) déviantes. La ville est, dès lors, un espace d’énonciation dans lequel les habitants se conforment à une grammaire (définissant une culture) qui régule le vivre-dans-le-monde (l’existence), le vivre-ensemble et le vivre-avec-les-autres.
Cette grammaire qui régit jusqu’aux expressions corporelles[4] (légitimant un appel à la grammaire tensive[5]) permet d’expliciter cette caractéristique fondamentale de la forme de vie saint-louisienne exprimée en termes de lenteur, de nonchalance et de maîtrise d’une passion telle que la colère. Cette caractéristique qui lorsqu’elle est revendiquée dans le champ international et supportée par une politique urbaine (un marketing) devient une marque de la ville. Cette caractéristique est encore plus sensible pour un observateur[6] extérieur (dont le modèle est l’Ethnologue) qui peut mesurer l’écart entre le régime tensif du Saint-Louisien et le régime tensif d’un Parisien[7]. Il va sans dire que cette grammaire tensive sera liée à une philosophie religieuse de l’existence qui s’explique par l’histoire. Plus qu’un espace neutre, la ville, dont jusque même les constructions sont des produits de cette culture à laquelle nous avons donné la dimension d’une forme de vie, est un champ dans lequel des possibilités de faire-sens sont disponibles. Dans un tel champ qui est un véritable espace d’écriture, une page bien différente il est vrai des réseaux (mégapoles) new yorkais, il est possible de saisir une certaine visée que nous dirons herméneutique. En se déployant dans un tel territoire, en y produisant un certain nombre de paroles (énoncés, performances) le sujet y survit.
Cette culture est réaffirmée par chaque sujet énonciateur de naissance ou d’adoption (ayant accepté de jouer le jeu). En même temps ces habitants s’affirment en tant que sujets dans ces valeurs, grâce à ces valeurs. La ville comme ses habitants revendiquent dès lors un caractère spécifique.
2. Le caractère de Saint-Louis
Sans toujours comprendre les ressorts de cette opération de personnalisation, on prête intuitivement aux villes un caractère. Dans les romans, qui fournissent les meilleures descriptions phénoménologiques et sémiotiques des villes, cette personnalisation est, quoique discrètement, devenue systématique puisque ces villes y sont, plus que des décors passifs, de véritables personnages.
Par leur présence diffuse elles agissent sur les hommes, les font agir. Les hommes sont en réalités des organes de ce corps gigantesque. Les Saint-louisiens actualisent Saint-Louis tout comme le locuteur wolof actualise la réalité virtuelle appelée le wolof. Il serait donc plus rigoureux de dire qu’une ville comme Saint-Louis est davantage une grammaire (ou, comme dirait Chomsky, une compétence) qu’un discours (une performance). Une telle démarche permettrait de suspendre la question de la vérité des valeurs saint-louisiennes que d’aucuns qualifient d’imaginaires[8]. À tout prendre, une culture est à la fois une identité et un système de valeurs régulant la perception et l’action et fonctionnant de ce fait comme une axiomatique.
Au fur et à mesure se forment dans une société comme des dimensions sémantiques transmises de génération en génération (dimensions que nous allons, au fur et à mesure, expliciter). Des légendes se tissent autour des villes. Plus la ville grandit, davantage sa légende s’enrichit dans une cohérence parfaite. Ces légendes fondent le génie de ce lieu, une formidable grammaire ayant la puissance d’une forme de vie.
Toutes les générations continuant le Grand Récit de cette ville laissent les traces de leur passage sur un décor très sélectif. Peu, au total, des acteurs de cette aventure, voient leurs noms officiellement retenus dans l’histoire d’une ville. Peu, eu égard à tout ce qu’une ville connaît de passagers (de personnages), deviennent des monuments qui, parce qu’ayant fait honneur à cette ville, ou même l’ayant marqué dramatiquement, représentent cette ville : constituent, en quelque sorte, pour parler comme Julien Gracq, les emblèmes. Saint-Louis fait partie de ces villes qui comptent peu de héros mais beaucoup de génies de lieux. Cette caractéristique n’empêche pas qu’elle est une ville fondamentalement révolutionnaire.
3. Le discours politique de Saint-Louis
Lorsque l’Historien jette un regard sur une ville aussi historique que Saint-Louis, pour dire qu’elle en a vu passer, il est surtout frappé par cet amalgame si étrange de vestiges qui survivent aux décors qui ont été conçus au prix de sang et de larmes. Cette ville est d’une hétérogénéité énonciative étourdissante. Tel un palimpseste les traces de plusieurs époques s’y manifestent. Telle rue, tel pont, telle bâtisse, telle maison… témoignent de l’intolérable légèreté de l’être. Les villes disent d’abord cela : à la fois l’insupportable vanité de l’homme et l’admirable volonté des hommes fidèles à une idée, idée qui s’appelle ici ville et ville qui fonctionne comme un testament écrit sur un palimpseste, par une multiplicité d’auteurs dont il ne reste que d’éphémères et précaires traces.
Cette idée qui prend corps, ou pour rester dans notre sujet, cette idée qui prend forme urbaine la Ville la raconte aux vivants en choisissant des figures, des modèles qui la représentent, qui constituent le prototype de son caractère. Ces histoires constituent les récits urbains, ou récits de fondation de lieux. Cette légende préserve le Génie d’un lieu. C’est ce qui fait que la Ville est fondamentalement peuplée de survivants, hantée par les fantômes des ancêtres. C’est cette fameuse attraction, dont parle Julien Gracq, qui relie la Ville à toutes les strates de son passé.
Une ville telle que Saint-Louis, la jeunesse fougueuse n’en perçoit que le présent si ce n’est la poussée vers le futur, est un collage de plusieurs époques. Vous y trouverez les vieilles bâtisses coloniales comme la Poste que les ancêtres, s’ils revenaient à la vie reconnaîtraient très facilement. Si vous prolongez votre chemin et si vous connaissez l’histoire de l’architecture vous tomberez sur un oxymore. Il s’agit de la grande mosquée dont le substrat est une église.

Illustration 1 : la grande mosquée
Cette mosquée fut une église. Cette mosquée a été arrachée aux colons. Cette évidence, ce fait simple sous la forme d’un lieu de culte, est une conquête, un titre de gloire. Et pour le colon et pour le colonisé. Celui-ci y montre son courage, celui-là son esprit de grandeur. On pourrait ainsi, écoutant les rumeurs de la ville, aujourd’hui si calme, y écouter des fantômes continuant de s’y battre. Certes les quartiers de l’Île (Lodo (nord) et Sindone (Sud)) ne sont plus aussi grouillants de monde et d’activités comme ils le furent vers les années soixante avant que Saint-Louis ne cesse d’être d’abord la capitale de l’A.O.F. et du Sénégal. A défaut de ce vacarme, s’élève une rumeur semblable à celle de la mer qui en constitue le contrepoint. Cette rumeur d’une autre nature, y est sensible voire palpable. L’architecture hétéroclite d’une ville qui jusqu’à maintenant résiste à la modernisation interpelle le Visiteur.

Illustration 2 : Saint-Louis, une architecture archaïsante
Saint-Louis semble en effet frappé du sceau de l’hysteresis. S’il n’y a pas comme dans New York un labyrinthe de rues, il s’y déploie une multiplicité impressionnante de plis temporels. Ce qui, on le verra, ne manque pas de rejaillir sur les mœurs de ses habitants.
Cette vieille capitale qui fut bruyante à l’instar de toutes les capitales, reste aujourd’hui bavarde sous la forme subtile du murmure. Une ville, en réalité, est, en soi, monumentale : elle est un énoncé légendaire. Ainsi, pendant longtemps, la Gare ferroviaire qui a constitué le cœur de Saint-Louis, lieu d’échanges intenses avec l’extérieur, se meurt aujourd’hui. On ne prête guère attention à ces vieilles bâtisses qui sont devenues pour l’autochtone inattentif, comme une catachrèse. En effet, paradoxalement, l’Indigène habite sa ville en automate. En général le Sénégalais ne lit pas ses rues ; on ne lui enseigne pas à lire sa ville, à la respecter, à la parcourir en pèlerin. Le Citoyen sénégalais n’est pas sensibilisé à cette épaisseur historique. Il faut percevoir le mouvement d’expansion de cette ville pour en comprendre le sens de conquête.
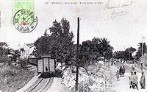
Illustration 3 La route de Sor et la gare primitive vers1902
La gare a résonné comme une insulte pour le colonisé et un titre de gloire pour le colonisateur. Le symbole de sa force et de sa bonté. Lorsqu’à un certain moment il a été mis fin à ce train dont les hurlements réguliers rythmaient la vie des Saint-Louisiens, le Politique ne répondait certainement pas, par-delà, les années, à Faidherbe. Il ne pensait certainement pas à Lat Dior Ngoné Latyr Diop refusant jusqu’à la mort son implantation. Nous entrons dans le domaine fascinant des symboles urbains grâce auxquels les villes deviennent des actes politiques.
Par sa pérennité et sa fidélité à son histoire, la Ville proclame son affirmation de la durée et sa résistance au temps. Lorsqu’on considère tous ceux qui ont bâti pierre par pierre une ville, ceux qui ont connu leur heure de gloire et dont ne subsistent que quelques infimes traces, on prend la mesure du sens de ces agglomérations. Elles nous rappellent, si nous voulons bien prendre la pleine mesure de leur gravité exceptionnelle, qu’éphémères sont les hommes. Même les cimetières, au terme seulement de quelques générations, sont plongés dans l’oubli. Au terrain Wembley la jeunesse joue sur les ossements des morts. Les défenseurs des tombeaux, ceux qui entretenaient les tombes, sont depuis longtemps morts. Les enfants qui ont renoncé à maîtriser cette interminable généalogie s’occuperont de leurs fraîchement-morts. On comprend de quelle manière les villes se conçoivent : grâce à l’oubli. Mais les pères viennent, selon une manière à dire, hanter les lieux. Comme quoi les morts ne sont pas morts… Ainsi, dans le mystère de la mémoire collective si exacte : elle trie très exactement.
On pense à la tour de Babel. On pense à New York de Léopold Sédar Senghor avec « Les gratte-ciel qui défient les cyclones sur leurs muscles d'acier et leur peau patinée de pierres ». On pense à toutes ces œuvres à travers lesquelles une Nation exprime sa grandeur. Les villes, tout espaces qu’ils soient, sont des êtres temporels et politiques. En effet une ville est d’abord, dans la dimension dite géopolitique, à une échelle compétitive, un territoire. Une ville est délimitée par une frontière matérielle, empirique, mais ce matériau est travaillé par un ordre formel qui en fait le moyen de l’affirmation souveraine d’une identité dans le temps. Elle est constance et fidélité à des valeurs dans la durée. Ces valeurs d’urbanité définissent les lois de l’hospitalité et le caractère de cette cité.
4. Saint-Louis : un art de vivre
Une ville comme Saint-Louis, est célèbre pour son urbanité qui est élevée au rang d’art de vivre, ou, en termes sémiotiques, de forme de vie[9].
Un écrivain saint-louisien, comme tout écrivain de ville, est celui qui a su saisir et exprimer l’âme de cette ville, la forme de cette ville. Pour décrire une ville, il ne suffit pas d’être né dans une ville, mais de co-naître à cette ville. Cette compréhension est aisée pour les phénoménologues aptes à saisir d’emblée l’âme d’une ville. Pour être une cité il faut impérativement avoir vécu dans cette cité, être imprégné positivement de son atmosphère, en comprendre le pouls, l’âme, à savoir cet équilibre insaisissable au premier regard.
Ecrire une ville comme Saint-Louis, ou en wolof Ndar Guedj, c’est très exactement la prendre comme personnage principal. Tous les autres personnages ne sont que prétextes pour se livrer à la psychologie de cette ville.
Par personnages nous entendrons :
- Les fameux Citadins qui subissent impavides la loi des villes et parfois tentent de se révolter ;
- À l’occasion les campagnards qui s’y perdent où y cheminent avec un regard ethnographique ;
- Les objets techniques comme métros, trains, car-rapides ;
- Les avenues, boulevards, rues et ruelles.
Chaque habitant d’une ville en porte l’empreinte indélébile : le Saint-Louisien est Saint-Louis. Du reste le Saint-Louisien exilé dans cette ville qui, au plan caractérologique est aux antipodes de Ndar Guedj, nous voulons parler de Dakar, est facilement reconnaissable à sa démarche, à son air, à ce je ne-sais-quoi auquel on reconnaît la marque d’une ville.
En effet chaque ville a sa personnalité. Notamment cette ville traditionnelle qu’est Saint-Louis et qu’une espèce de ceinture aquatique et les avatars de l’histoire (il aurait pu être le Dakar d’aujourd’hui) empêchent, du moins pour le moment, d’atteindre les dimensions gigantesques d’une mégapole. Habiter Saint-Louis c’est s’y adonner à un art de vivre, ou pour parler comme Jean-Luc Nancy, un art de la ville[10] bien singulier.
Ndar Guedj (en wolof la ville marine) est une ville très féminine. Ce n’est pas que ce soit une Amazonie imaginaire dans laquelle ne vivraient que des femmes. C’est peut-être à cause de sa mer si féminine par à rapport à celle si masculine de Dakar (voir Tounka de Abdoulaye Sadji) qu’on dit que Saint-Louis est une ville féminine. Peut-être à cause des alizés qui viennent la fouetter ? On ne sait jamais en réalité pour quelles exactes raisons une ville se découvre un caractère, se retrouve avec une réputation. On ne sait jamais comment une ville devient une ville et se fabrique une histoire. En effet les légendes fourmillent à propos de Saint-Louis, légendes qui par l’exagération épique et l’exagération mythique sont seule à même de restituer la vérité propre de la cité.
Du reste le péripatéticien, grâce à la marche, peut saisir le rythme de cette ville. D’emblée il est frappé par la nonchalance de Saint-Louis. Et de fait ses habitants sont d’une nonchalance légendaire. C’est comme s’ils n’étaient pas pressés par le temps.
Cette paresse est telle que même les hommes sont dits presque efféminés. Il est vrai que dans d’autres lieux il serait inconcevable qu’on se permette de traîner autant en chemin. Cette nonchalance, qui constitue comme le tempo de cette ville, vous est imposée. Il suffit d’ailleurs que vous fassiez une entorse à cette règle élémentaire pour qu’On vous regarde avec l’air sévère d’un Malherbe qui rencontrerait un solécisme. Casser le rythme c’est comme casser une harmonie, c’est déranger des règles de conduite qui sont d’abord incorporées avant de faire l’objet d’un méta-discours.
La culture c’est beaucoup de choses : c’est notamment un art de se mettre en mouvement. Se mouvoir, comme dirait les phénoménologues, c’est, d’abord et surtout, se déployer dans un(e) tempo(ralité)spécifique. Contrairement à l’Occidental frénétique, le Saint-Louisien déambulant est un être inchoatif insensible à l’objectif : c’est à croire qu’il a médité René Char qui nous enjoignait à ne pas nous attarder à l’ornière des résultats. L’art de marcher est l’effet d’un art de la ville (J Marion) qui lui-même est l’effet d’un art de vivre. La forme d’une ville est une forme de vie. Un corps qui marche lentement est un corps pour qui il n’y a pas de quoi se précipiter puisque, de toute façon, les choses suivent leurs cours et, comme la tortue qui pourrait être l’emblème (on aurait dit le totem) de cette ville, atteindra sa cible en temps déterminé. La manière dont on marche est une manière de vivre qui elle-même est une philosophie en mouvement. Le marcheur pressé (comme le Parisien de Dadié) ou patient (comme notre Saint-Louisien) expérimente sa forme de vie. Marcher exprime notre rapport à la mort.
Que Saint-Louis soit une ville philosophique (stoïcienne ou épicurienne) ne saurait surprendre puisque nous avons là une cité profondément religieuse. Non seulement les bâtiments religieux y pullulent mais le temps est régulièrement ponctué par les appels du muezzin si ce ne sont les chocs des clochers. Cette information est de taille car nous avons en Saint-Louis une ville complexe qui peut tromper l’observation hâtive. Le visiteur peut croire que les habitants si aimables, à la limite faible, lymphatique, est très vite détrompé. Ici autant sinon plus qu’ailleurs les apparences sont trompeuses. Il faut, il est vrai, pour comprendre une ville lorsqu’on y est un hôte, déchiffrer les langages de l’hospitalité et des affects. Cela est d’autant plus vrai pour cette terre à la légendaire téranga.
Certes le touriste blanc, appelé de manière ambiguë toubab[11], est embêté par les talibés qui sont les signes tangibles d’une ville atteinte d’hysteresis, mais Saint-Louis reste une ville hospitalière. A l’hôte est dû tous les égards. Le sourire l’y accueille. La patience l’y accompagne à chaque coin de rue. La gentillesse et la générosité le nourrissent. C’est tout cet art d’accueil que l’on appelle téranga. Mais justement cette téranga qui ne dépasse pas les trois jours réglementaires est un piège qui peut l’empêcher de comprendre le caractère de cette ville dite féminine. Si la ville est qualifiée métaphoriquement, pour faire vite, de féminine cela ne veut nullement dire que les habitants soient féminins. Loin s’en faut. À moins que l’on comprenne par féminité un certain art, une certaine forme de vie : faite ici d’un mélange explosif de discrétion pudique qui n’exclut pas un érotisme discret. Ces manières de vivre, cet art du secret font la légende de Ndar Guedj, ville dite d’élégance et de bon goût[12]. Certes la géographie, comme nous l’enseigne la géocritique et la géopoétique, y joue un grand rôle. Mais toutes les villes conçues comme Saint-Louis n’ont pas le caractère de Saint-Louis. Redonnant au mot caractère toutes ses résonances prospectives, nous dirons que l’histoire y joue un rôle essentiel. Du reste l’histoire de cette ville est vertigineuse. Terre de repos, elle a connu bien des civilisations : l’arabe, très prégnante, la française très sensible ont vu leurs alluvions se déposer sur le sol africain. Embouchure de plusieurs cours d’eau cette forme de vie ne peut être qu’énigmatique. C’est en vain d’ailleurs qu’on tenterait de décrypter ce sang métis.
Avant de savoir à quoi s’en tenir, le Visiteur entre dans une ville ayant une réputation légendaire. Nous empruntons volontiers, pour cheminer dans les méandres sémiotiques de cette ville, le regard du Visiteur entrant dans une ville tel un Rastignac à l’abordage d’une ville à conquérir. Les erreurs qu’il commet dans l’appréciation de cette ville font partie intégrante de cette ville. Un être est ce qu’il paraît et ce qu’il est (si ce mot a encore un sens)
Notre Visiteur entre dans une ville qu’on lui dit chaude. Les femmes, ses totems, font la réputation de cette ville. On lui a certainement parlé des Dryankés : ces grandes dames à la démarche lente que le touriste voit, à sa grande surprise, si rarement dans des rues où pullulent des filles si minces et si occidentales. Si elles ne pullulent pas, ces dryankés sont cependant bien présentes. Il suffit de les chercher dans les lieux qu’elles fréquentent : marchés, cérémonies… La discrétion est ici la règle essentielle de la convenance et l’érotisme de rigueur. Comme dans toutes les villes les zones mal famées existent mais sous la forme de la dispersion.
Son regard cherche les fameuses gourmettes. Si celles-là ont véritablement disparu en tant que corps, elles ont laissé leurs traces indélébiles : il suffit de savoir les déchiffrer. Notamment sous une forme réactualisée dans l’art de s’habiller des jeunes filles. Si notre visiteur est un ethnologue impatient (défaut qu’il ne faut surtout pas avoir lorsqu’on se propose de percer les secrets d’une ville justement féminine), il s’en ira plein de morgue. Il dira partout son désarroi d’avoir été trahi par des légendes. Il vous dira que c’est une ville fade, ennuyeuse et de surcroît parcouru régulièrement par l’insupportable vent d’harmattan. À quoi s’ajoutent des rues vieilles, une urbanisation défectueuse, des rues sales, une population fausse et hypocrite. On croirait entendre Camus.
Le problème de l’écriture ethnographique c’est qu’elle refuse, pour parler comme Maurice Merleau-Ponty, de percevoir une ville. Ignorant les plus élémentaires leçons de Ferdinand de Saussure, il réduit la forme d’une vi(ll)e aux êtres et aux objets qui la composent. Qui n’apprendrait que des mots sans se laisser pénétrer par la grammaire qui les fait vivre n’entrerait jamais dans la vie de la langue que parlent les habitants d’un lieu (qu’il soit campagnard ou citadin). L’ethnologue ne se livre qu’à une espèce d’urbanisme primitif.
Comprendre une ville c’est entendre sa rumeur, écouter ses murmures, déchiffrer les paroles qu’elle nous permet d’énoncer. Si l’ethnologue est un fort mauvais guide, parce que mu par des intérêts touristiques qui lui font rechercher, comme le mauvais journaliste, le spectaculaire, notre vrai visiteur est un excellent guide.
Malgré les premières déceptions notre phénoménologue de Christoph Colomb continue sa pérégrination. A force de patience, cette vertu cardinale pour qui veut s’adonner à l’incertaine tâche d’interprétation, on subit la mutation des enfants du laboureur. Il trouve le trésor là où on ne lui avait pas indiqué. Petit à petit il est initié à la grammaire de cette ville. A l’issue de ce parcours initiatique on comprend bien ce qu’est la légende urbaine. Ce que le mythe dit fermement, ou pour le dire autrement, ce que le récit énonce spectaculairement est présent mais de manière plus diffuse. Ce qui est dilué dans la durée seule la patience et l’immersion subjective peut le percevoir. Pour dire une ville il faut la vivre c’est-à-dire l’être. On est alors citoyen pour sa capacité à avoir su l’habiter. Un album-photos, quelle que soit son ampleur et le talent de son auteur, ne vous décrira une ville : il faut au moins une parole qui parle la grammaire de cette ville, fidèle à cette grammaire. Bref une légende pour que cette ville soit racontée. Son code de conduite déchiffré.
Une ville vit à travers ses habitants. Qu’une ville soit colonisée par des barbares et vous la verrez du jour au lendemain défigurée. Il a fallu bien des générations pour qu’à la suite d’une longue évolution créatrice une ville comme Ndar Guedj naisse des flancs des eaux et se voit attribuer le fameux nom de Saint-Louis centre du bon goût et de l’élégance. Il a fallu une longue durée qu’aucune historiographie ne saurait raconter pour que soit transmis et créé au fil des générations l’art de vivre spécifiquement saint-louisien.
Imprégnée de notre ville l’ex-visiteur élu citoyen racontera la même légende avec la même ferveur. Singulièrement lorsque pour quelque raison il se sera éloigné de son terroir. Le voyage, comme on le sait, est agrandissement de notre horizon et par la même occasion, eu égard au lieu qu’on quitte, distanciation. Or l’arrachement à nos liens affectifs nous rend nostalgique. Grâce à cette merveilleuse passion, une âme comme l’âme senghorienne voit ce dans quoi il était immergé, parce qu’y étant trop attaché, se réduire à ses propriétés essentielles. Alors la ville de Saint-Louis nous apparaît telle qu’en elle-même. Se forme alors une parole de grâce, une parole de célébration comme en surent proférer des poètes tel Ronsard, Saint John Perse. Cette parole, comme toute parole, tisse des légendes, les célèbres légendes de ville. Les villes ne peuvent donc qu’exister de manière légendaire dans les écrits urbains.
Mais dans la ville réelle on est imprégné par l’insaisissable féminité de cette ville. On peut presque partout toucher la sensualité à travers le vêtir, le sentir, le déambuler. Certes, comme dans toutes les villes, même celles dites religieuses, il y a des maisons closes, des lieux de dépravations. Certes. Saint-louis reste fondamentalement pudique. Cela en raison de la présence d’un Dieu qu’on croise partout dans une ville où pullulent des mosquées parfois conquises de haute lutte. D’ailleurs la rumeur sonore de cette ville est un mélange d’appels à la prière, de wazifa, de musique et pour les insulaires de ce grondement infini de l’Océan qui en est comme la basse.
Voilà une ville qu’on dit la porte du paradis. Voilà des citadins qui vivent dans la croyance que Dieu les regarde.
Conclusion
Une ville ne saurait donc se réduire aux rues inscrites dans un territoire physique. La ville « engorgé de codes […] dont l’usager […] doit s’assimiler pour pouvoir y vivre »[13] est donc une grammaire jouant de la configuration spatiale et réglant les attitudes des habitants de cet écoumène élevé au rang d’espace de jeu. Une ville ne saurait être ramenée au système des rues, aux maisons. Sans les hommes qui l’habitent et qui y sont comme des pions dans l’immense échiquier on ne saurait parler de ville. Sans cet échiquier également (qui est un champ de positions) on ne saurait parler de ville. Et cela quoique le citadin porte toujours l’empreinte de la cité dont il s’est nourri. La ville finit par émerger de l’interaction des acteurs qui le conçoivent à travers le temps (c’est la mémoire de cette ville) et ne cessent de la réinventer. En se mouvant dans les macro-signes qui la constituent les acteurs, dans la mesure où ils en respectent les règles du jeu, sont les paroles de cette ville. Ils produisent du sens, vivent du sens que l’on peut mesurer en termes de bénéfices symboliques ou en termes de joie. Toute performance réussie provoque en guise de récompense un épanouissement de l’être. Le bonheur de vivre dans une ville comme Saint-Louis est telle que les visiteurs récalcitrants finissent par s’y enliser dès qu’ils sont pris à son jeu. En s’éloignant de ce milieu où il baignait comme un poisson dans l’eau, il éprouve la nostalgie d’une vie si heureuse.
Bibliographie
AUGE, Marc. Non-Lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité. Paris : Le Seuil, 1992.
BARTHES Roland, L'empire des signes, centre-ville, centre-vide, Seuil/Points-Essais, Paris, 2005
BARTHES, Roland. « Sémiologie et urbanisme », in L’aventure sémiologique. Paris : Seuil, 1985 (p. 261-271)
BERQUE, Jacques. Ecoumène : introduction à l’étude des mileux humains. Paris : Belin, 1987
BROCHOT, Aline et de la SOUDIER, Martine, dir. EAutour du lieu. In Comunications n°87, 2010
De CERTEAU, M., GIARD, L., MAYOL, P. L’invention du quotidien 2 : habiter, cuisiner. Paris : Gallimard, 1994.
FONTANILLE, Jacques « Territoire », ACTES SÉMIOTIQUES [En ligne]. 2014, n° 117. Disponible sur : <http://epublications.unilim.fr/revues/as/5239> (consulté le 04/11/2014)
MARCOS Isabel (sous la direction de),Dynamiques de l'espace - Essais de sémiotique de l'espace, L'Harmattan, Paris, 2007
MAROUF, Nadir. Pour une sociologie de la forme. Mémlanges sylvia Ostrowetsky.Paris ; l’Harmattan, 1999
PETITIMBERT, Jean-Paul « Territoire(s) de marque », ACTES SÉMIOTIQUES [En ligne]. 2014, n° 117. Disponible sur : <http://epublications.unilim.fr/revues/as/5268> (consulté le 04/11/2014)
SEGAUD Marion, Anthropologie de l'espace : habiter, fonder, distribuer, transformer, A. Colin, Paris, 2007
URBAIN Jean-Didier « La trace et le territoire », ACTES SÉMIOTIQUES [En ligne]. 2014, n° 117. Disponible sur : <http://epublications.unilim.fr/revues/as/5277> (consulté le 04/11/2014)
URBAIN, Jean-Didier. Au Soleil. Naissance de la Méditerranée estivale, Payot, 304 pages, 2014.
URBAIN, Jean-Didier. L'envie du monde, éditions Bréal, 2011.
URBAIN, Jean-Didier. L'idiot du voyage : histoires de touristes, éditions Payot, 2002
URBAIN, Jean-Didier. Secrets de voyages : menteurs, imposteurs et autres voyageurs impossibles, éditions Payot, 2003.
* Université Gaston Berger de Saint-Louis
[1] Dans l’incipit de la Peste, Albert Camus décrit admirablement, d’un point de vue métaphysique, c'est-à-dire la vie citadine considérée de haut, les mœurs d’une ville moderne, dans le cas d’espèce, Oran. Pour notre part nous aimerions prendre la mesure de la signifiance qui se déploie dans le parcours d’un Saint-louisien et le jeu que donne à voir cette ville.
[2] Il serait intéressant d’étudier le type de tourisme auquel donne lieu la ville de Saint-Louis. Que viennent-ils chercher à Saint-Louis ? Comment le vivent-ils ? C’est dans ce sens qu’on peut lire avec un intérêt certain Jean-Didier Urbain : « Pour l’heure, cette réflexion en cours s’inscrit dans le prolongement d’une précédente recherche qui avait conduit, dans la perspective d’une étude sur les pratiques touristiques, à redéfinir lelieucomme unespace dramatisé, c’est-à-dire spécifié, inséré et isolé des autres par sadensitéfictionnelle ou historique. Doté d’une épaisseur ou d’un substrat narratifs distinguant et singularisant cet espace comme « place », « endroit » ou « scène » du fait de l’ajout à sa forme ou son modèle (reconnu par ailleurs) d’une intrigue unique, un supplément local à même de fonder son attractivité ponctuelle au-delà de sa seule vision (comme paysage ou panorama). Si bien que fut proposé à cette occasion de distinguer untourisme d’espacesd’untourisme de lieux. Le premier, héritier dusightseeing, use d’un mode d’observation global privilégiant le regard distant du panorama et des voies principales, tandis que le second use d’une vision rapprochée et des voies secondaires privilégiant la quête intime des traces des histoires du…lieu. À quoi peut s’ajouter un troisième tourisme : letourisme des étendues, porté par un désir de vide ou d’éloignement – appel du désert, songe de piéton lunaire ou rêverie cénobite en un espace « originel » ou pré-sociétal. Ce désir répond en effet à un courant fort de sensibilité au monde des voyages d’agrément », Jean-Didier Urbain, L’envie du monde, Paris, Bréal, 2011, p. 187 et suiv
[3] « Une œuvre de Spranger porte le titre de Formes de vie (Lebensformen), mais il s’agit de types de caractères individuels. Le terme de Wittgenstein, au contraire, met l’accent sur l’entrelacement de la culture, des conceptions du monde et du langage. » Hans-Johann GLOCK. Dictionnaire Wittgenstein. Paris : Galliamard, 1996, p.250.
[4] FONTANILLE. Soma et sema. Paris : Maisonneuve et Larose, 2004.
[5] Jacques FONTANILLE et Claude. ZILBERBERG. Tension et signification. Liège : P. Mardaga. 1998
[6] Jacques FONTANILLE. Sémiotique du discours. Limoges : Presses de l’Université de Limoges, 2003
[7] Voir Bernard Dadié. Un nègre à Paris. Paris : Présence Africaine, 1959
[8] Voir alpha Amadou SY. L’imaginaire saint-louisien, (domou n’dar), à l’épreuve du Temps. Thiès : Éditions Fama : Décembre 2009.
[9] « Selon l'abbé Gédoyn, l'urbanité, ce mot tout romain, qui dans l'origine ne signifiait que la douceur et la pureté du langage de la ville par excellence (Urbs) (…) ce mot-là en vint à exprimer bientôt un caractère de politesse qui n'était pas seulement dans le parler et dans l'accent, mais dans l'esprit, dans la manière et dans tout l'air des personnes. » Sainte-Beuve. Causeries du lundi. 28 oct. 1850.
[10] Corps de/dans la ville / Jean-Luc Nancy, in colloque internationalL'Art de la Ville / The Art of the Cityorganisé par l'équipeCultures Anglo-Saxonnes (CAS) de l'Université de Toulouse 2-Le Mirail, 6 -8 novembre 2008.Dans un style à la fois érudit et ludique, prenant au pied de la lettre le thème "l'Art de la ville" et refusant l'idée de ville limitée à ses fonctions, le philosophe Jean-Luc Nancy présente une vision de la ville en tant que créatrice d'elle-même, de sa propre œuvre, tout entièrement faite de son propre mouvement. D'un mouvement de prolifération indéfinie, de dispersion permanente, d'éloignement et de rapprochement mais aussi constitutive, tout autant que constituée, de la circulation et du mouvement des passants -"acteurs et spectateurs à la fois"- de la rencontre, "du rendez-vous qui est peut-être l'œuvre majeure de la ville". Pour Jean-Luc Nancy, "il y a un art de la ville. C'est un art du corps en mouvement, du sens prochain toujours renvoyé au lointain, un art d'une certaine insignifiance faisant réseau de signes -des signes qui ne sont pas des signes signifiants, pas tout à fait signifiants- un art du croisement, du frôlement, des pas, des passages, des directions et des errances". In http://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/corps_de_dans_la_ville_jean_luc_nancy.4167
[11] Voir Christine DELPHY. Classer et dominer. Paris : La Fabrique.
[12] Voir Ousmane Socé Diop. Karim. Roman SénégalaisParis Nouvelles : Éditions latines, 1935, 1948, 1957. Réédité en 2000
[13] De CERTEAU, M., GIARD, L., MAYOL, P. L’invention du quotidien 2 : habiter, cuisiner. Paris : Gallimard, 1994.p. 20.
![]() Télécharger l’article en version PDF
Télécharger l’article en version PDF
Résumé
Ma contribution vise à explorer les notions discursives de la modernité et la notion d’interconnexité globale au sein des jeunes hommes Pikinois. Bien que de nombreux chercheurs constatent le faible impact de la mondialisation qui caractériserait les grandes banlieues africaines, j’aimerais proposer une lecture alternative en suivant l'approche de Jean-Marc Éla (1999) et son « anthropologie de la banalité et de la quotidienneté » en analysant la notion « du agency » entre une conversion affirmée de la mondialisation traduite par l’exclusion de la participation aux processus urbains et la manière dont les jeunes hommes façonnent ce qu'ils perçoivent comme la modernité dont ils négocient l’interconnexité globale. Mon argument se basera sur le fait que les pratiques visibles de la consommation agissent comme des percées à la modernité et permettent aux jeunes hommes de participer à celle-ci.Aussi, les figures de constructions identitaires deviennent cruciales et ont besoin d'être analysées à la lumière de cet ardent désir que les jeunes Pikinois ont de participer à une culture de consommation mondialisée. Cet article tente ainsi de donner une idée plus précise sur des notions locales comme Boy Pikine, Baay Faal et Boy Town.
Mots-clés: Agency, modernité, mondialisation, interconnexité globale, urbanité, jeunesse, consommation, Pikine
INTRODUCTION
Dans son ouvrage intitulé “Remotely global” Charles Piot s'appuie sur un travail ethnographique chez les Kabiyè du Nord-Togo et argumente que des domaines triviales, considérés clairement traditionnels, sont en fin de compte liés à des expériences de la modernité. L’isolement, analysé dans toutes ses facettes, comme une peur/expérience douloureuse, caractérise aussi de nombreux jeunes de la banlieue de Dakar. Les banlieues ici, comme de nombreuses autres dans le monde entier, sont souvent victimes d’évaluations discriminatoires de l’extérieur.
Pikine, ville-satellite à l’est de la péninsule du Cap-Vert, qui a été l’un des grands projets urbains gouvernementaux de restructuration de l’Afrique, ne fait pas exception à cela. Alors qu'il y a quelques années le géographe Gérard Salem considérait Pikine comme une “ville de riens” et une ville “sans vraie histoire” (1998: 271), l'intérêt pour cette ville et celui des autres espaces urbains en Afrique a été relégué à une approche générale de la recherche dans les sciences humaines de “voir et de lire les villes africaines contemporaines [...] à travers les grands récits de l'urbanisation, de la modernisation et de la crise” (Mbembe et Nutall 2004: 353). Mais les commentaires généralisant qui étaient souvent utilisés ont échoué dans la description de la composition hétérogène des voisinages des quartiers urbains précaires des grandes agglomérations partout dans le monde. Nous pouvons dire maintenant que cette évaluation n’est plus valable pour Pikine.
Fondée en 1952, lorsque les quartiers péricentraux de Dakar ont été effacés de squatters en situation irrégulière, Pikine était une destination pour des migrants ruraux fuyant la sécheresse, en particulier dans les années 1960. Aujourd'hui, Pikine est une grande ville-satellite cosmopolite dans la périphérie de Dakar avec une population d'environ un million et demie d’habitants formée d’une mosaïque de différentes communautés ethniques. Avec la prolifération de nouveaux restaurants, en particulier dans le créneau du Fast Food, Pikine acquiert de plus en plus une envergure mondiale. Aujourd'hui Pikine est caractérisé par un conglomérat diversifié de constructions formelles à faible coût: petits blocs de logements de ciment et immeubles d’un étage à multi-étages auto-construits.
Même si ses habitants peuvent être comptés parmi les citadins pauvres, nous devons nous abstenir de faire toutes sortes d’hypothèses d’un point de vue de la victime. Au contraire, nous devons prêter notre attention aux figurations d'agency d'un point de vue constructif. C’est à cet effet que cet article de recherche tente de donner un examen plus minutieux de la société pikinoise et leur conception de soi. De plus, je tiens à attirer l’attention du lecteur sur le fait que récemment nous avons assisté à une “ouverture des sociétés africaines en termes d'interconnexité globale” (Schapendonk 2013: 10). Néanmoins, pour beaucoup de personnes, aussi pour les jeunes citadins de Pikine, cette interconnexité globale “s’expérimente principalement dans son absence,sous la forme de non-arrivée du changement, des promesses non tenues et des aspirations insatisfaites” (Graw 2012 : 32) traduit dans une “misère et d'incohérence de la vie dans les banlieues” (Devisch 1999: 5; cf. AbdouMaliq 2001: 17), au lieu d’une augmentation réelle de la mobilité ou de flux de marchandises” (Graw 2012: 32).
Sur la base de onze mois de travail sur le terrain à Pikine, je suis l'approche de Jean-Marc Éla (1999) et son “anthropologie de la banalité et de la quotidienneté[1]”. J'analyse l'agency, comment des jeunes hommes dans la banlieue de Pikine négocient leurs désirs pour la mondialisation et comment cela est lié à leurs processus de figurations d'identité plus intégréedans des discours locaux.
INTERCONNEXITÉ GLOBALE
L’amour et la valorisation que les jeunes de Pikine donnent à leur localité sont exprimés par des sloganstels que I love Pikinepar exemple sur des T-shirts et l'idée de la Pikinité[2], va de pair avec l’intégration de ces discours dans les forces de liaisons mondialisées. Afin de ne pas être isolés, les jeunes sont en train de négocier activement leur participation dans les évènements mondiaux. Dans le cadre d'une citoyenneté mondiale, je définis personnellement en corrélation avec la définition de Nadine Dolby, qui dit que la citoyenneté est “marquée par une relation entre un État, un ‘peuple’ et un territoire particulier.” (2006: 34), c’est-à-dire en d'autres termes l'accès des habitants dans leur localité à un éventail de possibilités offertes par le flux global des marchandises, que ce soit matériel ou immatériel.
De nombreux chercheurs ont parlé d’une prolifération inégale de la mondialisation sur le continent africain. Nombreux sont les chercheurs qui parlent de non-arrivée de la mondialisation en Afrique. Francis Nyamnjoh a intitulé un de ses articles scientifiques: “For Many are Called but Few are Chosen” (Beaucoup sont appelés mais seulement quelques-uns sont élus), puisque les images de la mondialisation sont accessibles partout et montrent un déséquilibre extrême. En effet, beaucoup ne participent pas à ce “monde cosmopolite prometteur” (Salazar 2010: 58, cf. Jónsson 2008, Ferguson 2006). Ce que Donna Perry a nommé “urbanized globalization” (mondialisation urbanisée) (2009: 41) se traduit souvent par une exclusion d’une participation aux processus mondiaux pour la plupart des jeunes, même s'ils sont leurs acteursles plus importants. Ainsi seulement quelques possibilités restent à façonner la modernité (Halperin et Scheld 2008: 170-174; cf. Schapendonk 2009: 2).
Dans son travail sur la région sud-ouest de l'Inde sur la côte de Malabar, Ritty Lukose soutient que “la jeunesse est considérée comme un groupe social de consommateurs, le premier à se plier sous ce qui est compris comme pression de la mondialisation homogénéisant, une mondialisation fondamentalement liée à une Américanisation. Les pratiques de la consommation juvénile deviennent donc un indice de la présence et de l‘accès à la mondialisation” (2005: 915). De nos jours les marchandises sont disponibles partout, mais cette disponibilité mondiale ne signifie pas l'accessibilité globale (Nyamnjoh 2004: 48), comme ce récit d'un jeune homme du quartier de Pikine le démontre:
Dans la rue, tu vois une boutique, y a l’habit qu’on a exposé pour vendre. Tu veux l’acheter, ça te plait, tu veux l’acheter, tu peux pas. Quand tu regardes, tu sais que t’as pas de l’argent pour acheter cela. On veut des choses, on veut faire des choses, mais on peut pas, parce qu’au fond, ou bien quand on regarde aux alentours de nous, on voit que, on ne peut pas, quoi, parce que y a le manque de moyens, qui ne nous le permet pas, quoi. (Pape[3], 20 ans)
La réalité est composée de nombreux blocages. Beaucoup de jeunes doivent se contenter de ce que le philosophe Achille Mbembe appelait “lécher la vitrine” (Meyer et Geschiere 2008: 5), l’impuissance de la réalisation des désirs en raison du manque de moyens financiers, ce qui conduit à un désenchantement, à la frustration et au stress (cf. Durham 2000: 113). Il y a “une économie de biens souhaités qui est connue, qui peut parfois être vue, que l’on veut apprécier, mais á laquelle on n'aura jamais accès” (Mbembe et Rendall 2002: 271). Les jeunes sont placés dans une position douloureuse entre des aspirations et des opportunités (Whyte et al. 2008: 14) dans une ville de nombreuses possibilités (cf. Beck 2010: 14). L'occident s’apparente à une expérience visuelle omniprésente quotidiennement à Dakar: hôtels de luxe, grandes villas et voitures de luxe, restaurants chics (qui propose essentiellement des plats d’’ailleurs’), boîtes de nuit et casinos qui créent à Dakar une ambiance “d’une décadence culturelle et sociale” (Biaya 2001: 76). D'autre part, cependant, la désillusion, le vagabondage, la marginalisation et le chômage sont une réalité incontournable et toujours présente (Van Eerdewijk 2006: 4). Dakar peut être l'Europe[4] (le Plateau, Point E, Fann, Almadies, Nord Foire, etc.) ou l’Afrique (Grand Yoff, Grand Dakar, Pikine, Guédiawaye, etc.), une vitrine de modernité (cf. Dimé 2005: 97), mais au même temps son contraire flagrante, un kaléidoscope d’un “champ discursif au cœur de l'expérience visuelle” (Grabski 2007: vii).
Les trottoirs sont trop souvent transformés dans des marchés aux puces en plein air énormes qui évoquentpartout aux tentations consuméristes, encore plus marquées dans la soirée, quand nous pouvons observer l'appropriation de l'espace du piéton par des vendeurs pour l'exposition de leurs produits, par exemple des chaussures (partiellement jusqu’au point où les piétons doivent utiliser la rue). De plus, la ville est remplie d’affiches publicitaires d'idéaux consuméristes qui sont irréalistes pour la plupart de la population. Pour beaucoup de gens un Toyota RAV4, un Mitsubishi ASX, faire des vacances au Maroc ou en voyage à Paris, Istanbul ou bien à une autre destination est bien au-delà de leurs moyens, et parfois même pas dans leurs habitudes de consommation.
Les jeunes se trouvent dans une situation inconfortable: ils sont soit des non-consommateurs soit des consommateurs qui ont d’énormes difficultés. C’est pourquoi, pour inverser cette position, ils font usage de différents outils d'un répertoire très élaboré pour pouvoir participer à la vie sociale urbaine. Il faut de la ruse locale, Achille Mbembe parle d’urban knowledge (connaissances urbaines) (1997: 153), nandité ou bien muus dans le jargon local. Je vois ces expressions locales sur le modèle de Mbembe, qui explique que le “Urban knowledge est considérée comme la capacité d’improviser, de survivre, et en fin de compte de réussir dans la ville. Cette connaissance peut être seulement acquise d'une manière pratique, mais également a besoin de l'expérimentation et de l'improvisation” (McLaughlin 2001: 156).
Pour les jeunes hommes, cette ruse locale est d'une importance cruciale. Mon argument dans cet article se basera sur l’idée que la négociation des percées sur les circuits consuméristes et l'affichage public de consommation permettent aux jeunes hommes Pikinois de participer à la modernité d'une manière qui leur permette d’être un acteur actif et constitutif.
LE CONTEXT SOCIAL DE LA NÉGOCIATION DE L’INDENTITÉ DES JEUNES
Je compare la société oblige sénégalais avec la conception française de noblesse oblige, qui était pratiquée en Europe par la classe noble en particulier au cours de la période médiévale. Cela ne signifie pas que les pratiques subversives ne sont pas possibles, mais toutes les actions humaines, en particulier dans le voisinage où on vit se surveille strictement. De plus la croyance islamique sert de tuteur conservateur de l'ordre moral et influence l'action humaine. Cependant, même si les activités sont regardées d'un œil critique, l'Islam peut être qu’un obstacle sur le mode de vie des jeunes. C'est aux gens eux-mêmes de respecter les principes islamiques ou de trouver des moyens acceptés ou cachés afin de les contourner. La manière de les contourner ou de naviguer auprès des terrains sociaux qui ont des potentialités contradictoires sont liées à une planification de vie avec des idéologies abstraites et confuses.
Les idéologies des jeunes sont converties dans des pratiques comportementales irrationnelles. En effet, elles apparaissent ici comme fluides, ambigües, contradictoires et incompatibles avec les convictions rationnelles. Ils sont tiraillés entre plusieurs impératifs et oscillent constamment dans une pluralité de logiques contradictoires, par exemple: les impératifs de la redistribution dans la communauté et ceux des solidarités familiales, etc. (Marie 1997: 410).
Prédispositions à la solidarité d’un côté, pulsions individualistes de l’autre; interdit d’individualisme et soumission à « la loi de la dette » d’une part, le devoir de réussir, d’autre part. Telles sont déjà les contradictions qu’installe en eux la socialisation communautaire. Mais ce n’est pas tout: voici qu’en même temps, la socialisation urbaine vient au contraire s’appuyer sur leurs pulsions individualistes en les sommant plus que jamais, sous l’empire de la rareté, d’être compétitifs, agressifs et autonomes. (Marie 1997: 420)
En accusant l'ordre ancien, présenté dans le monde contemporain comme des concepts fluides de restes demeurant, cette nouvelle génération est à la recherche de quelque chose, qui n’est même pas encore défini ces derniers. Les stratégies de camouflage jouent un rôle vital pour la navigation dans les vécus des citadins masculins. Les pratiques quotidiennes consistent à ne pas révéler les réalités sombres de la vie dans la banlieue, mais plutôt de montrer des pratiques harmonieuses de cohabitation. Il y a un impératif social de préserver une image sociale intacte et de gérer une certaine forme d'imagination positive qui cache beaucoup de facettes de réalités quotidiennes paupérisées (cf. Dime 2005: 212). Le terme sag (honneur, fierté) et la logique de dafa sag (quelqu'un qui est honorable) et daw gàcce(éviter le déshonneur) dans le jargon local signifie cela.
Ces jeunes font usage de différents outils d’un répertoire très élaboré, qui reflète des normes sociales acquises, pour manipuler l'ordre social établi courant et en tirer profit. Nous comprenons ces négociations complexes de l'agency quotidienne dans le cadre de ces interactions sociales créatives, qui sont mises à profit pour tirer des bénéfices de conditions de vie qui sont apparemment immuables et immobiles.
‘ÊTRE DANS LE MONDE’ À TRAVERS DE VÊTEMENTS D’OCCASION
Les types de consommations peuvent être le plus facilement exprimés par des pratiques vestimentaires. La consommation “est entraînée ici par un fantasme alimenté qui conduit à créer un espace d'identité, un style de vie, et la réalisation d'une rêverie de la bonne vie (...)” (Friedmann 1994: 121). Consumérisme, réalisé grâce à des pratiques vestimentaires, est lui-même un acte de satisfaire des désirs qui sont corrélés aux modes de vie aspirés. Il remplace d'autres formes de réalisation matérielle qui ne sont pas possibles ou difficiles à atteindre, dans un monde où beaucoup de gens courent auprès des images interprétées de soi d'une bonne vie (cf. Friedmann 1994: 121). En outre, avec ces pratiques les jeunes citadins arrivent eux-mêmes à se retirer des réalités économiques précaires en transformant leurs apparences de sorte à avoir ce qu'ils considèrent comme des représentations symboliques de leur propre réussite. Porter des haillons placerait les jeunes contemporains dans une situation désavantageuse, qui volerait leur dignité et les reléguerait à un statut d’indigence et à un manque d'accès. Le manque d'accès peut être décrit ici comme un mot qui englobe toute exclusion de particuliers des circuits sociaux, culturels et économiques.
Mais comment ces jeunes, qui n'ont presque pas de moyens, arrivent à avoir accès à des vêtements de fantaisie? De nombreux marchés dakarois, Colobane, Sandaga, Castor, HLM et les marches hebdomadaires, qui ont lieu dans un quartier de Dakar, un quartier de Pikine ou d'un autre chaque jour de la semaine, offrent des “vêtements jetées de l'Ouest” (Hansen 2000: 3), appellée fëgg jaay, littéralement "secouer" (= fëgg) et vente (= jaay). Mais est-ce que ces vêtements d'occasion, dont personne ne connait le propriétaire précédent, peuvent mettre des jeunes hommes à la mode et leur permettre “d’être dans le monde”? Mais si les connexions transnationales sont rares, le recours à ces connexions devient difficiles, et que les ressources financiers pour acheter des vêtements originaux dans des magasins prêt-à-porter font défaut, ces marchés servent comme une solution pour rester à la mode.
Alors que l'observateur profane voit peut-être juste des tas énormes de vêtements d’occasion, chaque stand est spécialisé et offre différentes parties de vêtements. Les détaillants savent les conditions locales spécifiques ainsi que les exigences et préférences des jeunes clients. Mais la compréhension des pratiques d'achat comme des actes aveugles de copier “l'Occident” ne prennent pas en compte les processus complexes d'acquisition de produits occidentaux. Au contraire, ces jeunes citadins ont créé des pratiques vestimentaires idiosyncrasiques qui sont adaptées aux cosmologies locales et qui répondent aux tendances actuelles et aux normes culturelles acceptées. Dans ces marchés, loin de remplir simplement des nécessités vestimentaires de base, il est assez probable d’obtenir des vêtements qui répondent, aux besoins et aux désirs de chacun en aidant ainsi les jeunes à négocier et créer leurs propres identités sociales (Hansen 2000: 6).
Tandis que les jeunes se valorisent à travers des pratiques vestimentaires ils ont besoin du savoir urbain et des contacts appropriés, soit sur des marchés de l’habillement, soit dans des magasins de vêtements prêt-à-porter. Ils ont besoin de connexions à travers des connaissances ou avec une famille qui a de bonnes liaisons, qui leur permettent d'avoir accès aux vêtements venant de l'étranger. Maa la dàq dox(littéralement: je marche mieux que toi)tient pour une expression de quelqu'un qui a de bons réseaux et qui connait bien la ville. Des marchés sénégalais sont des lieux d'échange, pas nécessairement de marchandises en échange de l'argent, mais aussi pour l’échange de biens contre d'autres biens. Dans plusieurs marchés comme Colobane les gens peuvent échanger leurs vieilles chaussures contre des nouvelles chaussures (chaussures d'occasion), une pratique qui est appelée localement dugal (littéralement: entrer). Une personne amène une paire de vieilles chaussures, ajoute une petite somme d'argent (teg) et choisit une autre paire de chaussures. Cela est seulement possible avec des chaussures originales, qui sont appelés dàll bal. Bal se réfère ici à un grand sac rempli avec des chaussures originales venant de l'Europe. La fourchette de prix est entre 7.000 CFA (Euro ~ 10,50) et CFA 30.000 CFA (Euro ~ 46).
Les jeunes disent que les Chinois ont inondé le marché avec des vêtements bon marchés. Les dàll bal sont reconnaissables en raison de leur qualité. Les gens disent que ces chaussures sont faites de cuir, tandis que les chaussures chinoises sont synthétiques. Les vendeurs mélangent normalement des chaussures chinoises et dàll bal. Mais le plus souvent ils cachent les dàll balpour les utiliser comme un atout. Comme les dàll bal sont plus chers ils sont justement mis en évidence dans le cas où le vendeur pense que le client est capable d'acheter des chaussures à un prix élevé. Alors, c'est au client de discerner entre Chinois et dàll bal, parce qu’un commerçant fait toujours semblant de vendre que de dàll bal, considérés comme solides, contrairement aux chaussures chinoises qui ont tendance à être facilement endommagées. Les gens disent que les chaussures chinoises sont pour lesngaka, une expression, qui se réfère aux gens ignorants ayant peu de connaissances. Aujourd'hui les mentalités sont en train d’évoluer. Dans le passé, il y avait quelque chose comme une loi non écrite qui a impliqué que si un jeune voulait être considéré à la mode, il devait porter des dàll bal. En plus, il a choisi la paire de chaussures attentivement en fonction de l’événement auquel il va assister. Cependant, aujourd'hui les gens profitent de plus en plus des prix bon marché de la Chine et avec la nouvelle philosophie “Gëm sa bopp” (Croire en soi) les gens croient de plus en plus en eux-mêmes et se placent au-dessus des clichés chinois ou original.
Mais les réactions demeurent ambivalentes. Certains jeunes croient que les Chinois ont arrangé le marché, parce qu’ils ont fait en sorte que les vêtements deviennent abordables pour la jeunesse, entendu qu’auparavant il n’y avait que des boutiques de prêt-à-porter, qui étaient très coûteuses. On dit que les Chinois ont effacé les différences visuelles entre les jeunes nantis et les autres en proposant des vêtements à des prix abordables pour tout le monde. Auparavant les différences entre les capacités à consommer et à ne pas consommer ont été soulignées par des pratiques vestimentaires. Malgré tout, les manières d’inclusion et d’exclusion sont jusqu’à nos jours négociées par des processus complexes. Les jeunes hommes qui ont par exemple des frères établis[5] à l'étranger ou qui sont issus de familles riches ont des avantages plus évidents. Lors de mon enquête, j’ai parfois demandé auxjeunes dans quel marché ils avaient acheté leurs vêtements. Il était important pour certains de souligner le fait qu’ils ne les ont pas achetés sur un marché sénégalais, mais qu’un parent de l’Europe le leur avait envoyés[6]. Les jeunes hommes attachent beaucoup d’importance à la notion d'authenticité des vêtements. Mais cela ne signifie pas que ceux qui ont moins accès à des liaisons transnationales ou qui disposent de faible moyens sont laissés de côté. Les Pikinois, en particulier, s’attribuent eux-mêmes des stratégies très avancées pour se prendre en charge.
Dans des circonstances économiques lugubres, les jeunes font usage d'un vaste répertoire créatif pour s'adapter aux défis locaux et combler les désirs vestimentaires. Cela explique le sureffectif des marchés qui offrent des vêtements. Leurs magasins de marchandises sont parfois occupés par plusieurs personnes dont certains sont des intermédiaires. Le sureffectif s'explique facilement en raison de la disponibilité illimitée des jeunes hommes sans emploi, qui ne veulent pas rester à la maison dans la frustration et dans le stress physique. De plus, ils ne veulent pas passer toute la journée dans le koñ[7], où des amis et des connaissances du quartier se réunissent ensemble, et où des membres de la famille et les aînés peuvent les voir comme des jeunes hommes paresseux. Travailler sur ces marchés situés en town, un mot que signifient des quartiers urbains comme le Plateau (centre-ville de Dakar) et les parties de la ville au tour du Plateau, leur permette d’oublier les contraintes locales. Ils sont en mesure de négocier simultanément des connexions dans les circuits locaux et transnationaux. Ceux qui n’ont pas la possibilité de travailler dans les secteurs formels, prennent de plus en plus d’assaut les marchés de vêtements locaux. Ce business leur permet de s’occuper au lieu de sombrer dans une oisiveté apparente.
À l'heure actuelle travailler dans le commerce de vêtements est bien vu parce que c’est une activité lucrative. Même si en raison de l'explosion de stands commerciaux un gain financier n'est pas toujours garanti, un jeune vendeur du marché (market mandans le jargon local) peut emprunter des vêtements à la mode dans son stand ou celui d'un ami. Ces articles d'habillement lui permettent d'être à la mode quand il rentre dans son quartier. Lorsque ce dernier est considéré comme une arène sociale où quelqu’un doit montrer qu’il est au-dessus de tous, ces jeunes hommes qui travaillent dans des magasins vestimentaires ont tendance à être très appréciés dans le milieu où beaucoup d'accent est mis sur l'apparence.
LA TRANSFORMATION DU BOY PIKINE AU BAAY FAAL ET BOY TOWN
« Aujourd’hui tout le monde est Boy Town. »(Badara, 38 ans)
Au début de mon travail sur le terrain, je me souviens d'un après-midi quand j’étais assis dans une cantine à proximité d’un petit kiosque, où l’on vend en général des matériaux légers dans un marché situé sur le trottoir, dirigé par un membre de la famille où je vivais. J’étais en train d’apprécier un café Touba dans un verre plastique, une forme locale d’une boisson populaire de café épicé avec des grains de selim, qui sont des graines d'un arbuste Xylopia aethiopica avec de la saveur musquée qui est utilisé comme un substitut de poivre (également connu sous le nom de poivre de Guinée) et des clous de girofle, des boutons de fleurs séchées aromatiques, lorsque je suis entré en contact avec Hassan. Ce qui m’a frappé dans cette première rencontre avec lui été ma supposition naïve qu’il pouvait être un Móodu Móodu[8], quelqu'un qui avait “déjà fait” l'Europe. Passant avec ses jeans élégants, baskets branchés, un T- shirt à la mode et de grands écouteurs il a impressionné le profane que j’étais à l’époque comme moide venir d’ailleurs. Mais je me trompais, il venait de la commune d’arrondissement voisine, de Guinaw Rail Nord, qui est considérée comme encore plus pauvre. Beaucoup de gens de Wakhinane II ont considéré cette commune presque comme un réservoir de criminalité, d’agression et d'analphabétisme.
Un autre jour, quand j’étais en train de vendre des parfums[9] avec Amadou dans les alentours du quartier Almadies, probablement l'un des plus beaux et coûteux quartiers résidentiels de Dakar, à la recherche du gain de personnes présumées riches, nous étions assis dans un bar et faisait comme si on était de jeunes pauvres de la banlieue de Dakar, qui n’avaient même pas les moyens de prendre une tasse de café. Lorsque la serveuse s’est approchée de nous, nous lui avons justement demandé la permission de nous reposer et de vendre si possible quelques parfums aux clients.N’ayant même pas les moyens de consommer quelque chose, vu que la carte de menu proposait des boissons trop coûteuses pour nous. La frustration se lisait sur le visage d’Amadou, et c’est qui m’a demandé de se payer un simple café sur le profit des ventes réalisées.
Avec ces deux exemples il devient tout à fait clair que des invocations consuméristes omniprésentes ont un impact très important sur les jeunes, même s'ils se considèrent comme Baay Faal[10], qui reconnait une tradition d’un mode de vie modéré et pieux et le refus de la société de consommation. En ville avec son affichage visuel de la richesse, de la mondialisation et de la misère intégrée dans une économie très problématique des attentes et des désirs exagérés et en même temps dans des principes islamiques pieux et modérés, la conception du Baayfaalisme doit être reconfigurée. Je tiens également à réfléchir sur le terme Boy Pikine. De l'extérieur, les résidents de Pikine sont perçus comme enclin à la criminalité et au comportement subversif. Pikine est considéré comme un reflet négatif de l'urbanité où les jeunes jouent le modèle antisocial: déscolarisés, sans profession et traîner dans la rue. Ces préjugés négatifs sont á la base d’une production et d’une reproduction du désordre social.Mais même si la zone de Pikine peut être un lieu de stigmatisation et de ségrégation, comme elle est définie à l’extérieur, cette attribution négative donne à sa population un sentiment d'attachement plus fort. Pikine, pour eux, est particulièrement un endroit où la solidarité et la vie en communauté sont grandement vécues. Ses habitants mettent en évidence un mode spécifique de socialisation entre eux, en particulier boloo (un sens de la communauté ou jàppalante dans le jargon local) contrairement dans d’autres quartiers de Dakar, où l'individualisme prévaut (bopp-sa-bopp, littéralement Chacun pour soiet Keen woluwul kenn, littéralement personne ne fait confiance l'autre) et dimbalante (solidarité). Le jeune homme de Pikine était appelé Boy Pikine, un vrai connaisseur, un véritable débrouillard mais en même temps un gentleman. Il est l'incarnation de quelqu'un qui a de la ruse locale et du savoir urbain, mais il est considéré contrairement à l’extérieur.
Dans tout Dakar, dans chaque quartier, soit Boy Pikineou non, on voit des jeunes qui pratiquent le sujjòot, la salutation des Baay Faal (ou bien des Mourides en général), mettant la main d'un autre disciple de Ibrahima Fall à leur propre front pour indiquer leur adhésion. Ce sont des jeunes gens ordinaires, qui ne sont pas vêtus d’haillons usés et rapiécés, et la plupart d'entre eux semblent être au courant des tendances actuelles de la mode juvénile, embrassant surtout des influences américaines. Vlada, Nike, Adidas, Reebok, Puma, Converse, Vans, DC Shoes sont des noms de marques populaires de chaussures connues par cette jeunesse. Ils se soumettent à un canon normatif de valeurs, qui est négocié par eux. Ces produits appropriés servent de “constituants de soi-même”, où des négociations d'identités englobent des pratiques de consommation (Friedmann 1990: 327).
La consommation ici agit comme un remède pour le terme ‘abjection’ de James Ferguson (1999: 236). Plutôt que de faire partie d’une société de consommation mondiale, la jeunesse a été “mise de côté, expulsée ou écartée" de celui-ci. En plus, elle peut être comprise comme “non seulement être rejetée mais étant jetée ainsi expulsion mais aussi avilissement et humiliation” (1999: 236. Grâce à la consommation, un individu peut surmonter cette abjection, en montrant, en particulier dans le public qu’il est en train d'avancer, et qu’il fait partie d'un monde de plus en plus matérialiste. Mais comme la consommation est limitée en raison de moyens financiers, il est enclin à faire place à des fantasmes (cf. Rowlands 1996: 203). Cette expérience difficile pertinente n'est pas prise pour acquis. Comme l’argumente Nyamnjoh, ces jeunes "refusent tout simplement de céder à une exclusion facile et sont prêts à tout sacrifier, y compris la morale, la dignité et même en fin de compte leur humanité, juste pour être des resquilleurs consommateurs et des zombies” (2005: 295).
Américanisation indique un rejet des modes de consommation élitistes et proximité à la Métropole et également des hiérarchies locales traditionnelles, qui déclarent les États-Unis comme l’incarnation de la supériorité culturelle et du “pouvoir “modernisant” de l'Occident symbolique” (Newell 2012: 178). Cette résistance aux constructions hégémoniques incite les jeunes à créer leur propre monde et de refuser une soumission aux contraintes de configurations globales du pouvoir.
En dehors des pratiques vestimentaires élaborées dans cette économie d’apparence, le corps joue un rôle important. Mamadou Diouf, historien et professeur d'études africaines à l'Université Columbia de New York soutient le fait que le corps demeure la dernière ressource pour négocier une participation dans des espaces publics que des jeunes ont à leur disposition (2002: 278; cf. Diouf 2003: 11).
Comme les vêtements en général prennent une attention particulière en ville, le pouvoir économique ou un substitut, c’est-à-dire la capacité d'avoir accès aux vêtements de marque par tous les moyens possibles, joue un rôle crucial. Comme une appartenance à la mode est en corrélation avec la figure de Boy Town, les limites entre le modèle urbain de Baay Faal et le Boy Town s'estompent. Mais nous ne devons pas voir ces processus de mélange des cultures qui sont apparemment dissemblables comme un résultat de désintégration d'éléments traditionnelles de la culture et comme une adhésion et adoption fragmentée, inégale et arbitraire des caractéristiques comprises à moitié de cultures occidentales, mais comme une occurrence hybride de nouvelles synthèses créatives des modes de vie. Les jeunes par conséquent sont en train de négocier de diverses idéologies contradictoires pour des différents arrangements. Cette capacité d’alterner entre des séries contradictoires d’attitudes et des registres moraux sans être inquiétés par ceux-ci, les aide à naviguer dans des développements sociaux inégaux, qui caractérisent la vie urbaine sénégalaise (cf. Fabian 1978: 317-318). De plus “la morale n'est pas un système cohérent mais un conglomérat incohérent et non systématique des différents registres moraux qui existent parallèlement et qui dans la plupart de cas se contredisent” (Schielke 2009: 166).
Paradoxalement pour l'observateur européen, d'autres pourraient aussi soutenir que généralement, dans le monde entier, la consommation ne révèle pas la puissance économique authentique de la culture des jeunes (cf. Newell 2012). Les modes de consommation dakaroise ont leur propre logique entre apparences, moyens financiers et de facto ressources économiques limitées. Surmonter des limites financières avec un vocabulaire de stratégies intégrées dans le savoir urbain, c’est ce que Marco Di Nunzio appelle “street smartness” (intelligence de la rue) (2012: 437), nandité (quelqu'un qui est initié) dans le jargon local.
Les jeunes tentent de pratiquer du camouflage en présentant des illusions de dund bu neex (la belle vie) à travers des modes de consommation ostentatoire, et de fait ils réussissent. Les individus qui sont pauvres donnent des apparences superficielles et se prétendent riches. Du savoir urbain et de la ruse locale sont organisés ici pour performer une intégration culturelle et urbaine. L’Intégration urbaine est regardée comme beaucoup plus que simplement la participation dans des circuits économiques qui permettent le fonctionnement des économies urbaines et particulièrement des économies informelles en ville. Pour les jeunes citadins de sexe masculin, l’intégration urbaine se traduit par la capacité de se contrôler et par l'appropriation de certains éléments considérés comme souhaitable et le refus d'autres caractéristiques indésirables des mondes de vécus urbains. Être en ville (being-in-the-city) pour eux à plus à avoir avec une quête d’une citoyenneté mondiale, c'est-à-dire non seulement faire partie des flux mondiaux de marchandises, mais aussi de prendre une part active et composante dans ces flux et d’être à la hauteur pour les manipuler et se les approprier.
Cette revendication d'une citoyenneté mondiale ne doit pas être invisible, mais elle reflète plutôt une logique interne d'une certaine visibilité qui est intégrée dans des cultures qui sont fortement imbriquées dans une structure complexe : d’une part entre une aspiration pour le prestige et le statut social, et d’autre part une aspiration à des concepts modérés et des morales.
Avec la situation de vulnérabilité actuelle, les jeunes hommes, qui sont entravés par d'énormes charges financières pour être à la hauteur de leurs idéaux, qui sont en partie fixés par eux-mêmes mais surtout imposés de l'extérieur, se limitent à mettre en place une multitude d'espaces dans lesquels ils peuvent effectuer et exercer leurs identités négociées. Par conséquent ils cherchent l'attention et la confirmation des autres. “Culturellement ils sont construit comme des ‘récipients vides’ (nourrissons) par un système structurel qui est qualifié de ‘bigmanity’[11] et les traite comme des pions. De ce fait, ils se battent pour se faire accorder une place d’adulte dans la société ou bien ils se font passer pour des parties prenantes avec essence à travers une consommation ostentatoire” (Fuh 2012: 501).
BOYTOWNISM ET BËGG ADDINA
En marchant à Pikine, on peut voir les adolescent(e)s habillés dans des vêtements de style étant donné qu’ils sont conscients du goût du dernier cri. La plupart de ces jeunes n’ont pas d’emploi fixe, ils passent toute leur journée dans leurs cercles d’amis à discuter de tout et de rien, à regarder les filles qui passent devant eux tout en buvant du thé. Ils ne se trouvent dans aucune activité physique visible, si le repas familial n’est pas servi c’est alors qu’ils disparaissent soudainement dans leurs familles respectives. Ils sont assis sur des sièges provisoires, rongeant du gerte caaf, (des arachides grillées vendues dans de petits sacs en plastique pour 25 CFA ~ 4 Euro Centimes) partout sur le bord du chemin.
Les jeunes appellent cela rey temps bi ou kill temps bi dans le jargon local, désigné “tuer le temps” (cf. Ralph 2008). Contrairement aux jeunes filles, ils ne sont pas limités à concession familiale comme “l'expérience urbaine la plus détaillée” (Hansen 2005: 10).
Tshikala Kayembe Biaya, un spécialiste de la langue et de la culture populaire urbaine africaine, parle d'une “géographie du plaisir” en se référant aux lieux touristiques sur la côte sénégalaise et à certaines boites de nuit dakaroises. Il affirme une castration de jeunes hommes, qui concernent notamment leur virilité. D'autre part, les jeunes femmes, bien conscientes de leur propre valeur dans cette nouvelle économie dans laquelle des apparences superficielles et des sexualités sont prépondérantes, savent comment exploiter cette situation pour leur propre bénéfice, qui résulte des frustrations économiques et sexuelles au sein des jeunes hommes (2001).
Même si il y a une tentation consumériste flagrante, les jeunes n’acceptent pas tous les emplois qui leur arrivent. Ils accordent beaucoup d'attention à leur statut et leur prestige, du fait que certains emplois sont considérés avantageux pour obtenir plus de statut et d'autres non. Des jeunes hommes donc se mesurent minutieusement sur une échelle hiérarchique entre haut et bas.
« Les Boy Town aiment la facilité. Ils n’aiment pas travailler. Ils se considèrent comme de enfants, et se comportent comme des Parisien, comme des gens riches (…) » (Modou, 25 ans)
Cet extrait de l’interview montre la notion négative de ce terme en indiquant que le Boy Town est comme une personne paresseuse, qui veut donner l’impression d’être un Parisien, dans le sens de quelqu’un qui connaît l’étiquette européenne, de quelqu’un cosmopolite, très mal perçu comme un riche, à qui tout est remis sur un plateau d'argent, sans aucun effort de sa part. Cette notion négative est accompagnée d’une identification pour des caractéristiques particulières du Boy Town, de telle sorte qu’il peut aller sans problème dans des parties les plus sophistiquées de la ville avec ses boîtes de nuit de luxe, ses casinos et ses restaurants coûteux, comme la zone résidentielle de Almadies avec ses boîtes de nuit Nirvana Night Club, Patio, Casino, VIP, ils vont dans les restaurants de luxe Villa Crystal, le Must au Point E, le Café de Rome, le Terrou-Bi, un des hôtels les plus luxueux de Dakar comprenant un casino, une discothèque, qui est situéeenviron trois à quatre kilomètres au nord du plus grand centre commercial, le Sea Plaza.
J'ai souvent entendu que beaucoup de Pikinois vont à ces lieux, cédant aux tentations d'un monde de consommation ostentatoire en pratiquant bëgg àddina, qui signifie “vivre la vie au maximum”, de sortir, de profiter de la vie nocturne dans des discothèques et des bars, manger dans des restaurants et Fast foods, etc. Chaque samedi soir, ma sœur d'accueil se préparait, plongée dans le choix d’une de ses nombreuses robes de sa garde-robe pour être sañse[12]pour le soir, pour aller à un concert de Pape Diouf, Viviane N’Dour[13]ou tout simplement aller au Nirvana Night Club au cœur des Almadies ou dans une autre discothèque.
Dans cet affichage de capacités consuméristes émerge la figure du Boy Town, un modèle extrêmement controversé, avec qui beaucoup de jeunes hommes, en fonction de leur situation, s’identifient. L’importance montante de la figure du Boy Town afin est en corrélation avec une érosion flagrante des valeurs et une individualisation qui est en cours dans la société (bopp-sa-bopp, chacun pour soi), qui résulte d’une crise des valeurs.
Cette évolution des valeurs requiert des redéfinitions de nombreux concepts qui prévalent dans la société, comme un lent processus d'individualisation qui est de plus en plus visible en jeu (cf. Calvès et Marcoux 1997). Isabelle Sévédé-Bardem voit ce processus comme un phénomène concomitant d’une modernisation progressive dans des sociétés urbanisées qui déclenche une multiplicité de pratiques intégrées dans des logiques d'hybridation entre des solidarités traditionnelles et des tendances de l'individualisation, et enfin introduit une sélectivité plus proche et un choix plus sélectif des services d'assistance et de solidarités (1997: 206-207).
REMARQUES FINALES
Des chercheurs africains, en particulier dans le domaine de cultural studies ont souligné l'importance immense des pratiques de consommation dans des cultures juvéniles et dans ses figurations. Au cours d'une néo-libéralisation de la société, des pratiques de consommation sont déployées pour façonner des identités sous-culturelles juvéniles, qui sont en opposition avec les convictions établies de longue date. Il serait irréfléchi de penser que la hausse du coût de la vie et l'avancement général de la quantification économique de tous les domaines de la vie ont produit tout simplement des victimes d'une hégémonie capitaliste; au contraire ces victimes prétendues ont élaboré des stratégies d'adaptation complexes, incorporées dans des processus de d'identités juvéniles.
Comme la migration internationale devient de plus en plus difficile pour les jeunes hommes et que l’immobilité devient une réalité incontournable (au moins temporairement), la circulation à travers des terrains urbains précaires a besoin d'un état spécifique de l'art des connaissances urbaines utilisées par des jeunes hommes pour survivre et préserver leur statut social.
La consommation ici doit être considérée d'un point de vue local, où elle est inévitablement liée à des perceptions locales de la façon dont la modernité est vécue et la connaissance de faire partie de celle-ci. Mais les jeunes ne veulent pas être simplement une partie passive de la modernité; ils veulent être des acteurs à part entière de ce qu’ils interprètent comme modernité. Des pratiques ostensibles indiquent une intégration dans la société de consommation moderne qui est devenue une ressource essentielle pour les jeunes hommes à défaut de marquer un point avec des investissements à long terme comme, l’éducation ou des plans d'affaires durables. Eux, ils attendent plutôt des résultats unilatéraux, positifs et avant tout rapides.
Pour être acceptée socialement dans le voisinage une jeune personne doit sauter sur le train de la consommation et modifier activement son environnement et inverser le processus de sa marginalisation et de son exclusion. Avec un recours auprès d’une des valeurs traditionnelles telles que la solidarité, les Pikinois amènent leur localité de nouveau dans un discours de convictions villageoises, mais en même temps ils sont profondément ancrés dans des négociations de participation à la vie urbaine et d'acteurs de la mondialisation et de la modernité. Non seulement ils aspirent au mimétisme de l'occident est aspirée, mais ils aspirent aussi à la participation active et à une configuration individuelle de la mondialisation.
Alors que le président sénégalais Léopold Sédar Senghor rêvait que Dakar serait comme Paris à l'année 2000, la question n'est plus si Dakar est comme une ville européenne, comme Paris, Berlin ou une ville nord-américaine comme New York ou Toronto, mais comment les acteurs urbains eux-mêmes, les habitants, s’approprient activement les réalités urbaines et les configurent de telle manière qu’ils répondent à leurs besoins et qu’ils soient capables de déclencher des sentiments d’appartenance aux flux mondiaux au point qu’ils pourraient dire “Bien que nous soyons de Pikine, nous pouvons être également des habitants de Paris, Berlin ou New York!”
Références citées
AbdouMaliq, S. (2001) ‘On the worlding of african cities’, African Studies Review 44 (2): 15-41.
Babou, C. A. (2008) ‘Migration and cultural change: money, “caste,” gender, and social status among Senegalese female hair braiders in the United States`, Africa Today 55 (2): 3-22.
Beck, R. M. (2010) ‘Urban languages in Africa’, Africa Spectrum 3/2010: 11-41.
Biaya, T. K. (2001) ‘Les plaisirs de la ville. Masculinité, sexualité et féminité à Dakar (1997-2000)’, African Studies Review 44 (2): 71-85.
Brunner, A. (2010) Die Anfänge des Mbalax. Zur Entstehung einer senegalesischen Popularmusik. Vienne: Institut de Musicologie.
Buggenhagen, B. (2008) ‘Beyond brotherhood: gender, religious authority and the global circuits of Senegalese muridiyya’, in M. Diouf et M. A. Leichtmann (eds.), New perspectives on Islam in Senegal: conversion, migration, wealth, power and femininity. Basingstoke: Palgrave Press.
Buggenhagen, B. (2012) ‘Fashioning piety: women’s dress, money, and faith among Senegalese muslims in New York City’, City & Society 24 (1): 84-104.
Calvès, A. E. et Marcoux, R. (2007) ‘Présentation: les processus d’individualisation « à l’africaine »’, Sociologie et sociétés 39 (2): 5-18.
Devisch, R. (1999) ‘Mimicry, parody, and the ‘cannibalisation’ of the French master language in the prophetic healing churches of Kinshasa’, Le Cap: Document présenté au Département d'anthropologie, Université du Cap, 30.04.1999
Dianka, D. (2007) ‘La migration internationale féminine individuelle à partir du Sénégal vers la France: le cas des Fatou-Fatou’. Thèse de doctorat, Université de Reims Champagne-Ardenne.
Dimé, M. N. (2005) ‘Crise économique, pauvreté et dynamique des solidarités chez les catégories sociales moyenne et populaire à Dakar (Sénégal)’. Thèse de doctorat, Université de Montreal.
Di Nunzio, M. (2012) ‘“We are good at surviving”: street hustling in Addis Ababa’s inner city’, Urban Forum 23: 433-447.
Diouf, M. (2002) ‘Des cultures urbaines entre traditions et mondialisation’, in M.-C. Diop, M (ed), Le Sénégal contemporain. Paris: Karthala.
Diouf, M. (2003) ‘Engaging postcolonial cultures: African youth and public space’, African Studies Review 46 (2): 1-12.
Diouf, M, et Rendall, S. (2000) ‘The Senegalese murid trade diaspora and the making of a vernacular cosmopolitanism’, Public Culture 12 (3): 679-702.
Dolby, N. (2006) ‘Popular culture and public space in Africa: the possibilities of cultural citizenship’, African Studies Review 49 (3): 31-47.
Durham, D. (2000) ‘Youth and the social imagination in Africa: Introduction to parts 1 and 2’, Anthropological Quarterly 73 (3): 113-120.
Éla, J.-M. (1999) ‘Vers une économie politique des conflits au ras du sol’, Afrique et développement 24 (3&4): 103-133.
Enda Graf Sahel (2009) ‘Pikine aujourd’hui et demain: diagnostic participatif de la ville de Pikine (Dakar, Sénégal)’, Dakar: Enda Sahel et l’Afrique de l’ouest – Groupes recherche action formation ou Enda Graf Sahel.
Fabian, J. (1978) ‘Popular culture in Africa: findings and conjectures’, Africa 48 (4): 315-334.
Fall, A. S. (1999) Bricoler pour survivre: perceptions de la pauvreté dans l’agglomération urbaine de Dakar. Paris: Karthala.
Ferguson, J. (1999)Expectations of modernity: myths and meanings of urban life on the Zambian Copperbelt.Londres: University of California Press.
Ferguson, J. (2006) Global shadows: Africa in the neoliberal world order. Durham: Duke University Press.
Fouquet, T. (2005) ‘Variations autour des imaginaires constitutifs de la frontière et de l’Ailleurs chez les jeunes Dakarois: le « désir de l’Ailleurs » en perspective’
< http://jeunes-et-societes.cereq.fr/PDF-RJS2/FOUQUET.pdf >, consulté le 18.07. 2013.
Fouquet, T. (2007) ‘Imaginaires migratoires et expérience multiples de l’altérité: une dialectique actuelle du proche et du lointoin’, Autrepart 41: 83-97.
Fuh, D. (2012) ‘The prestige economy: veteran clubs and youngmen’s competition in Bamenda, Cameroon’, Urban Forum 23 (4): 501-526.
Friedmann, J. (1990) ‘Being in the world: globalization and localization’, Theory, Culture & Society7: 311-328.
Friedmann, J. (1994) Consumption and identity. Londres: Harwood Academic Press.
Gondola, D. (1999a) ‘La sape des mikilistes: théâtre de l'artifice et représentation onirique’, Cahiers d’Études Africaines 39 (153): 13-47.
Gondola, D. (1999b) ‘Dream and drama: the search for elegance among Congolese youth’, African Studies Review 42 (1): 23-48.
Grabski, J. (2007) ‘Introduction to special Issue: visual Experience in urban Africa’, Africa Today 54 (2): vii-xii.
Graw, K. (2012) ‘On the causes of migration: being and nothingness in the African- European borderzone’, in K. Graw et S. Schielke (eds.), The global horizon: migratory expectations in Africa and the Middle East. Leuven: Press universitaires de Louvain.
Halperin, R. A. et Scheld, S. (2008) ‘Introduction: youth engage the city and global culture’, City and Society 19 (2): 169-178.
Hansen, K. T. (2000) Salaula: the world of secondhand clothing and Zambia. Chicago, Londres: The University of Chicago Press.
Hansen, K. T. (2005) ‘Getting stuck in the compound: some odds against social adulthood in Lusaka, Zambia’, Africa Today 51 (4): 3-16.
Heath, D. (1992) ‘Fashion, anti-fashion and heteroglossia in urban Senegal’, American Ethnologist 19 (2): 19-33.
Jónsson, G. (2007) ‘The mirage of migration: migration aspirations and immobility in a Malian Soninke village’. Copenhague: Mémoire de maîtrise, Institut d'anthropologie de l'Université de Copenhague.
Lefebvre, H. (1997): «Introduction» Critique de la vie quotidienne.Paris: L'Arche.
Lukose, R. (2005) ‘Consuming globalization: youth and gender in Kerala, India’, Journal of Social History 38 (4): 915-935.
Marie, A. (1997) L’Afrique des individus: itinéraires citadins dans l’Afrique contemporaine (Abidjan, Bamako, Dakar et Niamey). Paris: Karthala.
Mbembe, A. and Nuttal, S. (2004) ‘Writing the world from an African metropolis’, Public Culture 16 (3): 347-373.
Mbembe, A. and Rendall, S. (2002) ‘At the edge of the world: boundaries, territoriality, and sovereignty in Africa’, Public Culture 12 (1): 259-284.
Mbembe, A. (1997) ‘The ‘thing’ and its doubles in Cameroonian cartoons’, in K. Barber (ed.), Readings in African popular culture. Bloomington: Indiana University Press, Bloomington, Oxford: James Currey.
McLaughlin, F. (2001) ‘Dakar Wolof and the Configuration of an Urban Identity’, Journal of African Cultural Studies, 14 (2): 153-172.
Médard, J-F. (1992): Le “big man en Afrique”: analyse du politicien entrepreneur »,Année sociologique, 42 : 167-192.
Meyer,B. and Geschiere, P. (2008) ‘Introduction‘, in B. Meyeret P. Geschiere (eds), Readings in Modernity in Africa. Bloomington: Indiana University Press.
Newell, S. (2012) The modernity bluff: crime, consumption, and citizenship in Côte d’Ivoire. Chicago: University of Chicago Press.
Nyamnjoh, F. B. (2000) ‘‘For many are called but few are chosen’: globalization and popular disenchantment in Africa’, African Sociological Review 4 (2): 1-45.
Nyamnjoh, F. B. (2004) ‘Globalisation, boundaries and livelihoods: perspectives on Africa’, Identity, Culture and Politics 5 (1&2): 37-59.
Nyamnjoh, F. B. (2005) ‘Fishing in troubled waters: disquettes and thiofs in Dakar’, Africa 75 (3): 295-324.
Panzacchi, C. (1996) Mbalax Mi. Musikszene Senegal.Wuppertal: Peter Hammer.
Perry, D. L. (2009) ‘Fathers, sons, and the state: disciple and punishment in a Wolof hinterland’, Cultural Anthropology 24 (1): 33-67.
Piot, C. (1999) Remotely global:village modernity in West Africa. Chicago: University of Chicago Press.
Ralph, M. (2008) ‘Killing time’, Social Text 26 (4): 1-29.
Rowlands, M. (1996) ‘The consumption of an African modernity’. in M. J. Arnold, M. G. Christaud et K. L. Hardin (eds.), African Material Culture. Bloomington: Indiana University Press.
Salazar, N. B. (2010) ‘Towards an anthropology of cultural mobilities’, Crossings: Journal of Migration and Culture 1 (1): 53-68.
Salem, G. (1998) La Santé dans la ville: géographie d’un petit espace dense: Pikine (Sénégal). Paris: Karthala.
Sarr, C., Ndiaye, L., Wade, A., Sow, A. et Kane, M. S. L. (2009) ‘Genre et migration clandestine dans les zones côtières au Sénégal’, Dakar: Laboratoire Genre, IFAN – Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Projet institutionnalisation du genre, des droits et de la participation citoyenne des femmes à l’Université C.A. DIOP – Dossier du CRDI Nr. 104029.
Schapendonk, J. (2013) ‘Sub-saharan migrants heading north: a mobility perspective’, in A. Triulzi et R. McKenzie (eds.), Long journeys. African migrants on the road. Africa-Europe Group for Interdisciplinary Studies, Leyde: Brill.
Schielke, S. (2009) ‘Ambivalent commitments: troubles of morality, religiosity and aspirations among young Egyptians’, Journal of Religion in Africa 39 (2): 158-185.
Sévédé-Bardem, I. (1997) Précarités juvéniles en milieu urbain africain (Ouagadougou): “Aujourd’hui, chacun se cherche”. Paris: Harmattan.
Sidibé, M. (2005) Migrants de l'arachide: La conquête de la forêt classée de Pata, Casamance, Sénégal. Paris: IRD Éditions.
Van Eerdewijk, A. (2007) The ABC of unsafe sex – gendered sexualities of young people in Dakar (Senegal).Nimègue: Anouka Van Eerdewijk.
Whyte, S. R., Alber, E.et Van der Geest, S. (2008) ‘Generational connections and conflicts in Africa: an introduction’, in E. Alber, S. van der Geest et S. R. Whyte(eds.), Generations in Africa: connections and conflicts. Münster: LIT.
Wood, S. (2008) ‘Mangi teus teus: between a Weberian and historical understanding of economic dominance among pious Muslims in francophone West Africa’, Journal of Islamic Marketing 1 (3): 203-219.
[1] En se référant sur le travail de Lefebvre (1997), le sociologue Éla mets l’emphase à la centralité et le pouvoir explicatif d'une analyse des faits banals et des pratiques quotidiennes, ce qui semble d’être trivial pour comprendre les changements modernes dans les sociétés africaines. Le point focal de la recherche sur la banalité et les pratiques quotidiennes devaient se fonder sur une attention antérieure sur leurs acteurs, qui sont consécutives aux nouvelles dynamiques sociales. Pour Éla ces acteurs de “souterrain” guideront les recherches pour trouver à rétablir les aspects de vitalité, créativité et de l'inventivité inhérent aux sociétés africaines (1999: 104).
[2] Pikinité révèle un réveil de la fierté et de l'identification des gens avec leur localité. Il sert de récipient pour recueillir des caractéristiques positives de la façon dont un quartier urbain précaire doit être dans les yeux de ses habitants. Avec ces attributions vives une contre-déclaration a gagné du terrain qui valorise un quartier urbain autrefois célèbre pour sa mauvaise réputation. L'idée de Pikinité était particulièrement favorisée par le lutteur Tyson, surnom de Mouhamed Ndao, et d'autres artistes connu de Pikine comme Ndongo Lô, Pape Diouf et Ive Niang.
[3] Pour préserver l’anonymat de certaines personnes, tous les noms ont été changés.
[4] Cf. les observations faites par Thomas Fouquet sur les jeunes citadins féminins à Dakar. Pour eux un certain habitus européenne est aspiré et considérée comme capitale culturelle. Elles essaient de “maîtriser l’étiquette des milieux les plus occidentalisés de Dakar [...]” (2007: 111), et avoir accès “à une autre histoire” (2005: 5).
[5] J'utilise “établie” ici dans le sens de migrants, qui vivent dans des conditions à l'étranger qui leur permet de répondre à certaines attentes familiales.
[6] Avant mon deuxième voyage de recherche au Sénégal la liste de souhaits de mes frères d'accueil contenait des maillots de football originaux du FC Bayern Munich et Borussia Dortmund. L'allusion que je pouvais aller avec mes frères d'accueil sur le marché Colobane et leur acheter ces maillots de football n'ont pas été acceptés; je dû les apporté dans l'avion de l'Allemagne au Sénégal.
[7] Koñ bi est appelé banc jaaxle (ainsi nommés bancs publics où les jeunes sans travail ou bien des pères passent leur journées et réfléchissent sur leur sorte (Fall 1999: 84)). Au village il était appelé d’habitude penc (mi). Ce mot a un double sens: il désigne un espace central, mais aussi un bois qui sert comme "place du village” (Sidibé 2005: 21).En Afrique francophone, il est souvent appelé l’arbre à palabres.
[8] Móodu-Móodu se réfère à Mamadou Moustapha Mbacké. Il était le fils aîné de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur de la confrérie Murīdiyya (Diouf and Rendall 2000: 695). Pour les femmes Móodu-Móodu on emploie les termes Móodouse ou Fatou-Fatou et Bineta-Bineta (cf. Sarr et al 2004: 5, Dianka 2007).
[9] Lors de mon premier travail sur le terrain (2011/2012) j'ai été engagé personnellement dans le secteur informel en vendant de parfums avec un informateur.
[10] Des Baay Faal ruraux marchent sur les traces de cheikh Ibrahima Fall (1855-1930) (un disciple d’Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927), fondateur de la Murīdiyya), bien connu pour son dévouement et sa soumission à Dieu. Ahmadou Bamba a considéré le travail, en particulier le travail agricole manuel comme une forme d'adoration de Dieu. Suivant leur philosophie des obligations musulmanes, tels que la prière et le jeûne, sont substitué par le travail manuel dur et la dévotion pour leur marabout (chef religieux et enseignant, guide spirituel), en ligne avec leur devise “Jëf Jël” (littéralement : Tu vas récolter ce que tu as semé) et assiduité comme idéal. Les Baay Faal s'habillent dans des habilles colorés avec des haillons opaques, un patchwork appelé njaaxas, fait de petits morceaux carrés ou de longues bandes de damassé multicolores. Leur mode de vie ascétique se manifeste entre autre par le refus de nouveaux vêtements. Quand ils ont besoin de vêtements ils amènent des restes de vêtements chez un tailleur et lui demandent de les coudre ensemble pour un costume (Wood 2010: 208). Ils portent des images de Ahmadou Bamba et de Ibrahima Fall et ils ont des dreadlocks appelé njeñ qui signifie des cheveux forts, qui sont décorés avec de perles fait maison. Toute leur journée est consacrée à la prière et au travail. Touba, la ville principale de la Murīdiyya, qui accueille le festival annuel le plus important de cette confrérie, le Grand Magal, attire chaque année des millions de membres de l'étranger et de tous les coins du Sénégal. Ici les Baay Faal servent comme gardes de sécurité.
[11] Selon politologue Jean-François Médard bigmanity est un statut social de leadership personnel qui dépend des relations patron-client par lequel les relations sociales sont transformées en puissance et de contrôle stratégiques (1992).
[12] Sañse est en corrélation avec le statut du rang social des femmes, la richesse et l'honneur (jom). Il est l'une des stratégies que les femmes utilisent pour exposer leur richesse (alal), étroitement liée à la notion de beauté (rafetaaye) (Buggenhagen 2008; Heath 1992). Pour être sañse une femme doit décorer son corps correctement avec des accessoires et des vêtements à la mode; qui veut signifier de dépenser des grosses sommes pour l'or, pour des bijoux, du maquillage, des produits de blanchissement (xeesal) et des vêtements (Babou 2008: 13). Au Sénégal la notion de beauté n'est pas en corrélation avec le corps nu (comme c'est le cas dans de nombreuses sociétés occidentales) mais avec sa présentation de son décoration (Buggenhagen 2012: 96, cf. Biaya 2000).
[13] Viviane N’Dour est actuellement une des plus célèbres chanteurs de pop au Sénégal, aussi connu comme “la reine de Mbalax”. Mbalax est une musique populaire syncrétique, qui était fait célèbre par Youssou N'Dour et qui combine des éléments de musique populaire occidentale avec des chants en langue Wolof et des danses qui sont influencé par soul, Latin, jazz, rock et sabar. Pour en savoir plus voir Panzacchi 1996; Brunner 2010.
 Télécharger l’article en version PDF
Télécharger l’article en version PDF
Introduction
L’écriture d’une histoire de la peinture de chevalet au Maroc gagnerait certainement à déplacer son intérêt de la recherche d’un premier peintre marocain vers l’identification d’un espace témoin des prémisses de cette pratique en terre marocaine. En voulant retrouver “le premier peintre” et ce moment unique où a été conclu ce pacte avec l’image et la représentation sur un support indépendant, nous nous sommes retrouvées face à la difficulté de remonter à ce moment T0. Plusieurs raisons rendent une telle enquête ardue. Tout d’abord le décalage temporel inhérent à tout exercice historiographique qui nécessite une dimension interprétative de tout élément de la collecte ; ensuite la rareté, voire l’inexistence de documents écrits commémorant des évènements ou des faits relatifs à la pratique picturale marocaine avant le milieu des années 1940.
Afin de palier au silence historique relatif à ce phénomène, nous proposons dans cette analyse d’établir un lien entre l’espace urbain de Tanger et les débuts de la pratique de la peinture de chevalet au Maroc. Dans ce rapport la ville s’érige en mémoire prothèse. Pour cela, nous fondons notre propos sur les thèses historiographiques de Michel de Certeau et de Pierre Nora.
Ces deux théoriciens nous aideront dans un premier temps à développer une transformation de la ville-monument en ville-document et à analyser ensuite le mouvement par lequel un récit commémorant le premier peintre marocain connu institue la ville de Tanger en agent à même d’attribuer à cet homme un destin hors du commun. En dernier lieu, en nous aidant de l’approche de Pierre Nora, nous essaierons de restaurer un milieu perdu par la considération de données urbaines et sociales particulières à la ville de Tanger dès la fin du XIXème.
De Tanger "monument" à Tanger "document" : un déplacement nécessaire
Le récit de la naissance de la peinture de chevalet au Maroc entre la deuxième moitié du XIXème siècle et les premières décennies du XXème siècle est à construire. En effet, selon Michel de Certeau, l’opération historiographique consiste à “fabriquer” l’histoire à travers une série d’opérations qui se situent entre la documentation et l’interprétation. Ainsi le récit historique est intrinsèquement un récit herméneutique qui dépend essentiellement de la documentation disponible, de l’interprétation de l’analyste et des agendas ou contextes sociopolitiques qui environnent son interprétation. En effet, « [L’histoire] se déplace constamment entre le donné et le créé, entre le document et sa construction, entre le supposé réel et les mille et une manières de le dire. »[1]
Ce récit a déjà été mis en rapport avec un destin particulier, celui du peintre marocain Mohammed ben Ali R’bati[2]. Il a, par ailleurs, et entre autres, fait l’objet d’une chronologie faisant intervenir différents modes d’expressions artistiques, allant des représentations rupestres et grotesques préhistoriques aux peintres contemporains en passant par l’artisanat local et les peintres orientalistes[3]. Ces mouvements constituent autant de déplacements nécessaires face au décalage temporel qui éloigne l’analyste de son objet d’étude. Qui veut entreprendre une recherche sur l’histoire de la peinture au Maroc ne peut se détourner de la ville de Tanger. Cette ville s’impose comme sujet d’étude voir même comme document à déchiffrer.
Comme Michel De Certeau le souligne
En histoire, tout commence avec le geste de mettre à part, de rassembler, de muer en “documents” certains objets répartis autrement. Cette première répartition culturelle est le premier travail. En réalité elle consiste à produire de tels documents, par le fait de recopier, transcrire ou photographier ces objets en changeant à la fois leur place et leur statut. Ce geste consiste à “isoler” un corps, comme on le fait en physique, et à “dénaturer” les choses pour les constituer en pièces qui viennent combler les lacunes d’un ensemble posé a priori. [ce geste] bien loin d’accepter les données, il les constitue. Le matériau est créé par les actions concrètes qui le découpent dans l’univers de l’usage, qui vont chercher aussi hors des frontières de l’usage et qui le destinent à un réemploi cohérent. Il est la trace des actes qui modifient un ordre reçu et une vision sociale[4]
C’est dans cette perspective que cette étude tente de classer la ville de Tanger en document permettant de repérer des zones de perméabilité entre différentes composantes culturelles en présence dans la ville entre la fin du XIXème siècle et le début du XXème siècle. Cette démarche envisage de retrouver un contexte général de l’apparition ou de l’insertion du phénomène pictural.
En vue de rassembler les fragments encore dispersés de ce récit, nous distinguons trois paradigmes : l’objet, le sujet et la trace. Le premier paradigme se rapporte aux œuvres et à la production d’objets d’art. Le deuxième réfère aux acteurs et aux actions, en l’occurrence, des individus ou groupes d’individus constitués autour d’une activité de création ou de réception et organisé sous forme de réseaux. Le troisième s’appuie sur tout ce qui constituerait une extension aux deux premiers paradigmes, ce qu’il en reste substantiellement comme une indication, après coup. Cette dernière n’est ni le sujet ni l’objet en soi, mais le réceptacle qui en porte la trace. C’est une métaphore du lieu comme contenant et espace qui accueille les faits. C’est précisément ce dernier paradigme qui s’inscrit dans l’exercice d’interprétation qu’exige l'historiographie.
Si l’activité humaine s’inscrit dans le temps et dans l’espace, c’est précisément le donné spatial qui peut porter la trace du mouvement et des modifications qu’implique le temps, comme un témoignage muet et que l’analyste doit arracher au silence. Chaque lieu est porteur de traces inscrites soit dans sa matérialité encore vivante soit dans les récits et la littérature qui le décrivent et qui, a posteriori, peuvent ouvrir des possibilités d’interprétation et de construction/reconstruction. Le lieu peut donc être conçu comme l’écho d’une absence, d’un éloignement. Ainsi la ville de Tanger peut être classée, non seulement comme monument, mais aussi comme document dont la morphologie à une époque précise permet d’éclairer l’opacité qui entoure les débuts de la pratique picturale.
Compte tenu des déplacements et modifications que l’indépendance du Maroc a engendrés, Tanger sert ici de lieu portant les traces d’une mémoire révolue. Cette ville peut donc servir d’espace médiateur, lequel, sur la base de traces écrites et de récits particuliers, permet une relative visibilité du passé. Ce mouvement d'interprétation du lieu en document n'est entrepris que lorsqu'étant séparé des faits, la mémoire devient un devoir de construction. Comme Pierre Nora le rappelle « Moins la mémoire est vécue de l'intérieur, plus elle a besoin de supports extérieurs et de repères tangibles d'une existence qui ne vit plus qu'à travers eux »[5]. Mais cette mémoire loin de se contenter de papiers, interroge aussi l'espace urbain. Parce que nous ne sommes plus contemporains à la manière dont les premières occurrences qui ont fait intervenir la représentation picturale moderne en terre marocaine que nous sommes amenés à dénaturer cet espace urbain pour en faire un document historique. A cet égard, Pierre Nora souligne que :
A mesure même que disparaît la mémoire traditionnelle, nous nous sentons tenus d'accumuler religieusement vestiges, témoignages, documents, images, discours, signes visibles de ce qui fut, comme si ce dossier de plus en plus proliférant devait devenir on ne sait quelle preuve à l'on ne sait quel tribunal de l'histoire.[6]
L'opération historiographique est donc l'expression d'une cécité, d'un manque de visibilité. L'attitude qui consiste en l'accumulation de traces et d'archives de toutes sortes est selon Pierre Nora « liée au sentiment même de perte »[7].Tanger peut servir à donner une certaine matérialité à la mémoire des débuts de la peinture au Maroc. Cette ville peut constituer ce que Nora appelle une « mémoire prothèse » qui intervient sur un espace pour le considérer sous un autre jour. La conception de Tanger en ville-document implique que l’espace urbain admet d’être lu et interprété comme nous le démontrerons dans la partie de cet article.
Tanger : un espace agent
Notre étude interroge des récits romanesques ou « romancés » évoquant cette ville, lui accordant le statut d'agent à part entière, ainsi que des archives administratives et particulières rendant compte de la morphologie inédite de cette ville à un moment où le territoire marocain demeure fermé à l'infiltration européenne.
Dans un des livres qui célèbrent le premier peintre Marocain connu nous pouvons lire:
Il est des villes qui parlent à ceux qui les habitent. Elles les inspirent, dessinent des arcs de rêverie autour de leur enfance, soutiennent leur imagination et fortifient la conscience qu'elles peuvent avoir de la part manquante donnée à toute existence. Ainsi Tanger et R'bati. Mohammed ben Ali R'bati est né Rabat, mais il a grandi à Tanger et Tanger semble l'avoir aidé à se construire un destin.[8]
C'est ainsi que les auteurs introduisent le lecteur au premier peintre marocain actif dès 1900, c'est-à-dire en mettant en avant la cité où il vécut et pratiqua son art. Sur le plan grammatical, l'espace, dans cet incipit, ne constitue pas un simple complément circonstanciel de lieu ; il occupe littéralement la fonction du sujet qui agit. En admettant que « Tanger semble avoir aidé ben Ali R'bati à construire un destin », les auteurs sont en passe de construire un destin à ce peintre, et partant à considérer d'abord un repère spatial qui suggère un repère temporel. En situant cet homme dans cette ville et faisant de celle-ci un agent adjuvant à même de modifier le destin de ce cuisinier artisan menuisier, les auteurs posent Tanger à la fois comme lieu de mémoire et comme mémoire-prothèse au sens que Nora lui accorde. En d'autres termes, ils opèrent une compensation par le déplacement de l'agentivité du sujet peintre vers l'espace ayant accueilli son activité.
Qu'est ce qui permet un tel déplacement ?
Tanger début de siècle. Des images, des sons, du mouvement. Mais aussi une somme inouie de destins, justement, d'hommes et de femmes venus de tous les horizons aspirés par cette ville sur laquelle veille l'ange du bizarre, et qui est l'un des trois "nombrils" de la Méditerranée notre Mère. La ville est un port, le premier depuis l'Amérique pour les transatlantiques. La porte de notre Orient le plus proche. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque le Maroc reste encore une sorte de Tibet africain, un royaume toujours difficilement accessible, malgré René Caille, premier Européen à traverser le Sahara occidental du nord au sud, malgré Delacroix qui, s'écartant des chemins d'une mission diplomatique, a découvert les paysages d'une Afrique romaine, malgré Charles de Foucauld qui a endossé les habits d'un juif errant pour courir l'intérieur non cartographié du pays.[9]
La couleur narrative de ce texte nous met d'emblée dans une ambiance générale qui demeure diffuse ; un air qui donne à Tanger sa couleur de ville de tous les possibles. Au-delà de la véracité de l'hypothèse que R'bati est le premier peintre marocain, c'est précisément cette image d'un lieu parenthétique qui ouvre la possibilité d'un tel récit des débuts de la pratique picturale en territoire marocain.
Avant d'établir la chronologie qui clôt ce livre sur la biographie et l'œuvre du peintre marocain, les auteurs confient ce qui suit :
La biographie de Mohammed ben Ali R'bati a été établie à partir de témoignages de ses descendants et de ses proches. Fautes de documents, elle reste incertaine, les témoignages étant parfois contradictoires.[10]
Parce qu'il y a manqué de documents écrits, Tanger se constitue dès lors comme le lieu qui cristallise autant de causes ayant présidé à la vocation d'artiste de R'bati et qui font de ce sujet de l'empire iconoclaste un aquarelliste, alors même que le statut d'artiste est un anachronisme dans le contexte marocain de l'époque. En l'absence de documents écrits et outre les témoignages oraux dont ils disposent, les auteurs reconstituent l'ambiance tangéroise qui devient non seulement le témoin le plus proche de la réalité de l'époque, mais surtout l'agent responsable de l'épanouissement de l'activité de cet artiste.
L'air est doux, le ciel ressemble à une aquarelle. Un peu de vent. Il y a souvent du vent à Tanger. [...] Sur le Grand Socco, c'est un mouvement permanent. Des caravaniers et des charmeurs de serpents, des paysans descendus de la montagne. Leurs femmes, chevilles guêtrées et jupes lourdes, coiffées de chapeaux de paille à larges bords, sombreros multicolores à la mode rifaine, comme on en voit encore aujourd'hui, assises tout le long de l'escalier qui mène au marché aux poissons. Dans les ruelles de la ville arabe, le matin déroule ses heures claires. Mélopée des enfants à l'école coranique-R'bati la fréquenta dans son âge tendre, peu assidu en vérité, déjà épris de dessins et de couleurs.[11]
Nous pouvons en effet entrevoir dans ce passage une tentative de réactualisation du milieu par l'utilisation du présent, double d'une comparaison avec la réalité contemporaine. En effet, la mémoire du passé tend à se confondre avec quelque chose d'immémorial et de permanent dans la ville. Ce quelque chose d'intemporel est précisément la ville en tant qu'espace vivant qui se modifie tout en excédant les limites du temps. Tanger se construit ainsi en mythe, celui d’un milieu favorable à la perméabilité de certaines pratiques occidentales, telle que la peinture, en contexte marocain alors même qu'en 1900 les tensions existant entre les deux rives de la Méditerranée n'offraient pas de conditions favorables à un tel état de choses. Cependant, la mémoire-prothèse a ceci de particulier qu'elle peut invertir, comme l'exemple le démontre, un récit romancé et sensuel en interpellant la perception contemporaine de l'espace en vue de reconstituer sa mémoire perdue. Aussi bien la vue que le toucher interviennent dans ce fragment au moyen d'une focalisation interne. C'est dans ce point de vue interne que loge l'essentiel de la démarche herméneutique et subjective d'une telle interprétation et qui à terme consiste à fabriquer le passé sur la base du présent.
Reconstitution d'un « milieu »
Pierre Nora précise qu'"il y a des lieux de mémoire parce qu'il n'y a plus de milieux de mémoire"[12]. Dans ce qui suit nous montrerons comment la ville de Tanger est un lieu de mémoire pour les prémisses de la peinture de chevalet au Maroc car en tant que ville-document elle se présente comme un des premiers milieux ayant permis une certaine tolérance à l'égard de l'exercice de la peinture à un moment où le Maroc était encore fermé à ce type de pratiques.
L’élan herméneutique qui nous permet une telle interprétation trouve un de ses socles dans la morphologie spatiale de cette ville dès la fin du XIXème siècle/début du XXème siècle. Tanger révèle à ce moment de son histoire une organisation sociale et institutionnelle ancrée dans la coexistence de plusieurs modèles de représentation. La situation géographique de cette ville la met d'emblée dans une position d'ouverture de par son caractère portuaire. En effet, la ville connaît la plus forte concentration diplomatique et consulaire de l'empire chérifien dès la fin du XIXème siècle.
La concentration des colonies européennes en terre tangéroise : causes et conséquences
A cet égard, rappelons que la diplomatie européenne constitue une des premières formes de présence européenne au Maroc. Les missions diplomatiques débarquaient d'abord au port de Tanger pour continuer leurs trajets vers Meknès ou Fès en fonction du lieu des séances d’audience accordées par les monarques ou les autorités du Mekhzen. La route entre Tanger et Fès était connue, dès 1885, sous le nom de « chemin des ambassades »[13]. Un itinéraire sécurisé incontournable, emprunté par les diplomates et les plénipotentiaires dans un premier temps et fréquenté ensuite par d’autres catégories de gens, notamment les touristes de passage.
| Tanger | Mogador | Autres ports[14] | Total | |
| 1832 | 220 | 17 | 11 | 248 |
| 1836 | 300 | 21 | 28 | 349 |
| 1850 | 330 | 28 | 31 | 389 |
| 1854 | 340 | 30 | 36 | 407 |
| 1858 | 522 | 78 | 98 | 698 |
| 1864 | 940 | 123 | 297 | 1360 |
| 1867 | 965 | 148 | 384 | 1497 |
Tableau représentant la Population européenne au Maroc entre1832 et 1867[15]
Comme cela est manifeste dans le tableau ci-dessus, Tanger assiste dès 1832 à une présence européenne qui va en augmentant. Cela ne va pas sans engendrer des conséquences sur le paysage social de la ville. En effet, l'historien Jean-Louis Miège signale que les villes marocaines, à l’époque, se gonflent non seulement par l’arrivée des étrangers mais aussi par des sujets marocains qui ne tardent pas à constituer un réseau de demandeurs d’emplois autour de chaque famille européenne. Dans ces groupes marocains, venus en masse des campagnes environnantes, sont recrutés des employés et des domestiques qui travaillent pour des européens.
Autour de chaque européen se groupait une clientèle d’employés, de domestiques et de protégés venus des campagnes proches. Le mouvement d’urbanisation, trait essentiel de l’évolution du Maroc moderne tire ses principes de cet afflux dans la décennie 1854-1864. La clientèle gravitait autour de chaque foyer chrétien accroissant le rayonnement de l’influence européenne jouait un rôle décisif dans la diffusion de certaines habitudes […][16]
Il est possible d'inscrire dans cette nouvelle organisation sociale et économique, le déplacement de Ben Ali R'bati et son recrutement par le portraitiste britannique Sir John Lavery. J-L Miège rapporte même qu’il n’y avait « nul domaine de la vie économique et social qui ne se trouvait affecté par l’essor de la colonie européenne »[17]. Cette population a évolué en groupes nationaux organisés dont les influences sont relativement distinctes. Nous reprenons ci-après le tableau[18] établi par Jean-Louis Miège[19] et qui montre clairement cette évolution entre 1836 et 1864.
| Britanniques | Espagnols | Italiens (Sardes) | Français | Divers | Total | |
| 1836 | 110 | 104 | 42 | 37 | 56 | 349 |
| 1858 | 310 | 146 | 50 | 65 | 40 | 611 |
| 1864 | 500 | 592 | 61 | 87 | 110 | 1350 |
Il apparaît clairement que les deux populations les plus présentes au Maroc à ladite période sont les communautés britannique et espagnole. La première est installée pour des raisons essentiellement commerciales dans la mesure où le Maroc constitue alors un entrepôt de marchandises anglaises. Les espagnols, après avoir été minoritaires et voués aux petits métiers, s’imposent comme groupe majoritaire. Ces derniers se dirigent vers le Maroc fuyant la crise économique dans leur pays. A partir de 1868, les espagnols constituent 60% des européens implantés au Maroc. Ils demeurent longtemps la communauté la plus proche des marocains avec lesquels ils entretiennent un rapport de concurrence pour les métiers.
Les espagnols apportaient leur langage et leurs habitudes […] ils sont ceux qui sont les plus en contact avec les marocains […]. Cette colonie confond sa manière d’être avec celle des sujets de l’Empire […] au point que ces derniers modifient leurs habitudes et se façonnent à la vie que mènent là-bas nos compatriotes[20]
Mais cette concentration est notable particulièrement dans la ville de Tanger. En effet, des constations parues dans la presse et des témoignages trouvés dans les échanges épistolaires des diplomates de l’époque attestent de l’hispanisation du port tangérois, comme nous pouvons le lire dans ce fragment : « N’étaient les pavillons qui flottent le dimanche au mât de chaque chancellerie, je me croirais en Espagne. »[21]
Le chef de la mission française fait ce constat en débarquant à Tanger en juillet 1887. C’est une constatation qui nous informe de l’existence de nombreuses représentations étrangères d’une part, et sur le caractère fortement hispanisé de la ville. En outre, la chambre de commerce espagnole publie en août 1891 un énoncé qui signale que
Le caractère espagnol s’est infiltré dans la ville de [Tanger] où la colonie espagnole augmente fabuleusement de jour en jour et où les nouvelles entreprises s’étendent dans les faubourgs de la cité.[22]
Dans la même correspondance, il est possible de lire
[qu’] avec son hôpital, sa mission religieuse, ses écoles, ses cercles, sa chambre de commerce, ses journaux, sa Plaza del Toro, une véritable ville espagnole se créait à l’intérieur de Tanger, tendait à absorber Tanger [23].
Tanger dispose donc très tôt d'une morphologie qui est à même de l'ériger en catégorie urbaine d'exception compte tenu de sa situation portuaire qui lui vaut la réputation d'un espace cosmopolite.
A noter par ailleurs que le sujet anglais est fortement présent au Maroc dans les deux dernières décennies du XIXème en tant que touriste. A ce titre il est important de rappeler que le tourisme[24] a également contribué à déteindre une atmosphère européanisée au Maroc, spécialement à Tanger, lieu de débarquement par excellence. Les statistiques ci-dessous précisent la croissance du phénomène touristique.
| 1887 | 6901 |
| 1888 | 10530 |
| 1889 | 11001 |
| 1890 | 14000 |
| 1891 | 17403 |
| 1892 | 14820 |
| 1893 | 15407 |
| 1894 | 14873 |
Ces chiffres publiés par The Chember of Commerce journal[25] montrent le nombre considérablement croissant des voyageurs européens débarqués à Tanger entre 1887 et 1893. Les relevés enregistrés par les journaux tangérois montrent aussi cet afflux. L’année 1894-95 correspond en revanche à une période de disettes et d’épidémies graves, ce qui explique la diminution du nombre de débarqués européens à cette date. Comme en atteste la presse écrite de l’époque « l’afflux des visiteurs provoque un grand changement dans la routine de la vie quotidienne de Tanger »[26].
Pendant que le Maroc est fermé à l'Europe durant la deuxième moitié du XVIIIème siècle, Tanger y constitue déjà un lieu de résidence des diplomates étrangers et une sorte de bastion contre l'infiltration européenne. N'ayant jamais bénéficié du statut de ville impériale, elle semble avoir succombé plus rapidement à la pénétration étrangère[27]. Pendant la deuxième moitié du XIXème siècle, elle est le réceptacle de la communauté étrangère, avant que ce statut international ne soit officialisé au début du XXème sièlce[28]. Manifestement, Tanger est la ville qui semble être la première du Maroc à connaître cette forte influence, européenne en général, et espagnole en particulier, et ce par la présence de structures et d’institutions sociales relatives à la communauté établie.
Dans ce contexte de coprésence, les deux composantes sociales se mélangent dans la mesure où la composante européenne est, à partir de cette période, constituée non plus d’individus éparpillés, mais de groupes solidaires. Cette transformation sociale modifie non seulement la physionomie sociale des villes mais semble toucher également leur physionomie spatiale. Ces dernières connaissent une extension considérable.
Parmi les conséquences de la concentration consulaire et des colonies européennes dans la ville, on peut noter le lancement d'actions d'aménagement et d'équipement. En effet, les différentes formes de présences, qu'elles soient consulaires, diplomatiques, commerciales ou communautaires, confèrent d'abord à la ville un caractère diplomatique, puis international et contribuent activement à son ouverture aux influences européennes. L'action d'aménagement et d'équipement a par ailleurs modifié l'organisation spatiale de la cité et l'a fait entrer dans l'ère de la modernité. Le témoignage de Pierre Loti en 1889 rend compte de ce phénomène d'imprégnation qui touche à première vue le paysage urbain à travers l'européanisation de l'architecture et l'organisation sociale à travers le commerce, la protection et la naturalisation. Dans la dernière entrée de son journal du 4 mai 1889, Pierre Loti écrit :
Après une journée de marche encore longue sous un ardent soleil, vers le soir, nous voyons poindre devant nous Tanger la Blanche ; au-dessus, la ligne bleue de la Méditerranée, et au-dessus encore, cette lointaine dentelure irisée qui est la côte d'Europe. Nous éprouvons une première impression de gêne, presque de surprise, en passant au milieu des villas européennes de la banlieue. Et notre gêne devient de la confusion lorsque, en entrant dans le jardin de l'hôtel, avec notre suite de muletiers, de ballots, notre déballage de Bédouins nomades, nous tombons au milieu d'un essaim de jeunes misses anglaises en train de jouer au lawn-tennis... Vraiment Tanger nous paraît le comble de la civilisation, du raffinement moderne. Un hôtel, où l'on nous donne à manger sans exiger de nous la lettre de rançon signée du sultan [...] Des choses laides et des choses commodes. La ville partout ouverte et sûre ; plus besoin de gardes pour circuler par les rues, plus besoin de veiller sur sa personne ; en résumé, l'existence matérielle très simplifiée, plus confortable, nous sommes forcés de le reconnaître, facile à tous avec un peu d'argent. [...][29]
La veille, en prévoyant déjà son retour dans cette ville depuis une autre région du Maroc, Loti écrit « Tanger la Blanche, la pointe d'Europe, et déjà les choses et les gens de ce siècle. »[30]. Son témoignage permet d'entrevoir la situation médiane de cette ville qui, tout en faisant géographiquement partie du territoire marocain, semble déjà avoir un « pied » en Europe. Elle constitue vraisemblablement un entre-deux entre l'orient et l'occident, le seuil qui mène aussi bien à l'un qu'à l'autre des deux versants de la Méditerranée.
Au début du XXème siècle, la mémoire de Tanger la "moderne" est inscrite dans un chemin emprunté par toute personne arrivant à Tanger depuis le port jusqu'aux légations étrangères situées à l'extrémité de la ville et dont nous retrouvons une description dans un des premiers guides touristiques en date, Tanger[31] d'Albert Cousin membre du conseil supérieur des colonies. Sa description conforte l'idée selon laquelle le modèle urbain européen est présent de façon significative dans la ville au début du siècle dernier. Le point de vue d'Albert Cousin est différent de celui emprunté par Loti, puisque sa description donne à voir une objectivité presque clinique. Ce dernier ne décrit que ce qu'il voit et nous découvrons, plus d'un siècle plus tard, une organisation urbaine où le local côtoie « l'exotique » de manière remarquable.
Du point de vue culturel, ce texte montre que la ville abrite en 1902 les quatre religions monothéistes, musulmane, juive, catholique et protestante et qu'il existe pour chacune d'elles un lieu de culte. Il montre par ailleurs que toutes les puissances européennes y sont représentées, soit par des ministres plénipotentiaires, soit par des consuls. Du point de vue des équipements urbains, les rues et certaines maisons sont présentées dans sa description comme étant éclairées au moyen de l’électricité ; une station électrique étant installée dans la ville depuis 1894. Le téléphone y est également utilisé depuis 1883 et cinq postes fonctionnent in situ, dont trois européennes et une marocaine. Tanger dispose donc assez tôt d'équipements urbains tels que l'électricité et de moyens de communication tels que le téléphone et les postes. Du point de vue de l'activité touristiques, on peut noter en 1902 que des cafés français, anglais, allemands et espagnols se trouvent sur la place du petit Soko et que la ville compte sept hôtels et un théâtre nommé « Licco-Romea ».
Tous ces éléments de la vie citadine européenne indiquent une présence occidentale et une activité touristique importantes. Ils suggèrent en outre la coprésence de plusieurs modèles culturels qui, dans le cadre de la cité, n'échappent pas à des influences mutuelles et à des transferts culturels.
En effet, les échanges commerciaux avec les pays européens, la forte concentration des colonies étrangères dans la ville et son urbanisation ne sont pas les seules causes des transformations sociales qui la touchent et qui y donnent lieu aux premières possibilités de transferts culturels. Un autre phénomène largement pratiqué dans le pays pendant la deuxième moitié du XIXème siècle a contribué à modifier la structure sociale. Il s’agit notamment du phénomène de la protection.
Le phénomène de protection et autres stratégies et leurs conséquences socio-culturelles
Le droit de protection est le privilège d’une Puissance étrangère représentée dans un pays de soustraire ses propres nationaux, ceux des Puissances non représentées et même certains indigènes de ce pays à l’autorité de son souverain et de substituer vis-à-vis d’eux sa juridiction à la sienne.[32]
Le régime de protection au Maroc est un phénomène qui a été étudié, notamment par M. L. Martin, du point de vue de son influence sur l’économie marocaine. Mais il n’existe, à notre connaissance, aucune étude du point de vue culturel à ce sujet. Nous allons, sur la base de ce document réservé au régime de la protection, tenter de déceler les brèches que ce phénomène d’administration a pu ouvrir sur le plan social et interculturel.
Réservée en principe aux sujets étrangers, la protection évolue et étend son champ d’application aux employés des protégés et aux courtiers des représentations consulaires. Selon M.L. Martin, les sujets musulmans recourent à la protection afin d’échapper aux « vexations » et à « l’arbitraire » des autorités musulmanes compte tenu des impôts imposés aux lendemains des périodes de sécheresse et de disettes. Il semblerait par ailleurs que le terme « vexations » renvoie aux rapports conflictuels auxquels sont exposés les sujets marocains travaillant au service des « infidèles[33] » de la part de leurs compatriotes et coreligionnaires.
Les sujets marocains juifs et musulmans se mettent sous la protection des représentations étrangères afin de disposer de leur juridiction en cas de litiges ou d’autres situations de conflit. Ce régime d’administration, en général, leur permet de se soustraire aux paiements d’impôts. Il donne lieu progressivement à « une catégorie d’exception » qui nous semble constituer un des vecteurs de la composante culturelle européenne du fait de leur proximité.
L’extension de ce régime connaît son apogée après 1860, compte tenu de l’augmentation des colonies européennes. Appliquée désormais aux sujets musulmans, elle est viagère et non héréditaire, sauf pour une famille tangéroise, les Benchimol, qui a fourni des censaux interprètes au port de Tanger de père en fils. Notons à cet égard qu'Abraham Benchimol a accompagné le peintre Eugene Delacroix lors de son séjour marocain. L'artiste français accompagnant la mission diplomatique menée par le Comte de Mornay a pu ainsi accéder aux intérieurs marocains et disposer de modèles parmi la famille du traducteur tangérois.
Les protégés sont divisés en deux catégories : les indigènes employés par les légations et les autorités consulaires d’une part ; et d’autre part, les indigènes employés par les négociants français pour des affaires de commerce. Ces derniers occupent essentiellement les fonctions de facteurs, courtiers, et agents commerciaux. Ils parent aux obstacles liés à la langue et aux difficultés de déplacement rencontrés par la majorité des agents européens.
L’évolution du régime de protection au Maroc donne lieu à des formes plus officieuses, notamment la protection de deuxième et de troisième degré. Cela signifie, en d’autres termes, qu’un protégé peut en protéger un autre et ainsi de suite. Cette forme officieuse est essentiellement la conséquence de l’association de sujets européens avec des sujets marocains dans le domaine agricole. Il semblerait que le seul moyen de faire de l’agriculture pour les européens à cette époque était de s’associer à un sujet de l’empire.
Par ailleurs, le document d’archive nous renseigne sur l’attitude longtemps réticente des musulmans à l'égard de ce régime d'exception :
[…] les musulmans refusèrent longtemps d’accepter cette protection si commode ; ils considéraient comme contraire à leur religion de se mettre à l’abri derrière un infidèle […] quelques exceptions finirent cependant par se produire devant les avantages évidents[34] de la protection [35]
Manifestement, la réaction à l’égard de ce régime dans le cadre de la communauté musulmane évolue d’une forme de réticence justifiée par les mœurs et la religion vers une forme d’adhésion sous couvert de l’utilité du régime en question. Suite à la convention de Madrid du 3 juillet 1880, le régime de protection s’étend aux fonctions d’interprète, soldat, domestique et secrétaire indigènes. Il est possible de penser que cette tolérance du régime de protection de la part de certains marocains instaure un rapprochement inédit entre les communautés marocaine et étrangère.
Quels que soient les motifs de son intégration, nous pensons que le régime de protection constitue une manière de « vivre ensemble » entre étrangers et marocains. Cet état de choses façonné par la présence consulaire et diplomatique, par le commerce portuaire et le régime de protection peut être interprété comme un filtre à travers lequel passent des composantes et des valeurs du quotidien notamment sur le plan linguistique, vestimentaire et architectural.
Du point de vue linguistique, on notera à Tanger l’insertion de la langue espagnole comme idiome consacré au commerce et de l’anglais comme signe de snobisme qui font partie de ces composantes qui traversent ce filtre. Ces transformations latentes touchent en premier lieu la bourgeoisie marocaine nouvellement constituée et particulièrement les familles de confession juive.
L’européanisation des sujets marocains israélites se fait aussi la conséquence de la naturalisation. Moins pratiquée que la protection car plus contraignante, la naturalisation est néanmoins un recours pour les grands négociants en vue d’élargir leur marché. Installés à Manchester ou à Londres pour y créer des filiales et pour y être représentés, ces sujets d’origine marocaine, selon J-L Miège[36], semblent s’être mêlés rapidement à la vie européenne et s’y être adaptés. En rentrant au Maroc, ces derniers donnent à leurs enfants des prénoms anglais et une instruction et éducation à l’anglaise :
Ces juifs sont tous impatients de s’européaniser. Dès 1850-1860 les intérieurs à mobilier britannique sont fréquents à Mogador où il n’est point de famille aisée qui n’ait en bonne place le portrait de la reine Victoria […] à Tanger le costume traditionnel est assez vite délaissé. Les hommes adoptent la Jacquette, les femmes, dès 1860, portent des crinolines dont elles exagèrent les proportions.[37]
Manifestement, les sujets marocains israélites, protégés ou naturalisés, à Tanger, sont parmi les premiers à avoir arboré le vêtement européen, signe d’une ouverture sur l’Europe. Ils constituent par ailleurs un vecteur social de cette composante culturelle. En effet ces sujets européanisés sont des diffuseurs ou vecteurs des habitudes européennes en milieu marocain. De par leur proximité des deux mondes (européen et musulman), il est possible de supposer que les marocains israélites ont pu répandre ce qu’ils ont emprunté à la communauté européenne, notamment dans les domaines suivants :
- les finances (la création de banques) ;
- la presse, (la première imprimerie marocaine, située à Tanger, est créée par un marocain israélite) ;
- les habitudes culinaires (la consommation du thé),
- objets ou dimensions de la vie quotidienne comme l’utilisation des bougies ou des lampes à pétrole ;
- l’importation de mobilier européen ;
- le port du vêtement européen ;
- l’insertion d’éléments de décoration d’intérieur comme les tableaux de peinture, comme précisé dans l’exemple du portrait de la reine d’Angleterre.
Tanger et les peintres orientalistes
Comme nous venons de le souligner, la position géographique de la ville et son statut portuaire comme lieu de débarquement par excellence en font une porte vers l'Orient. Ce seuil de l'Orient devient le fantasme de nombreux peintres orientalistes depuis la visite de Delacroix. Prématurément « moderne », il est possible de penser que cette ville a été témoin du geste artistique. En effet, Tanger a été un passage nécessaire pour de nombreux peintres orientalistes qui viennent, sur les traces d'Eugene Delacroix, perpétuer une tradition orientaliste qui fait de la ville un lieu incontournable de création et de villégiature.
Selon la chronologie de Maurice Arama[38], plus d'une soixantaine de peintres orientalistes se sont succédés au Maroc entre 1832 et 1920. Le séjour d'Henri Matisse à cet égard donne à penser une certaine évolution des rapports des marocains vis à vis de la représentation et du fait d'être représenté ou de se laisser représenter. Henri Matisse, a séjourné à deux reprises au Maroc en 1912. Il semble s’être confronté à la fois à la réserve des marocains quant à la représentation picturale et à un comportement social nuancé vis à vis de cette pratique. Dans le propos interprétant certains épisodes de son séjour marocain, l’activité du peintre semble être entourée d’intrigues et de subterfuges :
Il semble que Matisse ait eu des difficultés à trouver des modèles qui veuillent poser pour lui, en particulier des femmes, à cause de la loi du voile. Seules les juives et les prostituées en étaient exemptées. Matisse était donc obligé de travailler en secret. Le 1er avril, il écrivit à sa famille que Mme Davin, la propriétaire de l’hôtel Villa de France, lui avait trouvé un atelier où « la jeune fille arabe », sans doute Zorah, pouvait venir sans être vue. Il écrivit encore le 6 avril disant qu’il avait voulu travailler avec « la jeune fille », mais que c’était impossible parce que son frère était proche et qu’il l’aurait tuée. Mais le « jeune groom du Valentina » était libre et il pourrait poser. C’est sans doute Amido.[39]
Dans la conjoncture de 1912, les hommes semblent être plus disposés à poser que les femmes. Dans la catégorie féminine, les femmes arabes sont moins disposées à pratiquer cette activité que les femmes israélites et les prostituées. En effet, Dans une carte postale que Matisse adresse à Marquet de Tanger le 28 décembre 1912 on peut lire : « Camoin qui vient d’en voir de vertes avec la diphtérie est retapé, court les maisons malfamées où il fait poser des juives et des arabes».
Nous supposons donc que certains artistes fréquentaient les maisons closes et faisaient poser des prostituées. Cela constituait, peut-être, le seul moyen de disposer de modèles locaux. Nous pouvons supposer aussi que ce phénomène a donné lieu à une sorte de commerce organisé par une logique sociale de dissimulation. En d’autres termes, dans certains espaces, certains sujets pouvaient fréquenter la peinture.
A ce titre rappelons que « Zohra », qui apparaît dans trois peintures d’Henri Matisse, est une jeune marocaine qui a posé pour le peintre lors de ses séjours à Tanger et dont le nom apparaît dans certaines de ses correspondances, notamment avec le peintre Marquet. Le personnage de Zohra est un des rares que nous pouvons citer dans ce cadre.
Conclusion
De ce qui précède, il apparaît que la ville n'est pas un simple donné statique, mais bien le lieu même de la pratique sociale et de son fonctionnement ; le lieu de transferts ou transactions de divers ordres notamment commerciaux, linguistiques, urbains, architecturaux, techniques et même vestimentaires. En 1902, Albert Cousin affirme que « [Tanger] a conservé son caractère mauresque, bien que les maisons européennes se multiplient [...] Tanger est le point de contact principal du Maroc avec la civilisation européenne [...] ».
Tout en conservant son caractère mauresque, cette ville, de par sa situation géographique, c'est à dire en tant que lieu de passage/transit ou de séjour, devient un espace médiateur. La cité, comme nous l'avons suggéré, est aussi un espace de conflits, d'inclusion ou d'exclusion. La pratique picturale, apparemment exclue par les marocains, est sujette - dans un espace tel que Tanger - à une logique de dissimulation et de compensation qui peut être interprétée comme conséquence de la morphologie spatiale et sociale de la ville qui accueille cette pratique et sa réception. Les différentes références contenues dans les textualités, littéraires, archivistiques ou utilitaires, ici considérées, contiennent une part de la mémoire tangéroise révolue. Elles donnent à lire la coexistence de diverses communautés, la concentration de différentes colonies européennes et le fonctionnement de stratégies économiques et sociales telles que le commerce portuaire et le régime de protection.
C'est ainsi que le parcours tant soit peu romancé de ben Ali R'bati devient représentatif du rapprochement culturel que Tanger a pu occasionner entre différentes confessions et cultures. En effet l'espace urbain de cette ville semble s'être dérobé aux prescriptions communautaires et autres filtres culturels qui sont supposés séparer les différents groupes culturels en présence au Maroc entre la fin du XIXème siècle et le début du XXème. Le sujet marocain y est très tôt exposé, bon gré mal gré, à des pratiques exogènes et à des formes de l'altérité qui s'observent dans la langue, l'habillement, l'architecture et la technologie et dans lesquels nous suggérons d'inscrire la pratique picturale. De toute évidence, ce type de transferts n'est pas exclusif à la ville de Tanger. La ville d'Essaouira anciennement appelée Mogador a, en tant que ville portuaire, connu un destin qui pourrait ouvrir des perspectives à la recherche des origines de la peinture de chevalet au Maroc.
Dans le livre consacré à la vie et à l'œuvre de Mohammed ben Ali R'bati, Abderrahman Slaoui crée un rapprochement entre les intuitions de Delacroix et de Matisse tout en précisant : "Que l'on sache, il n'a pas eu connaissance des peintures de l'un ou de l'autre, encore qu'il ait pu croiser Matisse à Tanger en 1912."[40] Le récit des débuts de la pratique de la peinture au Maroc semble trouver dans la ville de Tanger un potentiel narratif inépuisable car l'espace a ceci de particulier qu'il peut, en tant que contenant, occasionner des rencontres et des contiguïtés insoupçonnées entre certains éléments dès lors que ceux-ci y circulent simultanément. Si R'bati n'avait pas séjourné dans cette ville, aurait-il eu le même destin, serait devenu, a posteriori, l'ancêtre de tous les peintres marocains ? La postérité lui aurait-elle fabriqué le même destin ?
Nous avons tenté dans cette analyse de reconstituer un « milieux » susceptible d'occasionner cette rencontre et ce hasard. Eu égard à la distance qui nous éloigne de ce milieu, le récit puise dans ce lieu des possibilités de commencement et introduit nécessairement des transformations voire des métamorphoses, ou ce que Pierre Nora appelle la « mémoire-distance » ou « l'hallucination artificielle du passé »[41]. Dans le cas de cette analyse, c'est la ville de Tanger qui ouvre la voie à cette hallucination nécessaire, car elle permet d'entrevoir une origine et à répondre à une volonté de mémoire.
Bibliographie
- Arama Maurice, Itinéraires marocains : regards de peintres, Editions Jaguar, 1991.
- Cousin Albert, Tanger 48 photogravures, Editions Augustin Chalamel, 1902.
- De Certeau Michel, L’écriture de l’histoire, Gallimard, 1975.
- Dosse François, “Michel de Certeau et l’écriture de l’histoire”, in Presse de Sciences Po/Vingtième siècle. Revue d’Histoire, 2003/2 - n° 78, pp. 145-156.
- Elderfield John, Matisse au Maroc : Guide d’interprétation, Edition ADAM BIRO
- Hilali Mimoun, "Le cosmopolitisme à Tanger: mythe et réalité, in Horizons Maghrébins, N 31-32, 1996, pp. 42-48.
- Loti Pierre, Au Maroc, Paris, Calman Levy Editeur, 1890
- Martin M. L., Archives Marocaines, Publication de la Mission Scientifique du Maroc, Volume XV, Fascicule I, 1909, Paris, Edition Ernest Leroux.
- Miège Jean-Louis, Le Maroc et l’Europe : 1822-1906, Edition la Porte, 1996.
- Nora Pierre, Les lieux de mémoire, Paris, Editions Gallimard, 1997.
- Rondeau Daniel, Slaoui Aderrahman, de Pontchara Nicole, Un peintre à Tanger en 1900, Mohammed Ben Ali R'bati, Malika Editions (Fondation Abderrahman Slaoui), 2000.
- Roux Charles, « Missions diplomatiques françaises à Fès », in Hespéris, 3ème et 4ème trimestre, 1948.
- Catalogue de l’exposition pédagogique « Repères pour une Histoire de la peinture au Maroc », Editions OKAD, 2009.
* Université Chouaib Doukkali / El Jadida
[1] François Dosse, “Michel de Certeau et l’écriture de l’histoire”, in Presse de Sciences Po/Vingtième siècle. Revue d’Histoire, 2003/2 - n° 78, pp. 145-156.
[2] Mohammed ben Ali R’bati ou Rabbati est considéré comme le premier peintre marocain connu. Né à Rabat en 1861, il s’installe à Tanger en 1886 à l’âge de 25 ans pour des raisons encore méconnues. En 1903, il est engagé comme cuisinier au service du peintre britannique John Lavery. R’bati est présenté par ce dernier comme un excellent cuisinier doublé d’un aquarelliste. Dans son autobiographie « The Life of a Painter », Lavery atteste que R’bati est le seul artiste marocain qu’il a rencontré lors de ses séjours au Maroc.
[3] Catalogue de l’exposition pédagogique « Repères pour une Histoire de la peinture au Maroc », Editions OKAD, 2009. Ce projet a été dirigé par le critique d’art marocain Aziz Daki et organisé par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique, la Fondation ONA, l’Institut Goethe de Rabat et l’Institut Français de Rabat. Nous avons pris part à ce projet en tant que documentaliste.
[4] Michel De Certeau, L’écriture de l’histoire, p. 84.
[5] Pierre Nora, Les lieux de mémoire, volume I, p. 30
[6] Pierre Nora, Ibid. p. 31.
[7] Pierre Nora, Ibid. p. 31.
[8] Daniel Rondeau, Aderrahman Slaoui, Nicole de Pontchara, Un peintre à Tanger en 1900, Mohammed Ben Ali R'bati, Malika Editions (Fondation Abderrahman Slaoui), 2000, p. 7.
[9] Daniel Rondeau, Aderrahman Slaoui, Nicole de Pontchara, Ibid. p. 7. (Italique par nous-mêmes)
[10] Daniel Rondeau, Aderrahman Slaoui, Nicole de Pontchara, Ibid. p. 135.
[11] Daniel Rondeau, Ibid., p. 8. (Italique par nous-mêmes)
[12] Pierre Nora, Ibid. p. 23.
[13] Charles Roux, "Missions diplomatiques françaises à Fès", in Hespéris, 1948, 3ème et 4ème trimestre, p. 225.
[14] Les autres ports représentent : Tétouan, Larache, Rabat, Mazagan, Casablanca et Safi.
[15] Jean-Louis Miège, Le Maroc et l’Europe : 1822-1906, Tome II, p. 474.
[16] J-L Miège, Ibid, p. 481.
[17] J-L Miège, Ibid. p. 481.
[18] Tableau sur la population européenne au Maroc par groupes nationaux.
[19] J-L Miège, p. 481.
[20] J-L Miège affirme que la situation inverse était aussi possible, in La Iberia, n° du 25-10-1887, cité par J-L Miège, Le Maroc et l’Europe : 1822-1906, Tome IV, pp. 290-291.
[21] Cité par J-L Miège dans Le Maroc et l’Europe : 1822-1906, Tome IV, p. 291
[22] Ibid. p. 291
[23] Ibid. p. 291 (italique par nous-mêmes)
[24] Sur les débuts du tourisme au Maroc voir les premiers guides touristiques qui en marquent l’avènement, notamment Guide du Voyageur au Maroc de Kerdec et Tanger d’Albert Cousin.
[25] Cité par J-L Miège, Le Maroc et l’Europe : 1822-1906, Tome IV, p. 295.
[26] Al Moghrab Al-Aksa, n° du 10-10-1896, cité par J-L Miège Tome IV, p. 295.
[27] Mimoun Hilali, "Le cosmopolitisme à Tanger: mythe et réalité", in Horizons Maghrébins, N 31-32, 1996, pp. 42-48.
[28] Tanger est instituée en ville internationale du 1er juin 1925 au 29 octobre 1956, Mimoun Hilali, Ibid.
[29] Pierre Loti, Au Maroc, Calman Levy Editeur, Paris, 1890, pp. 355-356.
[30] Pierre Loti, Ibid, p 352.
[31] Albert Cousin, Tanger 48 photogravures.
[32] M. L. Martin, Archives Marocaines, Publication de la Mission Scientifique du Maroc, Volume XV, Fascicule I, 1909, Paris, Edition Ernest Leroux, p. 1
[33] Ce terme renvoie aux non musulmans.
[34] Il est important de considérer ce document avec l’objectivité que le recul historique nous permet. Ce discours devrait être relativisé en prenant en considération les motifs de légitimation d’un futur régime de protectorat.
[35] M. L. Martin, Op ; Cit. p. 11
[36] J-L Miège, Le Maroc et l'Europe : 1822-1906, Tome II, p. 574.
[37] J-L Miège, Op ; Cit. 579
[38] Maurice Arama, Itineraires marocains : regards de peintres, Editions Jaguar, 1991.
[39] John Elderfield, Matisse au Maroc : Guide d’interprétation, p. 212.
[40] Abderrahman Slaoui, Un peintre à Tanger en 1900, Mohammed ben Ali R'bati, p. 20.
[41] Pierre Nora, Op. Cit., pp. 34-35.
![]() Télécharger l’article en version PDF
Télécharger l’article en version PDF
Dans le présent travail nous essayerons de mettre l’accent sur une pratique à la fois universelle et mondiale, mais aussi particulière et spécifique, celle du Street Art et particulièrement celle des tags. Les chercheurs reconnaissent que ces transcriptions sont un langage urbain présent sur tous les continents (U. Hannerz 1983, P. Bertoncini 2009) mais possédant des particularités dans chaque pays voire dans chaque territoire (P. Bertoncini 2001). Les études faites dans ce sens traitent ces inscriptions comme un langage jeune (J. Billiez 1998), urbain (P. Bertoncini 2009, T. Bulot 2007, H. Lefebre 1968), exprimant un malaise sociétal (P. Bertoncini 2009) ou une revendication identitaire (T. Bulot 2007) voire une appartenance socioculturelle, religieuse à un groupe particulier (P. Bertoncini 2009). Faire parler les murs de la ville constitue pour les sciences humaines et sociales un vrai défi (Albera &Tozi 2005). Les spécialistes tentent de décoder leurs significations et de leur attribuer ainsi un statut plus légitime, car jusqu’à aujourd’hui les graffitis sont considérés comme une pratique clandestine, interdite par la loi car déformant le paysage de la ville (T. Bulot 2007).
Dans les villes arabes, les tags et les graffitis sont aussi présents (A. Alviso-Marino. 2013). Ils véhiculent une urbanité particulière, propre à un contexte socioculturel à la fois conservateur et novateur. Le printemps arabe et les crises économiques et politiques ont été une source inépuisable de créations et de mise en œuvre d’un nombre considérable de graffitis et de messages à travers tous les pays arabes. En Algérie, les conditions socioculturelles et les bouleversements politiques et économiques que le pays vit depuis quelques décennies, ont été une base féconde pour une expression murale à travers tous les espaces urbains.
Dans tous ces contextes, cette pratique est particulièrement renvoyée aux garçons. Le Street Art est souvent considéré comme un art masculin, car pratiqué dans la rue. Nous allons partir du postulat selon lequel le recours aux tags est également attesté chez les filles ; mais chez elles, cette pratique répond à d’autres besoins et véhicule une autre philosophie. Leurs créations obéissent à des contraintes qui les rendent différentes de celles des garçons. Dans le présent travail, nous allons essayer de décoder le langage implicite des tags féminins, et de les étudier sous un aspect méthodologique différent en mettant l’accent sur les référents utilisés, les sujets traités, ainsi que les langues employées. Autour de cette problématique, plusieurs questions se posent :
- Quelle place occupe la parole féminine dans le Street Art ?
- Quels messages véhiculent les tags féminins ?
- Comment s’effectue l’appropriation des territoires urbains par les tagueuses ?
Nous adoptons une triangulation méthodologique (L. Savoie-Zajc 2009) afin de vérifier tous les éléments relatifs à la question. L’usage de plusieurs outils d’investigation (Photos, entretiens, observations et prises de notes) est susceptible de nous fournir un meilleur cadrage de notre problématique.
Une néotoponymie pour la ville arabe
Le monde arabe est en perpétuelle reconfiguration. Il semble évident que les cartes géopolitiques, socioéconomiques et même culturelles ont changé. On assiste aujourd’hui à la naissance d’une nouvelle dimension cadrée par des paramètres différents relatifs à la mondialisation, le multiculturalisme, et le besoin d’aller vers l’autre. Le printemps arabe, déclaré dans plusieurs pays arabes ces dernières années, ainsi que tous les bouleversements qu’il a engendrés ont certainement accéléré ce processus. Outre la déstructuration de l’ordre politique et gouvernemental, les modes d’expression semblent aussi modifiés ou même transformés par cette nouvelle génération dont les besoins sont nettement différents par rapport à leurs aînés (Y. Gonzalez-Quijano 2013).
Sur ce plan, anthropologues, sociologues et linguistes relèvent un épanouissement des modes de communication chez les jeunes. En plus de l’écrit et de l’oral, le dessin et la transcription murale sont devenus aujourd’hui des canaux de transmission largement utilisés par la nouvelle génération. Les travaux réalisés dans ce cas (J. Billiez 1998, T. Bulot 2007, D. Pirani 1992) évoquent l’efficacité de ces nouveaux moyens et leur remarquable productivité. Bien qu’aux yeux de beaucoup d’entre eux (les grammairiens surtout), ces pratiques sont considérées comme clandestines, car déstructurant la langue et mutilant le paysage de la ville, il reste intéressant de voir qu’ils véhiculent une large littérature dans le monde entier. Les transcriptions murales telles que les graffitis et les tags constituent à elles seules un univers original où se déploient toutes les innovations et les créations des jeunes. Cette néotoponymie redessine la ville (R. Lajarge et C. Moise 2008), par la mise en place de frontières symboliques (T. Bulot 2007) que les taggueurs et les graffiteurs placent pour définir leurs territoires.
Dans le monde arabe, cette nouvelle pratique devient de plus en plus répandue. Les jeunes Arabes recourent au langage mural dans toutes les circonstances de leur vie quotidiennes (A. Alviso-Marino 2013, J. Wender 2011, K. Ouaras 2009). Violent, satirique, expressif, ce langage est pour la jeunesse le moyen idéal pour exprimer ses pensées et critiquer sa sociétés dans la discrétion et l’intimité nécessaire. Une lecture attentive de ces productions laisse apparaître la récurrence de certains thèmes tels que : la politique, le football, l’éducation, la sexualité, la musique… (R. Marrouch 2013) Le mode d’appropriation de l’espace employé ici est assez révélateur du besoin des jeunes de tracer leur territoire par des marqueurs socioculturels, politiques, religieux et même identitaires parfaitement particuliers. L’aspect viril, parfois même agressif, discriminatoire pousse les observateurs à insister sur le fait que ces transcriptions sont parfaitement masculines (S. Johannes 2012). Les filles sont ainsi écartées de cette dimension, car, considérées comme plus normatives, plus réservées, moins agressives.
Le street art tel qu’il est perçu aujourd’hui est polyphone, pluridimensionnel, il ne peut être porteur d’une identité sexuelle unique. L’implication des filles dans ce domaine se confirme de plus en plus. Le corpus que nous allons exploiter dans la présente étude, se veut justement le reflet de cet éclatement. Nous focaliserons notre attention sur les tags faits par des filles. Nous étudierons leurs thèmes favoris, leurs poids identitaires, ainsi que leurs façons de signer leurs territoires.
Collecte des données et méthodologie préconisée
La parole féminine a-t-elle son poids dans l’univers des tags et des graffitis urbains ? A-t-elle le droit de modifier la physionomie de l’espace qu’elle occupe ? La tagueuse procède-t-elle à une sélection de son lieu d’expression ? Les réponses à ces questions nous mènent à une investigation des territoires de la ville où se déploient habituellement cette parole murale.
Le corpus collecté se compose principalement de photos prises dans plusieurs quartiers du centre-ville de Constantine. La sélection des lieux d’enquête a été imposée par la disponibilité des graffitis. Ainsi, les murs des lycées, des stades, des clubs sportifs, les panneaux d’affichage réservés aux campagnes électorales, les marchés, et les murs des cybercafés, et bien d’autres espaces nous ont servi de lieux d’enquête très intéressants. En plus des photos, nous procédons à une observation directe de cette pratique avec un groupe de jeunes (filles et garçons) dans le but de mieux cerner les particularités des tags féminins. Nous accompagnons les tagueuses, nous nous entretenons avec elles, et nous essayons de comprendre les messages qu’elles tentent de transmettre à travers leurs tags.
Les tagueuses dans leurs Harems
À Constantine, les jeunes sont nettement majoritaires. Les chiffres délivrés par l’Office National des Statistiques (ONS) montrent clairement que la société constantinoise est jeune. Dans les commerces (Hedid 2007, 2013[1]), dans les administrations ainsi que dans tous les espaces discursifs (Hedid 2011), les jeunes sont partout (L. Le Pape 2013), ils ne manquent pas d’afficher leur identité jeune, leur différence, leur perception de la vie. Dans ce cas, il devient intéressant de remarquer qu’ils n’occupent pas tous les espaces de la même manière, ou du moins, ils ne cherchent à marquer leur passage que dans certains sites. Dans les grands boulevards de la ville, ils ne sont que des passagers, leur identité jeune se noie dans le circuit des interactions urbaines. Néanmoins, les modes de transgression de cette cohésion avec la ville se multiplient, notamment lorsque la communauté est secoué par un évènement social, sportif ou autre. Dans ce cas, les jeunes se manifestent, occupent tous les grands axes de la ville, s’affichent ouvertement et font tout pour dominer et imposer leur jeunesse (A. El Sakka 2013). Dans les ruelles et les petits axes, l’effervescence de l’expression jeune est manifeste. Orale, écrite, picturale, la parole jeune est bel et bien présente dans ces interstices (M-M Bertucci. 2003). Il semble même clair à tout observateur, que ces passeurs tentent par tous les moyens de graver sur les murs de la ville, les signes de leur présence et les marques de leur identité. En effet, les murs de ces espaces témoignent de leurs passages. Les tags et les graffitis relevés dans la ville de Constantine mentionnent clairement une pensée controversée de leur vision du monde. Des thèmes variés, à un plurilinguisme frappant, en passant par un brassage de plusieurs sous cultures. Les garçons innovent, créent, critiquent, les graffitis leurs permettent de délimiter leur territoire, de communiquer leur pensée et de délivrer leurs peurs et leurs fantasmes.
Du côté des filles, l’épanouissement de leur production est très apparent. Cependant, la lecture de leur corpus nous met devant l’obligation de modifier notre démarche. Si les garçons semblent vouloir s’afficher au grand public à travers les messages que portent leurs graffitis et leurs tags, les filles tentent au contraire de se libérer discrètement, leurs messages ne sont jamais complétés, l’observateur doit se référer à d’autres paramètres et placer à chaque fois ses interprétations sur d’autres paradigmes pour pouvoir comprendre leurs significations. Sur les voies publiques, les tagueuses ne sont pas apparentes. Le besoin de se conformer aux restrictions de la société arabe les pousse à taguer dans des espaces clos, peu fréquentés, où les passants ne peuvent pas les observer. Si les garçons se cachent pour éviter les autorités, les filles le font car, non seulement elles doivent éviter les autorités, mais elles doivent obéir à leur société.
Dans ce cas, les interstices (M-M Bertucci 2003) leurs servent de lieux d’expression. Les espaces privilégiés sont les ruelles les moins fréquentées, les murs d’intérieur des bâtiments et des immeubles, les murs des lycées, où elles se tiennent pour attendre avant d’entrer, les troncs des arbres, les cages d’escalier, les murs entre les immeubles. D’autres espaces clos telles les toilettes sont aussi des lieux d’expression convoités par les filles, grâce à leur intimité qui met les tagueuses en sécurité. Les espaces choisis partagent un élément important, ils sont tous peu exposés aux regards, et peuvent être un véritable harem où les filles peuvent s’exprimer librement sans être gênées.
Les tags féminins : caractéristiques, langues et interprétations
Les tags relevés traitent plusieurs thèmes : l’amitié, l’amour, les études, le monde des célébrités,…. le mode d’expression employé révèle une des caractéristiques qui différencient la parole féminine de la parole masculine.
Des tags peu violents : bien que le passage sur le mur soit déjà une transgression des règles, les messages des filles ne semblent véhiculer ni violence ni brutalité (Photo N°1). Ce que laissent apparaître leurs transcriptions c’est un désaccord avec les restrictions de leurs familles, qu’elles revendiquent à travers des tags destinés à leurs petits copains, des citations tirées des chansons d’amour. Contrairement aux tags des garçons (Photo N°2), qui, pour exprimer les mêmes besoins recourent aux blasphèmes et à tous les types de la violence verbale.

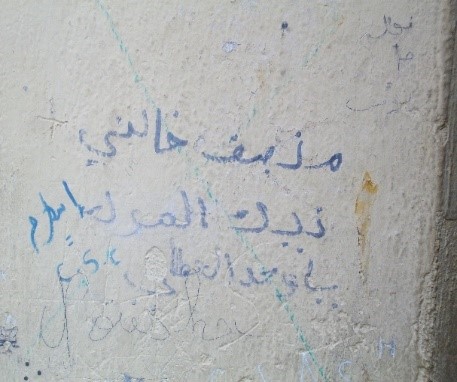
Photo N°1 Photo N°2
L’implicite : les tags des filles sont faits pour être vus et non pour être interprétés. Il s’agit d’un code partagé, un we code (J. J. Gumperz 1982) discret, intime, que les tagueuses utilisent pour créer un lieu d’expression et un univers de communication particulier et sécurisé. Nous relevons, dans notre corpus, des tags faits pas un groupe d’élèves filles (Photo N°3), dans lesquels elles se moquent de leur enseignante des mathématiques. Les signes utilisés sont identiques dans plusieurs tags : la référence aux groupes des mafias (la camorra), la représentation de l’enseignante (une vieille dame voilée), l’usage des signes des mathématiques (pour évoquer la matière enseignée), des abréviations créées (APT=Amour Pour Toujours) pour coder le message. L’interprétation de ces messages ne peut se faire que par un membre du groupe. Les différentes lectures que la communauté peut faire de ces signes la mettent devant le paradoxe de la polysémie et de l’éclatement sémantique, car les tagueuses partagent avant tout le même référent, la même source et une schématisation identique de la réalité vécue, conforme à l’image qu’elles se font de leur monde.
Il est clair qu’elles font recours aux mêmes transcriptions pour homogénéiser leurs messages et garantir la solidarité de leur groupe. Adopter les mêmes procédés de transcription rend plus facile la compréhension des tags, et permet aux filles de partager un espace d’interaction et d’échange sans la moindre ambigüité. Pour mieux vérifier l’efficacité de cette attitude, nous orientons notre enquête vers les garçons et vers d’autres catégories sociales (les adultes : femmes et hommes), nous leur montrons les photos et nous leur demandons une interprétation de ces tags. Tous sans exception, ont pensé à des dessins sans significations. Cependant, les interprétations étaient très nombreuses lorsque nous avons orienté l’enquête vers les garçons. Ces derniers se sont référés à leurs propres paramètres pour dire que ces tags présentent une belle-mère car « les filles sans être mariées, elles ont très peur de leurs futures belles mères », ou une méchante sorcière car « les filles ont peur de tout ». Si cette étape nous éloigne de notre objet d’étude, elle nous y ramène par une donnée très importante qui concerne directement la densité des réseaux (L. Milroy 1980) des tagueuses et la difficulté que les autres éprouvent à pénétrer leur univers.

Photo N°3
L’anonymat : les tags des filles passent pour des messages anonymes. Aucun signe ne doit être communiqué pour permettre aux observateurs de révéler leur identité. L’espace urbain où les identités se noient dans le circuit des interactions sociales (T. Bulot 2007) favorise cette attitude. Les tagueuses ne laissent pas leur nom de famille, ni aucune indication qui permette de les reconnaître. Les garçons préservent l’anonymat par précaution, les filles le font par obligation, et pour tenir à une stratégie d’évitement pour ne pas affronter leur société (Photo N°4). Les prénoms qui apparaissent dans les deux photos (Redouane, Kenza, Nessrine,…) sont portés par un très grand nombre de personnes et ne sont identifiables que par les tagueuses. Une autre technique très employée est celle du verlan. Les tagueuses inversent les noms pour les coder. Dans la photo N° 5, tous les noms sont inversés : ARIMA=AMIRA, MELSI=ISLEM, EVOL=LOVE, seule la tagueuse et son compagnon peuvent décoder ce message.


Photo N° 4 Photo N° 5
Affirmation identitaire : parmi les tags les plus utilisés par les filles, ceux de leurs prénoms. En effet, dans tous les quartiers visités et dans tous les espaces observés, ce type de tag est présent. En psychologie, ce type de comportement est souvent relié à un besoin d’affirmation. L’adolescent qui se sent négligé ou ignoré par son entourage a tendance à mettre son nom partout où il va. Chez les filles, ce besoin semble très présent. Leurs noms ne sont pas transcrits isolément, ils sont toujours accompagnés par les noms de leurs amis (Photo N° 6), ou de leurs initiales. Les groupes formés sont souvent rassemblés dans des ensembles additionnés par des signes pour exprimer la solidarité de leur amitié.
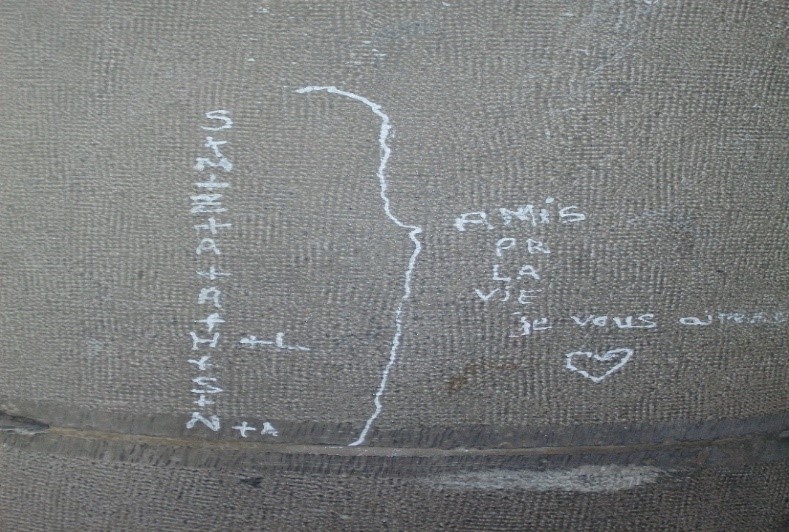
Photo N° 6
Identification : elle consiste en la modélisation d’un comportement afin de se conformer à un modèle considéré comme supérieur et irréprochable. Chez les tagueuses, les célébrités sont une référence incontournable. Elles cherchent à imiter leurs comportements, leurs habits, et même les scénarios de leurs clips. Les tags sont un mode de communication extrêmement sollicité dans la culture « hip hop ». Les jeunes ne manquent jamais de le mentionner. Les corpus relevés comptent plusieurs transcriptions qui évoquent la présence de l’esprit artistique et culturel « hip hop». Bien que les filles ne soient pas très attachées à ce type de tags, certaines d’entre elles nous confirment qu’elles le font sur les murs avec leurs copains, mais elles le font seules dans les toilettes, et sur les tables de leurs classes.

Photo N°7
Les langues des tags
Le plurilinguisme est une des caractéristiques du Street art. Le contact de l’arabe algérien avec d’autres codes linguistiques permet aux tagueuses de bien codifier leurs messages et de les rendre plus représentatifs de l’esprit urbain. L’arabe algérien qui constitue, dans la plupart des cas, le code de base pour la formation des tags, est alterné principalement avec le français et l’anglais. Cependant, l’utilisation de chaque code est fonction du message transmis.
La lecture des données relevées montre que l’anglais est utilisé pour évoquer certains thèmes tels que : la culture Hip Hop, ou pour reproduire les paroles des rappeurs, dans le but de se conformer à leur univers. Les filles usent alors de plusieurs vocables pour concrétiser cette affiliation (i love you, i hate you, it’s hard, it’s easy, best of the best,..). Bien que ces éléments n’attestent pas forcément du niveau de maîtrise de l’anglais et ne confirment pas la présence de cette langue dans le paysage sociolinguistique des tagueuses, ils certifient néanmoins l’envie et le besoin qu’ont ces filles de l’intégrer dans leurs pratiques langagières, voire dans leur répertoire verbal. Comme seconde interprétation de la présence de l’anglais dans les tags, nous pouvons évoquer le besoin de créer un espace protégé, réservé aux jeunes. Car, contrairement au français, cette langue est peu maîtrisée dans le contexte algérien, les messages des jeunes ne risquent pas d’être décodés, et deviennent ainsi des liens forts garantissant la persistance et la densité de leurs réseaux (L. Milroy 1980).
Sur les murs de la ville, le français est très présent. Il est, à côté de l’arabe algérien, une des langues les plus employées dans le contexte algérien (D. Morsly 2008, K. Taleb Ibrahimi 1997, 2002). Dans le corpus collecté, cette langue couvre plusieurs parties du discours. Elle est souvent utilisée comme une langue encastrée (Myer-Scotton 1998) qui suit la forme d’une autre langue, et parfois comme une langue matrice qui impose sa structure aux autres codes. Sur les murs nous relevons : je t’aime, toujours CSC (équipe de football locale)[2],… Cependant, l’arabe algérien reste le code dominant, transcrit en arabe ou en caractères latins, les jeunes l’utilisent comme une plateforme à toutes leurs productions. Ce que ces productions laissent apparaître, c’est que le plurilinguisme urbain est formé comme une spirale à plusieurs composantes. Néanmoins, une des composantes est souvent dominante par rapport aux autres.
Dans le Street art, ce plurilinguisme apparaît comme un bloc, où toutes les langues se mêlent. Une des spécificités et certainement pas la seule de la culture urbaine est inévitablement son dialogisme et sa polyphonie. La multiplication des codes linguistiques dans le contexte urbain n’est plus à prouver (T. Bulot 1999). Les interactions interpersonnelles s’accomplissent dans un mélange de langues (L-J Calvet 1993), elles se développent dans cet éclatement linguistique et anonyme (T. Bulot 2007). Les transcriptions murales des filles se créent dans cette dimension plurilingue, elles deviennent représentatives d’une communication intime en construction permanente selon les reconfigurations de la communauté urbaine. Les filles agissent sur un espace qu’elles veulent par railleurs dominer à leur manière. Leurs tags deviennent dans cette perspective une sorte d’un discours féministe, produit pour marquer leur présence, conquérir des territoires et des pratiques (les tags) qui semblent appartenir jusqu’à présent aux garçons, et baptiser ainsi un univers d’interaction intime ou se déploie la pensée féminine. Le « discours mural féminin » inaugure, comme celui des garçons, une redistribution des rôles et une autre schématisation des rapports des filles entre elles et avec l’espace qu’elles occupent. Consciemment ou sciemment, les tagueuses signent, par leurs transcriptions, un territoire et une appartenance à un groupe bien défini (il s’agit par exemple d’une répartition selon le lycée fréquenté, la classe, la cité habitée,…).
Que conclure ?
La particularité des discours féminins tient au fait qu’ils portent un double poids, ils ont à la fois une portée identitaire et communicationnelle. Lorsque les filles se mettent à pratiquer un art clandestin (Brassaï 2002), cela devient non seulement une exception mais une transgression plus frappante que si elle est pratiquée par des garçons. En effet, si les tagueurs se basent souvent sur l’humour, la beauté et la provocation dans la production de leur Street art, les tagueuses se livrent à des toiles qui évoquent l’affirmation de soi, la libération de leurs pensées et la solidarité de leurs groupes.
Les rapports étroits entre la société et le Street art ne sont plus à prouver. Les murs sont en réalité le reflet de tous les bouleversements que vivent les jeunes dans leur quotidien. Les tags qui ont toujours été considérés comme un mode d’expression parfaitement masculin, deviennent aujourd’hui un code partagé entre les filles et les garçons. Ce qui atteste par ailleurs d’une évolution dans la perception du rôle de la femme et de son statut dans la société. Le partage d’un espace de communication avec les garçons constitue pour ces filles un exploit. Les nombreuses restrictions que les sociétés arabo-musulmanes imposent aux femmes ont fait de la parole féminine une pratique limitée voire un tabou (Morsly 1998). Le défi que les jeunes tagueuses relèvent ici est de taille, elles défient non seulement les garçons, mais elles violent les normes répressives que leurs familles imposent.
En ville, l’éclatement des modes de communication est perceptible. Les interactions verbales dans cet espace sont souvent complexes, plurilingues et difficiles à analyser (Hedid 2007, 2011, 2013). Dans ce circuit, la parole féminine est souvent en compétition pour avoir plus de légitimité. Les rapports de force sont définis par l’appropriation d’un espace discursif ouvert, multilingue, et pluriculturel. Dans les marchés (Hedid 2007, 2011), comme dans les quartiers (Hedid 2013) la femme se distingue par des pratiques langagières et des choix de langue différents de ceux des garçons. Pour les filles, le Street art permet l’accès à une dimension plus ouverte, plus expressive car anonyme et autorise l’usage de l’implicite.
Références bibliographiques
- Allal. A. 2013. « Un homme, un vrai ! » Halima, une femme rebelle à Gafsa». In Jeunesses arabes. Du Maroc au Yémen : Loisirs, cultures et politiques. Sous dir. L. Bonnefoy et M. Catusse. Éditions La découverte
- ALVISO-MARINO. A. 2013. « Les murs prennent la parole. Street Art révolutionnaire au Yémen ». In Jeunesses arabes. Du Maroc au Yémen : Loisirs, cultures et politiques. Sous dir. L. Bonnefoy et M. Catusse. Éditions La découverte
- BERTUCCI M- M, 2003, « Le français des banlieues : Un parler interstitiel ? » In Martin, S. (dir). Chercher les passages avec Daniel Delas. Paris : L’Harmattan. Pp 133-139
- BULOT T, 2007, « Espace urbain et mise en mot de la diversité linguistique », In : Les codes de la ville, culture, langues et formes d’expression urbaines (sous dir T. Bulot et C. Bierbach). Pp 15-33
- DUMONT. M. 1998. Les enseignes de Dakar, un essaie de la sociolinguistique africaine. Éditions L’Harmattan.
- El Sakka. A.2013. « Supporters à distance. Les fans du Barça et du Real en Palestine » In Jeunesses arabes. Du Maroc au Yémen : Loisirs, cultures et politiques. Sous dir. L. Bonnefoy et M. Catusse. Éditions La découverte
- Gonzalez-Quijano.Y. 2013. « Du feuilleton télé à la Web-série. Les jeunes générations arabes changent de format» In Jeunesses arabes. Du Maroc au Yémen : Loisirs, cultures et politiques. Sous dir. L. Bonnefoy et M. Catusse. Éditions La découverte
- GUMPERZ J.J, 1982, Discourse strategies. Cambridge (Mass.), Cambridge university Press
- HANNERZ, Ulf. 1983. Explorer la ville, Paris, Éditions de Minuit,
- HEDID S, 2007, Le français dans les transactions algériennes en milieu urbain : Analyse pragmatique des requêtes dans les agences de voyages à Constantine. Mémoire de Magister Sous la Direction de la Professeure Yasmina Cherrad. Université Constantine 1
- HEDID S, 2010, « Le corpus urbain : un puzzle à reconstruire ». In Corpus entre donnée sociale et objet d’étude“. Actes du colloque : “Corpus entre donnée sociale et objet d’étude“. Algérie. Pp127-137.
- HEDID S, 2011, « Un français pour les jeunes Algériens » In Diversité. "Ville-École- Intégration". N°164. “La mer au milieu“. Éditions CNDP. CRDP. Pp. (80-85). France.
- HEDID S, 2013. “Lorsque les représentations sociolinguistiques redessinent la ville. La mise en mots de la mobilité socio-spatiale. Le cas de Constantine“. In Glottopol N° 21 – Lieux de ségrégation sociale et urbaine : tensions linguistiques et didactiques ? Numéro dirigé par Marie-Madeleine Bertucci. Sur le site : http://www.univrouen.fr/dyalang/glottopol
- LEFEBVRE, H. 1968. Le Droit à la Ville, In «Société et urbanisme», Paris, Éditions Anthropos.
- Le Pape. L.2013. « Histoire de voir le temps passer. Les hittistes algériens». In Jeunesses arabes. Du Maroc au Yémen : Loisirs, cultures et politiques. Sous dir. L. Bonnefoy et M. Catusse. Éditions La découverte
- MILROY L, 1980, Language and social networks, Londres. Blackwell
- MORSLY D, 2008, « Linguistique et colonialisme, analyse et intuition à propos des langues en situations coloniales ». In Les boîtes Noires de L. J. Calvet. Éditions Écriture. Pp 169-177
- STAHL J. 2008. Street Art. Éditions N. F. Ullmann
- TALEB IBRAHIMI K, 1997, Les Algériens et leurs langues. Éléments pour une approche sociolinguistique de la société Algérienne. Éditions El Hikma.
- TALEB IBRAHIMI K, 2002, « Entre Toponymie et langage, balade dans l’Alger plurilingue. Les enseignes des rues de notre ville ». In Insaniyats N° 17- 18. Pp 09-15
- TRIVASSEN. R. 2012. Langage des jeunes. Plurilinguisme et urbanisation. Éditions L’Harmattan. Collection Espaces Discursifs.
[1] Hedid. S. Étude des représentations des langues et des variétés dialectales chez les jeunes commerçants de la ville de Constantine. Thèse de Doctorat en cours. Codirigée par Y. Cherrad et M. M Bertucci. Université Constantine1
[2] La présence de ces éléments en français ne prouve pas que les filles maîtrisent le français, mais atteste d’un besoin de parler cette langue et de la maîtriser.
![]() Télécharger l’article en version PDF
Télécharger l’article en version PDF
Résumé
Le graffiti est un langage urbain et juvénile. Rebelle, il est au cœur du hip hop. Seulement, à la place du son, scandé ou rappé, il fait, à l'aide d'une bombe, exploser l'amertume et l'angoisse qui accompagnent la vie quotidienne en ville. L’image devient l'avenue qui mène vers ce que la ville doit être.
Mots clés : liberté, angoisse, Hermétisme, Musique, Imagination, Passion
Abstract
Graffiti is an urban and youthful language. Rebellious, it is in the heart hip hop. But, instead of the sound - whether chanted or rapped - it makes explode, with the help of a bomb, the bitterness and anguish that go with life in the city. The picture becomes the avenue that leads towards what the city must be.
Key words: freedom, anguish, reconditeness, music, imagination, passion.
I- Cadre théorique et méthodologique
1.1 – Contexte et justification
Dans Ville cruelle, Eza Boto sentait déjà le besoin de faire la différence entre le Tanga Nord et le Tanga sud. S’il use de notions cardinales pour une délimitation géographique d’un espace qu’occupent, en réalité, les mêmes gens, c’est bien parce que, contrairement à la campagne, lieu de liberté et d’un certain bien être, la ville a une conscience et des pratiques qui rappellent sa férocité. C’est peut-être exagéré de parler de férocité à l’entame de ce propos. Seulement, puisqu’il est question de « paroles de ville », il faut admettre que quand elle parle, c’est pour émettre une parole qui a tout l’air d’un avertissement. Avertir l’autre qui séjourne dans l’espace urbain qu’il est dans un lieu en mutation ; qui a de l’ambition et qui s’agrippe sur un certain passé pour construire son avenir. C’est pourquoi, elle ne se tait jamais. Devant parler sans jamais se taire, elle diversifie ses moyens d’expression.
Comme moyens d’expression privilégiés, nous avons le son et l’image. De nos jours, on n’aurait pas eu tort de parler de monopole. Car, la ville, fief d’une certaine population juvénile qui en revendique d’ailleurs la paternité, couve des frustrations d’autant qu’elle ne dispose guère d’assez de recettes pour offrir à ses jeunes les ressources nécessaires pour donner corps à des aspirations parfois démesurées. C’est la raison pour laquelle, la parole de la ville est, pour l’essentiel, une parole juvénile. Victimes du pouvoir de l’image et du son, les jeunes s’éloignent de la tyrannie du livre au profit d’une autre forme de tyrannie : les tags et graffs.
Le graffiti[1], cependant, était bien présent chez les Grecs et chez les Romains. Il aura donc résisté au temps pour être d’usage encore de nos jours. Qu’est ce qui peut alors justifier une telle permanence ; une telle force au point que la ville l’adopte pour en faire un support majeur de communication ? En attendant de répondre à cette interrogation, rappelons la réflexion que William P. Mac Lean esquisse sur ce que peut être sa signification :
La signification profonde des graffitis réside, non pas dans les moyens par lesquels ils sont effectués, qui ne diffèrent pas de ceux qu'utilisent le dessin et l'écriture en général, mais dans la nature — autant psychologique que matérielle — des supports sur lesquels ils sont réalisés... De nos jours, ils désignent des inscriptions et des dessins non officiels tracés à main levée, et supposent des supports (mur de bâtiment, murailles, colonnes, etc.) d'un caractère particulier.[2]
Cela veut dire que la dimension psychologique est de taille dans l’exercice du graffiti qui ne manque pourtant pas de mystère. Autrement dit, cet art donne l’impression de voiler son message comme pour refuser l’usage d’un langage commun et ordinaire ; donc banal. Avec dextérité et engagement, on situe le langage au carrefour des mythes et mythologies pour inventer de nouvelles valeurs à partir desquelles la jeunesse vivrait sa passion pour ensuite soulever des montagnes. Cela serait la manifestation d’un triomphe qui ne ferait aucun mal. Lieu de rencontres plurielles, la ville est un espace, naturellement, conflictuel. Mais, d’un certain point de vue, le graffiti aura dit et le rappelant sans cesse, que vivre avec l’autre en harmonie est un idéal ; qu’un tel idéal ne peut avoir des chances d’être atteint que dans l’émergence d’une émotion qui revisite les gloires du passé pour offrir à demain d’autres gloires.
1.2 – Problématique
C’est pourquoi, au cœur de notre problématique, nous nous pencherons sur le signifiant d’un signe qui intègre une certaine violence d’autant que tout se fait avec, à la place d’une plume ou d’un pinceau, une bombe.
Cette bombe qui explose, ne fait-elle pas exploser avec elle la mer gelée qui cristallise les angoisses de l’humain ? Ne s’agit-il pas, pour ce dernier, de trouver un refuge qui offre les moyens qui rendraient possible la transformation des rêves en réalité ? Ces rêves sont-ils rêvés par quelques ou par tous les occupants de la ville ? Cette quête de territorialité ne rapproche-t-elle pas la ville de la jungle étant entendu, par exemple, qu’un lion qui s’installe avec sa reine et sa famille, commence toujours par marquer son territoire en urinant sur les quatre points cardinaux du périmètre à occuper ?
Voilà des indices qui nous feront réfléchir. Pour mener la réflexion, nous interrogerons les seules images – nous avons écouté les graffitistes ; mais nous nous refuserons de nous fier à de tels propos qui commentent beaucoup qu’ils ne lisent et déchiffrent – captées çà et là, dans le plateau et dans la banlieue dakaroise, comme pour rappeler à l’humain ce que doit être l’humanité.
Pour y voir clair, nous commencerons par examiner la forme dans cette pratique. Nous nous rendrons compte qu’elle est remplie de poésie. Parce que remplie de poésie, elle sera riche en métaphores et en images mémorielles symboliques encore que l’objectif, en partie, est de protéger une mémoire séculaire d’une part ; d’en construire une autre pour fixer dans l’éternité l’instant qui ne peut être considéré comme simple fait de mode d’autre part. Nous n’oublierons pas de mesurer, dans cette perspective, le coefficient qu’on peut bien accorder à son allure hermétique. Ensuite, nous en viendrons au fond. A ce propos, il s’agira d’adjoindre à une orientation esthétique, une autre, éthique. Alors se découvre une ville qui se projette en puisant ses références dans les grandes figures d’hier et d’aujourd’hui. Qu’elles soient d’ici ou d’ailleurs, elles sont omniprésentes dans l’univers des graffitistes qui en font des modèles ou des sources d’inspiration. On peut bien se demander ce qui justifie la belle part qu’occupent Mandela et Bourba Djioloff dans un tel champ…
Enfin, nous mettrons en relief le surréalisme d’une pratique qui n’est pas seulement intention ou ambition, mais action. Puisqu’il s’agit de faire flamboyer l’avenir, tout se fera dans l’anticonformisme, dans la violence, dans la rébellion. L’intérêt est donc à chercher ; non plus dans l’exercice d’une expression artistique spécifique, mais dans l’émission d’une parole qui monte de la ville – le graffiti s’en fait l’écho sonore – pour informer sur la révolution entreprise ; sur la révolution à entreprendre donnant ainsi raison à Arthur Rimbaud qui avait l’intime conviction qu’il « faut changer la vie, car la vraie vie est absente ».
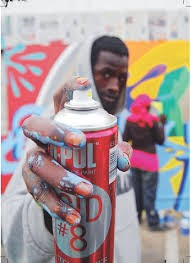

1.3 – univers de recherche et outils d’analyse
La technique d’échantillonnage qui nous a permis de concevoir notre corpus est celle du hasard simple. Après avoir été tenté par la méthode probabiliste, nous avons retenu celle – là en diversifiant les styles (Fresque, Street art, Tags, Personnages, Paysage, Hardcore, Bubble…) et en tenant compte des thématiques représentées. Pour l’analyse, nous nous fondons sur l’approche positiviste autant que sur celle des sémiologues pour aboutir à une signification.
– l’approche positiviste :
Le positivisme en art procède à une description minutieuse de l’œuvre en remontant le cours de l’histoire. Pour lire et comprendre une œuvre d’art, il faut la replacer dans le contexte de sa production. En effet, étant constituée de fond et de forme, elle a besoin de repères qui serviront de références qui informent sur les cibles de la représentation et qui orientent son interprétation. Car, « forme symbolique »[3], pour paraphraser Panofsky, elle s’inspire du monde et de toutes les réalités qui le composent pour en témoigner ou pour rivaliser avec, si elle n’en console pas.
Autant les « plus désespérés sont les chants les plus beaux »[4], autant les tableaux les plus gais et les plus tristes diffusent l’odyssée de la vie. Pour percevoir les gloires et les déboires contenus dans un tel patrimoine, il faut forcément interroger le temps. Cette investigation est incontournable dans la mesure où, non seulement elle revient sur un contexte, mais elle éclaire sur l’actualité de l’époque. Il s’agit d’engager une enquête qui sélectionne des éléments de lisibilité et d’appréciation et qui offre des normes susceptibles de mener à la signification. En fait, il s’agit de militer pour une véritable objectivité dans l’acte qui se penche sur l’œuvre d’art. Et, pour toute interprétation qui vise une signification, il est obligatoire de prendre l’art pour une unité composée d’éléments divers.
Quiconque est mis en présence d’une œuvre d’art, soit qu’il la recrée esthétiquement ou mène à son propos une enquête rationnelle, est affecté par ses trois composantes : forme concrète, idée (dans le cas des arts plastiques, le sujet) et contenu. La théorie pseudo – impressionniste, qui veut que « la forme et le coloris nous parlent de formes et de coloris, un point c’est tout » est tout simplement fausse. C’est l’unité entre ces trois composantes qui s’actualisent dans l’expérience esthétique et toutes trois concourent à ce qu’on appelle le plaisir esthétique.[5]
Le plaisir esthétique a donc pour antécédent une synchronisation de composantes aussi fondamentales les unes que les autres. Panofsky est catégorique. Ces propos prennent l’air d’une contestation radicale qui remet en cause toute attitude qui ignore la forme physique ou l’inspiration ou les sens dans toute interprétation d’une œuvre d’art.
L’association de ces trois atouts est inéluctable. Ce qu’on peut admettre sans trop de réserve. La raison est toute simple. Les œuvres d’art obéissent à des critères de composition, comme autant de principes, qu’on peut véritablement énoncer. Ce point de vue inclut dans l’art une dimension intelligible. Et, dès lors qu’il est question d’intelligibilité, les règles du jeu sautent à l’œil nu.
- La sémiologie :
Loin des considérations relatives à son contexte de production, l’œuvre d’art est désormais considérée comme un langage régi par un code et des conventions. Pour l’exploiter, l’analyser, l’interpréter et le comprendre, la sémiologie s’interroge sur le « comment » qui la fonde et qui valide toute notion de sens qu’elle peut avoir.
Une telle interrogation met en branle une foule de méthodes qui illustrent bien le caractère polysémique de l’art. L’interprétation devient un acte de recréation. Recréation signifie, dans ce cas, non pas simple reprise sous le même modèle, non plus répétition, mais retourner sur les pas du créateur. Prenons l’exemple, pour être plus clair, du mot texte.
Il vient du latin texere qui renvoie au « tissu ». Interpréter un texte, du point de vue sémiologique, c’est-à-dire mettre en relief toutes les manipulations que le tailleur, notre auteur, a effectuées pour aboutir à son produit final composé, en fait, de pièces détachées (manches, coudes, dos…). La tâche consiste à identifier le processus de création, toutes les voies empruntées pour arriver au résultat que matérialise l’œuvre. C’est dire que, autant l’intelligence et le talent permettent de produire, autant elles rendent également possible toute attitude qui se penche sur une œuvre en vue de lui donner un sens. On se rappelle Montaigne qui préfère « une tête bien faite » à une autre « bien pleine » autant que Voltaire qui demande à son lecteur de lui « expliquer ce qu’il a voulu faire ».
C’est cet acte de recréation, recréation devrait – on dire, qui fonde le caractère polysémique qu’on évoquait tout à l’heure. La preuve est manifeste dans la richesse des approches bien différentes que Saussure, Pierce, Umberto Eco, Pierre Guiraud, Roland Barthes… proposent du signe, puisque le sens et la signification d’une œuvre d’art résultent des relations entre signe et signifié. Le destinataire peut, dès lors, mettre un contenu dans une œuvre d’art sans tenir compte du contexte de sa production. L’essentiel est de travailler et procéder logiquement pour convaincre. Pour Umberto Eco, le signe ne sera considéré comme tel que quand il mène à la signification et à l’interprétation en associant le contexte de production de l’œuvre, la culture du récepteur et ses préoccupations[6]. Ce qui veut dire qu’il appartient au récepteur de mettre le trait d’union entre le signe et sa signification.
L’œuvre d’art ne signifie plus ce qu’elle est pour son auteur. Elle traduit ce que la culture et la civilisation de son récepteur en font. Le blanc, par exemple, est manifestation de paix, de quiétude, de pureté dans les civilisations occidentales et certaines autres, africaines et orientales. Il signifie tout le contraire chez les Asiatiques. Il symbolise l’horreur et la mort, le recueillement et l’angoisse[7].
II – le graffiti : esthétique et quête identitaire
2.1 – une partition de musique
Si le langage du graffitiste est garni de poésie, c’est bien parce que ce langage sert de moyen d’expression à la ville en général et aux jeunes qui y vivent en particulier. Rappelons-le, le graffiti est à situer au cœur du hip hop dont il est un élément à part entière. Il est donc musique. Ce qui fait penser à l’intitulé d’une émission de la radio mondiale « la photo sonore »[8]. Tout est image. Seulement, l’image est si « bruissante » qu’elle attire.
A priori, elle n’attire que par la forme. C’est pourquoi d’ailleurs le professeur Modou diouf considère que tenter de la déchiffrer, c’est entreprendre « un travail de recréation »[9].
Sans même situer notre réflexion sur le terrain de l’interprétation ; de la re-création, nous nous limiterons à lire des images qui représentent des femmes qui dansent, un micro, une guitare, la clé de sol…. Ces indices sont révélateurs d’un esprit citadin et juvénile illustrant ainsi les propos de Youssou Ndour qui chante les mutations, les métamorphoses de l’individu devrai-je dire sachant que nul n’est de la ville. L’on vient, au Sénégal en tout cas, du Baol ou du Cayor, du Saloum ou du Walo pour, finalement, s’installer dans un espace qui se veut plus moderne. Il dit: « I was a country boy » « now I am a city man »[10]. Voilà pourquoi l’on sent le besoin d’affirmer une identité comme pour échapper à une crise identitaire. La manière choisie sera donc parlante en puisant ses ressources dans ce qu’on peut considérer comme un langage universel.
2.2 – une pratique anticonformiste
Cependant il perd ce privilège de pouvoir parler à tous d’autant plus que le langage est dans une certaine mesure déconstruit. Il n’y a pas de normes, il n’existe guère de code qui peut aider l’autre à comprendre ce qui est dit. Ce phénomène est une constante que l’on retrouve dans toute activité qui intègre, dans ses propriétés, la poésie. Sortir de l’ordinaire, n’est-ce pas la seule vocation de la poésie ? C’est d’ailleurs ce qui fait son charme et sa force. De même, toute la vitalité du graffiti réside dans son immense pouvoir attractif qui fait qu’on peut s’arrêter et lire sans ne vraiment pas comprendre grand-chose.

Aussi, faudrait-il le rappeler, en dehors d’un usage fréquent, dans la représentation, d’images appartenant à l’univers musical, il y a les couleurs. « ut pictura poesis » enseignait le grand poète.[11] Cela veut dire que dans son mutisme qui n’est paradoxalement pas muet, le maniement des couleurs aura renforcé une certaine poéticité. Autrement dit, quand la ville parle par l’intermédiaire du graffiti, elle use des couleurs les plus chaudes à l’image de Baudelaire qui tenta d’extraire la beauté du mal[12]. Il est donc question de réussir des associations qui rappellent l’oxymore.
Quand on représente la jeune citadine, par exemple, on lui fait porter une petite minijupe non pas pour célébrer sa beauté, mais plutôt pour se rebeller contre des pratiques vestimentaires qui manquent d’originalité subissant les affres de la mode commandée par les feuilletons et les médias.
2.3 – une pratique hermétique
Arthur Rimbaud, dans Voyelles, attribuait à chaque lettre une couleur. Chez le graffitiste, chaque couleur sera inscrite dans une nouvelle dynamique. Car l’essentiel, à l’image des surréalistes, est de réinventer le monde. Pour y arriver, est inventé un art qu’on accepte désormais comme tel[13] qui sera poétique et moderne. L’addition entre la poésie et la modernité aboutit inévitablement à l’hermétisme. De ce point de vue, se pencher sur « paroles de ville » devient une aventure. Mais l’aventure est fondée. Car, « toute chose sacrée qui veut demeurer sacrée… doit s’entourer de mystère ».[14] La ville est un espace qui a tout l’air d’un carrefour. Elle attire comme la lumière attire le papillon. Cette force attractive est d’autant plus vrai que le phénomène de l’exode rural est une réalité propre à l’Afrique et, par extension, au monde entier. La gigantesque[15] ville de New York n’a-t-elle pas son « down town » ?
Bref, le graffiti nous dit que la ville est ce lieu privilégié qui profite de la vie et qui prend le soin de dire à tous ceux qui s’en approchent que, quelles que puissent être les mœurs, tant au plan social, politique, économique, moral ou religieux, les apparences sont à préserver. « Jouer le jeu » peut mener au pire…[16]mais en ville, il faut savoir « jouer le jeu ». « To be or not to be » ! criait – on pour que se réalise la Negro – Renaissance. Il n’y a rien de plus noble. Pour dire cette noblesse, elle aura choisi cette forme de représentation remplie de poésie encor que la poésie est l’héritage de la noblesse du monde. Elle sera donc, à la fois, riche en couleurs et en sons tout en restant très hermétique. Ne l’oublions surtout pas, peint et adossé sur un mur, le graffiti occupe beaucoup d’espace, usant de couleurs vives dans le seul but d’avertir sur ce que reste la ville. Un lieu qui s’affiche par de larges immeubles qui invitent l’homme au combat de la survie tel que le soutenait Nietzsche pour qui le « surhomme » doit se battre, s’imposer et exterminer les faibles afin de s’ériger majestueusement en dieu terrestre. Autant il faut gueuler et vociférer dans la cohue de la ville pour se faire entendre, autant le graffiti, par son gigantisme et ses couleurs fortes, kidnappe notre regard dans l’immensité d’une ville qui offre trop de choses à voir.
III – Peindre pour réinventer le monde
Fait par des hommes, le graffiti s’adresse à des hommes. Derrière la violence de sa représentation, nous avons, en réalité, un cri hautement humaniste. Une telle adresse n’a d’autre ambition que de dire des aspirations et de dénoncer des misères. Tant au plan social, politique ou moral, les dénuements sautent à l’œil nu. De nos jours, dans un contexte de mondialisation qui rythme une vie orientée par la vitesse de l’ordinateur et de l’internet, les valeurs, quelques nobles qu’elles soient, sont menacées.
Conscient de cette menace qui devient même une crise des valeurs, le graffiti fonctionne comme une sentinelle qui veille sur un esprit qui peut être tenté et, par conséquent séduit, par les faits et figures légendaires des autres, oubliant les siens. Cet esprit est d’ailleurs à la base de tous les conflits de génération. Léopold Sédar Senghor parlait d’« enracinement et d’ouverture ».
En ville, on aura eu l’impression, examinant une certaine conscience et un certain comportement, qu’il y a plus d’ouverture que d’enracinement. Pour ne point céder à un tel vent autant d’espace, le graffiti représente d’authentiques et d’héroïques figures pour témoigner sur une misère morale et pour dire qu’on aura eu tort de ranger aux oubliettes les dignes fils d’un Monde et d’un pays qu’on peut légitimement considérés comme des fous d’amour qui auront offert leur vie pour que l’humanité reste humaine et que le sourire soit la chose du monde la mieux partagée.
Sur les murs de la Médina et sur les palissades de Guédiawaye, sur tous les ouvrages d’art des nouvelles infrastructures de la capitale sénégalaise, l’icône de Mandela est omniprésente. La disparition de cet homme, dernièrement, a plongé le monde dans une terrible angoisse et dans une grande torpeur. Lui comprenait ce que devait être l’Afrique du sud, terre de Chacka, terre de l’apartheid. Se refusant tout esprit revanchard, il prophétisait une civilisation arc-en-ciel. Souvenons-nous de la merveilleuse philosophie zouloue de l’altérité : l’Ubuntu. Je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes. Nul n’a le droit d’oublier ces hommes qui ont tenu la dignité de la nation nègre par leurs maigres bras. Ce qui sera formidable dans cette production de normes ; autant dire cette réhabilitation des valeurs guerrières, est tout simplement son caractère visionnaire.
On immortalise Mandela, Senghor Thomas Sankara ou Lumumba parce qu’ils étaient en avance sur leur temps. Les jeunes graffitistes aussi empruntent une voie avant-gardiste qui choque par son audace et son originalité autant qu’elle plait. En ressuscitant les valeurs d’antan, le tag semble faire dans l’anticonformisme. Et c’est tout le paradoxe de la peinture urbaine. La production artistique est bouleversée dans ses formes, sortie de ses demeures classiques. Mais les héros qu’elle représente n’ont-ils pas tous été en quelque sorte des marginaux pour avoir dénoncé un état social et politique jugé, en leur temps, par quelques de ceux qui le pilotaient, comme tout à fait normale. L’anormalité est ici la proposition de valeurs nouvelles centrées sur le refus de se perdre dans le conformisme aveugle.
Autrement dit, sur ces mures repose un cours sur l’éthique qui rappelle ce qui se fait de manière officielle dans nos écoles et universités. Cheikh Anta Diop, Amady Aly Dieng, le professeur Djibril Samb et tant d’autres nous apprennent à refuser l’idée d’une Afrique ignare laissée sans âme et sans raison. Sur les murs de la ville, on dément aussi Hégel principal théoricien de « l’enfance de l’Afrique ». La culture nouvelle se fera en divorçant avec la norme du blanc. Nos références seront ici Lat dior, Bourba Djolof… Aux oubliettes nos ancêtres les gaulois !
Notons aussi que l’éthique qui n’est rien d’autre que la norme établissant les frontières entre le bien et le mal, le permis et l’interdit s’arroge, dans l’univers du graffiti, le droit à la violence. Puisque nous perdons chaque jour un peu plus de ce que nous sommes, notre éducation devient une urgence. Ces jeunes nous bousculent tout simplement parce qu’ils ont peur de perdre le peu d’africanité qui leur reste. Les concepts utilisés sont en réalité les meilleurs indicateurs qui mettent à nu la détermination qui sous-tend ce mouvement de mutation. On se nomme AMONIAK, DOCTA, MIZERABLES, ZEINIX…autant de patronymes qui témoignent de la violence et un peu du désespoir de ces jeunes citadins. Par exemple, AMONIAK, selon les membres de ce groupe, signifie littéralement en wolof « am wala niak ». Les murs de la ville semblent être leur dernier recours.

L’école de la vie se fera désormais dans ces lieux insolites. L’aspiration à des valeurs nouvelles qui nous est refusée dans les institutions se passera dans la rue. Il faudra se faire entendre vaille que vaille. N’est-ce pas cette même tension que vivent, sous des formes différentes, tous les jeunes de toutes les villes et de tous les temps ? En 1989 tombait le mur de Berlin. Construit en 1961, ce mur représentait deux états d’âmes, deux conceptions différentes et opposées pour un peuple éclaté en deux races politiques. Au recto, tout est resté propre. Cette limpidité était révélatrice de l’adhésion de la communauté de l’ouest à l’orientation politique et même raciste d’un système politique. Au verso, se refusant cette propreté, peintres et jeunes révoltés noircissent le mur à coups de bombe. Finalement, il s’écroule sous le poids des graffitis symbolisant l’aspiration à quelque chose d’autre. Lorsqu’il tombe en 1989, toutes les briques avaient fini d’être recouvertes par la peinture des bombes.

La parole des villes sera désormais l’arme des temps nouveaux. Si on peut échapper au Rap en refusant d’écouter ses mélodies agaçantes et répétitives, on n’échappera jamais au discours des graffitistes qui s’impose par un visuel insolent. L’art est réinventé, la musique repeinte et enfin la culture ressuscitée. Pourtant, ces jeunes citadins ne puiseront pas forcément leurs références aux Etats Unis, encore moins chez nos anciens colons. Ils vont tous s’abreuver dans les marres de la profonde et lointaine Afrique des guerriers et des contestataires. Hommage sera fait à Lat Dior, Bourba Djolof, EL Hadj Malick, Serigne Touba, Mandela, Senghor ou Cheikh Anta. Désormais, par le graffiti, la parole de la ville portée par des députés d’un genre nouveau devient la caisse de résonnance de toutes les aspirations d’une communauté qui refuse de confier son destin aux hommes politiques. Elle demeure la voix populaire des sans « voix » avec lesquelles elle fraternise rappelant les propos de Césaire qui ne pouvait admettre un quelconque hiatus entre son peuple et lui. Dans la première phase de son retour au pays natal, sentant son peuple hésitant, il fait les premiers pas pour rendre son accueil ; l’accueil de l’enfant prodigue, chaleureux et triomphant : « Embrassez-moi sans crainte, leur dira-t-il ; car si je sais que parler, c’est pour Vous que je parlerais. »
Conclusion
Sans avoir la prétention de clore un sujet encore végétatif, on peut se permettre au moins quelques observations pour mieux relancer le débat sur cet art qui prête sa voix à la ville. Le graffiti présente en vérité une double mutation. D’abord, esthétiquement, il renverse la perspective artistique qui sépare le visuel et le sonore. Ici l’on se sert de ses yeux pour mieux entendre. Ensuite, disons-le, l’étrange réside dans ceux qui portent ces paroles : des jeunes désenchantés, parfois situés aux antipodes de l’école de la république. Pourtant, la parole qui sort de leurs bombes est hautement artistique et intellectuelle. Au demeurant, où se trouverait alors réellement l’école si elle doit être le lieu de formation d’un citoyen de type nouveau ?
Bibliographie
Alfred de Musset, «La nuit de Mai », Les Nuits (1835-1837), livre-cd, coll.LQP, Paris, Le livre qui parle, 2007
Erwin Panofsky, L’œuvre d’art et ses significations, Paris, Gallimard, 1969.
Mamadou DIOUF, « Fresques murales et écriture de l’histoire. Le Set Setal à Dakar », Politique africaine, 46, 1992
Martine Joly, L’image et les signes, Paris, Nathan, 1994
Leopold S Senghor « New York », chants d’ombre, Paris, Seuil, 1945
Stéphane Mallarmé in Grande Encyclopédie Larousse, Larousse, Éd. 1971 – 1976, pp. 8467 – 8470.
Umberto Eco, Le Signe, Bruxelles, Editions Labor, 1988.
http://www.au-senegal.com/dakar-capitale-de-l-art-urbain,3439.html
* Université Cheikh Anta Diop de Dakar
[1] Il est écrit dans le Dictionnaire Littré graffito pl. graffiti : « mot italien employé pour désigner ce que l’on trouve d’écrit sur les murailles dans les villes et les monuments de l’antiquité. »
[2] In Encyclopœdia Universalis
[3] Erwin Panofsky, L’œuvre d’art et ses significations, Paris, Gallimard, 1969, p.17.
[4] Alfred de Musset, «La nuit de Mai », Les Nuits (1835-1837), livre-cd, coll.LQP, Paris, Le livre qui parle, 2007.
[5] Erwin Panofsky, L’œuvre d’art et ses significations, op.cit, p.43.
[6] Umberto Eco, Le Signe, Bruxelles, Editions Labor, 1988.
[7] Martine Joly, L’image et les signes, Paris, Nathan, 1994.
[8] Sélectionnés par la Rédaction, des documents sonores exploitent les faits qui dominent l’actualité au quotidien. Cette émission est présentée sur Rfi par Edmond Sadaka si ce n’est Jean-François Cadet.
[9] Mamadou DIOUF, « Fresques murales et écriture de l’histoire. Le Set Setal à Dakar », Politique africaine, 46, 1992, pp. 41-54.
[10] Nous faisons allusion au caractère urbain de la musique de Youssou Ndour qui le reconnait d’ailleurs dans le Cafard Libéré Plus du 27 Décembre 1991. Plus tard, en 1999, il confirme cette orientation en mettant sur le marché de la world music, avec Sony, un album au titre expressif « Joko- from village to town ».
[11] « Comme on peint est donc la poésie », cette célèbre expression latine est d’Horace qui parle ainsi de l’action picturale dans son Art poétique.
[12]Nous empruntons le terme à Baudelaire et à son recueil Les fleurs du mal publié en 1857.
[13] A l’origine, le graffiti était considéré comme un acte de vandalisme. Vers 1970 par exemple, il va jouir d’une certaine respectabilité en franchissant le seuil du métro. Membre du hip hop, il fera l’addition entre mouvement, musique et danse comme en témoigna le Beakdancing qui aura fait fureur sur Dakar dans les années 80.
[14] Stéphane Mallarmé in Grande Encyclopédie Larousse, Larousse, Éd. 1971 – 1976, pp. 8467 – 8470.
[15] Leopold S Senghor « new York », Chants d’ombre, Paris, Seuil, 1945.
[16]Nous faisons allusion, à titre indicatif, au sort de Meursault, le héros d’Albert Camus dans l’étranger.









