Sur le fil...
Safara n°22 est désormais disponible...
![]() Télécharger l’article en version PDF
Télécharger l’article en version PDF
Introduction
Nous proposons dans ce texte de distinguer et présenter sommairement des grands aspects d’un texte littéraire, c’est-à-dire les différentes facettes que l’on peut y trouver. Nous introduirons d’abord la distinction entre cinq composantes de l’analyse de textes littéraires: (1) approche (par exemple, l’analyse thématique, la sémiotique); (2) aspect (par exemple, le fond, la forme, le style); (3) configuration (par exemple, le thème de l’amour); (4) proposition (par exemple, Hamlet n’aime pas vraiment Ophélie) et (5) corpus (par exemple, les tragédies de Shakespeare). Puis nous présenterons des grands aspects du texte littéraire que peut considérer une analyse; nous en distinguons une trentaine (fond, forme; genre; etc.).
A. Les composantes de l’analyse:
1. Présentation générale
L’analyse de produits sémiotiques (par exemple, des textes) se réalise dans la combinaison des composantes suivantes: un ou plusieurs corpus, une ou plusieurs approches, un ou plusieurs aspects, une ou plusieurs configurations et une ou plusieurs propositions. Notre propos visera l’analyse de textes littéraires; mais il peut convenir, avec ou sans ajustements, à d’autres formes d’analyses littéraires. Pour une typologie des analyses littéraires, voir le chapitre « Objets possibles pour une analyse ».
L’approche est l’outil avec lequel on envisage l’objet d’étude. « Approche » est un concept plus général que celui de « théorie », en ce qu’une théorie n’est pas nécessairement destinée directement à l’application et en ce que toute analyse n’est pas nécessairement la mise en œuvre consciente, explicite et soutenue d’une théorie. Cependant, toute analyse présuppose une approche et toute approche présuppose une théorie littéraire, fût-elle rudimentaire et non conscientisée. Par exemple, en littérature, une analyse thématique traditionnelle ne repose pas à proprement parler sur une théorie explicitée; la micro-lecture est plus une méthode d’analyse qu’une théorie. Une typologie des approches peut être trouvée dans Hébert, 2014 et 2013.
L’approche est donc le « comment ». L’approche comporte des concepts, un « programme » indiquant la manière de les utiliser dans l’analyse et d’autres éléments méthodologiques, que ces éléments soient intégrés dans l’approche proprement dite ou propres à l’analyse en cours.
L’aspect est la facette de l’objet d’étude que l’on analyse. Pour prendre un exemple simple, traditionnellement on considère qu’un texte se divise sans reste (et en principe sans recouvrements, mais ce n’est pas si sûr) en deux parties ou deux aspects: le fond (les contenus, notamment les thèmes) et la forme (la manière de présenter les contenus). Un aspect peut se décomposer en sous-aspects, c’est le cas notamment des aspects fond (thème, motif, etc.) et forme (ton, rythme, etc.).
Ce que nous appelons la « configuration » est l’élément particulier visé dans l’aspect, par exemple l’amour pour l’aspect thématique. L’aspect et la configuration sont donc le « quoi ».
Il faut distinguer la configuration et le sous-aspect. Par exemple, si l’on considère que l’analyse thématique porte soit sur des thèmes soit sur des motifs, thèmes et motifs sont alors des sous-aspects mais pas des configurations. Par contre, le motif de la femme méprisée dans Hamlet sera une configuration.
Ce que nous appelons la « proposition » est la forme particulière que prend la configuration dans l’objet d’étude selon l’analyste, proposition que l’analyse s’assure de valider ou d’invalider (par exemple: Hamlet n’est pas véritablement amoureux d’Ophélie). Si cette proposition est centrale dans l’analyse, elle peut être élevée au rang d’hypothèse globale. Sur l’hypothèse, voir Hébert, 2014. La proposition est donc le « ce qu’on dit du quoi » (en termes techniques, le quoi est le sujet et le ce qu’on en dit, le prédicat). La proposition est appuyée par une argumentation, laquelle est constituée d’arguments de nature et en nombre variables.
Un corpus, au sens large, est constitué d’un produit ou plusieurs produits sémiotiques (par exemple, des textes) intégraux, choisis par inclination (corpus d’élection) ou retenus par critères « objectifs », et qui font l’objet d’une analyse. Au sens restreint, il s’agit d’un produit ou d’un groupe de produits sémiotiques intégraux retenus sur la base de critères objectifs, conscients, explicites, rigoureux et pertinents pour l’application souhaitée. Des approfondissements sur le corpus peuvent être trouvés dans Hébert 2014 et 2013.
2. Approfondissement sur les aspects et approches
2.1 Combinaisons aspect-approche
Posons que chaque objet d’analyse, dont le texte littéraire, est décomposable en aspects (parties, composantes, facettes, niveaux, dimensions, composantes, etc.) et que les diverses approches (grilles, théories, modèles, dispositifs, méthodes critiques, etc.) de cet objet se distinguent principalement en fonction des aspects qu’elles visent.
Il est possible qu’une approche ne soit valable que pour un aspect (une approche pourra prétendre être la seule à même de rendre compte de tel aspect ou être celle qui en rend mieux compte). Par exemple, la narratologie ne touche, en principe, que la dimension narratologique du texte; la stylistique ne touche en principe que, justement, la partie stylistique d’un texte, dont, en principe, elle est la mieux à même de pouvoir rendre compte.
Inversement, une même approche pourra étudier plusieurs aspects du texte. Cependant dans ce cas, en général, ces aspects distincts se laissent englober, d’une manière ou d’une autre, constituant en cela des sous-aspects. Ainsi, la sémiotique, la discipline qui notamment décrit les signes, s’applique autant aux signifiés (les contenus des signes) qu’aux signifiants (les formes qui véhiculent ces contenus), mais ces deux parties ne constituent que les sous-aspects du signe, qui est l’objet même de la sémiotique. Cela étant, rien n’empêche de constituer des approches composites, par exemple en mélangeant une analyse narratologique et une analyse stylistique. Comme pour tous les mélanges, celui-ci doit être légitime (il est des théories quasi-impossibles à mélanger parce que reposant sur des hypothèses, postulats opposés) et dynamique (il ne s’agit pas de faire une analyse narratologique et en parallèle une analyse stylistique mais de faire « converser » ces deux analyses).
2.2 Portée des aspects
Certains aspects ne portent pas pour tous les produits d’un même corpus (par exemple, la versification ne s'applique pas, sauf exception rarissime, au roman et pas complètement pour la poésie non versifiée). Dans certains cas, un aspect recouvrera en totalité ou en partie un ou plusieurs autres aspects. Par exemple, l’analyse du rythme présuppose celle de la disposition des unités et en conséquence le rythme englobe une partie si ce n’est la totalité de la disposition (même si des analyses de la disposition peuvent en principe ne pas toucher au rythme); l’analyse des contenus englobe et dépasse celle des thèmes, puisque tous les contenus ne sont pas des thèmes au sens traditionnel du mot.
2.3 Recoupements entre aspects et approches
Un élément d’un texte peut relever de plusieurs aspects Par exemple, la majuscule, particularité graphique et grammaticale, peut participer également de phénomènes sémantiques et rhétoriques, comme le soulignement ou la personnification (laquelle touche également la dimension symbolique).
Des approches sont susceptibles de se recouper en (bonne) partie, par exemple la stylistique et la rhétorique (on a pu dire que la stylistique est la rhétorique des modernes). Des aspects sont susceptibles de se recouper en (bonne) partie, par exemple les thèmes et les signifiés.
Des aspects pourront correspondre à des sémiotiques (des langages) se manifestant au sein du même objet, que cet objet soit proprement polysémiotique (par exemple, le théâtre: parole, geste, musique, etc.) ou qu’il soit polysémiotique uniquement dans sa diversité interne (par exemple, dans un texte, la ponctuation en tant que système autonome de signes, distinct de celui formé par les mots).
2.4 Valorisation des aspects
Du point de vue de la production ou de la réception, on pourra valoriser différemment les aspects dégagés dans la typologie des aspects. Par exemple, fond et forme sont censés, traditionnellement du moins, rendre compte sans résidu de l’ensemble du texte (et, plus généralement, de tout produit sémiotique): tout y est soit fond, soit forme. Certains genres, mouvements, courants, périodes, écoles, auteurs valoriseront l’un ou l’autre. Par exemple, les « formalistes » valorisent la forme. Cette valorisation d’un aspect donné se manifeste notamment: dans le temps de production investi dans cet aspect (en principe, il sera plus élevé pour l’aspect valorisé, par exemple pour les thèmes dans le cas des « substantialistes »); dans les jugements sur cet aspect éventuellement présents dans le texte lui-même; dans le temps de réception accordé à cet aspect (en principe, pour une œuvre substantialiste, on accordera plus d’importance à l’analyse du fond qu’à celle de la forme).
Prenons un exemple moins simpliste que l’opposition fond/forme, d’ailleurs contestable. Considérons que la représentation théâtrale implique plus d’une douzaine de « langages » ou sémiotiques (parole, décor, accessoire, musique, etc.). Ces sémiotiques pourront être présentes/absentes dans une classe, un type d’œuvres (un genre par exemple) ou une œuvre donnée. Cette présence/absence pourra être éventuellement quantifiée ou en tout cas qualifiée en termes d’intensité (les costumes sont-ils un peu, moyen, fortement présents dans cette œuvre?). Ces sémiotiques pourront être caractérisées aussi qualitativement ailleurs que dans leur présence/absence (par exemple, tous les costumes porteront une tache rouge). Enfin, les différentes sémiotiques pourront être hiérarchisées entre elles. Par exemple, dans la dramaturgie moderne, au contraire de la dramaturgie traditionnelle, on tend souvent à considérer que la parole n’est qu’une sémiotique parmi d’autres, et on ne la mettra donc pas nécessairement au premier plan. La structure de l’œuvre peut même tendre à l’équivalence de chaque sémiotique, produisant une sorte structure neutre ou aucune sémiotique ne ressort vraiment globalement (même si ponctuellement, localement il peut en être autrement).
B. Aspects du texte littéraire
Plutôt que de dresser un impossible inventaire des aspects du texte en tenant compte de la variation de cet inventaire en fonction des différentes conceptions du texte et de ses aspects, d’un théoricien ou d’une époque à l’autre, nous avons décidé de privilégier, pour l’essentiel, une approche raisonnée plutôt qu’encyclopédique.
Cet inventaire[1] des aspects ne présente pas directement une méthode d'analyse, mais quelques angles d'analyse d'une œuvre (par exemple, il ne suffit pas, pour obtenir une analyse satisfaisante, de repérer quelques phénomènes dans un texte et de les classer sous les divers aspects). Si, pour produire une analyse, on prend plusieurs aspects, en général on choisira des aspects qui sont complémentaires en eux-mêmes (par exemple, grammaire et syntaxe; disposition et rythme) ou dont on pourra faire état des relations particulières qu’ils entretiennent entre eux dans l’œuvre analysée. On évitera donc des analyses « en vrac », où l’on passe d’un aspect à un autre sans que des relations explicites et significatives soient établies et interprétées (par exemple, on évitera de faire une analyse de la versification d’un poème et une analyse de ses thèmes sans montrer les relations entre ces deux aspects).
1. Connotation, dénotation
Kerbrat-Orecchioni (2002: 425) propose ces définitions et ces exemplifications des concepts de dénotation et de connotation en linguistique (ils ont d’autres sens en logique et en philosophie):
On peut considérer que le contenu sémantique d'une unité linguistique quelconque se décompose en deux types de composantes: les traits dénotatifs, qui seuls interviennent directement dans le mécanisme référentiel, reflètent les propriétés objectives de l'objet dénoté, et sont seuls en principe impliqués dans la valeur de vérité de l'énoncé ; les traits connotatifs, qui jouent certes un rôle non négligeable dans le choix du signifiant, mais dont la pertinence se détermine par rapport à d'autres considérations que celle de la stricte adéquation au référent. On en donnera deux exemples: 1) Le contenu de “fauteuil” s'oppose dénotativement à celui de “chaise” sur la base du trait [du sème] /avec accoudoirs/ vs /sans accoudoirs/ […] Mais le terme connote en outre l'idée de confort: même si tous les fauteuils ne possèdent pas nécessairement cette propriété, le trait [confortable] vient s'inscrire dans “l'image associée” au concept par la masse parlante, et surdéterminer le contenu sémique de l'item. 2) “chaussure” s'oppose dénotativement à “chaussette”, mais connotativement à “godasse”: ces deux termes ont en effet la même extension ; ce n'est donc pas la nature du référent qui détermine dans ce cas le choix du signifiant, mais les caractéristiques de la situation de communication (connotation de type “niveau de langue”).
Nous ajouterons qu’un terme connoté et son correspondant que nous dirons non connoté (en fait, la connotation est toujours symétrique) peuvent ne pas partager la même extension, le même inventaire: par exemple, « cheval » (neutre) est plus extensif que « canasson » (péjoratif), dont il englobe l’extension.
L’auteure (2002: 425) rappelle que, comme toute unité sémiotique, une unité de connotation se décompose en signifiant (Sa) (la forme du signe) et signifié (Sé) (le contenu du signe), même si « [o]n a souvent tendance à appeler “connotations" les seuls contenus connotés. »
La connotation peut se loger à différents endroits:
La connotation peut en effet investir le matériel phonique, prosodique ou graphique (problème des “phonostylèmes”, de l'“accent” régional, du symbolisme des sons, des jeux phonique et typographiques...) ; elle peut exploiter une structure morphologique, une construction syntaxique, une unité lexicale, ou même le dénoté discursif... Ces divers éléments pouvant être source de connotations, on voit que leur support est selon les cas de dimension inférieure, égale, ou supérieure à celle du mot. D'autre part, les connotateurs fonctionnent volontiers en réseaux: c'est sur une constellation de faits hétérogènes que repose souvent, dans un texte donné, son contenu connoté. Mais il ne faudrait pas pour autant ramener toutes les connotations à des fait de “parole”: si certaines d'entre elles sont individuelles (propres à un sujet, ou à un idiolecte textuel), d'autres sont en revanche codées en langue [par exemple, les connotations péjoratives de “ –ard ”, dans “chauffard”, “criard”, etc.].
Comme l’auteure le signale à propos du dénoté, le signifiant de connotation peut être un contenu, un signifié. Mais nous ajouterons qu’il peut être un contenu connotatif. Par exemple, si pour un locuteur misogyne « Femme » contient le trait connotatif /négatif/, pour son interlocuteur qui ne l’est pas, /négatif/ mènera à la connotation /misogyne/. Plutôt que de considérer que l’unité source de la connotation est un signifiant de connotation et l’unité but un signifié de connotation, on peut également considérer que l’unité source est un interprétant (c’est-à-dire une unité ayant une incidence sur le contenu) et l’unité but un sème et/ou un signifié.
Kerbrat-Orecchioni (2002: 425-426) propose ce classement des signifiés de connotation:
Les connotations qui viennent enrichir la représentation du référent à la faveur de divers mécanismes associatifs (tout mot connote en effet ses propres paronymes, synonymes, ou homonymes), ou de divers jeux sur le signifiant (trope, calembour, allusion, etc.). - Les connotations “stylistiques”, qui signalent que le message procède d'un sous-code particulier (ou “lecte”): variante diachronique (connotations archaïques ou modernistes), dialectale (“septante”), “sociolectale” (termes propres à un milieu socio-culturel), “idiolectale” (termes propres à une formation idéologique), ou “typolectale” (termes propres à un type de discours particulier -- ainsi “onde” ou “azur” sont-ils marqués d'une connotation “poétique”). - Les connotations “énonciatives”, qui fournissent des informations sur le locuteur et la situation de communication: on y retrouvera certaines des catégories précédentes (le problème des “niveaux de langue” relevant à la fois du style et de l'énonciation), aux côtés des connotations “axiologiques” (péjoratives ou mélioratives), ou affectives (valeurs “émotionnelles”, dont Bally a tenté l'inventaire, et que prétend mesurer le “différenciateur sémantique” d'Osgood).
Les connotations sont tantôt valorisées (comme en littérature) tantôt dévalorisées (comme dans certaines théories linguistiques). Leur « domaine de pertinence s'étend sur l'ensemble des systèmes sémiotiques (les connotations sont en effet massivement présentes dans les messages iconiques, filmiques, musicaux, gestuels, etc.). » (Kerbrat-Orecchioni, 2002: 426)
2. Contexte
Le contexte d’une unité est un « milieu » qui l’« entoure », fait d’unités (termes, relations entre ces termes, opérations, etc.), de même nature ou non qu’elle (par exemple, des mots comme contexte d’un mot), qui soit ont une incidence sur elle en la déterminant plus ou moins, soit n’ont pas d’incidence sur elle et donc ne la détermine pas. L’incidence peut se produire sur l’un et/ou l’autre des aspects d’un produit sémiotique (signifiants, signifiés, genre, style, etc.). On peut élargir la définition de « contexte » et distinguer (en enrichissant une typologie de Rastier): (1) le contexte actif, celui qui a une incidence sur l’unité analysée; (2) le contexte passif, celui sur lequel l’unité analysée a une incidence; et deux contextes inertes: (3) le contexte non actif, celui qui n’a pas d’incidence sur l’unité; (4) le contexte non passif, celui sur lequel l’unité n’a pas d’incidence.
On peut distinguer entre le contexte interne et le contexte externe. L’intériorité et l’extériorité sont alors définies par une frontière qui est celle du produit sémiotique en cause (par exemple, un texte). Le contexte interne est soit monosémiotique (par exemple, pour un texte ordinaire), soit polysémiotique (par exemple, pour un texte illustré). Le préfixe « co- » peut servir à désigner le contexte interne, que ce contexte soit de même sémiotique ou d’une autre sémiotique que l’unité analysée. Par exemple, le cotexte d’une unité désigne, dans un texte, l’ensemble des autres signes textuels. S’il s’agit d’un texte ordinaire, l’unité analysée et son cotexte correspondent sans reste au produit sémiotique. S’il s’agit d’un texte illustré, le cotexte et l’unité analysée laissent de côté les images; parler de coproduit d’une unité permet alors d’inclure dans le contexte et les unités textuelles et les unités imagiques. On peut distinguer de nombreuses formes de contextes externes: biographique (sous l’angle historique ou psychologique; voir Psychologie), sociologique (voir Société), historique (la grande et la petite histoire), socioculturel, artistique et esthétique, scientifique, politique, idéologique, les autres œuvres du même auteur ou d’autres auteurs, etc. Les cinq grandes variables contextuelles externes sont le producteur, le récepteur, le temps, l’espace et la culture. Évidemment, le temps, l’espace et la culture du producteur et du récepteur peuvent être les mêmes ou encore être différents (par exemple, un lecteur étranger non contemporain d’un roman qu’il lit); il faut donc distinguer le contexte de production et le contexte de réception.
De même que le producteur (volontairement ou involontairement), la production, le récepteur attendu (et donc celui non attendu), la réception attendue (et donc celle non attendue) se reflètent toujours dans le produit, le contexte se reflète toujours dans le produit (par exemple, même une utopie de science-fiction « parle » de l’époque contemporaine, fût-ce par la négative ou par l’omission significative). En effet, tout signe s’offre dans une triple perspective, selon Bühler: symbole relativement au référent (ce dont on parle), signal relativement au récepteur et indice (ou symptôme) relativement au producteur.
Tout produit est affecté par le contexte et, ne serait-ce que pour cette raison, le reflète donc; tout produit affecte plus ou moins, en rétroaction, le contexte qui l’a vu naître et qui s’en trouve ainsi changé. Tel texte mineur a eu un impact mineur voire nul ou quasi-nul sur le contexte; mais des textes peuvent avoir eu et avoir encore un impact majeur: par exemple, la Bible.
Les approches dites contextuelles (par exemple, l’histoire littéraire pour les textes), en tant qu’elles excluent méthodologiquement l’immanence de l’œuvre, et les approches dites immanentes (par exemple, la sémiotique, la rhétorique), en tant qu’elles excluent méthodologiquement le contexte de l’œuvre, sont plus complémentaires qu’opposées, puisqu’il n’est pas possible de comprendre l’œuvre sans un minimum de contextualisation et de description interne.
3. Croyance, valeur, idéologie, argumentation
Ce qui est impliqué dans les croyances, valeurs et idéologies, ce sont les modalités: déontiques (liées au devoir: obligations, interdictions, facultativités, licences, etc.; voir Écart et norme); thymiques (positif ou euphorique, négatif ou dysphorique, neutre ou aphorique, etc.); véridictoires (vrai, faux, etc.) et ontiques (factuel: cela existe; contrefactuel: impossible ou irréel; possible).
La dialogique (Rastier) est la composante textuelle dont relèvent les éléments affectés d’une modalité. Les modalités sont des caractéristiques de grande généralité, regroupées par oppositions (de deux ou plus de deux éléments), affectées par un sujet observateur à un objet observé, objet dont la nature est alors reconnue comme infléchie par elles. Par exemple, Marie (sujet observateur) croit que la Terre est ronde (vrai et réel), qu’elle peut gagner à la loterie (vrai et possible) et elle aime le chocolat (positif ou euphorique). Sur la dialogique, voir Hébert 2007 et 2013.
Il faut distinguer des sujets observateurs et des modalisations de référence et d’autres d’assomption. Les sujets et modalisations de référence sont associés à la vérité ultime du texte (en général le narrateur omniscient d’un texte est le sujet de référence). Les sujets d’assomption produisent des modalisations qui correspondent ou non aux modalisations de référence (par exemple, les modalisations de tel personnage seront données pour fausses par le narrateur). Les sujets observateurs sont de différents types: auteur empirique (c’est-à-dire réel, par exemple le Baudelaire réel), auteur construit (dégagé à partir du texte, par exemple le Baudelaire qu’on s’imagine à partir de ses textes), narrateur, personnages, narrataire (voir Histoire), lecteur construit (l’image que le texte donne du lecteur attendu), lecteur empirique (réel).
Lorsque la modalité affectée à une même unité est différente d’un sujet à un autre, il y a conflit modal; lorsqu’elles sont identiques, il y a consensus modal. L’équilibre consensuel ou conflictuel peut être modifié par des conversions, par lesquelles les sujets changent de croyance modale.
Une idéologie est une structure hiérarchisée de modalisations, essentiellement déontiques, onto-véridictoires et thymiques, propre à une société ou à un groupe social. On peut appeler « idioidéologie » l’idéologie d’un individu.
Un système de valeurs est une structure hiérarchisée de modalisations thymiques.
L’argumentation est un processus visant à faire admettre la valeur d’une proposition logique, c’est-à-dire un couple fait d’un sujet (ce dont on parle: par exemple, Madame Bovary) et d’un prédicat (ce qu’on en dit: par exemple, ce personnage s’ennuie); la proposition peut être, notamment, une modalisation (le prédicat est alors une modalité) ou un ensemble de modalisations. L’argumentaire est l’ensemble des arguments validant ou invalidant une proposition logique. Sur l’argumentation, voir Hébert, 2014.
4. Disposition
La disposition est le placement des unités (signifiants, signifiés, etc.) dans un substrat temporel (par exemple, la place respective des mots d’un roman ou des séquences d’un film) ou spatial (par exemple, la disposition des accessoires sur une scène).
Dans la mesure où le rythme naît par la présence d’au moins deux unités (mais ce peut être la même unité répétée) disposées dans au moins deux positions successives, toute étude rythmique présuppose une étude dispositionnelle (voir Rythme). Mais toute analyse dispositionnelle n’intègre pas nécessairement une analyse rythmique (même si elle peut difficilement en faire l’économie et n’a pas intérêt à le faire). Voir le chapitre sur le rythme dans L’analyse des textes littéraires: vingt approches (http://www.signosemio.com/documents/approches-analyse-litteraire.pdf).
La disposition est établie ou modifiée par les grandes opérations de transformation (voir Opération). L’adjonction, la suppression et la substitution modifient l’inventaire des unités; le placement établit la position des unités; le déplacement (dont la permutation est l’une des formes) la modifie; etc.
En suivant la terminologie de Rastier, la disposition des signifiants (par exemple, la forme des mots) peut être appelée distribution et celle des signifiés (par exemple le contenu d’un mot), tactique. Distribution et tactique ne correspondent pas exactement, puisque, par exemple, il existe des unités du signifié discontinues (par exemple, les isotopies) relativement aux signifiants qui les manifestent et que dans un même signifiant peuvent se « superposer » deux signifiés et plus (par exemple, un signifié littéral et un autre figuré), etc.). Sur la disposition, voir Hébert, 2012.
5. Écart, norme
La littérature a été souvent définie comme un écart par rapport à une norme, cette norme pouvant varier d’une théorie à une autre (le texte scientifique, le degré zéro de l’expression, etc.). On a pu considérer le texte littéraire comme contenant des écarts, plus d’écarts que les textes non littéraires; et la poésie comme contenant plus d’écarts (et/ou des écarts différents) que les textes littéraires non poétiques. On a dit des textes littéraires des grands écrivains qu’ils violent les normes, sont au-delà des normes et/ou fondent leurs propres normes. La figure de style (par exemple, la métaphore) a été définie également comme un écart. De même que le style. Voir Style. D’autres notions littéraires sont plutôt envisagées comme des normes: la langue (les règles grammaticales, syntaxiques, morphologiques, etc.), les genres, les clichés narratifs (par exemple, l’arroseur arrosé) ou thématiques (par exemple, la femme fatale), etc.; ce qui n’empêche pas que ces normes – heureusement pour le bien de la littérature – puissent être non respectées (le théâtre de Michel Tremblay a enfreint la norme du théâtre québécois de son époque en introduisant le langage populaire appelé « joual »). Nos remarques peuvent s’appliquer, avec d’éventuels ajustements, à d’autres arts.
Les notions d’écart et de normes peuvent évidemment servir à décrire des phénomènes non nécessairement littéraires ou artistiques: par exemple, le comique est toujours produit par un écart (glisser sur une pelure de banane n’est pas « normal »); la déviance psychologique est, comme le mot l’indique, un écart.
Une norme peut être considérée comme une unité affectée d’une modalité déontique (c’est-à-dire relative au devoir-avoir, devoir-être et/ou devoir-faire). D’un point de vue logique, l’unité prend la valeur d’un sujet (ce dont on parle) et la modalité, d’un prédicat (ce qu’on en dit). On peut distinguer entre modalités déontiques attributives (modalisant par avoir ou par être) – par exemple, une maison doit avoir une porte – et modalités déontiques actionnelles (modalisant par faire) – par exemple, une guitare doit produire de la musique. Cependant, en définitive, une modalité déontique actionnelle se laisse analyser en modalité déontique attributive.
Les modalités déontiques prennent quatre formes principales (nous les illustrons avec devoir et avoir, mais les même principes valent pour devoir et faire ainsi que devoir et être): (1) prescription (devoir avoir); (2) interdiction ou proscription (devoir ne pas avoir); (3) permissivité (ne pas devoir ne pas avoir); et (4) facultativité (ne pas devoir avoir). Les deux premières modalités peuvent être regroupées sous l’étiquette « obligation » et les deux dernière, sous l’étiquette « option ». La liberté, au sens restreint (0), s’applique pour ce qui n’est affecté d’aucune des modalités – et qui est donc, à cet égard, indécidé ou indéterminé –; au sens large (0 + 3 + 4), elle inclut aussi les options. Évidemment, un élément donné peut passer d’une modalité à une autre, par exemple de 1 vers 4, de 0 vers 1, etc. Par exemple, le romantisme poétique prescrivait le lyrisme (modalité 1); en réaction le mouvement du Parnasse l’a proscrit (modalité 2). Comment considérer les éléments qui, sans être obligatoires, sont néanmoins possibles et fréquents (par exemple, un conte n’a pas à mettre en scène un dragon, mais il n’est pas rare d’en voir)? Nous dirons que les modalités peuvent être vues comme catégorielles (sans gradation possible) ou comme graduelles. Les éléments non obligatoires mais possibles et fréquents tombent sous le coup d’une prescription graduelle; cela revient à dire qu’ils tombent en même temps sous le coup d’une facultativité graduelle, puisque interdiction et facultativité sont, lorsque graduels, en corrélation inverse (si l’un augmente l’autre diminue, etc.).
Le mot « norme » convoque, fût-ce implicitement, celui d’« écart ». La norme ne prend sa valeur que relativement aux écarts attestés, probables voire simplement possibles; l’écart ne prend évidemment sa valeur que relativement à la norme qu’il met à l’épreuve. La perspective est relative: ce qui est une norme relativement à un écart est aussi un écart relativement à cet écart, etc. Il existe aussi des écarts de l’écart, qui sont donc des retours à la norme. Le contenu d’une norme ou d’un écart n’ont rien de substantiel et un même phénomène peut être à la fois norme et écart, en succession dans le temps ou dans un même temps. Par exemple, la versification de la poésie, norme jusqu’au XIXe siècle français, est un écart, par rapport à la norme actuelle, où la poésie est non versifiée (du moins la poésie « savante »). La versification était un écart par rapport à la langue standard, non versifiée, mais, en même temps, elle était la norme en poésie.
Le mot « norme » peut désigner deux choses: soit la « règle » et/ou le modèle abstrait, le type, qu’elle fonde; soit l’unité qui respecte cette règle et la réalise comme occurrence. Par exemple, « Le chat mange la souris. » est un énoncé qui, notamment, respecte les normes du français et les normes du vraisemblable. Cet énoncé, cette occurrence réalise donc ces deux normes. Le mot « écart » est, quant à lui, généralement employé uniquement pour désigner l’unité occurrence qui contrevient à la norme abstraite (la règle et/ou le type qu’elle fonde). Par exemple, « La souris mange le chat » est un écart par rapport à la norme du vraisemblable. Cependant, en plus d’avoir cet emploi, le mot peut désigner le processus d’écart et également la différence, la distance entre la norme et l’unité qui ne la respecte pas (par exemple, en statistiques).
Une norme est toujours définie par une instance, collective ou individuelle. Pour un même phénomène, elle peut varier en fonction des facteurs de variabilité habituels: temps, espace, sujet observateur, culture, etc. Une loi, par exemple une loi naturelle (comme la gravité), est, en principe, immuable et non définie par une instance (à moins d’invoquer Dieu, la Nature, etc.). Les sciences de la nature reposent sur des lois; les sciences de la culture (dont les études littéraires), sur des normes.
Posons qu’une norme est toujours définie dans un système. Nous avons dégagé ailleurs quatre grands systèmes qui interagissent dans un texte littéraire (voir Style). Par exemple, la langue (ou dialecte) est un tel système, mais également les sociolectes (qui définissent les discours, les genres, etc.) et les idiolectes (qui définissent le style d’un écrivain, etc.). Par exemple, Le sonnet du trou du cul de Rimbaud et Verlaine est un écart par rapport au genre sonnet, au sonnet modèle donc, qui suppose un sujet si ce n’est noble du moins non vulgaire.
Norme et écart sont associés: à des prévisions, qui se réaliseront ou non; à des attentes, qui seront comblées ou non; à des euphories (satisfaction), dysphories (insatisfaction), aphories (indifférence), etc. Selon le cas, ce qui est attendu, c’est la norme (par exemple, dans une lettre administrative) ou l’écart (par exemple, dans un texte littéraire). Selon le cas, c’est la norme ou l’écart qui est souhaité et donc procure euphorie.
La norme indique, du côté de la production, d’un point de vue prescriptif (au sens large, en incluant toutes les modalités déontique), qu’on en soit conscient ou non, la forme que devrait prendre le produit ou une de ses parties. Du côté de la réception, elle peut être utilisée, d’un point de vue évaluatif, pour évaluer ce qui a été produit. Enfin, du côté de l’immanence du produit, du produit en lui-même, d’un point de vue descriptif, la norme correspond à ce qui a été effectué avec (la plus grande) régularité; on rejoint ici la norme statistique.
6. Espace
L’espace est le substrat dans lequel se déploient les phénomènes bi ou tridimensionnels et l’effet de ce déploiement. De même que le temps est associé à la fois à une position et à une durée (définie par la différence entre deux positions), l’espace correspond à la fois à une position (définie dans deux ou trois dimensions) et à une étendue (aire ou volume). L’étendue spatiale se mesure en deux (surface) ou trois dimensions (volume), de même la position spatiale se donne en fonction de deux ou de trois dimensions. Mais il est également, en cela il n’est plus comparable au temps, une forme. Contrairement au temps (qui va du présent vers le futur), l’espace, l’espace ne possède pas a priori une orientation. L’espace est aussi l’organisation particulière d’un lieu naturel ou construit quelconque; on peut aussi parler d’organisation spatial.
De même que la position temporelle est rapportée à un état donné d’une culture donnée (telle pièce écrite au XIXe reflète plus ou moins, fut-ce par la négative ou par l’omission significative, la culture de son époque), l’espace est rapporté à une culture donnée (telle pièce écrite en France plutôt que partout ailleurs et reflétant plus ou moins la culture française).
De même qu’on peut distinguer cinq temps principaux en interaction dans une production textuelle (ou autre: film, etc.), on peut y distinguer cinq principales sortes d’espaces: (1) espace de la production (associé à l’auteur et à l’écriture: lieux où il écrit, lieux qui l’« habitent », qui l’ont habité); (2) espace thématisé dans la production: (2.1) espace montré ou représenté, (2.2) espace évoqué (par exemple un personnage en prison (espace représenté) rêve à la plage (espace évoqué)); (3) espace de la réception (lieux où se trouve le récepteur au moment de la réception, lieux qui l’habitent, qui l’ont habité). Voir Temps. Pour une pièce de théâtre, l’espace de la production est double: celui de l’écriture et celui de l’élaboration de la mise en scène. On peut également considérer comme espaces, susceptibles de structurations et de dispositions variées: la page et/ou la double page (la page de gauche avec celle de droite) du texte écrit; la surface d’un tableau, etc. Voir Disposition. De même que les relations temporelles incluent la succession et la simultanéité (ou concomitance), les relations spatiales incluent, notamment, la contiguïté et la superposition (spatiale). Voir Temps.
Dans l’analyse des espaces, on notera notamment: le nombre d’espaces (espace dyadique, triadique, etc.); l’étendue des espaces, leur « ameublement » (personnes, objets qui s’y tiennent, processus qui s’y déroulent, etc.); la distance entre espaces; les espaces littéraux et métaphoriques (le salon bourgeois symbolisant l’enfer dans Huis clos de Sartre); les déplacements d’un espace à un autre et au sein d’un espace; l’ouverture (place publique, etc.), fermeture (labyrinthe, prison, etc.) des espace; leur accessibilité, inaccessibilité (lieu utopique); évidemment, leur caractère positif, neutre, négatif; l’indice de mobilité des personnages (nombre de déplacements); la nature iconique (espace représenté de manière réaliste), stylisé, symbolique des espaces; la nature réelle (par exemple, la vraie tour Eiffel), réaliste (par exemple, la tour Eiffel dans un roman réaliste) ou fictive (par exemple, l’Eldorado, l’Olympe). Sur l’espace, voir Hébert 2013.
7. Fond, forme
Traditionnellement, on considère que le fond est ce dont on parle (les thèmes ou, plus généralement, les contenus ou signifiés,) et la forme, comment on en parle. Le fond peut être subdivisé en sujet – ce dont on parle proprement dit – et prédicat – ce qu’on en dit.
Dans la forme, on place la versification, les genres, les styles, les procédés rhétoriques, les tons, les niveaux ou registres de langue, les champs lexicaux, les figures de style (voir Style), la structure des phrases, les temps et modes verbaux, la ponctuation, la structure du texte, la voix et le point de vue de narration, etc. (Lafortune et Morin, 1996: X) On a pu dire que le style est la forme du texte (Bénac et Réauté, 1993). Voir Style.
En réalité, cette distinction, en apparence claire, ne cesse pas d’être problématique. L’opposition fond / forme ne recouvre pas celle de signifié (contenu) / signifiant (véhicule du contenu). Voir Signe. En effet, si le fond correspond grosso modo au signifié (même si des signifiés ne sont pas nécessairement des thèmes: par exemple, les signifiés grammaticaux) et que certains éléments de forme ressortissent du signifiant (par exemple, plusieurs aspects de la versification), d’autres éléments de la forme font intervenir des éléments du signifié (par exemple, les tons: comique, sérieux, etc.) voire sont composés uniquement de signifiés.
Par ailleurs, il est sans doute possible de distinguer un fond et une forme des signifiants et un fond et une forme des signifiés (sur le modèle de Hjelmslev, qui parlait de substance et de forme). Le fond est alors la partie invariante et la forme, la mise en forme et l’une des manifestations possibles de cette partie.
Par exemple, pour ce qui est des signifiés, le signifié général ‘mourir’ (fond) peut être manifesté par les signifiés particuliers ‘mourir’ (forme), ‘décéder’ (forme), ‘manger les pissenlits par la racine’ (forme), etc. Par exemple, pour ce qui est des signifiants, une rime en -oir (fond), peut être manifestée par les signifiants gloire / espoir (forme), gloire / devoir (forme), etc. Autre exemple pour les signifiants, si on prend comme fond des signifiants les phonèmes, alors l’agencement spécifique de ces phonèmes, dans un poème, par exemple, est la forme de ce fond.
Fond et forme sont traditionnellement réputés indépendants (théorie fond/forme). Cette conception entretient des relations affines avec les théories essentialistes (notamment l’idéalisme platonicien): il y a quelque chose qui est manifesté par une forme. Elle entretient également des relations étroites avec la théorie ornementaliste, qui veut qu’une œuvre d’art soit un (bon) contenu agrémenté d’une forme attrayante (par exemple, des figures de rhétorique).
Dans les approches modernes (théorie fond-forme) d’inspiration non essentialiste, on considère plutôt qu’un changement au fond implique un changement à la forme et vice-versa (« mourir » n'a pas exactement le même sens que « décéder »). Autrement dit, comme le postule Saussure pour le signifiant et le signifié, fond et forme sont unis par une relation de présupposition réciproque: si on change l’un, on change l’autre. C’est ce que semble indiquer Flaubert: «La forme ne peut se produire sans l'idée et l'idée sans la forme».
Le formalisme désigne une théorie (par exemple, le formalisme russe, la sémiotique, la narratologie) qui met l’accent sur le texte en lui-même et sur les phénomènes proprement littéraires, plutôt que sur l’auteur, le lecteur et autres éléments contextuels ou « extérieurs » (dimension sociologique, etc.). Dans un sens plus large, le mot désigne également, en littérature et plus généralement dans les arts, la posture de production (par exemple, la rédaction d’un texte littéraire) qui met l’accent sur la forme plutôt que sur le contenu. La posture qui met l’accent sur le contenu peut être appelée « substantialisme » (dans un sens différent de celui qu’accordait Hjelmslev à « substance ») ou « contenuisme » (Dirkx, 2000: 72).
Les œuvres, mouvements, poétiques, théories, genres, auteurs, etc., peuvent être classés en formalistes / substantialistes selon l'intérêt qu'ils portent à la forme ou au fond. De manière générale, le substantialisme est valorisé au détriment du formalisme, ainsi que les tons qui leur sont souvent respectivement associés, le sérieux (profond) et le ludique (léger). Hugo est un substantialiste lorsqu’il affirme: « La poésie n’est pas dans la forme des idées, elle est dans les idées elles-mêmes. » Par contre, certaines esthétiques font l’inverse: celle d’Oulipo, par exemple, et, de manière générale, les esthétiques modernistes.
L’opposition fond/forme est homologue, analogue à une série d’oppositions traditionnelles dans notre culture: âme / corps, être / paraître, intelligible / perceptible, etc. Ajoutons qu’elle est homologue à invariant / variable, général / particulier, type (modèle) / occurrence (manifestation du modèle), etc.
8. Genèse, variante, mise en livre
La génétique textuelle est l’étude des brouillons (et épreuves, annotées ou non), conçus comme des avant-textes. Elle permet de rendre compte des modalités, causes et effets des opérations de transformations (ratures, ajouts, etc.) intervenues d’un avant-texte à un autre et d’un ou de tous les avant-textes au texte « final ». Nous dirons qu’elle peut également rendre compte de ces mêmes opérations intervenant d’une version d’un texte « final » à une autre (par exemple, les deux éditions anthumes, c’est-à-dire non posthumes, des Fleurs du mal).
Un avant-texte introduit en principe des variantes par rapport à un autre avant-texte du même texte, s’il y en a un autre, et par rapport au texte final. Aux modifications opérées par l’auteur s’ajoutent celles, volontaires ou non, des instances éditoriales (coquilles, censure, etc.). Les instances éditoriale (éditeur, directeur de collection, typographe, etc.) font également, avec ou sans consultation avec l’auteur, des choix qui influent sur la production même si ces choix ne constituent pas toujours à proprement parler des modifications du texte: choix du format du livre, de la police, des couvertures, du tirage, de la distribution, de la promotion, etc. Lorsqu’il y a plusieurs éditions différentes, on peut comparer les variantes textuelles et livresques (médiatiques).
La genèse, la traduction, l’adaptation, les réécritures internes (par exemple, les trois aventures principales des Trois petits cochons), etc., sont des opérations comparables qu’on peut englober sous l’appellation générale, selon le cas, de transposition (s’il y a passage d’un système à un autre: traduction, adaptation, réécritures internes en différents styles, etc.) ou de diaposition (s’il n’y a pas ce passage: les réécriture interne des Trois petits cochons) (voir Transtextualité); elles exploitent notamment les grandes opérations de transformation (voir Opération).
La genèse et la génération constituent les deux grandes perspectives de la production (voir Noyau génératif).
9. Genre
Tout produit sémiotique (texte, image, etc.) relève, fût-ce seulement par la négative, d’un ou de plusieurs genres. Un genre textuel peut être défini sous différents angles, notamment soit en tant que programme de normes, soit en tant que type associé à ce programme, soit en tant que classe de textes qui relèvent de ce type. Un genre est un programme de prescriptions (éléments qui doivent être présents), d’interdictions (éléments qui doivent être absents) et autres modalités déontiques (facultativités, permissivités, optionnalités, etc.). qui règlent la production et l’interprétation (la réception) des textes. Le genre, avec le corpus, le contexte externe, etc., fait partie des unités globales déterminant les unités locales, par exemple un produit sémiotique donné..
Prescriptions et interdictions s’appliquent, selon le cas, aux signifiants (un sonnet doit comporter des rimes de tel type) ou aux signifiés (un sonnet ne peut pas, en principe, être vulgaire, d’où l’effet parodique du « Sonnet du trou du cul » de Rimbaud et Verlaine) ; un conte de fée peut comporter ou non un ogre). Le programme que constitue le genre définit un texte type ou modèle (par exemple, le sonnet) auquel correspondent plus ou moins les textes occurrences qui en relèvent (tels sonnets) ; le genre définit ainsi une classe de textes occurrences.
Un genre entretient des relations « horizontales » avec les genres avec lesquels il est interdéfini au sein d’un champ générique (par exemple, la tragédie et la comédie de l’époque classique). Il entretient également des relations « verticales » avec les genres qui l’englobent (le roman policier est englobé dans le roman) ou qu’il englobe (les différents sous-genres ou formes du roman policier). Tout texte relève d’un ou de plusieurs genres de même niveau et de plusieurs genres de niveaux différents (niveaux supérieurs et/ou inférieurs).
Les genres peuvent être appréhendés dans l’une ou l’autre des trois perspectives suivantes: (1) le producteur et la production (de quel genre relève cette production selon le producteur?) ; (2) le produit (de quel genre relève cette production selon les marques génériques qu’elle contient?) ; (3) le récepteur et la réception (de quel genre de texte relève cette production selon celui qui la reçoit, la lit, l’interprète?). Dans certains cas, les perspectives ne correspondront pas. Par exemple, Maupassant (production) appelle certains de ses textes « contes », alors que les lecteurs actuels (réception) considèrent qu’il s’agit plutôt de « nouvelles ».
À un courant (le réalisme), un mouvement (le nouveau roman), une école (le romantisme), une période (le Moyen âge) correspondent des genres plus ou moins spécifiques. Comme n’importe quelle autre forme sémiotique, les genres apparaissent dans la transformation de formes antérieures ou contemporaines, se transforment et disparaissent en donnant ou non naissance à de « nouvelles » formes.
10. Histoire, récit, narration, action
L'histoire, dans un texte littéraire selon la perspective de la narratologie, est l'enchaînement logique et chronologique des actions et états thématisés (c’est-à-dire véhiculés par le contenu du texte). Le récit est la façon particulière de présenter les actions et états d’une histoire. Une même histoire peut être racontée de différentes manières (par exemple, en suivant l’ordre chronologique ou non).
Le narrateur est l’instance thématisée (intégrée dans les contenus du texte) qui produit le récit et le narrataire, l’instance thématisée à laquelle le récit est fait. Narrateur et narrataire sont les pendants dans le texte des instances empiriques et extratextuelles que sont l’auteur et le lecteur réels; ils sont également les pendants de l’auteur construit et du lecteur construits, soit l’image que donne le texte, respectivement, de son auteur et de son lecteur.
Une histoire implique des actions, une action pouvant être considérée comme le passage d’un état à un autre qui lui est opposé (par exemple, celui qui est pauvre peut devenir riche). Ces transformations impliquent des personnages (plus exactement des acteurs, voir Personnage) qui produisent, volontairement ou non, les actions et/ou en reçoivent les effets. Les actions peuvent être subdivisées en trois grandes catégories: les actions proprement dites, les paroles (et autres produits sémiotiques assimilables: les images, etc.) et les pensées verbales.
Un récit est fait, schématiquement, d’une part, de descriptions d’actions et d’acteurs (personnages, objets, concepts, pensées non verbales, etc.) et, d’autre part, de logues de paroles (monologues, dialogues, etc.) ou de pensées (monologue intérieur). Les logues peuvent eux-mêmes enchâsser des descriptions et logues (et ainsi de suite).
Prologue et épilogue sont des séquences narratives facultatives qui encadrent le récit principal. Le prologue est une séquence narrative qui précède le récit principal et lui sert d’ouverture; l’épilogue est une séquence narrative qui suit le récit principal et lui sert de conclusion.
L’intrigue est le fil logique qui unit les différents états et actions de l’histoire. L’exposition est la ou les parties du récit qui présentent et mettent en place les principaux éléments de l’histoire. Le nœud est la « Péripétie ou suite de péripéties qui, dans une pièce de théâtre, un roman, amènent l’action à son point culminant, si bien que la situation ne pourra être éclaircie que par la catastrophe finale, ou par l’accomplissement d’actions nécessaires qui constitueront le dénouement. » (Bénac et Réauté, 1993: 160) Le dénouement est la partie du récit vers lequel les actions et états de l’histoire convergent et offrent leurs pleines conséquences.
La courbe dramatique représente la fluctuation de l’intensité dramatique en fonction de l’écoulement du temps (par exemple, généralement l’intensité dramatique atteint son sommet dans le nœud et/ou le dénouement).
11. Langue
Considérons que la langue est faite des composantes suivantes: morphologie et lexique, sémantique, grammaire et syntaxe. La morphologie est la forme des unités lexicales: morphèmes (par exemple, les racines des verbes), mots, expressions, phraséologies (par exemple, les proverbes et autres phrases toutes faites). Le lexique est l’inventaire même des unités lexicales. La sémantique est le sens, en contexte et s’il y a lieu hors contexte (en langue), des unités lexicales, des syntagmes, des propositions, des énoncés, du texte. La grammaire est l’ensemble des règles de transformation morphologique des unités en contexte. La syntaxe est l’ensemble des règles de combinaison et de distribution des unités (considérons que la ponctuation en fait partie), eu égard à leur nature (par exemple, substantif, verbe) et fonction (par exemple, sujet, complément).
Donnons quelques exemples seulement d’éléments linguistiques auxquels on peut s’intéresser. On peut étudier: les catégories lexicologiques (synonymie, parasynonymie, homonymie, polysémie, hyponymie/hyperonymie (par exemple: chien/mammifère), holonymie/méréonymie (par exemple, corps/tête), etc.); les niveaux ou registres de langue (vulgaire, populaire, littéraire, etc.); les types de vocabulaire (langue générale, langues de spécialité, etc.); les champs lexicaux et sémantiques, les isotopies (voir Signe); les dénotations et connotations (voir Connotation, dénotation); les sens littéraux et figurés; les ruptures syntaxiques; les inversions; les élargissements ou restrictions de sens; etc.
En tant que les composantes de la langue sont définies par des normes, on peut étudier, dans un texte donné, le respect ou non-respect de ces normes (voir Style).
12. Mode mimétique
Un mode mimétique est un mode d'organisation qui détermine le régime d'impression référentielle du texte (Rastier) et, plus généralement, d’un produit sémiotique. L’impression référentielle – terme moins connoté que celui d’illusion référentielle que l’on utilise souvent – peut être définie comme l’effet de réel de ce produit.
Plus concrètement, le mode mimétique peut être appréhendé dans le type de relation entre le monde construit par le produit et le monde réel. Parmi les modes mimétiques, on peut distinguer (avec certains recoupements): le réalisme empirique (dans le réalisme, par exemple), le réalisme transcendant (par exemple, dans le romantisme, le symbolisme, le surréalisme), l’idéalisme, le merveilleux, le fantastique, l’étrange, la science-fiction, l’absurde, l’allégorisme, le symbolisme, le mythique, le légendaire, l’historique, le biographique, le fantasy, etc.
13. Noyau génératif
La génération est, avec la genèse, l’une des deux perspectives possibles pour envisager la production. La génération consiste dans le passage d’un type (ou modèle) à une occurrence (manifestation du modèle) ou encore dans celui d’un noyau génératif à la manifestation. Dans les deux cas intervient le passage d’une unité virtuelle à la « même » unité mais réalisée. Ce passage se produit grâce à des opérations de transformation (adjonctions, suppressions, substitutions, conservations, etc.).
L’analyse générique, dans la mesure où elle conçoit l’occurrence (par exemple un texte donné) comme le résultat d’opérations de transformations effectuées à partir du type (par exemple, le roman), est une approche générative. À l’opposé, la génétique textuelle, qui notamment rend compte du passage des avants-textes (brouillons et épreuves) au texte, est évidemment une approche génétique.
D’autres approches sont encore plus nettement génératives. Van Dijk considère que le contenu d’un texte peut être résumé dans une macroproposition qui génère l’ensemble du contenu de ce texte; c’est ainsi que « Je t’aime » serait la macroproposition de tel sonnet de Louise Labé. On voit la critique principale que l’on peut faire de ces approches et donc de l’aspect, le noyau génératif: ce noyau est très général et de ce fait peut tout aussi bien convenir pour un grand nombre de productions sémiotiques; leur pouvoir caractérisant, du moins celui associé au noyau le plus profond, est alors faible. Selon Spitzer, toutes les parties de l’œuvre (du moins les principales parties) sont isomorphes (elles ont la même structure) entre elles et le tout est isomorphe aux parties; en ce sens, chaque partie est une microreprésentation, c’est-à-dire qu’elle constitue une réplication, en plus petit, du tout. Les parties sont ici des grands aspects du texte (style, composition, intrigue, thèmes, etc.). L’élément qui explique la structure est l’étymon spirituel (ou la racine mentale): étymon parce que, comme la racine étymologique d’un mot, il est originel; spirituel parce qu’il est caractéristique de l’esprit de l’auteur. Cet étymon est, pour Spitzer une vision du monde. Voir Vision du monde. Mais, comme nous l’avons vu, on peut considérer qu’il existe des noyaux génératifs qui ne soient pas des visions du monde. On peut également considérer qu’une œuvre peut posséder plusieurs noyaux génératifs. De Saussure à Jakobson, la théorie du mot clé est un autre exemple de théorie générative. En vertu de cette théorie, un texte donné est généré par les diverses formes que prennent les graphèmes (lettres) et/ou phonèmes d’un mot donné ou d’un groupe de ces unités; dans sa version forte, cette théorie veut que tout texte ait son mot clé.
14. Onomastique
L’onomastique est l’étude des noms propres (dorénavant « Np »). L’onomastique d’un texte est l’inventaire des Nps qui s’y trouvent (voire éventuellement ceux d’autres textes, s’il y a des évocations de ces Nps d’autres textes) et la structure de significations qu’ils fondent. L’onomastique littéraire s’intéresse à la nature (et donc notamment aux espèces de Nps), aux fonctions, aux modalités, causes et effets de la présence des Nps dans une œuvre littéraire donnée ou un groupe de ces œuvres ou dans un ou plusieurs genres littéraires.
Les natures – l’être des phénomènes – et les fonctions – le faire des phénomènes – peuvent être envisagées notamment sous deux angles: méréologique (avec des touts et des parties) et classificatoire (avec des classes et des éléments classés). Ainsi, on peut dresser l’inventaire des traits de définition du phénomène (qui sont autant de parties qui le composent). Par exemple, on a cherché à définir le Np d’un point de vue: morphologique (il porte souvent la majuscule, etc.); syntaxique (il est souvent sans déterminant, etc.); sémantique (selon la théorie considérée: il n’aurait pas de sens (asémanticité), il n’aurait que peu de sens ou seulement une sorte de sens (hyposémanticité), il serait le signe linguistique avec le plus de sens (hypersémanticité); etc. On peut également faire une typologie, c’est-à-dire une classification des diverses formes possibles d’un même phénomène. Ainsi les anthroponymes sont les noms et prénoms de personnes; on peut leur adjoindre les Nps d’animaux (Fido, Prince, etc.) voire d’objets singuliers (par exemple, les noms d’épées, comme Excalibur). Les toponymes sont les noms de lieux naturels ou artificiels (Montréal, le lac Noir, Le Louvre, etc.). Les chrononymes sont les noms de périodes historiques (le Moyen âge, la Renaissance). Les réonymes sont des noms d’objets ou d’institutions (par exemple, les marques de commerce: Viagra, ou les noms de compagnies: Ford). Dans la mesure où l’on considère que les titres d’œuvres sont des noms propres, la titrologie est une branche de l’onomastique littéraire. De plus, natures et fonctions peuvent être envisagées statiquement ou dynamiquement, c’est-à-dire dans leurs éventuelles transformations (apparition, maintien ou transformation, disparition, etc.) dans le temps historique (d’une période à une autre), dans le temps de l’histoire racontée ou dans la succession des unités du produit sémiotique (par exemple, la succession des mots, des chapitres d’un texte).
Les noms propres forment, avec d’autres types d’unités linguistiques (noms communs, pronoms, descriptions définies), l’étiquette d’un acteur (un acteur est une entité, en incluant les personnages mais en ne s’y limitant pas, dotée d’un rôle dans un texte; voir Personnage, actant, acteur, agoniste). Sur l’onomastique, voir Hébert, 2013.
15. Personnage, actant, acteur, agoniste
Au sens le plus large, un personnage est une entité anthropomorphe impliquée (ou susceptible de l’être) en tant qu’agent (ou sujet) dans l’action thématisée (c’est-à-dire « racontée » dans les signifiés) et fictive d’un produit sémiotique (un texte, une image, etc.). Par exemple, en vertu de cette définition, dans un roman, une pomme qui tombe par gravité sur la tête de quelqu’un est l’agent d’une action, celle de tomber sur la tête du malheureux justement, mais elle n’est pas anthropomorphe, notamment en ce qu’elle n’a ni conscience ni volonté, et n’est donc pas un personnage; également ne sera pas considéré comme un personnage le politicien réel dont on rapporte, fort mal selon lui, les propos dans un quotidien. Mais seront des personnages, par exemple, l’épée magique dotée de conscience et donc de volonté dans un conte, François, le chat qui obsède les deux protagonistes dans Thérèse Raquin (Zola), HAL 9000 (alias Carl), l’ordinateur contrôlant de 2001, l’odyssée de l’espace.
La sémiotique préfère à la notion de personnage, plutôt intuitive et problématique, les notions d’acteur et d’actant. Au sens large, un actant est une entité qui joue un rôle dans un processus (une action) et/ou une attribution (l’affectation d’une caractéristique à quelque chose). Un acteur est une entité qui remplit au moins deux rôles (ce peut être le même rôle pour deux processus ou attributions ou plus) dans un produit sémiotique donné (par exemple, tel texte). Par exemple, celui qui se lave est un acteur puisqu’à la fois agent de l’action et patient de cette action. Les acteurs ne se limitent donc pas aux personnages, même largement définis. Ainsi, l’indice boursier Dow Jones sera un acteur dans un texte financier.
Les rôles possibles peuvent varier d’une théorie à une autre. Le modèle actantiel de Greimas en prévoit six: sujet, objet (l’action que le sujet veut accomplir), destinateur (ce qui demande que l’action soit posée), destinataire (ce pour qui, pour quoi l’action est faite), adjuvant (ce qui aide le sujet dans son action), opposant (ce qui nuit au sujet dans son action). La sémantique interprétative de Rastier prévoit, sans exclusive, une quinzaine de rôles: (1) rôles processuels: accusatif (élément affecté par l'action) ; datif (élément qui reçoit une transmission) ; ergatif (élément qui fait l'action) ; final (but recherché) ; instrumental (moyen employé) ; résultatif (résultat) ; (2) rôles attributifs: assomptif (point de vue) ; attributif (caractéristique) ; bénéfactif (élément bénéfique) ; classitif (classe d’éléments) ; comparatif (comparaison métaphorique) ; locatif spatial (lieu) ; locatif temporel (temps) ; maléfactif (élément néfaste) ; holitif (tout décomposé en parties) ; typitif (type auquel se rapporte une occurrence).
Au point de vue de l'ontologie naïve (qui définit les sortes d'êtres, au sens large), un acteur peut correspondre à: (1) un être anthropomorphe (par exemple, un humain, un animal ordinaire ou magique, une épée qui parle, etc.) ; (2) un élément inanimé concret, incluant les choses (par exemple, une épée ordinaire), mais ne s’y limitant pas (par exemple, le vent, la distance à parcourir) ; (3) un concept (le courage, l’espoir, la liberté, etc.). Par ailleurs, il peut être individuel ou collectif (par exemple, la société).
Dans l’analyse d’un acteur simulacre d’un être humain (personnage), on peut distinguer les aspects suivants: 1) aspect physique (apparence, taille, poids, etc.) et physiologique (âge; tempérament[2] sanguin, nerveux, musculaire, etc.; etc.); (2) aspect psychologique (caractère, désirs et aversions, aspirations, émotions, attitudes, pulsions, etc.), intellectuel (intelligence, connaissances, culture, etc.) et idéologique (croyances, valeurs, moralité, etc.) ; (3) aspect relationnel et social (histoire personnelle, noms et prénoms, classes sociales (politiques, économiques, professionnelles, etc.), état civil, famille, conjoint, amis, ennemis, relations professionnelles, etc.); (4) pensées, paroles (et autres produits sémiotiques: dessins, etc.) et actions. Chacun de ces aspects peut être déployé en sous-aspects. Par exemple, l’aspect physique comprendra l’apparence extérieure du visage, du corps, etc.
Un agoniste, dans la théorie de Rastier, est un acteur de niveau hiérarchiquement supérieur qui subsume, englobe au moins deux acteurs ayant des rôles identiques ou similaires. Par exemple, dans la série des Tintin d’Hergé, Dupont et Dupond forment de manière générale un tel agoniste. Les acteurs englobés dans un agonistes peuvent relever de la même classe ontologique (par exemple, deux humains comme les Dupont-Dupond) ou encore relever de classes ontologiques différentes (un humain et un animal, un humain et un objet, un animal et un objet, etc.). Charles Grandet est associé, par le narrateur balzacien, à un élégant coffret dans Eugénie Grandet; Julien Sorel, dans Le rouge et le noir, s’identifie lui-même à l’aigle napoléonien.
16. Psychologie
La psychologie étudie les contenus et processus mentaux et les actions (gestes, paroles, etc.) qui en découlent en sont les indices et les affectent en retour. L’aspect psychologique est relatif à l’auteur et au lecteur ainsi qu’aux acteurs du texte qui sont dotés d’un esprit, d’une psychée complexe (humains, animaux supérieurs, êtres anthropomorphisés).
L’analyse peut porter sur les éléments psychologiques ou psychanalytiques associés à un texte: fantasmes, pulsions, motivations, mécanismes de défense, censure, refoulement, rêves, complexes, psychoses, névroses, phobies, affects, émotions, sentiments, passions, tempéraments, moi, surmoi, ça, etc.
Ces éléments peuvent être dégagés en fonction de la triple perspective de toute production: du côté du producteur (l’auteur réel ou celui construit par le texte), du produit lui-même (par exemple, l’inconscient du texte, celui des personnages), du récepteur (le lecteur empirique, réel ou encore le lecteur construit par le texte, l’image que celui-ci projette de ce lecteur).
17. Réception, production, immanence
La réception est, au sens restreint, l’ensemble des performances sémiotiques (et leurs produits) effectuées dans la réception d’une œuvre. En relève notamment: adaptations, traductions, ventes, réimpressions, rééditions, éditions différentes, lectures, interprétations, critiques, descriptions, analyses, citations, influences qu’a l’œuvre.
Au sens large, la réception est la perspective d’analyse qui se place du côté du récepteur et de la performance sémiotique de la réception. La réception est alors le processus et la relation qui unit le récepteur (par exemple, le lecteur) au produit (par exemple, le texte) lui-même et aux produits et productions qui en découlent (par exemple, la lecture, l’analyse, la critique du texte, etc.). Les perspectives complémentaires sont: la production (du côté de l’auteur et de ses performances sémiotiques: génétique du texte, intention, message, vision du monde (voir Vision du monde)) et l’immanence (du côté de l’œuvre en elle-même). La production est le processus et la relation qui unit le producteur (l’auteur) au produit. Autrement dit, un schéma de la communication littéraire prend en compte, au minimum, trois instances et deux processus-relations (trois si on inclut la transmission du produit au récepteur). Voir l’annexe sur les différentes situations d’analyse relativement aux trois instances et deux processus.
Entre les différentes perspectives, des différentiels sont susceptibles de se loger. Par exemple, une intention (perspective de la production) de produire tel phénomène chez le récepteur peut ou non être inscrite dans l’immanence de l’œuvre et peut ou non être perçue et être effective chez le récepteur (perspective de la réception). En gros, quatre combinaisons sont possibles. Prenons l’exemple du comique (on pourrait prendre d’autres exemples, comme les sens littéral et figuré) et les instances de la production et de la réception: (1) comique du côté de la production perçu comme comique du côté de la réception; (2) comique du côté de la production perçu comme non-comique (voire triste) du côté de la réception; (3) non-comique du côté de la production perçu comme non-comique du côté de la réception; (4) non-comique du côté de la production perçu comme comique du côté de la réception. Les combinaisons 2 et 4 correspondent à des processus communicationnels ratés, mais cette écriture ratée et/ou cette lecture « erratique » (St-Gelais, 2007) peuvent être créatrices et intéressantes. Sur les différentes situations d’analyse générée par la triple perspective: producteur, produit et réception, voir Hébert, 2014 et 2012.
18. Recueil
Un recueil est une œuvre constituée par le regroupement de textes, souvent courts. Sur l’analyse d’un recueil, voir Hébert, 2013.
Ces recueils seront anthologiques (par exemple, une anthologie des meilleurs textes de la poésie française du XXe s. ou des meilleurs textes d’Hugo) ou non (Les fleurs du mal de Baudelaire). Ils regrouperont des extraits de textes longs (par exemple, les anthologies scolaires) ou au contraire des textes courts ou non mais intégraux: des nouvelles, des poèmes, des aphorismes, etc.
La succession des textes au sein du recueil se prête à une analyse de la disposition (voir Disposition) et du rythme (voir Rythme).
La coprésence de plusieurs textes au sein d’une même unité englobante a pour effet de modifier, d’infléchir, de déterminer leur sens propre. En effet, en vertu du principe général que le global détermine le local – le contexte (corpus, culture, etc.) détermine le texte; le genre détermine le texte; le texte détermine ses constituants (phrases, mots), etc.) –, un texte dans un recueil n’a pas le même sens qu’en dehors de ce recueil. Chaque texte du recueil est le contexte, plus ou moins rapproché, des autres (voir Contexte).
La relation entre recueil et texte s’inscrit dans une famille de relations entre tout et partie: contexte et texte; lexie (groupe de morphèmes, ex. « agriculteur ») et morphème (ex. « agri- »); phrase et lexie; période (groupe de phrases) et phrases; texte et période; texte et chapitre; chapitre et paragraphe; strophe et vers; etc. Voir Contexte.
En ce qui a trait à la représentativité, des textes seront plus ou moins représentatifs (ou plus ou moins non représentatifs) du recueil que d’autres textes, et cela en fonction des caractéristiques envisagées (voir Style)...
19. Relation, opération, structure
Tout phénomène peut être envisagé comme une structure. Une structure est faite de deux éléments ou plus, ou termes, unis par au moins une relation dont on fait état (cependant, une structure réflexive unit un terme à lui-même). Une structure est le point de départ et/ou d’aboutissement d’opérations. Une opération est un processus, une action par laquelle un sujet opérateur caractérise, transforme ou émane (le modèle, le type émanant une manifestation, une occurrence) un objet; que cet objet corresponde par ailleurs à une relation, un terme, une opération ou une structure.
Les opérations de caractérisation dégagent des propriétés d’un objet, par décomposition (mentale), classement, typicisation (ou catégorisation; par exemple, en reconnaissant que tel texte est un poème), comparaison, corrélation présencielle (présupposition, exclusion mutuelle, etc.) et/ou causale, etc. Les opérations de transformation produisent, détruisent ou transforment des objets. Les grandes opérations de transformation sont: l’adjonction (on ajoute un élément); la suppression (on supprime un élément); la substitution (on remplace un élément par un autre); la permutation (on modifie l’ordre relatif des éléments, comme dans une anagramme) ou plus généralement le déplacement (précédé par un placement); l’augmentation (on augmente l’intensité d’un élément); la diminution (on diminue l’intensité d’un élément); et la conservation. Dans la conservation marquée, alors qu’on s’attend à ce qu’une opération soit effectuée, l’opération ne se produit pas; selon le cas, la conservation prend la forme d’une non-adjonction, d’une non-suppression, etc.
Parmi les grandes familles de relations on trouve: (1) les relations comparatives (identité, similarité, opposition, altérité, similarité analogique (dont la comparaison métaphorique et l’homologation), etc.); (2) les relations présencielles (présupposition, exclusion mutuelle, corrélation directe, corrélation inverse, etc.); (3) les relations globales-locales: typicistes (impliquant occurrences et types), méréologiques (impliquant parties et touts), ensemblistes (impliquant éléments classés et classes d’éléments); (4) les relations temporelles (succession, superposition, superposition-succession, etc.); (5) les relations spatiales; etc. Sur les relations et les opérations, voir Hébert, 2012 et 2007.
20. Rythme
Le rythme est l’effet de la succession d’au moins deux unités (mais ce peut être la même unité répétée) disposées dans au moins deux positions différentes; le rythme est également la structure particulière produite dans cette succession organisée.
L’étude du rythme dépasse le contexte de l’étude de la versification (voir Versification). D’une part, les textes en prose (non versifiés) comportent évidemment des phénomènes rythmiques; d’autre part, les rythmes peuvent impliquer des éléments qui ne sont pas des signifiants, mais des contenus (signifiés, sèmes, isotopies, etc.) ou encore des signes (faits d’un signifiant et d’un signifiés); de plus, toute production sémiotique (film, tableau, etc.) produit des rythmes et pas seulement les textes; enfin, bien d’autres rythmes que ceux étudiés en versification informent les textes versifiés, ces rythmes négligés (mais produisant tout de même leurs effets qu’on en soit conscient ou non) sont les rythmes du contenu (signifiés, sèmes, etc.) mais également des rythmes du signifiant délaissés dans l’étude versificatoire (par exemple, les rythmes des traits constituant les phonèmes et non pas seulement des phonèmes eux-mêmes).
L’étude rythmique présuppose l’étude de la disposition des unités (voir Disposition). La disposition des unités présuppose leur segmentation; leur mise en séquence ou sériation produit le rythme. Sur l’analyse du rythme, voir Hébert, 2013 et 2012.
21. Signe, signifiant, signifié
Le signe (par exemple, le mot « bateau ») est une unité constituée d'un signifiant et d'un signifié. Le signe linguistique minimal est le morphème (« agri-cult-eur » compte trois morphèmes). Le signe maximal est le texte.
Le signifiant est la forme du signe qui permet de transmettre le contenu, le sens. Il y a quatre sortes de signifiants textuels: (1) phonémiques (phonèmes, par exemple b-a-t-o,) et, plus largement, (2) sonores (intonation, timbre, etc.); (3) graphémiques (graphèmes ou grossièrement les lettres, par exemple, b-a-t-e-a-u) et, plus largement, (4) visuels (police, taille, disposition dans la page, images iconi Dans l’analyse des signifiants, on peut notamment chercher les répétitions significatives de phonèmes (allitérations, assonances, etc.) ou de graphèmes ou de groupes de phonèmes ou de graphèmes et ce, dans le cadre d’une analyse rythmique ou non (voir Rythme).
Le signifié est le sens, le contenu véhiculé par un signifiant. Un signifié est décomposable en sèmes ou traits, parties de sens. Le signifié ‘bateau’ se décompose en sèmes /moyen de transport/ + /sur l’eau/, etc. Un sème répété forme une isotopie (par exemple, /liquide/ dans « boire de l’eau »). Un groupe de sèmes répétés forme une molécule sémique (par exemple, /sentiment/ + /positif/ dans « amour et amitié »). Les topoï (ou clichés) sont des molécules sémiques stéréotypées (voir Topos). Diverses typologies des sèmes existent: figuratif / thématique / axiologique (Greimas et Courtés), inhérent / afférent (Rastier), dénotatif / connotatif (voir Connotation, dénotation).
Les types de sèmes que l’on peut s’attendre à trouver sont: (1) les sèmes associés à des classes oppositives de grande généralité (/abstrait/ vs /concret/, /animé/ vs /inanimé/, /humain/ vs /animal/ vs /végétal/ vs /minéral/, /positif/ vs /négatif/, etc.); (2) les sèmes associés à des classes correspondant aux champs de l’activité humaine (/alimentation/, /architecture/, /marine/, etc.); (3) les sèmes associés à d’autres classes que celles déjà mentionnées (/fruit/, /ustensile/, etc.); les sèmes qui ne fondent pas des classes mais définissent des caractéristiques (par exemple, /rond/, /doux/, /célèbre/, /jaune/, etc.). Un signifié comporte toujours plusieurs sèmes. Il peut contenir les quatre sortes de sèmes, c’est le cas par exemple de ‘poire’, qui contient notamment: /concret/, /végétal/; /alimentation/; /fruit/; /jaune/.
Lorsqu’on dresse la liste des signes lexicaux (morphèmes, mots, expressions, phraséologies) qui contiennent un sème donné dans un texte donné, on dégage le champ lexical de ce sème; par exemple: « noir », « hiver », « le Grand Voyage », « mort » pourraient constituer le champ lexical du sème /mort/ dans un poème. Nous dirons que les sèmes qui, dans un texte donné, accompagnent un sème donné dans les unités lexicales où ce sème se trouve constituent le champ sémantique de ce sème. Par exemple, si le sème /mort/ est, dans un texte donné, généralement ou toujours accompagné des sèmes /obscurité/ et /négatif/, ces sèmes en constituent le champ sémantique.
Des sèmes ou des signifiés peuvent être identiques. Ils peuvent également être opposés (par exemple, les signifiés ‘nuit’ vs ‘jour’, les sèmes /nuit/ vs /jour/). L’homologation est une relation entre (aux moins) deux paires d’éléments opposés (par exemple des sèmes opposés) en vertu de laquelle on peut dire que, dans l’opposition A/B, A est (toujours ou majoritairement) à B ce que, dans l’opposition C/D, C est (toujours ou majoritairement) à D. La notation formelle d’une homologation se fait de la manière suivante: A: B:: C: D, par exemple, dans notre culture: blanc: noir:: vie: mort:: positif: négatif (le blanc est au noir ce que la vie est à la mort, etc.).
L’analyse des signifiants peut transposer la plupart des concepts que nous venons de voir pour les signifiés: les sèmes deviendront des phèmes (par exemple, les statuts de consonne ou de voyelle correspondent à des traits, des caractéristiques phémiques); les isotopies deviendront des isophonies; les molécules sémiques deviendront des molécules phémiques; etc.
Des corrélations pourront être dégagées entre, d’une part, des sèmes, des isotopies, des molécules sémiques et, d’autre part, des phèmes, des isophonies et des molécules phémiques. (Pour une introduction à la sémiotique, voir Hébert, 2012 et 2007)
22. Société
Il existe deux grandes manières d’étudier les relations entre la société et le texte (littéraire ou non), manières qui peuvent se combiner.
La première est causale et s’attache à mettre au jour la détermination plus ou moins grandes des signifiants et signifiés du texte par le social.
La seconde est représentationnelle et s’attarde à la représentation du social qu’effectue le texte, en particulier, mais pas exclusivement, par la thématisation (l’inscription en tant que signifié, thème) plus ou moins directe (fût-ce par la négative ou par l’omission significative: le roman du terroir qui passe sous silence les problèmes liés à la vie campagnarde) du social dans le texte. La thématisation produit ce qu’on a appelé la « société du texte ».
Le reflet de la société dans le texte peut se faire par conservation (tel élément de la société trouvant son pendant direct dans le texte) ou encore être obtenu par l’une ou l’autre des grandes opérations de transformation que sont l’adjonction, la suppression, la substitution, la permutation, l’augmentation et la diminution. Voir Relation, opération et structure.
La « théorie du reflet » pose plusieurs pièges. Il faut notamment tenir compte d’un possible reflet par la négative, par l’omission significative, ainsi que des reflets composés par condensation (deux phénomènes et plus du réel reflétés en un phénomène du texte) ou dissociation (un phénomène du réel reflété en deux phénomènes et plus du texte). C’est sans compter les transpositions possibles (du sérieux au parodique, par exemple).
Les trois principaux aspects sur lesquels on peut se pencher dans l’analyse sociologique sont les classes sociales (dominants/dominés, nobles/roturiers, ouvriers/intellectuels, enfants / adultes, etc.), les institutions (État, système scolaire, Église, Justice, Éducation, etc.) et les idéologies (voir Croyances, valeurs et idéologies).
La société réelle est l’un des contextes du texte (voir Contexte) et constitue en fait le « réservoir » de tous les contextes déterminés par le social (en excluant donc, par exemple, le contexte physique brut). Sur l’analyse du social, Hébert, 2013.
23. Style
Le style a reçu de nombreuses définitions. Le style, pour ce qui des textes (mais la notion déborde le textuel), peut notamment être défini comme les choix faits par un énonciateur, entre tous les moyens que lui offre la langue et les autres systèmes textuels, en tant que ces choix manifestent un écart par rapport au degré zéro de l’énoncé, c’est-à-dire la formulation la plus logique et la plus simple. Par exemple, « Il est parti pour le très long voyage » est un écart par rapport au degré zéro « Il est mort ».
On notera que, dans une telle définition, il n’y a style que s’il y a écart; or, on peut aussi bien considérer que la réalisation de la norme, notamment si elle n’est pas attendue, est aussi un style. On peut également définir le style, plutôt que relativement au degré zéro, relativement au degré attendu (qui peut être le degré zéro ou un écart par rapport à celui-ci). Dans les deux cas, le style produit (et est produit par) un écart relativement à une norme. Voir Écart, norme. Or, les normes sont définies au sein de systèmes. Un texte est produit dans l’interaction de quatre grands systèmes: le dialecte (ou langue fonctionnelle), le sociolecte (usage de la langue et de normes proprement sociolectales qui définit notamment les genres), l’idiolecte (usage du dialecte, d’un sociolecte et de normes proprement idiolectales, c’est-à-dire propres à un énonciateur), le textolecte (usage du dialecte, d’un sociolecte, d’un idiolecte et de normes proprement textolectales, c’est-à-dire propres à un texte). Le style a pu être également défini, plus restrictivement, relativement à l’idiolecte, comme usage du dialecte et d'un sociolecte propre à un énonciateur, c’est-à-dire, en gros, comme norme idiolectale (Rastier, 2001) (par exemple, le style de Baudelaire). Mais si le style est ainsi particularisant, dans d’autres sens, il est généralisant. C’est ainsi qu’on parlera de styles associés à des genres, par exemple le style romantique, ou à des manières d’écrire générales: style simple, fleuri, tempéré, sublime, artiste, esthétique, impressionniste, noble, figuré, etc. (Bénac et Réauté, 1993). On touche alors, notamment, aux tons. Le ton est une manière d’écrire d’un énonciateur qui traduit son humeur ou ses sentiments et attitudes vis-à-vis du sujet qu’il traite. Le style a pu également être vu comme la forme du texte (par opposition à son fond; voir Forme et fond).
Peu importe comment on le définit, il faut se rappeler que le style touche autant les signifiés (les contenus) que les signifiants (les phonèmes, graphèmes, etc.). Les écarts sont produits par des procédés d’écriture (mais ceux-ci produisent également des non-écarts s’ils sont attendus). Parmi ceux-ci, on trouve les figures de styles. On peut regrouper les principales figures de style dans les familles suivantes (Pilote, 1997): (1) figures d'analogie: comparaison, métaphore, allégorie, personnification; (2) figures d'opposition: antithèse, antiphrase (ironie), chiasme, oxymore; (3) figures de substitution: métonymie, synecdoque, périphrase; (4) figures d'insistance: répétition, redondance, pléonasme, anaphore; (5) figures d'amplification: hyperbole, accumulation, gradation; (6) figures d'atténuation (ou d'omission): euphémisme, litote, ellipse; (7) figures faisant appel aux sonorités ou graphies: onomatopée, harmonie imitative, assonance, allitération. Faisons remarquer que tous les procédés d’écriture ne sont pas des figures (par exemple, S+7, où l’on substitue à un nom commun (un substantif, d’où le « S ») d’un texte de départ le septième nom commun qui le suit dans le dictionnaire), même si probablement tous les procédés d’écriture, dans la mesure où ils sont perceptibles, produisent, notamment, des figures. Au niveau le plus fondamental, les écarts stylistiques sont produits par les grandes opérations de transformation (voir Relation, structure et opération).
24. Temps
Le temps est le substrat dans lequel se produisent les simultanéités et les successions. Il peut également être vu comme l’effet de la succession, accompagnée ou non de simultanéités, d’unités. Enfin, il s’agit aussi d’un repère relatif (avant, après, etc.) ou absolu (1912, 1913, etc.), précis ou imprécis, associé à une ou plusieurs unités (position initiale, position finale et durée, c’est-à-dire intervalle de temps entre ces deux positions).
Distinguons entre trois grandes sortes de temps: (1) le temps thématisé, lié à l’enchaînement chronologique des états et des événements de l’histoire racontée dans une production sémiotique (fût-ce dans un seul mot comme « épousera », qui raconte une mini-histoire); (2) le temps de la disposition (voir Disposition), produit par la succession – fortement (dans un film), moyennement (dans un livre) ou faiblement ou non contrainte (dans un tableau) – d’unités sémiotiques « réelles » (signes, signifiants ou signifiés) de la production sémiotique. Ces deux temps peuvent coïncider ou non (exemple de non-coïncidence: le deuxième événement de l’histoire sera présenté dans la première phrase et le premier événement dans la seconde phrase). Le temps thématisé, qu’il soit fictif (dans un roman) ou reflète le temps réel (dans un quotidien), est un simulacre (3) du temps réel. On peut encore distinguer (1.1) le temps thématisé représenté et (1.2) le temps thématisé évoqué; par exemple des personnages du XXIe siècle (temps thématisé représenté) peuvent évoquer l’Antiquité (temps thématisé évoqué).
Si on rapporte le temps aux trois instances de la communication sémiotique et à ses deux processus (voir Réception, production et immanence), on peut distinguer cinq temps: le temps du producteur (de l’auteur); le temps de la production de l’œuvre; le temps du produit lui-même (par exemple, le temps thématisé); le temps de la réception de l’œuvre; et le temps du récepteur (voir Espace).
Rapportés aux trois statuts du signe, les éléments temporalisés auront trois statuts: (1) ce seront des indices relativement au producteur (le choix d’une forme, d’un signifié, d’un signifiant en tant qu’il informe sur la situation temporelle de production); (2) ce seront des symboles relativement à ce dont on parle (ce sont les temps thématisés); (3) ce seront des signaux relativement au récepteur (et donc des indices sur la nature prêtée, par le producteur, au récepteur et à sa situation temporelle).
Puisque le rythme peut être défini comme l’enchaînement, dans au moins deux positions temporelles successives, d’au moins deux éléments (fût-ce le même élément répété), l’étude du rythme présuppose l’étude du temps. Sur les relations temporelles, voir Hébert, 2007. Sur le temps, voir Hébert, 2013.
25. Thème, thématique, structure thématique
Au sens le plus large, un thème est un élément sémantique, généralement répété, se trouvant dans un corpus donné, fut-ce ce corpus réduit à un seul texte (ou plus largement, un seul produit sémiotique: image, film, etc.).
En ce sens, un thème n’est pas nécessairement un élément conceptuel, général, existentiel et fortement valorisé ou dévalorisé (l’amour, l’espoir, la mort, la gloire, la liberté, la vérité, etc.); ce peut aussi bien être un élément conceptuel autre (l’entropie, le pluriel grammatical, l’amour des chats) ou un élément concret, général (les êtres animés, c’est-à-dire dotés de vie) ou particulier (les chats), important (la Tour Eiffel) ou dérisoire (le chewing gum).
Considéré comme un tout inanalysé un thème correspond à un sème dont la répétition constitue une isotopie. Considéré comme un tout analysé, un thème correspond à un groupe de sèmes corécurrents (répétés ensemble), à une molécule sémique. Voir Signe.
Une structure thématique est un groupement d’au moins deux thèmes unis par au moins une relation dont fait état l’analyste; par exemple, si dans une œuvre l’amour (thème 1) cause (relation) la mort (thème 2), ces trois élément forment une telle structure.
Au sens traditionnel du mot, une thématique est un groupement d’au moins deux thèmes dont les relations ne sont pas nécessairement explicitées par l’analyste. Bref, il peut, en principe, s’agir d’un simple inventaire de thèmes coprésents. Une structure thématique, par définition, rend nécessairement explicites des relations entre les thèmes qui la constituent. Postulons que tout thème peut être analysable et transformé en structure thématique et inversement. Par exemple, on peut appréhender l’amour en tant que thème proprement dit ou comme une structure thématique triadique comportant deux termes et une relation: « X aime Y ».
En tant que groupe de sèmes, un thème peut être stéréotypé, c’est-à-dire défini relativement à un niveau systémique donné. Il prend alors la valeur d’un topos (au sens large), d’un cliché de contenu (par exemple, l’amour contrarié ou impossible, l’arroseur arrosé, etc.). Voir Topos.
Le symbole est une structure thématique de comparaison analogique métaphorique unissant un symbolisant (par exemple, une balance) et un symbolisé (la justice dans notre exemple). Différents niveaux de symboles peuvent être distingués. Voir Topos.
26. Topos
Un topos (« topoï » au pluriel), au sens le plus large, est un groupe de sèmes corrécurrents (qui réapparaissent ensemble), c’est-à-dire une molécule sémique, stéréotypé au sein d’un système autre que celui de la langue (voir Signe).
La stéréotypie peut être créée à différents niveaux (voir Style). Un sociotopos, ou topos au sens restreint, apparaît dans au moins deux productions de producteurs différents (par exemple, deux textes d’auteurs différents). Un idiotopos, sans être un sociotopos, apparaît dans au moins deux productions différentes d’un même producteur. Un textotopos, sans être ni un sociotopos ni un idiotopos, apparaît au moins deux fois dans une même production sémiotique.Une groupe sémique qui n’est ni un sociotopos, ni un idiotopos, ni un textotopos est un anatopos, un groupe sémique non stéréotypé.
Au-delà du sociotopos, défini au sein d’un même genre ou discours, on peut distinguer le culturotopos, partagé par une culture donnée indépendamment des frontières génériques et discursives, et au-delà encore, l’anthropotopos, qui est de nature transculturelle voire qui constitue une constante anthropologique (un élément présent dans toutes les cultures).
Un, plusieurs, tous les éléments constitutifs d’un topos donné peuvent être généralisés ou particularisés. Par exemple, par généralisation, le topos « /poète/ + /méprisé/ + /par peuple/ », qu’on trouve notamment chez Baudelaire et Hugo, deviendra « /être d’un monde supérieur/ + /méprisé/ + /par êtres d’un monde inférieur/ ». Cela permet par exemple d’élargir ce topos à Jésus, à l’homme de la caverne de Platon, à Socrate, etc.
On peut distinguer entre topoï thématiques (par exemple, la fleur au bord de l’abîme, le méchant habillé en noir) et topoï narratifs (par exemple, l’arroseur arrosé, la belle qui aime un homme laid).
Une œuvre est faite pour l’essentiel de topoï de différents niveaux et la part non stéréotypée des contenus thématiques est congrue. Il existe des milliers, peut-être des dizaines de milliers, de sociotopoï.
On peut appliquer aux symboles (et aux allégories qu’ils peuvent fonder s’ils sont étendus et systématiques) les mêmes distinctions que nous venons de faire pour les topoï: sociosymboles, idiosymboles, textosymboles, anasymboles, culturosymboles (la balance comme symbole de la justice) et anthroposymboles (les archétypes, par exemple l’arbre comme symbole de l’homme). Sur l’analyse des topoï, voir L’analyse des textes littéraires: vingt approches (http://www.signosemio.com/documents/approches-analyse-litteraire.pdf).
27. Transtextualité
Genette (1982: 8) distingue cinq formes de transtextualité: (a) la paratextualité (relation d’un texte avec sa préface, son titre, etc.) ; (b) l'intertextualité (citation, plagiat, allusion) ; (c) la métatextualité (relation de commentaire d'un texte par un autre) ; (d) l'hypertextualité (lorsqu'un texte se greffe sur un texte antérieur qu'il ne commente pas mais transforme (parodie, travestissement, transposition) ou imite (pastiche, faux, etc.), celui-là est l'hypertexte et celui-ci l'hypotexte) et (e) l’architextualité (relation entre un texte et les classes auxquelles il appartient, par exemple son genre). Quant aux éléments dits paratextuels, ils participeront, selon le statut qu’on leur accorde, d’une relation intertextuelle (au sens élargi que nous donnons au terme) si on les considère comme externes au texte, d’une relation intratextuelle si on les considère comme internes au texte, ou d’une relation proprement paratextuelle.
Quant à nous, nous définissons l’intertextualité dans un sens plus large que ne le fait Genette et englobons ce qu’il appelle l’intertextualité, la métatextualité et l’hyper/hypotextualité; évidemment, les distinctions de Genette n’en demeurent pas moins pertinentes.
L’autotextualité est susceptible de prendre plusieurs formes: du texte comme tout à lui-même comme tout, du tout à une partie, d’une partie au tout et, enfin, d’une partie à cette même partie. Lorsque la relation s’établit entre une partie et une autre du même tout, il y a intratextualité (par exemple, si on compare deux personnages du même texte).
L’intertextualité et l’architextualité peuvent être envisagées soit comme des relations globales (établies entre touts), soit comme des relations locales (établies d’abord entre parties puis, de manière indirecte, entre touts) ; dans ce dernier cas, le terme de départ est considéré comme une partie du texte et le terme d’arrivée, une partie d’un autre texte (intertextualité) ou une partie d’un type textuel (architextualité).
De surcroît, il existe des relations locales-globales: par exemple, une partie d’un texte évoquera globalement un autre texte ou un genre (par exemple, la phrase (partie) d’un roman qui dirait: « J’ai lu Hamlet » (tout)).
L’étude intertextuelle englobe et dépasse l’étude des sources et influences d’une œuvre (ne serait-ce que parce que des évocations intertextuelles peuvent ne pas être volontaires); les sources trouvent leurs pendants symétriques dans les textes « influencés » par un texte.
Un texte A peut entretenir une relation d’intertextualité directe avec un texte B ou indirecte en entretenant une relation d’intertextualité avec le texte C lui-même en relation d’intertextualité avec le texte B.
Deux textes peuvent sembler entretenir entre eux une relation intertextuelle directe, mais en réalité ils puisent, tous deux, éventuellement en s’ignorant l’un l’autre, à un troisième texte que l’analyste ignore ou encore dans un même réservoir des formes disponibles pluôt anonymes (sans être attachées à un auteur en particulier) et anopératiques (sans relever d’une œuvre en particulier), qu’elles soient prégnantes ou non, à une époque donnée.
Un cas particulier est celui où l’un des deux textes reliés est celui qui a justement participé, par son rôle canonique, à la constitution du réservoir des formes disponibles (par exemple, un traité moderne de féminisme qui n’aurait pas connaissance des travaux de de Beauvoir pourrait tout de même en reprendre les idées puisqu’elles sont largement diffusées). Évidemment, les ressemblances entre textes peuvent également être le fait de ce grand pourvoyeur de ressemblances qu’est le hasard. En élargissant l’hypertextualité on en vient à englober l’adaptation (un roman adapté en roman pour la jeunesse ou en film ou l’inverse), la traduction et mêmes les réécritures internes (par exemple, les trois séquences principales des Trois petits cochons) sous l’étiquette de transposition (s’il y a passage d’un système à un autre: dans la traduction ou dans les réécritures internes d’un style à un autre, par exemple) ou diaposition (s’il y a maintien dans un même système: dans notre exemple des Trois petits cochons). Nous employons ici le mot « transposition » dans un sens plus général que chez Genette). Une transposition fait devenir un élément x d’un système a en un élément x’ d’un système b. La transposition suppose donc le passage transformateur d’un « même » élément d’un système à un autre. Voir Hébert, 2013 et 2012.
28. Versification
La versification est un ensemble d’aspects textuels plus ou moins codifiés propres aux textes versifiés, rimés et/ou comptés ou encore partagés avec d’autres formes textuelles (par exemple, les allitérations et assonances, le rythme se trouvent aussi dans la prose).
Les principaux aspects englobés dans la versification sont les suivants: nombre de syllabes du vers; traitement des hiatus (synérèse et diérèse) et des « e » caducs; regroupement des vers: strophes; disposition; richesse, genre de la rime; césures et autres coupes; accents, scansion et rythme (voir Rythme); formes fixes ou non.
La plupart de ces aspects relèvent des signifiants (disposition des vers, richesse de la rime, etc.), mais d’autres relèvent des signifiés ou du moins des signes, c’est-à-dire de touts faits d’un signifiant et d’un signifié (par exemple, l’interdiction de faire rimer des mots de même racine, comme « bonheur » et « malheur »). C’est sans compter que des signifiés peuvent être associés aux éléments qui relèvent du signifiant (sens des phonèmes, sens de l’harmonie imitative, effet de stabilité et de symétrie des vers pairs, etc.).
Un texte sera versifié ou non (texte en prose). Un texte non (proprement) poétique peut être versifié (par exemple, le théâtre de Racine ou un roman en vers de l’auteur québécois Réjean Ducharme: La fille de Christophe Colomb); un texte poétique peut être non versifié (dans la poésie moderne ou dans la prose poétique). Sur l’analyse de la versification, voir Hébert, 2013.
29. Vision du monde, vision de quelque chose
La vision du monde, la conception du monde, est la représentation du monde qui est celle d’un producteur donné, d’une classe, d’un type de producteurs donné (par exemple, une école littéraire, une classe sociale, une nation, une culture, l’humanité entière). Donnons un exemple simplifié de vision du monde. L’historien de l’art Worringer voit dans les représentations picturales géométriques et schématiques des Égyptiens de l’Antiquité le symptôme, chez ce peuple, d’un rapport angoissé au monde.
Théoriquement et méthodologiquement, puisqu’elles peuvent ne pas correspondre, il faut distinguer la vision du monde réelle, empirique (celle qui se trouve « dans la tête » d’un producteur), et la vision du monde construite, celle dégagée à partir des productions du producteur. Par exemple, un auteur peut vouloir donner de lui ou de ce qu’il pense, à travers son texte, une image qui ne corresponde pas à ce qu’il est vraiment, à ce qu’il pense vraiment. La vision du monde construite est élaborée en utilisant le produit comme source d’indices mais aussi, éventuellement, en l’utilisant comme source d’informations thématisées (par exemple, si un texte parle directement de la vision du monde de l’auteur, etc.). La vision du monde construite se trouve véhiculée, plus ou moins directement, plus ou moins explicitement, plus ou moins consciemment, dans un, plusieurs, tous les produits du producteur (par exemple, plusieurs textes littéraires d’un même auteur). L’utilisation du produit comme source d’indices sur le producteur repose sur le postulat, difficilement contestable, que le produit informe toujours sur le producteur (et la production) et donc qu’il peut informer notamment sur la vision du monde qu’a ce producteur.
Par ailleurs, une « vision » peut également porter sur un élément plus restreint que le monde. Donnons des exemples littéraires. On peut ainsi analyser, dans un produit littéraire donné (texte, corpus, genre, topos, etc.), l’image, la représentation, la conception ou la vision que se fait l’auteur: de lui-même, de la littérature, d’une culture, d’une classe ou d’un groupe social, de la langue, d’un genre, de l’amour, etc.
Généralement, si ce n’est toujours, la vision peut être rendue par une ou plusieurs propositions logiques: par exemple, « Le monde est pourri », « Les femmes sont inconstantes ». Éventuellement les propositions logiques d’une même vision seront reliées entre elles par des relations particulières et donc constituées en structures plus ou moins complexes (jusqu’à former une idéologie élaborée). La vision peut être celle du producteur proprement dit (par exemple, un auteur), mais également, vision thématisée, celle d’un « personnage » (réel: un politicien dans un quotidien; fictif: un personnage dans un roman) dépeint dans la production; dans ce cas, la vision thématisée peut être congruente avec celle du producteur (le journaliste, le romancier) ou alors différente voire opposée.
L’analyse de la vision du monde – et, de manière plus atténuée, de la vision de quelque chose – s’inscrit généralement dans les études génératives. En effet, on postule souvent que cette vision génère le produit, partiellement ou totalement. Par exemple, Spitzer considère, c’est sans doute excessif, que la vision du monde d’un auteur informe non seulement les thèmes mais tous les aspects de l’œuvre (le style par exemple). Voir Noyau génératif.
Ouvrages cités
- BÉNAC, H. et B. RÉAUTÉ (1993), Vocabulaire des études littéraires, Paris, Hachette.
- DIRKX, P. (2000), Sociologie de la littérature, Paris, Armand Collin.
- GENETTE, G. (1982), Palimpsestes, Paris, Seuil.
- HÉBERT, L. (2007), Dispositifs pour l’analyse des textes et des images. Introduction à la sémiotique appliquée, Limoges, Presses de l’Université de Limoges.
- HÉBERT, L. (2012-) Dictionnaire de sémiotique générale, dans Louis Hébert (dir.), Signo, Rimouski, http://www.signosemio.com/documents/dictionnaire-semiotique-generale.pdf
- HÉBERT, L. (2013-), L’analyse des textes littéraires: vingt approches, dans L. Hébert (dir.), Signo – Site Internet bilingue de théories sémiotiques, Rimouski, http://www.signosemio.com/documents/approches-analyse-litteraire.pdf
- HÉBERT, L. (2014-), L’analyse des textes littéraires: une méthodologie complète, version numéro x, dans Louis Hébert (dir.), Signo [en ligne], Rimouski (Québec), http://www.signosemio.com/documents/methodologie-analyse-litteraire.pdf.
- KERBRAT-ORECCHIONI, C. (2002), « Connotation », dans A. Jacob (dir.), Encyclopédie philosophique universelle, S. Auroux (dir.), II. Les notions philosophiques, dictionnaire, tome I, Paris, Presses universitaires de France, p. 425-426.
- LAFORTUNE, M. et S. MORIN (1996), L’analyse littéraire par l’exemple, Laval (Québec), Mondia.
[1] Nous nous inspirons d'un document de J. Blais (U. Laval), que nous modifions et développons considérablement.
[2] Notons que le tempérament relèvera, selon les théories, soit de la physiologie, soit de la psychologie, soit des deux.
![]() Télécharger l’article en version PDF
Télécharger l’article en version PDF
RÉSUMÉ
La présente étude tente de mettre en relief les trois grands problèmes qui menaçaient fortement l’ordre de la République des Lettres au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle d’après le Journal d’un observateur, une des nouvelles à la main les plus répandues dans la France dans cette époque. Ce journal clandestin a dressé un tableau très clair des activités de la scène littéraire à la veille de la Révolution française.
SUMMARY
This study attempts to highlight the three major problems that threatened the very order of the Republic of Letters during the second half of the eighteenth century from the Observer Journal, the most prevalent in France at that time. This underground newspaper painted a very clear picture of the activities of the literary scene on the eve of the French Revolution.
INTRODUCTION
1.1.1. Histoire du journal en France
Dès son premier pas sur la terre, l’homme s’est évertué à découvrir son univers, avant même de chercher à se sustenter. Le monde s’est développé et la manière de vivre devenait bien compliquée ; toute la vie se tournant alors vers la sociabilité, l’homme s’est vu obligé, dès lors, de connaître ses semblables pour différentes raisons. Afin d’assouvir cette passion qui le poussait à toujours découvrir de nouveaux horizons, l’homme ne se contentait pas d’apprendre ce qui pouvait lui être utile, mais il cherchait à crocheter les serrures des portes du mystère. Le «journal», en ce sens, s’affichait comme une nécessité sociale et un moyen des plus efficaces pour assurer la circulation des nouvelles dans un monde avide de savoir([1]).
Les premiers essais renvoyant à la parution d’un journal remontent aux siècles les plus reculés, avant l’apparition de l’ars artificialiter scribendi, soit l’imprimerie ([2]). Les Romains et les Grecs avaient des journaux périodiques, juridique et politique, comme par exemple l’Acta diurna ([3]). Il faut remonter jusqu’à l’âge de la Renaissance et de la Réforme en France, pour retrouver de telles tentatives journalistiques : ainsi les « canards » se présentaient comme des feuilles consacrées aux faits divers alors que les « occasionnels » contenaient toutes les nouvelles des batailles entre les protestants et les catholiques([4]). Ces publications, qui étaient dépourvues de périodicité et de variété dans leur contenu, arrivaient rarement, cependant, à séduire les lecteurs.
L’histoire de la presse française débute réellement avec la parution de la Gazette de France, un journal périodique qu’édite Théophraste Renaudot et dont le premier numéro paraît le 30 mai 1631. Si l’on en croit l’assertion de Hatin, dans son étude sur l’histoire du Journal, cette publication s’est placée au-dessus de tout ce qui avait existé d’analogue soit en France soit à l’étranger, par : «la régularité de sa publication, par sa circulation européenne, par l’abondance et le choix des matières, par la supériorité de sa rédaction et le nombre de ses correspondants.» ([5]). Mais un coup d’œil rapide sur les articles de cette feuille périodique permet de constater qu’il ne s’agit pas d’autre chose que d’un bulletin officiel se bornant à rapporter des informations officielles de la Cour, les autres rubriques s’occupant des nouvelles des pays étrangers, comme par exemple la Turquie ([6]). Il faudra attendre jusqu’à la seconde moitié du XVIIIe siècle pour voir la publication en France du premier journal quotidien, au vrai sens du terme, qui portera le nom de Journal de Paris (1er janvier 1777).
1.1.2. La censure et la police de la librairie
Avec l’introduction de l’imprimerie en France, toute espèce d’écrit est jugé rigoureusement, le premier arrêt de la censure étant promulgué au cours de l’an 1332. À l’aube du XVIIIe siècle, la monarchie pensa à unifier tous les règlements décrétés pour la librairie et l’imprimerie dans le Code arrêté au Conseil d’état à la séance du 28 février 1732 qui resta en vigueur jusqu’à la fin de l’Ancien-Régime ([7]). Ce règlement renfermait toutes les précautions indispensables pour porter le métier de l’imprimerie et du commerce des publications à une grande perfection[8]. En vertu des dispositions de cette ordonnance, tout manuscrit, avant son impression, devait avoir deux lettres patentes d’approbation : l’une, administrative, de la Direction de la librairie qui représentait le pouvoir royal, et l’autre, professionnelle, de la Chambre Syndicale des Librairies. Mais ces deux autorisations n’ont jamais été délivrées sans un rapport positif et détaillé des censeurs royaux ([9]). Les contrevenants étaient punis de prison et souvent condamnés à mort ([10]).
Mais ces mesures répressives ont atteint leur paroxysme avec la mise en place d’une Police de la librairie dont le rôle consistait à contrôler toutes les étapes du métier de l’écrit et à confisquer tous les manuscrits suspects ou dépourvus de la permission royale de diffusion. La consultation de diverses pièces d’archives nous permet de connaître certaines des tâches qui étaient confiées à cette Police, soit, entre autres : vérifier l’entrée des livres aux douanes ; recevoir le serment des nouveaux officiers de la Police de la librairie et celui de nouveaux libraires ; s’occuper de la censure des pièces de théâtre, etc. ([11]).
1.1.3. La naissance des nouvelles à la main
La censure stricte sur tous les imprimés a pâli leur contenu, les auteurs s’intéressant plutôt à mettre en relief des bagatelles pour éviter toute confrontation avec l’autorité, tant politique que religieuse.
Le peuple a délaissé ces écrits qui n’ont pas assouvi sa curiosité ; il a fréquenté les cafés et les jardins pour collecter les informations ou les secrets au vrai sens du terme. Certains voyaient dans cette envie de s’informer de ce qui s’est passé derrière les portes fermées, une nouvelle sorte de métier pour gagner leur pain ([12]). Ils ont ébauché un plan pour organiser, classifier et rédiger toutes les nouvelles, les racontars et les faits du jour sous une forme de gazette qu’ils ont distribuée clandestinement et vendue à prix raisonnable pour le public ([13]). Parmi ces nouvellistes, certains ne se souciaient pas de publier les informations qu’ils avaient collectées, mais ils s’engageaient comme nouvelliste à la main ou « nouvellants », comme on les nommait dans le marché des nouvelles, chez les nobles ([14]). Ce service d’informations était le plus répandu pendant les périodes de troubles politiques.
Ces journalistes apprentis ou selon l’expression de l’époque les nouvellistes à la main ou les chasseurs de nouvelles, ont profité de leurs relations familiales ou commerciales à la cour et avec les hauts fonctionnaires de l’appareil administratif afin d’enrichir le contenu de leurs gazettes.
Leur travail a dépassé la compilation des informations mondaines, calomnieuses et diffamatoires pour revêtir une forme d’espionnage ; ils ont fondé un service de renseignements qui formait des agents secrets s’immisçant au sein des cercles décisionnels. Ce réseau compliqué a réussi à rassembler des renseignements très secrets sur des personnalités en vue de la noblesse parisienne, lesquels étaient souvent vendus au plus offrant. L’efficacité de ces agents dans le domaine de l’espionnage poussait la Cour à louer leurs services ([15]).
Devant l’augmentation de la clientèle, issue de toutes les couches sociales, pour ces manuscrits illicites, une foule de gens ont orienté leurs activités vers ce nouveau métier rentable ; on y trouvait des hommes, des femmes ([16]) et même des enfants. Afin de bien organiser ce commerce des nouvelles, les éditeurs se sont attachés, en catimini, à établir une corporation des nouvellistes ([17]). Si la Police de la librairie tenta de réfréner ces publications illicites, les résultats obtenus furent décevants en raison de l’absence de moyens réellement efficaces.
Dès lors, les autorités royales se trouvèrent obligées de fermer les yeux et de tolérer implicitement les activités de ces gazetiers, ce qui entraîna une augmentation dans la diffusion illicite des nouvelles à la main. En raison de l’influence de ces feuilles sur l’esprit du peuple, la police elle-même n’hésita pas à utiliser les services de certains gazetiers à des fins de propagande élogieuse pour la France ([18]). Enfin, sous le règne de Louis XIV, les nouvellistes et leurs manières de contourner la censure (qu’il s’agisse d’offrir des pots-de-vin aux mouches de la police ou de corrompre les chefs eux-mêmes) inspirèrent plusieurs auteurs ([19]). Toutefois, il convient de noter que ce ne fut pas toujours sans risque, alors que certains se verront enfermés à la Bastille ([20]).
Les scripteurs de ces feuilles n’avaient besoin ni d’effectifs considérables ni d’un lieu particulièrement équipé, le « chef de nouvelles » choisissant souvent pour son officine sa propre résidence ou encore un cabaret, l’important étant surtout d’être à l’abri du contrôle de la police. Le secrétaire de la rédaction jouait, quant à lui, un rôle essentiel. C’est en effet lui qui recevait, deux ou trois fois par jour, les nouvelles des agents et des correspondants. Il lui incombait également de s’assurer que les copistes engagés n’iraient pas vendre certaines nouvelles à d’autres nouvellistes ([21]). Une fois les nouvelles rédigées, il veillait à ce que les distributeurs portent les feuilles aux souscripteurs.
1.1.4. La naissance des nouvelles à la main de Bachaumont
Lorsqu’il est question de nouvelles à la main, on ne peut passer sous silence le salon de Madame Doublet qui tenait, dans son appartement rattaché au couvent parisien des Filles-saint-Thomas, un bureau d’esprit connu sous le nom de «Paroisse»([22]) où se réunissait une société choisie d’académiciens et de gens de lettres, tels Voltaire, Dortous de Mairan, secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences, Mirabaud, de l’Académie française ou encore le censeur royal Pidansat de Mairobert ([23]). Le salon de Madame Doublet fut l’un des plus célèbres réseaux de nouvellistes à la main de cette époque. On y mettait en commun les informations recueillies au cours de la journée et appelées à être redistribuées sous forme de nouvelles à la main. On y retrouvait deux registres dans lesquels chacun inscrivait, dans l’un, les nouvelles certaines et dans l’autre, celles jugées douteuses ([24]). Louis Petit de Bachaumont, ami de Madame Doublet, se chargeait de faire un journal avec les extraits des registres, rédigeant les informations retenues sur des feuilles volantes ou encore dites «feuilles de l’ordinaire». Les valets distribuaient alors ces nouvelles à la main sous le nom de Journal d’un observateur.
La présente étude tente de mettre en relief les trois grands problèmes qui menaçaient fortement l’ordre de la République des Lettres au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle d’après le Journal d’un observateur, une des nouvelles à la main les plus répandues dans la France dans cette époque ([25]). Ce journal clandestin a dressé un tableau très clair des activités de la scène littéraire à la veille de la Révolution française ([26]). Il en ressort des éléments susceptibles de saper les fondements du monde littéraire, dont les trois plus importants sont : le crime de plagiat, la relation d’hostilité entre auteur-libraire-lecteur et la censure.
2. Le crime de plagiat
Si l’on croit Henry Omont, dans son intervention devant l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, l’histoire du plagiat dans la littérature française remontrait au Moyen Âge, c’est-à-dire approximativement entre le XIIe et le XVe siècle ; la première supercherie littéraire a été faite par un prêtre du nom d’Egbert qui copia mot à mot le livre de Théofroy, abbé d’Epternach, intitulé : La vie de Saint Willibrod, évêque d’Utrecht ([27]).
On n’exagère pas en disant que, les chefs d'œuvres littéraires dans le monde entier avaient été victimes de plagiat. Dans le monde de la pensée, si chacun s’évertue à être le meilleur, les Muses n’inspirent malheureusement pas tous ceux qui prétendent au génie. Dès lors, il n’est pas surprenant de voir certains prendre des raccourcis en plagiant les ouvrages de penseurs ou d’écrivains de grand talent. L’absence de règles claires, au cours de la période qui nous occupe, permettait de jouer avec la notion de plagiat d’une manière assez large. Cela pouvait conduire, en certaines circonstances à remettre en cause l’honnêteté d’un auteur et l’originalité d’un ouvrage en raison, par exemple, d’une imitation jugée inacceptable. Il serait facile de multiplier les exemples : on connaît, au XVIe siècle, les accusations de plagiat portées contre Ronsard pour ses Quatre saisons de l’an, certains affirmant qu’il avait pillé les Macaronicæ de Teofilo Folengo, un poète italien ([28]) ; au XVIIe siècle, l’originalité du Cid de Corneille fut mise en doute alors qu’on lui reprochait d’avoir plagié une pièce espagnole de Guilhem de Castro (Las Mocedades del Cid) ([29]).
Ce problème d’authenticité inquiètera la critique littéraire tout en ouvrant un champ infini d’études qui tentent de donner une définition claire et exacte du plagiaire et aux autres termes apparentés comme le faussaire et le pasticheur. En contradiction avec le plagiaire qui copie mot à mot les écrits des autres pour pallier sa stérilité intellectuelle, le faussaire a des caractères et des objectifs très différents : on peut le classer au rang des créateurs, mais il doute de la valeur de son ouvrage. Afin de lui donner une sorte de valorisation, le faussaire cherche à l’attribuer à un autre écrivain connu, c’est-à-dire qu’il triche sur la signature de l’ouvrage. Quant au pasticheur, à la différence du plagiaire et du faussaire, il imite la manière de pensée et le style d’un écrivain à talent ([30]).
Rien d’étonnant à ce que le plagiat littéraire ait occupé une place saillante parmi les articles du Journal d’un observateur parce que ce phénomène animait la curiosité des lecteurs. Devant le grand nombre d’exemples de plagiat mentionnés dans ce journal ([31]), nous nous avons dû faire quelques choix. Le premier exemple qui mérite d’être cité, c’est l’imputation de plagiat qu’on a attribué aux écrivains de grand talent comme Voltaire, Diderot, Rousseau.
Il s’élevait une réclamation très vive contre Voltaire de la part de M. de Sauvigny ([32]) qui donna au public une tragédie en cinq actes, ayant pour titre : Hirza ou Les Illinois. Il reprochait à Voltaire d’avoir pillé sa tragédie dans Les Scuthes, tragédie en cinq actes, et de lui devoir tout ce qu’il y avait de beau dans cette pièce ([33]). En outre, dans l’Année littéraire, éditée par Élie Catherine Fréron ([34]), on publia un article contre Voltaire où l’auteur attaquait le Discours aux Welches en prétendant que le fonds avait été pillé chez un certain Deslandes. Voltaire ne resta pas silencieux face à cette accusation de plagiat dont le chargeait M. de Sauvigny, mais Le journal d’un observateur ne publie aucun plaidoyer voltairien. Afin d’esquiver tout soupçon de complicité de Bachaumont avec l’auteur d’Hirza contre Voltaire, on a compulsé d’autres journaux de cette époque, comme le Journal de Paris et des correspondances des grands écrivains comme la Correspondance de Grimm et de Diderot, mais la synthèse de cette recherche s’avère décevante. Toujours est-il qu’en absence de preuves irréfutables, nous tendons à croire les allégations de M. de Sauvigny contre Les Scuthes de Voltaire. Il faudra attendre des études plus approfondies sur ces deux pièces pour nous apporter de nouveaux éclaircissements ([35]).
Une autre accusation de plagiat littéraire sera intentée par Fréron contre Diderot. Il prétendait que le rédacteur en chef de l’Encyclopédie avait écrit son drame, Le fils naturel en s’inspirant du roman de Goldoni, intitulé Le père de famille et le véritable ami. L’auteur ne se serait pas contenté de piller le plan et l’intrigue de ce roman italien, mais il en aurait même puisé des expressions ([36]). À l’instar de l’écrivain du Siècle du Louis XIV, Diderot ne prêtait pas une oreille attentive à ces diffamations et refusa toute rencontre avec l’auteur italien pour se disculper de l’accusation de plagiat : « malgré toutes les démarches que lui [Galdoni] et ses amis ont faites pour le faire rencontrer avec M. Diderot, celui-ci a toujours éludé : en vain MM. Marmontel et Damilaville, intimement liés avec ce dernier, ont-il promis à l’Italien de lever les difficultés, il parait que ces deux ont échoué dans leur négociation » ([37]). Mais les études comparatives entre les deux romans ont permis de découvrir qu’il n’y avait que le premier acte du Fils naturel qui était semblable au roman de Goldoni. Bien que ces remarques permettent de disculper Diderot du crime de plagiat, le silence de ce dernier n’a pas moins laissé planer un doute. La vive polémique autour de l’originalité du Fils naturel semble avoir eu des effets à long terme ; le philosophe se vit obligé de sortir de son silence pour se défendre vigoureusement de l’imputation de plagiat dans son ouvrage les Entretiens sur le fils naturel ([38]).
Les accusations de plagiat atteignaient également Rousseau, Dom Casot, un savant bénédictin, faisant imprimer un livre ayant pour titre Histoire détaillée des plagiats de Jean Jacques Rousseau ([39]). Il y démontrait que ce philosophe avait pillé des pages entières et qu’en lui ôtant tous ces emprunts, il ne lui restait rien de ses pensées et de ses théories hardies ([40]). Malgré l’absence des défenses de Rousseau dans les feuilles de Bachaumont, on sait que ce philosophe s’est appliqué, dans ses Confessions, à détruire l’accusation de plagiat dont le chargeait Dom Casot ([41]).
Sur la scène théâtrale, le plagiat s’affichait comme une trame essentielle de ce monde. Le journal d’un observateur est rempli d’exemples qui montrent que les accusations de plagiat ont été largement employées comme moyen de publicité pour influencer les esprits des lecteurs ou des spectateurs.
Pour citer quelques exemples, M. D’Arnaud intentait une accusation de plagiat contre M. Bret en prétendant que ce dernier avait reconduit dans sa pièce intitulée Mauvais riche les meilleures situations, les personnages et les plus excellents traits empruntés de sa comédie, le Faux généreux ([42]). Une telle accusation mit M. Bret en rage, qui assurait qu’il n’avait jamais connu ni l’accusateur ni sa comédie tout en affirmant que les allégations de M. D’Arnaud ne visaient qu’à dénigrer sa réputation. Toutefois, les défenses de M. Bret ne présentent aucun déni précis contre l’accusation et nous tendons à prendre les accusations de M. D’Arnaud au sérieux.
Par ailleurs, les feuilles de Bachaumont ont mis en relief un autre crime de plagiat qui capta l’attention du public de cette époque. On reprochait à monsieur de Chamfort d’avoir copié sa tragédie Mustapha et Zéangir sur celle M. Belin qui portait le même titre ([43]). On y découvrait un plagiat manifeste, non seulement du sujet, mais du plan entier, de l’intrigue et presque de toutes les scènes. Afin d’affirmer l’authenticité de sa tragédie et de pulvériser les imputations de plagiat dont le chargeait M. Belin, Chamfort s’efforça de changer sept fois le dénouement ([44]) de sa pièce, mais tous ces essais ne réussirent pas à dissiper les préjugés et Bachaumont écrivait, le 1er janvier 1778, que tout cela « est une grande opération [changement le dénouement] pour un poète qui a été douze ans à se traîner sur les pas d’un autre, et à calquer sa tragédie sur la sienne. Il n’est pas encore prêt » ([45]).
Les accusations de plagiat n’étaient pas adressées seulement aux écrivains, les troupes théâtrales étant également victimes de plagiat. La troupe des Comédiens italiens intentaient une telle accusation contre celle du Théâtre français. Elle reprochait à sa rivale d’avoir copié les divertissements et la musique de la représentation d’une pastorale intitulée Hylas et Sylvie de Rochon de Chabannes ([46]). De sa part, le Théâtre français ripostait en alléguant la propriété de ces entractes ; cette contestation occasionna des méchancetés et de ridicules échanges. Car, au lieu de mettre un terme à ce différend, les deux troupes théâtrales y virent un moyen gratuit de propagande.
À l’opposition des autres genres littéraires, la poésie se présentait comme le genre le moins plagié au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Tous les numéros des nouvelles à la main de Bachaumont, qui s’étendent de 1762 jusqu’à la fin de l’année 1778, n’enregistrent que cinq cas de plagiat. Citons, à titre d’exemple : les accusations intentées par Voltaire contre M. de la Harpe ([47]). Cet écrivain, lauréat de l’Académie française, a pillé les quatrième et cinquième chants de la Guerre civile de Genève de Voltaire. Ce philosophe déiste irrité de ce plagiat et des tracasseries qui en résultaient déclara qu’il coupait toute relation avec M. de la Harpe ou ce «petit auteur», selon l’expression de Voltaire. Après un certain temps, des amis communs sont intervenus pour régler ce litige, et Voltaire pardonna à M. de la Harpe. Cette indulgence voltairienne n’était pas sans arrière-pensée, Voltaire cherchant sans doute à regagner l’affection et l’appui du public après avoir été lui-même accusé de plagiat par M. de Sauvigny.
Dans le monde de l’Opéra, le plagiat a pris de nouvelles dimensions où le plagiaire ne se contentait pas de piller l’ouvrage des autres, mais il volait aussi la musique, les danses, les masques et les décors. Les imputations les plus célèbres dans ce domaine sont venues de D’Auberval, maître des Ballets de Bordeaux, contre Gardel, maître des Ballets de l’Opéra de Paris, qui a calqué ses plans de pantomimes sur ceux de D’Auberval. « Il faut entendre la défense de celui-ci », peut-on lire dans un numéro du Journal d’un observateur daté du 29 août 1785([48]). Gardel ne se défendait jamais, laissant ainsi une porte ouverte aux diffamations de ses adversaires qui ont réussi à pousser le public à demander à la Cour la démission de M. Gardel de l’Opéra de Paris ([49]). Cependant, la Cour ne prêta pas une oreille attentive aux vœux du public et chercha plutôt à protéger un des favoris de la famille royale. Donc, on peut ajouter aux tares de la Monarchie absolue une autre, c’est la protection des plagiaires.
Un autre exemple concernant des accusations de plagiat dans le milieu de l’Opéra mérite d’être cité : M. Philidor, membre de l’Opéra de Paris et musicien connu pour son talent, avait été accusé de plagiat pour son opéra, Ernelinde. On prétendait qu’une grande partie de son opéra était plutôt due à de grands musiciens italiens. Afin d’en fournir la preuve, on publia un livre sous le titre de Collection des œuvres de Philidor, cet ouvrage se présentant comme une étude comparative entre la musique de M. Philidor et celle des grands maîtres italiens ([50]). On n’écoutait pas les défenses de M. Philidor contre ces accusations de plagiat documentées et on laissa la polémique se jouer dans le Journal d’un observateur, bien que les propos qu’on y publia fussent dépourvus de toute argumentation académique.
Au moment de quitter la salle somptueuse de l’Opéra de Paris, une question nous vient à l’esprit : pourquoi le plagiaire s’en tirait-il sans trop de conséquences ? La réponse vient sans doute de la place prépondérante qu’occupe l’opéra au cours du règne de Louis XVI. L’opéra, cet art italien, était l’un des divertissements les plus goûtés par les nobles et la famille royale ([51]), qui se souciaient peu des polémiques. Au cours des représentations données à Versailles et dans les autres châteaux de la noblesse et de la haute bourgeoisie, les acteurs, les danseurs, les musiciens et les chorégraphes pouvaient étendre leur réseau de connaissances ([52])susceptibles de leur obtenir des privilèges infinis dans tous les secteurs de l’État. Et, pour leur part, les nouvellistes devaient appuyer les décisions de l’administration dans n’importe quel litige pour avoir la possibilité de publier les annonces des spectacles de cet établissement artistique, lesquelles représentaient la base du budget de ces feuilles volantes ([53]).
Tournons-nous maintenant vers les journaux en considérant, par exemple les imputations de plagiat intentées par le Journal étranger contre le Journal des savants. Sans aucun changement, ce dernier a copié les remarques et les commentaires du premier sur la traduction française pour la version anglaise des Poésies d’Erses de Madame la Duchesse d’Aiguillon ([54]). Le Journal des savants garda le silence sur ces accusations qui indifféraient assez ses lecteurs. L’absence d’une punition sévère contre ce plagiat ouvrait toutefois la porte aux autres périodiques qui n’hésitaient pas à se piller mutuellement.
Tous ces plagiats, réels ou inventés, mettaient la stabilité de la vie intellectuelle en danger et tourmentaient les esprits des auteurs honnêtes qui cherchaient à éviter d’être accusés de plagiat. En lisant les articles du Journal d’un observateur, on peut voir à quel point les imputations de plagiat devenaient une obsession chez les écrivains. Citons quelques exemples : M. Durosoy, qui imprimait une tragédie intitulée le Siège de Calais, rendait compte, dans une préface assez longue, d’une comparaison entre sa pièce et celle de Belloy qui portait le même titre tout en affirmant que sa tragédie était bien antérieure à la pièce de Belloy ([55]). Citons un autre exemple : la peur d’être accusé de calquer sa comédie intitulée Sorcière par hasard sur la Fausse magie, comédie de Marmontel, poussa M. Framery à présenter au public une histoire très détaillée du processus de l’écriture de sa pièce ([56]). Ces exemples contribuent à montrer que cette atmosphère de suspicion perturbait le monde littéraire et enracinait dans les esprits une sorte de phobie du plagiat.
Toutefois, le plagiat n’était pas le seul phénomène qui semait la perturbation dans le monde littéraire lors de la seconde moitié du XVIIIe siècle, alors qu’une guerre éclatait entre les libraires et les auteurs. Tout essai de réconciliation était voué à l’échec ; la Cour se vit obligée de renvoyer ce dossier devant la justice.
3.L’auteur-libraire-lecteur : relation de complémentarité ou d’hostilité ?
La Renaissance ayant redécouvert les Anciens, le XVIIe siècle considéra comme sacré l’héritage que lui laissa le siècle qui l’avait précédé. Mais cet édifice intellectuel était basé sur un substrat immobile et tout changement qui pouvait secouer cet ordre intellectuel immuable était exclu et refusé :
Demeurer ; éviter tout changement, qui risquerait de détruire un équilibre miraculeux : c’est le souhait de l’âge classique. [...]. L’esprit classique, en sa force, aime la stabilité : il voudrait être la stabilité même. [...]. On a soustrait la politique, la religion, la société, l’art, aux discussions interminables, à la critique insatisfaite ([57]).
Alors que l’esprit qui caractérisait le siècle classique était le respect de la trinité sacrée : la religion, le Roi et les Anciens, celui du XVIIIe siècle dédaignait cette vénération et cette soumission qu’on jugeait servile à bien des égards. Dans une lettre à la princesse Dashkoff, Diderot manifestait l’esprit du XVIIIe siècle en ces termes : « chaque siècle a son esprit qui le caractérise. L’esprit du nôtre semble être celui de la liberté » ([58]). Cette nouvelle idéologie de nombreux auteurs tentaient de la communiquer au public ; mais le métier d’auteur, tout spécialement à cette époque, était peu rémunéré ([59]). Dépourvu des fonds nécessaires pour l’impression de son manuscrit, l’auteur frappait à la porte d’un mécène. Mais la multiplication du nombre des manuscrits dans toutes les branches de la connaissance rendait difficile cette recherche d’un mécène ([60]). La bourgeoisie entra alors en scène y voyant une manière de faire fructifier ses capitaux. Le métier de libraire ou d’imprimeur ou, selon un terme employé à l’époque, de « faiseurs de livres » devint à la mode. Mais quelle était la nature de la relation entre l’auteur et son éditeur à la fin de l’Ancien Régime ? Voyons de quelle manière cette relation est décrite dans le Journal d’un observateur.
« Si vous êtes un homme, allez lire et écrire », voilà l’une des idées fortes que prônait une certaine partie de la société de la seconde moitié du XVIIIe siècle. L’écrivain qui tentait de se faire une place sur la scène intellectuelle disposait de deux moyens pour y parvenir : le premier était d’éditer son manuscrit à son compte, cette pratique autonome et facile était l’apanage d’une certaine société d’auteurs issus de la noblesse ou de la bourgeoisie ([61]). Celui qui ne disposait pas des fonds nécessaires devait avoir recours aux libraires qui, dans ce cas, offraient un somme d’argent contre la cession complète de l’œuvre. En vertu de ce contrat, toutes les recettes des ventes du livre revenaient au libraire. Ce gain sommaire que l’auteur retirait de la vente de son manuscrit n’était pas loin de la convoitise des libraires. Afin de soustraire aux droits monétaires des auteurs, les imprimeurs s'efforçaient de dessiner une image utopique et idéale de l’écrivain tout en enracinant dans l’esprit du public le mépris profond pour l’auteur qui cherchait une rétribution monétaire de sa production intellectuelle ([62]). Contre l’exploitation des libraires, les écrivains employaient leurs talents oratoires pour solliciter la protection de la Cour, mais il fallut un certain temps pour que cette dernière prête une oreille attentive à leurs requêtes. Nous trouvons des échos de cette situation dans les nouvelles à la main de Bachaumont, alors qu’il mentionne l’Avis aux gens de lettres. Fenouillot de Falabaire ([63]), auteur de cette brochure, y dessine une image déplorable de la condition des gens de lettres en France à la fin de l’Ancien Régime : « gémissant sous le joug des libraires, travaillant en vils esclaves au champ fécond de la littérature, tandis que ces maîtres durs recueillent tout le fruit de leurs sueurs, et vivent à leurs dépens dans l’abondance et dans le luxe.» ([64]). L’auteur ne se contente pas de chercher à captiver l’attention du Roi et du public par des expressions touchantes, mais il compare les procédés des libraires de Paris et de ceux de Londres envers les auteurs, et il en fait voir l’énorme différence à la honte des premiers tout en présentant l’exemple de l’écrivain anglais, Robertson, qui a vendu le manuscrit de son livre intitulé Histoire de Charles Quint pour quatre mille guinées ; tandis que le privilège de l’impression de l’Encyclopédie, ce vaste dépôt de toutes les connaissances humaines, a été vendu par Diderot pour cent pistoles de rentes viagères, bien que ce dictionnaire énorme ait rapporté plus de deux millions en gain aux libraires. L’auteur de l’Avis aux gens de lettres termine sa brochure par une péroraison où il incite ses confères à la révolution contre l’exploitation des libraires, à s’aider mutuellement dans l’impression et la vente de leurs ouvrages ([65]).
Cet appel à réagir devait inspirer certains auteurs dont, entre autres, Luneau de Boisjermain, écrivain et critique connu par des ouvrages estimables et surtout pour son Commentaire des tragédies de Racine. Il apparaît dans les feuilles de Bachaumont comme le Spartacus des écrivains victimes des libraires de Paris. Il menera une guerre sans merci contre la tyrannie et l’avidité des imprimeurs tout en exhortant les auteurs à faire imprimer leurs ouvrages à leurs frais et à les faire débiter personnellement ou par des subalternes de confiance. Luneau de Boisjermain lui-même fit imprimer ses ouvrages à son compte et les vendit au public depuis son domicile ou par la poste. Les libraires ont considéré les tentatives de Luneau de Boisjermain pour une plus grande autonomie et une capacité de vivre de sa plume comme une menace qui méritait d’être affrontée avec sérieux. Monsieur Sartine, lieutenant de police et inspecteur de la librairie, recevait tous les jours des requêtes et des représentations de la part des libraires contre Luneau de Boisjermain. Ils l’accusaient de contrevenir aux règlements du Code de la librairie et imprimerie de Paris qui interdisaient :
à toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient, autre que les libraires et imprimeurs, de faire le commerce de livres, en vendre et débiter aucuns, les faire afficher pour les vendre en leurs noms, soit qu’ils s’en disent les auteurs ou autrement ([66])
En se basant sur cet article, le jugement rendu par Sartine dans ce procès fut en faveur des libraires et il ordonna la saisie de tous les livres mis en vente. Luneau de Boisjermain répliquaà ce jugement dans quatre mémoires successifs où il cherchait à prouver qu’il n’avait pas vendu et débité des livres et qu’il ne les avait point fait afficher pour les vendre ([67]). L’auteur reçut un large appui ([68]) de la part des gens de lettres[69] qui s’efforçaient de lier cette cause à toutes les autres du même genre et qui rejoignaient beaucoup d’autres auteurs : « Une affaire particulière, devenue presqu’une affaire générale entre les gens de lettres et les libraires […] » ([70]). Dans cette cause, Le journal d’un observateur renonça à toute impartialité et mit tout en œuvre pour orienter l’opinion publique en faveur de Luneau de Boisjermain, en choisissant, par exemple, des expressions émouvantes ou fortes pour influencer les points de vue des lecteurs : « tyrannie des libraires envers les gens de lettres ; sous le joug des libraires ; vils esclaves ; rapacité dévorante des libraires ; sangsues des auteurs.» ([71]), etc.
Après un flux de mémoires issus des deux camps justiciables, monsieur Sartine prononça, le 30 janvier 1770, un jugement favorable à Luneau de Boisjermain dans lequel il signifiait la mainlevée de la saisie faite chez Luneau de Boisjermain et le paiement de 300 livres de dommages et intérêts à monsieur de Boisjermain ([72]).
Tous les auteurs accueillirent avec allégresse ce règlement qui secouait le joug de la servitude tout en affirmant leur affranchissement de l’autorité des libraires. Le procès de Luneau de Boisjermain contre les libraires s’est affiché comme un conflit des intérêts et du droit entre deux corporations complémentaires. Cette cause a montré que la relation entre les gens de lettres et les libraires était au bord du précipice et avait besoin de l’intervention de la Cour. Le Roi a finalement répondu aux revendications des auteurs pour une plus grande autonomie en promulguant deux arrêts successifs (août l777 et juillet 1778) qui stipulaient le droit de l’auteur d’imprimer et de vendre ses propres ouvrages à condition qu’il ne le rétrocède à aucun libraire ; la durée du privilège obtenu par l’imprimeur de la part de l’auteur était de dix ans et non renouvelable ([73]). Les libraires considérèrent ces décrets comme une privation de leurs prérogatives acquises de longue date. Ils entrèrent en lice juridique avec le gouvernement. Les feuilles de Bachaumont ont consacré un grand nombre de pages pour exposer les réactions des libraires de Paris contre ces nouvelles lois. Il suffit d’en citer un exemple ayant pour titre : Les très-humbles et très respectueuses représentations adressées au roi par les libraires et imprimeurs-jurés de l’université de Paris ([74]). Cette pétition tendait à convaincre le Roi que les différentes dispositions de ses deux arrêts attaquaient plus ou moins directement leurs droits et menaçaient leurs acquis.
En feuilletant tous les numéros des feuilles volantes de Bachaumont, nous avons remarqué que la Cour garda un silence absolu devant les remontrances des libraires, les arrêts prononcés par la Cour donnant assez à penser sur la position adoptée. Par ailleurs, à la suite de notre étude des divers autres décrets royaux concernant les droits des auteurs, nous avons pu constater le support que leur a accordé la Monarchie. Mais ce soutien matériel et phycologique, présenté par le journal de Bachaumont et par le gouvernement aux auteurs, nous incite à s'interroger sur ses raisons. Il est très important de signaler que la plupart de nouvelles à la main à cette période a vu le jour au sein des salons littéraires fréquentés régulièrement des écrivains et des intellectuels. Les membres de ces boudoirs ont réussi à fonctionner ces feuilles volantes pour jouer un rôle publicitaire dans leur conflit contre les libraires. Mais à cette raison idéologique s'ajoute une autre raison technique qui compliquait l’affaire. La chambre de la librairie de Paris a décidé d’augmenter les prix des papiers et les frais de l’impression des manuscrits ([75]), ce qui allumait la colère des nouvellistes contre l’avidité des imprimeurs.
D’ailleurs, les problèmes économiques et politiques de la Monarchie à la fin de l’Ancien Régime portaient atteinte à sa splendeur des siècles précédents. À l’opposition de son père qui portait l’appellation de : Bien Aimé, Louis XVI méritait d’être qualifié de "Mal aimé", son échec persistant dans le traitement des problèmes de la France sur la scène mondiale et nationale, et surtout la crise financière, mettait son pouvoir au cible des critiques des penseurs et des écrivains qui stigmatisé toutes les tares de la société contemporaine à travers leurs écrits. La figure traditionnelle des hommes de lettres au XVIIe siècle, qui ne s’intéressait qu’à des thèmes en rapport avec la vie dorée des castes aristocratiques, a été transformée totalement à la fin de l’Ancien-Régime. Ils avaient une tendance à instruire l’opinion publique, à la diriger et à jouer un rôle sociale ([76]). Lors de la préparation du projet loi de loi à la première lecture, la Cour prenait parti à donner des privilèges aux hommes de lettres pour les utiliser pour enjoliver son image sombre.
Donc, les hommes de lettres jouissaient de certains privilèges au grand dam et à la colère des libraires. Ces décrets ont réussi à fournir aux auteurs la protection adéquate pour pratiquer un métier dont l’indépendance et la liberté représentaient un aspect essentiel. Dans ce cas, l’auteur pouvait espérer toucher une part convenable des recettes des ventes. Ces nouvelles mesures privaient les libraires de revenus considérables, aussi ont-ils cherché d’autres sources, telle la souscription, pour compenser ces pertes ; et ce furent les lecteurs qui en firent les frais.
La souscription se composait de : « l’obligation de prendre un certain nombre d’exemplaires d’un livre qu’on doit imprimer, et une obligation réciproque de la part du libraire, ou de l’éditeur, de délivrer ces exemplaires dans un certain temps.»([77]) . Ce système de financement permettait aux libraires de collecter à l’avance des fonds nécessaires pour l’impression d’un ouvrage et aux souscripteurs de recevoir des exemplaires des livres à des prix forfaitaires. Selon les dispositions de l’arrêt de 1777, l’auteur ou l’imprimeur avait le droit d’offrir une œuvre en souscription, mais il devait faire imprimer le prospectus qui expliquait la forme de l’œuvre à venir, son prix, etc.… ([78])
Poussés par leur avidité, la plupart des libraires n’ont pas rempli les conditions du prospectus des ouvrages présentés lors de la souscription. Ainsi, Le journal d’un observateur rapporte le cas qui a concerné la souscription de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert ([79]).
Luneau de Boisjermain est entré de nouveau en scène, mais cette fois comme un des souscripteurs de l’Encyclopédie. Il présenta, le 13 mars 1770, un mémoire concernant l’impression de l’Encyclopédie dans lequel il accusait les libraires, Briasson et Breton, de ne pas avoir respecté les engagements prévus dans le prospectus (publié en 1750) de la souscription de ce vaste dictionnaire. Selon le prospectus de l’Encyclopédie, les libraires associés à l’impression de l’ouvrage s’étaient engagés à livrer aux souscripteurs, entre le 1er octobre 1750 et le 1er mai 1750, moyennant 280 livres, un exemplaire de l’Encyclopédie imprimé en dix volumes, dont deux étaient composés de planches. En réalité, ces clauses n’ont jamais été remplies et les libraires ont plutôt imprimé cet ouvrage en vingt-sept volumes, qu’ils ont vendus au prix de 373 livres ; les souscripteurs se sentirent lésés par cette violation flagrante des articles du prospectus ([80]).
Le procès allait se prolonger jusqu’en 1777 et il est intéressant de voir que, si Le journal d’un observateur consacra plus d’espace aux réquisitoires des libraires qu’aux remontrances de Luneau de Boisjermain (16 articles contre 6 articles), c’était afin de pouvoir déconstruire plus aisément leurs arguments([81]). Par ailleurs, Bachaumont n’hésitait pas à utiliser l’humour pour attirer un large public vers le camp de Luneau de Boisjermain, comme en font foi quelques représentations de certains plaidoyers de Luneau de Boisjermain devant le tribunal ([82]). Toutefois, les défenses de Luneau de Boisjermain étaient mal fondées tandis que les allégations des libraires associés à l’impression de l’Encyclopédie étaient bien documentées, ce qui poussa le tribunal à prononcer son jugement en faveur des imprimeurs et à condamner Luneau de Boisjermain à tous les dépens ([83]).
On ne peut passer sous silence l’intervention de Diderot, directeur de l’Encyclopédie, dans cette cause. Il fit, en effet, parvenir une lettre à la libraire, datée du 31 août 1771, dans laquelle il se portait à leur défense. Dans le Journal d’un observateur, on critiqua cette immixtion de Diderot dans le différend :
On est fâché de le voir se compromettre et s’exposer au soupçon de passer pour le suppôt et le gagiste de ces libraires. On ne voit pas quel autre motif raisonnable a pu le déterminer à se donner ainsi en spectacle et à jouer un personnage, dont il ne peut résulter qu’un grand ridicule pour lui dans le public.([84])
Nos recherches ont toutefois montré que Diderot n’eut pas toujours la même attitude dans cette histoire. En lisant sa correspondance, nous avons trouvé qu’il se plaignait de l’exploitation des imprimeurs de l’Encyclopédie, se rangeant du côté de Luneau de Boisjermain au commencement de son litige avec les libraires associés ([85]). Plus tard, il adoptera une attitude très hostile envers Luneau de Boisjermain, mais pourquoi ? Diderot pensait-il que son soutien pour le camp de Luneau de Boisjermain pouvait nuire à sa relation avec les libraires, d’autant plus que tous les volumes de l’Encyclopédie n’étaient pas encore parus ? Si l’on en croit Proust, dans son étude intitulée Diderot et l’Encyclopédie, la raison de ce revirement imprévu chez Diderot serait l’engagement des libraires à assurer une dot à sa fille ([86]).
De ce qui précède, on peut inférer que l’exploitation, l’injustice et l’hostilité déterminaient une part de la relation auteur-libraire-lecteur à la veille de la Révolution française et ceci, dans un contexte où naissait une bourgeoisie pour laquelle le mercantilisme prenait ses distances avec une pensée aristocratique qui, jusque-là, avait considéré avec un certain dédain le fait de publier un ouvrage avec le dessein d’en tirer un revenu. Toutefois, les relations tendues qui existaient entre les auteurs et les libraires n’étaient que l’un des aspects des difficultés que rencontraient les auteurs lorsqu’il s’agissait de publier un ouvrage. La censure, en effet, constituait un problème non négligeable et plusieurs, pour la contourner, se tournèrent vers la Hollande, beaucoup plus ouverte que la France.
4. La censure
Tous les systèmes despotiques voyaient dans la liberté d’expression une menace considérable mérite d’être répressive. Ils se sont appliqués à enraciner dans l’esprit du public les principes de la soumission et de la sujétion et à éviter tout changement dans le statu quo par tous les moyens juridiques ou policiers. Dès les débuts de l’apparition de l’imprimerie en France, l’Église s’inquiéta de ce nouveau moyen de diffusion des idées et particulièrement de celles qui concernaient la religion « prétendue réformée ». C'est ainsi que le clergé présenta, le 7 juin 1533, une requête à François Ier pour abolir, par un édit, l’art typographique sous le prétexte de sauver le dogme catholique ([87]).
La Cour ne répondit pas à ces sollicitations mais chercha tout de même des moyens pour contrôler le flux des imprimés qui pouvaient contenir des idées subversives ; dans ce but on créa un Index qui comprenait la liste des livres défendus, ceux qui se risquaient à en publier ou à les vendre se voyant menacés d’anathème, voire de l’autodafé en cas de récidive ([88]). Les arrêts et les règlements politiques et religieux se succédaient pour tenter de contrôler les publications de tous genres, qu’il s’agisse de romans ou d’écrits scientifiques. La France, tout particulièrement, a exercé, dès le XVIIe siècle, un contrôle des plus sévères à cet égard. La censure était partout et, bien que, comme nous l’avons vu, son système n’était pas parfait, la liberté d’écrire et la libre pensée étaient menacées ([89]). Sur ce point, Le journal d’un observateur jette un jour intéressant.
Afin d’obtenir le privilège royal pour l’impression et la vente d’un livre, l’auteur devait présenter son manuscrit à la Direction de la librairie, attachée directement à la Cour, qui nommait, par un décret royal, des commissaires, c’est-à-dire des censeurs spécialisés dans le sujet que traitait le manuscrit. On avait l’habitude de déterminer le nombre de ces examinateurs selon les volumes que contenait l’ouvrage : un censeur pour une œuvre en un seul volume et quatre pour examiner les écrits en plusieurs tomes ([90]). Le rapport positif du censeur royal ne représentait qu’une permission d’imprimer le manuscrit, mais l’approbation pour la mise en vente de l’imprimé était délivrée par la police de la librairie qui nommait un autre censeur dont la tâche principale était de vérifier la conformité de l’imprimé avec le manuscrit et avec les corrections exigées ([91]).
Les censeurs royaux jouissaient de prérogatives étendues. Ils ne se contentaient pas d’inspecter les manuscrits, mais ils avaient aussi le droit de donner leur avis sur les écrits circulant dans les salons littéraires et même sur ceux présentés pour un prix académique. Leurs rapports, qu’ils présentaient au Roi, pouvaient mener à retirer le prix de l’Académie. Ainsi, l’Académie française ayant décerné le prix de poésie pour l’année 1764 à Monsieur de Chamfort pour sa pièce intitulée La jeune indienne, un censeur spécialisé dans le domaine de la théologie démontra qu’on trouvait dans ce poème les principes laïques de Rousseau et d’Helvétius ([92]) ; bien que ces accusations aient été fermement rejetées par la commission littéraire de l’Académie, la Direction de la librairie exigea de l’Académie qu’elle lui soumette les écrits présentés au concours à la censure royale.
De même que la police de la librairie, les censeurs royaux n’étaient pas toujours d’une parfaite rectitude morale et acceptaient volontiers de signer une permission de publier contre quelques espèces sonnantes et trébuchantes. Les autorités étaient très attentives aux manœuvres malhonnêtes de ces fonctionnaires royaux et sanctionnaient sévèrement le censeur soudoyé qui pouvait se voir enfermé à la Bastille ([93]). Si une relation d’amitié entre le censeur et l’auteur pouvait faciliter et accélérer les procédures administratives, certains auteurs n’hésitaient pas, pour leur part, à offrir un espace au censeur pour qu’il publie dans leur ouvrage une œuvre de son cru ([94]). Afin de mettre un terme à ces comportements, on défendit qu’il y ait la moindre relation entre l’écrivain et son censeur ([95]) ; en cas de contravention, la Direction de la librairie retirait le nom de l’accusé de la liste de ses censeurs et confisquait le manuscrit de l’écrivain ([96]).
Le journal d’un observateur nous rappelle aussi que les censeurs royaux fréquentaient les théâtres pour s’assurer que le texte de la pièce présentée correspondait bien à celui pour lequel l’auteur avait reçu une approbation. Les comportements des acteurs sur la scène faisaient également l’objet de leur examen. Ils faisaient leur rapport au directeur du théâtre et l’omission de se soumettre à leurs recommandations pouvait entraîner l’interdiction de présenter la pièce et même la fermeture du théâtre ([97]).
Pour les autorités religieuses, ces mesures de la censure manquaient encore de rigueur et, pour endiguer toute forme d’hérésie menaçant le dogme catholique, elles désiraient rendre obligatoire l’approbation de la Faculté de théologie pour obtenir le privilège qui permettait de publier un ouvrage. Le journal d’un observateur a critiqué, dans plus d’une centaine d’articles, l’immixtion de la religion dans le domaine de la vie intellectuelle et scientifique ([98]), rappelant que ses décisions étaient souvent dictées par l’ignorance et le préjugé ([99]).
Mais toutes ces mesures répressives ne réussissaient pas à endiguer la circulation des ouvrages les plus audacieux, des nouvelles à la main et des pamphlets, lesquels étaient imprimés clandestinement et circulaient sous le manteau à Paris. Les écrivains des ouvrages refusés par la Direction de la librairie ne mettaient pas les armes, mais ils confiaient leurs manuscrits aux imprimeurs étrangers (en Hollande, le plus souvent) et la vente aux colporteurs. Le risque, bien entendu, n’était pas absent et ceux qui se faisaient prendre dans ce jeu de cache-cache avec la censure, se retrouvaient à la Bastille et l’imprimeur voyait son commerce fermé ([100]).
CONCLUSION
Pour conclure, le plagiat littéraire, le conflit entre les gens de lettres et les libraires de même que la censure constituaient quelques-uns des problèmes essentiels qui occupaient la République des Lettres à la veille de la Révolution française. Toutefois, la diffusion des idées, le droit au libre arbitre et à la libre-pensée demeuraient des enjeux majeurs pour nombre de philosophes et d’auteurs et, à cet égard, l’imprimerie tout comme la circulation d’ouvrages sous le manteau résistèrent aux nombreux arrêts de la Cour et aux condamnations que réclamait l’Église. Ainsi, de tous ceux qui ont bravé les interdits dans ce siècle des Lumières, on peut dire qu’ils ont sans doute contribué à éclairer les esprits et cherché à agir selon cette formule de Kant qui, à la question Qu’est-ce que les Lumières ? (1784), répond qu’elle est « la sortie de l’homme de sa minorité dont il est lui-même responsable », la minorité étant « l’incapacité de se servir de son entendement sans la direction d’autrui.»([101]).
Ouvrages cités
Corpus
Louis Petit de Bachaumont, Pidansat de Mairobert, Mouffle d'Angerville: Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des Lettres en France, depuis MDCCLXII, ou Journal d'un observateur, contenant les analyses des pièces de théâtre qui ont paru durant cet intervalle, les relations des assemblées littéraires…, Londres, chez John Adamson, 1789, 36 volumes (11734 pages).
Ouvrages sur l'édition et l'imprimerie
-André Chevillier :L’origine de l’imprimerie de Paris. Dissertation historique et critique divisée en quatre parties, Paris, éd. J. de Laulne, 1694 (472 pages).
-Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes :Mémoires sur la librairie et sur la liberté de la presse, Paris, Agasse, 1809 (435 pages).
-Code de la librairie et imprimerie de Paris, ou Conférence du règlement arrêté au Conseil d’État du Roy, le 28 février 1723[...] avec les anciennes ordonnances [...] depuis l’an 1332 jusqu’à présent, Paris, Quillau, 1744 (573 pages).
-Jules Andrieu:La censure et la police des livres en France sous l’Ancien Régime : une saisie de livres à Caen en 1775, Paris, J. Michel et Médan, 1884 (55 pages).
-Lettres iroquoises, ou correspondance politique, historique et critique entre un iroquois voyageant en Europe, et ses correspondants, Londres, Au berceau de la vérité, 1783, t. II(306 pages).
-Louis-Pierre Manuel :La police de Paris dévoilée, Paris, J. B. Garnery, 1793. t. I(440 pages).
Ouvrages sur le journalisme
-Édouard Fournier:Variétés historiques et littéraires : recueil de pièces volantes rares et curieuses en prose et en vers, Paris, Pagnerre, 1855-1863, t. VIII (352 pages).
-Eugène Hatin :Histoire politique et littéraire de la presse en France : avec une introduction historique sur les origines du journal et la bibliographie générale des journaux depuis leur origine, Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1859, t. I (505 pages).
-Eugène Hatin,Le journal, Paris, Librairie Germer Baillière et Cie, 1800(198).
-Frantz Funck Brentano : Figaro et ses devanciers, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1909 (400 pages).
-Gabriel Peignot :Essai historique sur la liberté d’écrire chez les anciens et au moyen âge ; sur la liberté de la presse depuis le XVe siècle, et sur les moyens de répression dont ces libertés ont été l’objet dans tous les temps [...] suivi d’un tableau synoptique de l’état des imprimeries en France en 1704, 1739, 1810, 1830, et d’une chronologie des lois sur la presse de 1789 à 1831, Paris, Crapelet,1832(233 pages).
-Mélanie Blais :Une plume pour écrire, une feuille à envoyer. Les nouvellistes à la main à Paris au XVIIIe siècle, mémoire présenté pour l’obtention du grade de Magistère, Université de Sherbrooke, décembre 2002(195 pages).
Ouvrages généraux
-Daniel Roche :Le siècle des Lumières en province. Académie et académiciens provinciaux, 1680-1789, Paris, Mouton, 1978, t. I (394 pages).
-Denis Diderot :Correspondance, Paris, Minuit, 1964, t. XI (272 pages).
-DenisDiderot et Jean Le Rond D’Alembert :Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Lausanne, chez les Sociétés Typographiques, 1781, vol. XXXI, (660 pages).
-Denis Diderot : Œuvres de Denis Diderot publiées sur les manuscrits de l’auteur, Paris, Deterville, 1800, t. IV (550 pages).
-Édouard Fournier :Chroniques et légendes des rues de Paris, Paris, Dentu, 1864, p. 279.
-Feuillet de Conches :Les salons de conversation au dix-huitième siècle, Paris, Charavay frères, 1882 (227 pages).
-François Ravaisson Mollien :Archives de la Bastille : documents inédits, Paris, Durand et Pedone-Lauriel, 1866, t. XVI (522 pages).
-Gustave Vapereau :Dictionnaire universel des littératures, Paris, Hachette, 1876(2096 pages).
-Jacques Saint-Germain :La vie quotidienne à la fin du Grand Siècle, Paris, Hachette, 1965(320 pages).
-Jean-Jacques Rousseau :Les confessions, Paris, Firmin-Didot frères, 1844(622 pages).
-Louis-Antoine Caraccioli, Louis Sébastien Mercier :Les entretiens du Palais-Royal, Paris, Buisson, 1788, t. II (219 pages).
-Nicolas Boileau-Despréaux :L’art poétique, Paris, Delalain, 1815, chant IV, p. 36.
-PaulHasard :La crise de la conscience européenne (1680-1715), Paris, éd. Boivin et Cie, 1935(474 pages).
-Roger Chartier :Les origines culturelles de la Révolution française, Paris, Seuil, 1990 (244 pages ).
-Voltaire :Correspondance, Paris, Gallimard, 1963, t. X, p. 15).
Les articles parus dans les périodiques informatisées :
-Denis Malo, « Diderot et la librairie : l’impensable propriété »,Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, no 10, 1991, p. 57-90, [en ligne] :http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rde_07690886_1991_num_10_1_1100; page consultée le 6 mars 2013).
-Édouard Langille,L’histoire de Tom Jones, ou l’enfant trouvé (1750) et la genèse de Candide, Paris,Presses universitaires de France/Revue d’histoire littéraire de la France, 2008/2, vol. 108, p. 269-287, [en ligne] :http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=RHLF&ID_NUMPUBLIE=RHLF_082&ID_ARTICLE=RHLF_082_0269 (pageconsultée le 5 mars 2012).
-Emmanuel Kant :Qu’est-ce que les Lumières ? (1784), [en ligne] :http://www.cvm.qc.ca/encephi/contenu/textes/kantlumieres.htm
-François Moureau, « Informer et diffuser la pensée dans la France du dernier siècle de l’Ancien Régime »,Lumen, vol. 28 (Travaux choisis de la Société canadienne d’étude du dix-huitième siècle), 2009, p. 29-50, [en ligne] :http://id.erudit. org/iderudit/1012036ar (page consultée le 2février 2012).
-Gazette de France, [en ligne] :http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41590953d ; page consultée le 10 février 2012).
-Hélène Maurel-Indart, « Le plagiat littéraire : une contradiction en soi ? »,L’information littéraire, 2008/3, vol. 60, p. 55-61, [en ligne] :http://www.cairn.info/revue-l-information-litteraire-2008-3-page-55.htm (pageconsultée le 26 février 2012).
-Jean-Marc Civardi, « Quelques critiques adressées auCid de Corneille en 1637-1638 et les réponses apportées »,L’information littéraire, 2002/1, vol. 54, p. 12-26, [en ligne] :http://www.cairn.info/revue-l-information-litteraire-2002-1-page-12.htm(page consultée le 30 février 2012).
-Omont Henry, « Un plagiat littéraire au XIIesiècle. La vie de saint Willibrord, évêque d’Utrecht, par le prêtre Egbert », dansComptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, n. 1, 1903, 47e année, p. 98-100, [en ligne] :http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1903_num_47_1_19293(page consultée le 26 février 2012).
Les articles parus dans les périodiques :
-Alexandre Eckhardt, « Ronsard accusé de plagiat. L’invention de l’églogue », Revue du Seizième Siècle, tome VII, 1920, p. 235-247.
([1])-«Chercher depuis quand le journal existe, c’est en apparence, chercher depuis quand les hommes sont sociables, tant la vie commune nous semblerait impossible aujourd’hui sans ce merveilleux instrument de communication.» (Eugène Hatin, Le journal, Paris, Librairie Germer Baillière et Cie, 1800, p. 7.)
([2])-Cf. François Moureau, « Informer et diffuser la pensée dans la France du dernier siècle de l’Ancien Régime », Lumen, vol. 28 (Travaux choisis de la Société canadienne d’étude du dix-huitième siècle), 2009, p. 29-50, [en ligne] : http://id.erudit. org/iderudit/1012036ar (page consultée le 2 février 2012).
([4])-Plusieurs études sont consacrées à ce thème : on peut citer à titre d’exemple, Jean-Pierre Seguin : L’information en France avant le périodique. 517 canards imprimés entre 1529 et 1631, Paris, G.-P. Maisonneuve et Larose, 1964 et Maurice Lever : Canards sanglants, naissance des faits divers, Paris, Fayard, 1993.
([6])-Citons un passage d’un article du premier numéro : « De Constantinople, le 2 avril 1631. – Le roi de Perse, avec 15 mille cheveux et 50 mille hommes de pied, assiège Dille, à deux journées de la ville de Babylone, où le Grand Seigneur a fait faire commandement à tous ses janissaires de se rendre sous peine de la vie, et continue, nonobstant ce divertissement-là (cette diversion) à faire toujours une âpre guerre aux preneurs de tabac, qu’il fait suffoquer par la fumée » (Gazette de France, [en ligne] : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41590953d ; page consultée le 10 février 2012).
([7])-Il serait utile de souligner que cette ordonnance a été modifiée plusieurs fois, par exemple en 1757 et en 1777.
([8])-Cf. Code de la librairie et imprimerie de Paris, ou Conférence du règlement arrêté au Conseil d’État du Roy, le 28 février 1723 [...] avec les anciennes ordonnances [...] depuis l’an 1332 jusqu’à présent, Paris, Quillau, 1744.
([9])-« Alors le Censeur donnera son jugement par écrit à M. le Chancelier, pour décider si la permission doit être accordée ; mais il ne donnera au public que le certificat qu’il a lu l’ouvrage ; ce qui ne peut jamais le compromettre » (Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes : Mémoires sur la librairie et sur la liberté de la presse, Paris, Agasse, 1809, p. 36).
([10])-Une pénalité rigoureuse fut d’ailleurs plusieurs fois appliquée : « Je n’ai pas à dresser ici un martyrologe bibliographique ; qu’il me suffise de citer le malheureux Martin Hommet qui [...] fut pendu à Paris pour avoir imprimé et mis en vente un pamphlet contre les Guises [...] Je rappelle encore le compagnon imprimeur Rambault qui fut soumis à la question et pendu avec le garçon relieur Larcher pour l’impression et la vente d’un libelle qui dut blesser vivement Louis XIV » (Jules Andrieu: La censure et la police des livres en France sous l’Ancien Régime : une saisie de livres à Caen en 1775, Paris, J. Michel et Médan, 1884, p. 11).
([11])-Cf. Louis-Pierre Manuel : La police de Paris dévoilée, Paris, J. B. Garnery, 1793. t. I, p. 30-31.
([12])-« Le nouvellisme, qui d’abord n’avait été qu’une manie de curieux ou d’oisifs, devint un métier pour certains coureurs de nouvelles, qui se mettaient aux gages de quelque grand personnage, qu’ils avaient charge de tenir au courant des bruits de la ville » (Eugène Hatin : Histoire politique et littéraire de la presse en France : avec une introduction historique sur les origines du journal et la bibliographie générale des journaux depuis leur origine, Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1859, t. I, p. 47).
([13])-Le prix de l’abonnement de la nouvelle à main était de 6 livres par mois pour quatre pages in-4°, et de 12 livres pour huit pages. À ce propos, on peut consulter Édouard Fournier : Variétés historiques et littéraires : recueil de pièces volantes rares et curieuses en prose et en vers, Paris, Pagnerre, 1855-1863, t. VIII, p. 269.
([14])-« Ce confident des ministres est remarquable par un nez d’une grosseur énorme et qui s’apperçoit de fort loin. Tu ne peux te former une idée de la considération dont jouit ce nouvelliste ; il tient ses audiences lorsqu’il fait beau dans un des jardins du grand chef; […] il est toujours entouré d’une cour nombreuse.» (Lettres iroquoises, ou correspondance politique, historique et critique entre un iroquois voyageant en Europe, et ses correspondants, Londres, Au berceau de la vérité, 1783, t. II, p. 80).
([15])-La conspiration constituait une part essentielle de la vie de la Cour. À cet égard, la plupart des rois dans toute l’Europe et surtout en France avait des gazetiers à gages pour les informer de toutes les nouvelles concernant les courtisans. Après l’échec de la cabale des Importants, ou conjuration des Importants, nom donné au complot fomenté par quelques hommes de la Cour contre Mazarin, ce dernier eut recours au service des nouvellistes pour tenter de connaître les projets de ses ennemis : « les grands seigneurs avaient leur nouvelliste ou gazetier à gages, chargé de leur rapporter tous les scandales et toutes les aventures piquantes de la ville. Mazarin payait dix livres par mois un nommé Portail, pour lui "fournir des nouvelles toutes les semaines" » (Gustave Vapereau : Dictionnaire universel des littératures, Paris, Hachette, 1876, p. 1494).
([16])-Le rapport de l’inspecteur de police Poussot, daté du 16 mars 1717, cité par Brentano, confirme cette participation féminine dans le commerce des nouvelles : « La nommé Laboulaye est femme d’un sergent aux gardes françaises. Elle a déjà été plusieurs fois saisie (à cause de son métier de nouvelliste) » (Frantz Funck Brentano : Figaro et ses devanciers, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1909, p. 56).
([17])-« Mais comment n’a-t-on encore établi la confrérie des Nouvellistes, comme il y a celle des Francs-Maçons ? On s’assemblerait trois fois par semaine ; chaque associé serait obligé de fournir une nouvelle, et de payer une amende lorsqu’elle serait fausse. Les discours ne rouleraient que sur des nouveautés.» (Louis-Antoine Caraccioli, Louis Sébastien Mercier : Les entretiens du Palais-Royal, Paris, Buisson, 1788, t. II, p. 164).
([18])-« Enfin, de même que la police autorise l’envoi d’articles censurés aux abonnés, elle semble avoir adopté un troisième moyen pour solutionner ses problème de contrôle. Elle offre à certains nouvellistes des privilèges pour la rédaction de nouvelles à la main ; elle en engage qui écrivent notamment des gazettes manuscrites remplies d’éloges pour la France » (Mélanie Blais : Une plume pour écrire, une feuille à envoyer. Les nouvellistes à la main à Paris au XVIIIe siècle, mémoire présenté pour l’obtention du grade de Magistère, Université de Sherbrooke, décembre 2002, p. 123).
([19])-À cette époque, le personnage du nouvelliste inspira plusieurs ouvrages : Louise-Geneviève Gillot de Beaucour : Le galant nouvelliste : histoire du temps, 1693 ; Jean-Paul de Rome d’Ardène : Le nouvelliste, comédie en trois actes et en vers, 1743 ; Charles-François Panard : Le nouvelliste dupé, opéra-comique, en un acte, 1757.
([20])-Il est difficile de connaître le nombre de nouvellistes embastillées, mais on peut citer comme exemple le cas de Noël : « Berryer à D’Argenson. 9 janvier 1752. Noël, commis de l’intendant de M. le comte de Caraman, etc., demande sa liberté. A été arrêté pour raison de nouvelles à la main, ayant été accusé par Baize, autre nouvelliste qui venait d’être arrêté et conduit à la Bastille. On n’a rien trouvé chez Noël quand on y a fait perquisition, mais comme il était chargé par Baize, et qu’il s’était mêlé autrefois de nouvelles, on ne put se dispenser de le mettre à la Bastille » (François Ravaisson Mollien : Archives de la Bastille : documents inédits, Paris, Durand et Pedone-Lauriel, 1866, t. 16, p. 195).
([21])-Cf. Jacques Saint-Germain : La vie quotidienne à la fin du Grand Siècle, Paris, Hachette, 1965, p. 260.
([23])-Cf. Feuillet de Conches : Les salons de conversation au dix-huitième siècle, Paris, Charavay frères, 1882, p. 109.
([25])-Dans les dernières années de sa vie, Bachaumont a réuni tous les numéros du Journal d’un observateur, de 1762 jusqu’à 1771, dans un recueil intitulé Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la République des lettres en France depuis MDCCLXII jusqu’à nos jours, ou Journal d’un Observateur, contenant les analyses des pièces de théâtre qui ont paru durant cet intervalle ; les relations des assemblées littéraires ; les notices des livres nouveaux, clandestins, prohibés ; les pièces fugitives, rares ou manuscrites, en prose ou en vers ; les vaudevilles sur la Cour ; les anecdotes et bons mots ; les éloges des savants, des artistes, des hommes de lettres morts [...]. Après la mort de Bachaumont et de Madame Doublet, Mathieu François Pidansat de Mairobert, censeur royal et secrétaire de la rédaction du Journal d’un observateur, a continué à publier ce journal puis Moufle d’Angerville s’est chargé de cette mission jusqu’à la fin de l’année 1778, date du dernier numéro de ces nouvelles à la main.
([26])-Pour les citations de ce Journal, nous nous sommes basé sur le recueil des articles de 1762 jusqu’à 1787 imprimé à Londres en 1789 chez John Adamson en 36 volumes. Afin d’éviter d’alourdir le texte, nous avons corrigé l’orthographe du Journal en français moderne et l’ouvrage sera désormais désigné par le sigle JO, suivi de la date de l’article, du volume et de la page.
([27])-Cf. Omont Henry, « Un plagiat littéraire au XIIe siècle. La vie de saint Willibrord, évêque d’Utrecht, par le prêtre Egbert », dans Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, n. 1, 1903, 47e année, p. 98-100, [en ligne] : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1903_num_47_1_19293 (page consultée le 26 février 2012).
([28])-Cf.Alexandre Eckhardt, « Ronsard accusé de plagiat. L’invention de l’églogue », Revue du Seizième Siècle, tome VII, 1920, p. 235-247.
([29])-Sur la querelle du Cid, on peut consulter Jean-Marc Civardi, « Quelques critiques adressées au Cid de Corneille en 1637-1638 et les réponses apportées », L’information littéraire, 2002/1, vol. 54, p. 12-26, [en ligne] : http://www.cairn.info/revue-l-information-litteraire-2002-1-page-12.htm (page consultée le 30 février 2012).
([30])-Cf. Hélène Maurel-Indart, « Le plagiat littéraire : une contradiction en soi ? », L’information littéraire, 2008/3, vol. 60, p. 55-61, [en ligne] : http://www.cairn.info/revue-l-information-litteraire-2008-3-page-55.htm (page consultée le 26 février 2012).
([31])-On peut compter, dans tous les numéros de Bachaumont, environ 40 cas de plagiat sur toutes les scènes intellectuelles (articles de journaux, pièces de théâtre, poèmes, musique, etc.).
([32])-Edme-Louis Billardon de Sauvigny (Auxerre 1738, †Paris 1812) est un homme de lettres et dramaturge français. Parmi ses ouvrages, on peut citer : Réflexions en vers sur l’héroïsme, Le Persifleur, comédie en trois actes et en vers, Encyclopédie des dames, ouvrage destiné à l’instruction du beau sexe.
([34])-Les feuilles de Fréron étaient entièrement consacrées à critiquer les philosophes des Lumières au nom de la religion et de la monarchie.
([35])-Ce ne serait pas la première fois que Voltaire aurait pillé les ouvrages des autres écrivains et surtout des étrangers, son roman Candide s’inspirant de celui d’Henry Fielding publié sous le titre de Tom Jones ou L’enfant trouvé ; pour en savoir plus, voir l’étude d’Édouard Langille, L’histoire de Tom Jones, ou l’enfant trouvé (1750) et la genèse de Candide, Paris, Presses universitaires de France/Revue d’histoire littéraire de la France, 2008/2, vol. 108, p. 269-287,
[en ligne] : http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=RHLF&ID_NUMPUBLIE=RHLF_082&ID_ARTICLE=RHLF_082_0269 (page consultée le 5 mars 2012).
([36])-Cf. JO, 4 octobre 1764, vol. II, p. 100 ; JO, 22 mars 1765, vol. II, p. 170 ; JO, 30 septembre 1771, vol. V, p. 328.
([38])-« Que d’effort n’a-t-on pas fait pour m’étouffer en naissant ? Après la persécution du Fils naturel, croyez-vous, ô mon ami ! Que je dusse être tenté de m’occuper du Père de famille ? Le voilà cependant. Vous avez exigé que j’achevasse cet ouvrage ; et je n’ai pu vous refuser cette satisfaction. En revanche, permettez-moi de dire un mot de ce Fils naturel si méchamment persécuté » (Œuvres de Denis Diderot publiées sur les manuscrits de l’auteur, Paris, Deterville, 1800, t. IV, p. 455).
([39])-Le Journal de Bachaumont constitue, à notre connaissance, la seule référence de ce siècle qui ait cité ce titre. Nous n’avons trouvé aucune trace de cet ouvrage dans les écrits et les études du XVIIIe siècle, ce qui nous pousse à croire qu’il s’agit d’une œuvre inédite.
([41])-« Il se répandit [...] un bruit que je n’étais pas l’auteur du Devin du village. Comme je ne fus jamais un grand croque-note, je suis persuadé que sans mon Dictionnaire de Musique, on aurait dit à la fin que je ne la savais pas. » Par ailleurs, il se justifie sur la paternité de son œuvre dans ses Dialogues, où il estime qu’elle est marquée d’une « empreinte impossible à méconnaître. » Il insiste : « si j’ignorais quel est l’auteur du Devin du village, je le sentirais à cette conformité » (Jean-Jacques Rousseau : Les confessions, Paris, Firmin-Didot frères, 1844, p. 360).
([46])-Marc-Antoine-Jacques Rochon de Chabanne (Paris 1730 - † Paris 1800), dramaturge français. Sa production est très riche de comédies et d’opéras comiques ; on peut citer, à titre d’exemple : La coupe enchantée, opéra-comique en un acte et Le jaloux, comédie en cinq actes et en vers libres.
([51])-Les nouvelles à la main de Bachaumont donnaient une description de l’Opéra au cours d’une représentation : « Toutes les loges étaient louées ; il y avait du monde dès midi, et la salle regorgeait, ainsi que les corridors, les galeries, les avenues » (JO, 24 novembre 1767, vol. III, p. 257).
([52])-Les articles du Journal d’un observateur montraient la relation solide existant entre les membres de l’Opéra de Paris et le Roi et la famille royale. Lisons cette nouvelle, datée du 24 mars 1763 : « L’Anglois à Bordeaux a été joué à la cour. Le roi, la reine et la famille royale ont voulu voir l’auteur : en conséquence Favart s’y est rendu. Il a été accueilli avec beaucoup de bonté.» (JO, 24 mars 1763, vol. I, p. 194).
([53])-Citons, à titre d’exemple, cette annonce : « les Comédiens français donneront aujourd’hui le Fat puni et Impertinent. Le St. Larive remplira les deux rôles » (JO, Annexe, vol. XIV, p. 345).
([57])-Paul Hasard, La crise de la conscience européenne (1680-1715), Paris, éd. Boivin et Cie, 1935, p. 3.
([59])-À cet égard, rappelons ces vers de l’Art poétique de Boileau :
Je sais qu’un noble esprit peut sans honte et sans crime
Tirer de son travail un tribut légitime ;
Mais je ne puis souffrir ces auteurs renommez
Qui dégoûtez de gloire, et d’argent affamez
Mettent leur Apollon aux gages d’un Libraire
Et font d’un Art divin un métier mercenaire !
Nicolas Boileau-Despréaux : L’art poétique, Paris, Delalain, 1815, chant IV, p. 36.
([60])-Daniel Roche, dans son livre Le siècle des Lumières en province. Académie et académiciens provinciaux, 1680-1789, compte 1000 titres par an en 1720 et, pour la seconde moitié du XVIIIe siècle, environ 3500 titres par an (Paris, Mouton, 1978, t. I, p. 90).
([61])-« Les ambitions inédites d’auteurs qui ne veulent vivre que de leur plume créent un marché des œuvres qui obéit à ses lois propres et qui rétribue directement, sans le détour des pensions et sinécures, le travail d’écriture » (Roger Chartier : Les origines culturelles de la Révolution française, Paris, Seuil, 1990, p. 90).
([62])-À ce propos, on peut lire ce passage de L’origine de l’imprimerie de Paris :« un auteur trop intéressé à qui on doit s’en prendre ; et qui pour avoir tiré une somme considérable du libraire, c’est cause qu’on ne peut avoir un livre à un prix raisonnable ; conduite, à mon avis, peu digne d’un homme de lettres qui ne doit être animé quand il compose que de la vue d’un bien public. Le commerce qu’il fait de sa plume et dans lequel il ne se propose que le gain, rabaisse sa qualité à celle d’un négociant et ce n’est plus qu’une âme commune agitée d’une basse idée de gagner de l’argent.» (André Chevillier : L’origine de l’imprimerie de Paris. Dissertation historique et critique divisée en quatre parties, Paris, éd. J. de Laulne, 1694, p. 380).
([63])-Dans son article, Bachaumont ne cite pas le nom de l’auteur de cette brochure, mais il déclare qu’« un anonyme a répandu une brochure intitulé : Avis aux gens de lettres ». En consultant cette brochure sur le site (Gallica) de la Bibliothèque Nationale de France, nous avons trouvé le nom de l’auteur écrit à la main : Charles-Georges de Fenouillot de Falbaire de Quingey. Étant donné que l’auteur de cette brochure n’a pas obtenu l’autorisation (le privilège du roi) de la publier, il a sans doute choisi l’anonymat pour être en abri de la poursuite et de la censure.
([66])-Code de la librairie et imprimerie de Paris, ou Conférence du règlement arrêté au Conseil d’Etat du Roy, le 28 février 1723 [...] avec les anciennes ordonnances [...] depuis l’an 1332 jusqu’à présent, Titre II (Des imprimeurs et libraires en général), article (Défense de faire le commerce de livres sans qualité), p. 26.
([68])-Les auteurs engagèrent Linguet, un avocat célèbre de Paris, pour défendre Luneau de Boisjermain.
([69])-Voltaire était à la tête de la liste des écrivains de grand talent qui se rangeaient irrévocablement du côté de Luneau de Boisjermain. Dans la lettre qu’il lui envoie, le philosophe de Ferney met en relief les raisons de la condition sommaire des gens lettres : « Il me paraît que les toiliers, les droguistes, les vergetiers, les menuisiers, les doreurs, n’ont jamais empêché un peintre de vendre son tableau, même avec sa bordure. M. le doyen du parlement de Bourgogne veut bien me vendre tous les ans un peu de son bon vin, sans que les cabaretiers ne lui aient jamais fait de procès. Pour les gens de lettres, c’est une autre affaire, il faut qu’ils soient écrasés, attendu qu’ils ne font point corps, et qu’ils ne sont que des membres très épars.» (Voltaire : Correspondance, Paris, Gallimard, 1963, t. X, p. 15).
([75])-« Il est certain que le directeur actuel de la librairie a trouvé dans son tarif une mine d’or, s’il peut le maintenir sur le pied qu’il a imaginé. Pour une édition in folio, chaque volume, tiré à 1500 exemplaires=240. Pour une édition in-4. Idem=120 livres. Pour une édition in-8. Idem=60 livres. Pour une édition in-12. Idem=30 livres. Pour une édition in-16. Idem=15 livres » (JO, 3 juillet 1779, vol. XIV, p. 107).
([76])-« Monsieur Albert joint à la place de lieutenant-général de police, l’inspection de la librairie, partie bien essentielle dans un moment où les écrivains se tournent vers la politique et le gouvernement, et où tout le monde écrit sur ces matières » (JO, 12 mai 1775, vol. VIII, p. 29).
([77])-Denis Diderot et Jean Le Rond D’Alembert : Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Lausanne, chez les Sociétés Typographiques, 1781, Partie II, vol. XXXI, p. 527.
([78])-Cf. Code de la librairie et imprimerie de Paris, ou Conférence du règlement arrêté au Conseil d’Etat du Roy, le 28 février 1723 [...] avec les anciennes ordonnances [...] depuis l’an 1332 jusqu’à présent, Titre III (Des souscriptions), article XVII (Seront proposées par les libraires ou imprimeurs seulement) p. 126.
([81])-« Le procès concernant l’Encyclopédie se réveille. Les libraires associés à l’impression de cet ouvrage, par une astuce digne de leur mauvaise foi, ne veulent pas délivrer aux souscripteurs les derniers volumes de planches qu’ils ne donnent un certificat qui décharge lesdits libraires associés de tous les engagements qu’ils ont pu prendre avec eux, lesquels ils annulent, ayant été pleinement remplis, et etc. [...]. Ils espèrent par cette manœuvre dépouiller certainement de leurs titres les personnes que ne sont point instruites de l’infidélité contre laquelle on réclame.» (JO, 13 février 1773, vol. VI, p. 286).
([82])-« Le jour est indiqué à mercredi 11, et l’orateur, qui se sent apparemment les forces nécessaires pour jouer son personnage, fait courir des billets portant invitation de se trouver à la chancellerie du palais à huit heures du matin, où sera le spectacle qu’il annonce.» (JO, 18 août 1771, vol. V, p. 298). « La macération de son visage a parfaitement fécondé la commisération qu’il a voulu exciter, et son organe d’ailleurs quoiqu’affaibli par la douleur s’est prêté au volume de voix nécessaire pour le vaisseau de la grand’chambre où il parle.» (JO, 12 mai 1772, vol. VI, p. 136).
([85])-Il écrivit, le 13 octobre 1769, cette lettre à Sartine pour se plaindre de l’injustice des imprimeurs dans son grand projet, l’Encyclopédie : « N’est-il pas bien étrange que j’aie travaillé trente ans pour les associés de l’Encyclopédie ; que ma vie soit passée, qu’il leur reste deux millions, et que je n’aie pas un sol ? - A les entendre, je suis trop heureux d’avoir vécu.» (Denis Diderot : Correspondance, Paris, Minuit, 1955, vol. 9, p. 171).
([86])-Cf. Jacques Proust : Diderot et l’Encyclopédie, Paris, Armand Colin, 1962. En outre, Denis Malo a confirmé cette hypothèse dans son étude en signalant une lettre de Diderot à Sophie Volland datée du 14 juillet 1762 : « Je me suis arrangé avec les libraires. Mon travail me déplaît moins depuis que je suis soutenu par l’espérance de préparer la dot de ma fille. Autrefois sa mère aimait le luxe pour moi [...]. Mais il est inutile de vous achever cette histoire » (Corr., IV, 43, cité dans Denis Malo, « Diderot et la librairie : l’impensable propriété », Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, no 10, 1991, p. 57-90, [en ligne] : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rde_07690886_1991_num_10_1_1100 ; page consultée le 6 mars 2013).
([87])-Cf. Gabriel Peignot : Essai historique sur la liberté d’écrire chez les anciens et au moyen âge ; sur la liberté de la presse depuis le XVe siècle, et sur les moyens de répression dont ces libertés ont été l’objet dans tous les temps [...] suivi d’un tableau synoptique de l’état des imprimeries en France en 1704, 1739, 1810, 1830, et d’une chronologie des lois sur la presse de 1789 à 1831, Paris, Crapelet, 1832, p. 54.
([88])-Le premier index français des livres défendus a été publié en 1543. Cf. Gabriel Peignot, op. cit., p. 55.
([89])-Le thème de la censure royale au XVIIIe siècle a été traité par plusieurs chercheurs au dix-huitième et au dix-neuvième siècle. Citons à titre d’exemple : Gabriel Peignot, op. cit. ; Jules Andrieu, op. cit. ; Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, op. cit.
([90])-« Le roi vient de nommer quatre commissaires à l’effet d’examiner un ouvrage immense, auquel travaille depuis longtemps M. Barletti de Saint-Paul, ancien secrétaire du protectorat de France en cour de Rome, et membre de plusieurs académies. Le titre de cet ouvrage porte Institution nécessaire ou Cours complet d’Education et relative, dans lequel on trouve la vraie méthode d’étudier et d’enseigner les différentes sciences convenables aux deux sexes, à tous les âges et à tous les états. Les commissaires choisis sont MM. Bonami et de Guignes membres de l’Académie des Belles Lettres, et MM. de Moncarville et de Passe, censeurs royaux.» (JO, 8 septembre 1764, vol. II, p. 90).
([93])-« Il passe pour constant que le Sr. Marin, censeur de la police, a été 24 heures à la Bastille pour avoir passé les vers d’une pièce faite par M. Dorat.» (JO, 6 mars 1763, vol. I, p. 183).
([94])-« M. Colardeau pour satisfaire ses critiques, vient de faire réimprimer sa lettre amoureuse d’Héloïse à Abaillard, avec la traduction de divers morceaux qu’on lui reprochait d’avoir élagués. Nous croyons qu’il aurait pu être moins docile, le goût est la première qualité d’un traducteur, surtout Anglais. On a ajouté une vie d’Abaillard de la plume de monsieur Marin, censeur royal.» (JO, 8 novembre 1766, vol. III, p. 96).
([96])-« M. Helvétius est mort, il y a quelques jours, d’une goutte remontée. C’était le fameux auteur du livre De l’Esprit pour lequel il a essuyé tant de persécutions ainsi que son censeur et ami M. Texier. On lui reproche de n’avoir pas reconnu comme il convenait l’importance du service qui avait coûté si cher à ce dernier puisqu’il en avait perdu sa place […] » (JO, 29 décembre 1771, vol. VI, p. 70).
([98])-Ainsi, par exemple, en ce qui concerne l’introduction de l’inoculation contre la petite vérole, la Faculté de théologie de Paris s’y opposa : « Quant à la faculté de théologie, il suffit que ce soit une nouveauté pour être réputé condamnable […] » (JO, 24 juin 1763, vol. I, p. 237). Quant au comte de Lauraguais, qui défendait les principes de l’inoculation, il s’est vu arrêté et conduit « par ordre du Roi à la citadelle de Metz » pour avoir envoyé un mémoire en ce sens à M. de St. Florentin et des lettres au comte de Bissy et au comte de Noailles, dans lesquelles il aurait parlé de la « Faculté de théologie, du Parlement et de quelques personnes de la cour.» (JO, 16 juillet 1763, vol. IV, p. 286-287).
([99])-Ainsi, nous rapporte le Journal, « M. l’abbé Yvon [...] avait entrepris une Histoire ecclésiastique [...]. M. l’Archevêque [...], entouré d’hommes ignorants et à préjugés, s’est absolument opposé à la publication [...] de cette histoire [...]. En vain l’Abbé a demandé ce qu’on trouvait de répréhensible dans son ouvrage.» (JO, 22 avril 1768, vol. IV, p. 14-15).
![]() Télécharger l’article en version PDF
Télécharger l’article en version PDF
« HISTORIAL: Le Dasein doit être compris selon l’enchaînement de sa vie en une mobilité spécifique constituant son provenir (Geschehen) dont l’historialité est la structure ontologique.
Le Dasein se décide pour des possibles dont il hérite, se délivrant à lui-même en une possibilité à la fois héritée et choisie. L’histoire ne tire son poids ni du passé ni du présent enchaîné au passé, mais du provenir de l’existence jaillissant de l’avenir. » (BLAY, 2007, 370)
Résumé
Puisant dans les ressources conceptuelles (pour ne pas dire théâtrales) de la sémiotique et des philosophies derridienne et deleuzienne, cet article se propose d’explorer le théâtre artaudien. La machine théâtrale d’un Antonin Artaud, à l’image du dispositif alchimique par exemple, est une puissante machine temporelle. Du coup la littérature nous plonge dans une historialité à l’intérieur de laquelle faire preuve d’originalité c’est s’inscrire dans une différance qui est une manière d’être fidèle à une origine qui ne cesse de se dérober.
Mots-clés:Actualisation, avant-garde, bricolage, cosmogonie, cruauté, devenir, dissémination, dramatisation,
éclaircie, ésotérisme, genre, gnosticisme, hiéroglyphe, historialité, initiation, médiatisation, moderne, performance, peste, principe, scène, temps, théâtre, tourbillon, virtualisation, vivre.
Abstract
Drawing from the abstract or theatrical resources of semiotics and philosophies of Jacques Derrida and Gilles Deleuze, this article explores the theater of Antonin Artaud. The theatrical machine of an Antonine Artaud, just like the alchemical device, for example, is a powerful temporal machine. Consequently, the literature plunges us into the historical aspect inside which to show originality means to be different, which is a way of being faithful to an origin which does not stop shying away.
Key words:Actualisation, avant-garde, bricolage, cosmogonie, cruauté, devenir, dissémination, dramatisation,
éclaircie, ésotérisme, genre, gnosticisme, hiéroglyphe, historialité, initiation, médiatisation, moderne, performance, peste, principe, scène, temps, théâtre, tourbillon, virtualisation, vivre.
Introduction
Cet article est d’abord une application pratique des concepts de l’histoire littéraire (voir Moisan 1987). Cette méthode trop rapidement disqualifiée par Roland Barthes (1963) nous semble très efficace dans l’élucidation de la littérarité en général et de la théâtralité en particulier, pour ce qui nous concerne dans cet article. Mieux encore, en dehors de l’histoire littéraire, il est impossible d’appréhender la portée d’un énoncé littéraire qui est d’abord dialogue avec des pairs. Faire de l’histoire littéraire ce n’est pas plaquer l’histoire politico-sociale d’une société sur la littérature – ce que l’on appelle à proprement parler l’histoire de la littérature, ce qui revient à établir une relation de causalité (DROUET, 2012) entre le contexte (point A) et le texte (point B) et, du coup, à inscrire le texte dans une autre temporalité. L’histoire littéraire qui convoque la métaphore de la réfraction se veut en fait quelque chose de plus complexe et de plus précis. C’est, du moins telle que nous l’entendons, pour un personnage comme l’écrivain qui ne cesse de vivre à contrecourant de son époque, analyser dans une temporalité spécifique et infiniment plus profonde, l’évolution des formes littéraires.
Réfléchir sur la temporalité littéraire est un exercice éminemment structuraliste dans la mesure où cela revient à dégager le schéma de connexion entre les œuvres dans le temps c'est-à-dire 1) par-delà les auteurs 2) par-delà les époques 3) et suivant un fil conducteur les reliant. Faut-il considérer ce tissu 1) comme une ligne droite, la fameuse flèche irréversible du temps, 2) comme une ligne revenant sans cesse sur elle-même[1] 3) ou faut-il envisager une géométrie fractale (récursive) qui puisse rendre compte de la dynamique arthaudienne ? Postuler l’hypothèse d’une histoire littéraire[2] c’est du coup postuler un immense Texte (une bibliothèque dirait Jorge-Luis Borges) dans lequel chaque auteur aurait une place dans un ordre de succession et de transmission, bref de progression défini après coup. On pourrait même, pour être plus précis, comparer un ouvrage d’histoire littéraire à une montre, un calendrier qui aurait la particularité de ne pas être prévisionnel. Généralement on utilise à cet effet la représentation de la frise chronologie qui rend visible la contribution de chaque auteur dans une sorte d’œuvre commune. Les œuvres sont classés, dès lors, suivant des relations précises et variant, elles aussi, selon les hypothèses théoriques. On serait, en quelque sorte, en face d’une horloge littéraire.
L’exercice auquel nous nous livrons et qui a besoin qu’on en formulât de manière explicite et complète la théorie sous-jacente, peut s’appuyer sur l’histoire esthétique de la littérature telle que l’a pratiquée Eric Méchoulan(2004). De cette histoire, l’excellent essai d’histoire de la littérature française dirigé par Jean-Yves Tadié (2007) donne des esquisses intéressantes. Elle devra aller plus loin en suivant l’émergence et l’évolution des catégories proprement littéraires, la constitution puis l’institution d’une République des Lettres[3], la définition et l’élaboration de ses valeurs et de son économie. Au cours de cette enquête on se rendra compte que cette République des Lettres fonctionne comme un véritable champ de recherche dont le critère d’évaluation est l’originalité pour certains, la fidélité pour d’autres. Dans la vie de cette République, la question de l’historicité de l’œuvre joue un rôle important. L’un des principaux objectifs de cette étude est de donner un contenu précis à ce concept d’historicité en analysant son traitement chez un auteur comme Antonin Artaud (1896-1948). Très rapidement d’ailleurs on se rendra compte que la notion d’originalité vécue par l’auteur en termes de fidélité à l’esprit d’un genre devient très vite problématique. Du coup c’est une autre temporalité que l’histoire littéraire des écrivains permet de découvrir.
Puisant dans les ressources conceptuelles (pour ne pas dire théâtrales) de la sémiotique et des philosophies derridienne et deleuzienne, cet article se propose d’explorer le théâtre artaudien. La machine théâtrale d’un Antonin Artaud, à l’image du dispositif alchimique par exemple, est une puissante machine temporelle. Du coup la littérature nous plonge dans une historialité à l’intérieur de laquelle faire preuve d’originalité c’est s’inscrire dans une différance qui est une manière d’être fidèle à une origine qui ne cesse de se dérober. Afin de bien comprendre le fonctionnement de cette historialité particulière (en 3), nous explorerons d’abord les enjeux de la cruauté (en 1) avant d’étudier en quels termes l’histoire littéraire d’un écrivain comme Artaud réconcilie-t-elle originalité et fidélité (2).
1.Le principe de cruauté
L’objectif poursuivi par les analyses théoriques d’Antonin Artaud est de réfléchir sur l’essence du théâtre en particulier et des arts du spectacle en général. C’est au cours de cette élucidation exposée dans ses manifestes[4]que se posera indirectement la place de l’histoire dans l’évolution d’un genre. Cette approche pourrait parfaitement s’inscrire dans le cadre d’une esthétique théâtrale telle que présentée par Catherine Naugrette (2000) et dans l’histoire des écrivains dont nous reparlerons en 3.
C’est, comme le propose excellemment Michel Meyer (2001 et 2003), questionner la pratique théâtrale, se demander pourquoi on va au théâtre, les enjeux d’une telle expérience. De quelle manière le sujet se saisit-il dans cette expérience? Qu’est-ce qui s’y joue? Se livrer à une esthétique théâtrale, tâche qui doit précéder toute description du théâtre pour bien la guider, revient finalement à une phénoménologie du théâtre qui déchiffre la conscience à l’œuvre dans le texte théâtral ou, pour être plus précis, dans cette expérience collective qu’est la dramaturgie. Conscience qui, par le même mouvement, se livre à des calculs historiques, vit[5], si l’on en croit Antonin Artaud, une expérience temporelle régénératrice. Cette réduction eidétique permettrait de cerner, au prix d’une suspension de la notion d’auteur, certaines croyances, les « principes » à l’œuvre dans tous les textes spectaculaires, principes qui rappellent étrangement ceux de l’alchimie.
Il y a entre le principe du théâtre et celui de l’alchimie une mystérieuse identité d’essence. C’est que le théâtre comme l’alchimie est, quand on le considère dans son principe et souterrainement, attaché à un certain nombre de bases, qui sont les mêmes pour tous les arts, et qui visent dans le domaine spirituel et imaginaire à une efficacité analogue à celle qui, dans le domaine physique, permet de faire réellement de l’or. (ARTAUD, 1938, 73)
La notion de principe nous renvoie à des règles assez générales pour accueillir des changements sans trahir leur essence, changements qui, du coup, sont d’une toute autre nature. La nécessité de ces principes est exprimée par le principe de cruauté qui est à l’œuvre dans la poétique du théâtre artaudien:
[…] « Théâtre de la cruauté » veut dire théâtre difficile et cruel d’abord pour moi-même. Et sur le plan de la représentation, il ne s’agit pas de cette cruauté que nous pouvons exercer les uns contre les autres […]. Mais celle beaucoup plus terrible et nécessaire que les choses peuvent exercer contre nous. Nous ne sommes pas libres. Et le ciel peut encore nous tomber sur la tête. Et le théâtre est fait pour nous apprendre d’abord cela. (ARTAUD, 1964, 123)
La cruauté n’est pas surajoutée à ma pensée; elle y a toujours vécu: mais il me fallait en prendre conscience. J’emploie le mot cruauté dans le sens d’appétit de vie, de rigueur cosmique et de nécessité implacable, dans le sens gnostique de tourbillon de vie qui dévore les ténèbres, dans le sens de cette douleur hors de la nécessité implacable de laquelle la vie ne saurait s’exercer ; le bien est voulu, il est le résultat d’un acte, le mal est permanent. Le dieu caché quand il crée obéit à la nécessité cruelle de la création qui lui est imposée, et il ne peut pas ne pas créer, donc ne pas admettre au centre du tourbillon volontaire du bien un noyau de mal de plus en plus réduit, de plus en plus mangé. Et le théâtre dans le sens de création continue, d’action magique entière obéit à cette nécessité. Une pièce où il n’y aurait pas cette volonté, cet appétit de vie aveugle, et capable de passer sur tout, visible dans chaque geste et dans chaque acte, et dans le côté transcendant de l’action, serait une pièce inutile et manquée. (n.s.) (ARTAUD, 1964, 159-160)
Ces principes de cruauté, de rigueur nous apprennent à penser la mimésis théâtrale comme une expérience singulière où le sujet (dramaturge, spectateur) se retrouve en se perdant dans une création qui ne cesse de lui échapper. En prenant la place des dieux, le dramaturge se trouve entraîné dans une dynamique qu’il appelle tourbillon[6] en référence à l’état de dessaisissement de soi dans lequel est placé le sujet dans le gnosticisme. Tourbillon dû au fait que la création qu’il initie, dans le jeu duquel il entre, ne cesse de le soumettre à une nécessité rigoureuse, implacable, telle que ce qu’il poursuit ne cesse de se défaire. Parce qu’il se dérobe, la création ne peut que capturer des mirages de cet être:
Là où l’alchimie, par ses symboles, est comme le Double spirituel d’une opération qui n’a d’efficacité que sur le plan de la matière réelle, le théâtre aussi doit être considéré comme le Double non pas de cette réalité quotidienne et directe dont il s’est peu à peu réduit à n’être que l’inerte copie, aussi vaine qu’édulcorée, mais d’une autre réalité dangereuse et typique, où les Principes, comme les dauphins, quand ils ont montré leur tête s’empressent de rentrer dans l’obscurité des eaux.
Définition de la réalité au théâtre: « Or cette réalité n’est pas humaine mais inhumaine, et l’homme avec ses mœurs ou avec son caractère y compte, il faut le dire, pour fort peu. Et c’est à peine si de l’homme il pourrait encore rester la tête, et une sorte de tête absolument dénudée, malléable et organique, où il demeurerait juste assez de matière formelle pour que les principes y puissent déployer leurs conséquences d’une manière sensible et achevée. »
Tous les vrais alchimistes savent que le symbole alchimique est un mirage comme le théâtre est un mirage. Et cette perpétuelle allusion aux choses et au principe du théâtre que l’on trouve dans à peu près tous les livres alchimiques, doit être entendue comme le sentiment (dont les alchimistes avaient la plus extrême conscience) de l’identité qui existe entre le plan sur lequel évolue les personnages, les objets, les images, et d’une manière générale, tout ce qui constitue la réalité virtuelle du théâtre, et le plan purement supposé et illusoire sur lequel évoluent les symboles de l’alchimie. (ARTAUD, 1938, 75)
C’est cette réticence de la création qui se donne dans la réserve qu’il appelle sa cruauté. Cette conception de la création littéraire qui convoque les modèles du gnosticisme, à travers notamment l’évocation de la kabbale (ARTAUD, 1938, 200, 203 et 206), fait du dramaturge le contre-imitateur du démiurge figuré comme un archange diabolique qui a enfermé l’homme dans une prison cruelle. Du coup créer c’est s’inscrire dans une certaine temporalité.
Cette cruauté que le théâtre, depuis ses origines, a pour vocation de mettre en scène pour s’en échapper, et ce très clairement dans la tragédie (NIETZSCHE, 1872), doit continuer à survivre dans le théâtre, même moderne ou post-moderne. La dialectique de l’originalité et de la fidélité (la conformité au modèle) donne la pleine mesure de cette temporalité. L’approche sémiotique permet de surmonter la contradiction apparente entre la fidélité et l’originalité. Nous allons dans un premier temps explorer le bénéfice qu’offre cette méthode avant de montrer que la conception qu’Artaud se fait de la temporalité littéraire corrobore largement nos dires.
2.Pour une anthropologie théâtrale
La phénoménologie de l’expérience spectaculaire qui, dès lors, est à la fois une esthétique et une sémiotique tensive (FONTANILLE, 2003), est une perspective d’analyse qui permet de dépasser les formes pour cerner les forces. Ou, pour être plus précis, elle permet d’analyser les figures théâtrales comme des formes, un jeu de figures exprimant des forces s’évanouissant sitôt qu’actualisées (ou, pour adopter le point de vue du spectateur, saisies). A cet effet nous distinguerons avec Fontanille, à l’intérieur des tensions existentielles (2003, 288-295), la virtualisation qui fait sortir du champ de la présence, la réalisation qui fait entrer dans le champ de la présence, de l’actualisation qui les fait pressentir dans un mode de saisie que nous qualifierons d’éclaircie. Dans le texte extraordinaire ci-dessous Antonin Artaud décrit cette expérience que le dramaturge fait vivre au spectateur, après l’avoir lui-même vécue, sous la forme d’un piétinement qui rappelle le tourbillon déjà évoqué. Cet effritement des formes dont le jeu est parfaitement calculé entraîne le sujet vers une perte de soi qui convoque le schéma du parcours initiatique qu’on retrouve dans les textes mystiques (voir RIFFARD, 1990 et 2008):
Le théâtre lui aussi [comme la peste] prend des gestes et les pousse à bout: comme la peste il refait la chaîne entre ce qui est et ce qui n’est pas, entre la virtualité du possible et ce qui existe dans la nature matérialisée. (n.s.) Il retrouve la notion des figures et des symboles-types, qui agissent comme des coups de silence, des points d’orgue, des arrêts de sang, des appels d’humeur, des poussées inflammatoires d’images dans nos têtes brusquement réveillées ; tous les conflits qui dorment en nous, il nous les restitue avec leurs forces et il donne à ces forces des noms que nous saluons comme des symboles: et voici qu’a lieu devant nous une bataille de symboles, rués les uns contre les autres dans un impossible piétinement ; car il ne peut y avoir théâtre qu’à partir du moment où commence réellement l’impossible et où la poésie qui se passe sur la scène alimente et surchauffe les symboles réalisés.
Ces symboles qui sont le signe des forces mûres, mais jusque-là tenues en servitude, et inutilisables dans la réalité, éclatent sous l’aspect d’images incroyables qui donnent droit de cité et d’existence à des actes hostiles par nature) la vie des sociétés. (ARTAUD, 1938, 40)
Considérer les jeux de formes comme le moyen de réactiver les forces gelées c’est, du coup, pour un genre donné, à savoir le théâtre, distinguer la visée constitutive du genre (les philosophes diraient son essence) des formes à travers lesquelles cette intention originaire se réalise. On retrouve à peu près cette catégorisation chez Jean-Marie Schaeffer qui distingue les conventions constituantes des conventions régulatrices et traditionnelles[7]. A peu près, car cette distinction, en son principe très intéressante, reste au niveau de la forme. Il n’y a pas d’un côté des formes qui demeurent (les conventions constituantes) et de l’autre les formes variables (les conventions régulatrices et traditionnelles), mais d’un côté une machine à remonter le temps, machine indifféremment assimilée à des machines exorcistes, magique…, et de l’autre des matériaux à partir desquels cette dynamique peut opérer. La conception que nous nous faisons du travail du dramaturge rappelle évidemment la description que Claude Lévi-Strauss fait du bricolage.
Le bricoleur est apte à exécuter un grand nombre de tâches diversifiées ; mais, à la différence de l’ingénieur, il ne subordonne pas chacune d’elles à l’obtention de matières premières et d’outils, conçus et procurés à la mesure de son projet: son univers instrumental est clos, et la règle de son jeu est de toujours s’arranger avec les « moyens du bord », c’est-à-dire un ensemble à chaque instant fini d’outils et de matériaux, hétéroclites au surplus, parce que la composition de l’ensemble n’est pas en rapport avec le projet du moment, ni d’ailleurs avec aucun projet particulier, mais est le résultat contingent de toutes les occasions qui se sont présentées de renouveler ou d’enrichir le stock, ou de l’entretenir avec les résidus de constructions et de destructions antérieures. L’ensemble des moyens du bricoleur n’est donc pas définissable par un projet (ce qui supposerait d’ailleurs, comme chez l’ingénieur, l’existence d’autant d’ensembles instrumentaux que de genres de projets, au moins en théorie) ; il se définit seulement par son instrumentalité, autrement dit et pour employer le langage même du bricoleur, parce que les éléments sont recueillis ou conservés en vertu du principe que « ça peut toujours servir ». De tels éléments sont donc à demi particularisés: suffisamment pour que le bricoleur n’ait pas besoin de l’équipement et du savoir de tous les corps d’état ; mais pas assez pour que chaque élément soit astreint à un emploi précis et déterminé. Chaque élément représente un ensemble de relations, à la fois concrètes et virtuelles ; ce sont des opérateurs, mais utilisables en vue d’opérations quelconques au sein d’un type.
Le dramaturge, tel que le présente Antonin Artaud, en vertu du principe de cruauté, n’est pas un diseur (il n’a pas quelque chose à dire) mais un créateur. C’est un véritable initiateur. Il transforme le spectateur appelé à être un créateur-acteur, en une sorte de contre-démiurge qui démonte/remonte l’horloge cosmique. Ce créateur actualise un certain sens sur la scène théâtrale.
En considérant l’écrivain, dans la logique d’Antonin Artaud, comme un bricoleur, il peut alors considérer le texte comme une machine virtuelle, ou, dans le langage des informaticiens, comme une suite d’instructions (un chemin) formant une machine onirique virtuelle (un navigateur). L’objectif d’une telle analyse, qui permettrait parfaitement de cerner l’historicité du texte, consisterait à distinguer les matériaux contingents du projet. Il distinguera l’intention de sa réalisation.
Dans cette perspective, la métaphore de la machine, que nous voulons envisager ici dans sa dimension temporelle et que Gilles Deleuze a extraite de l’œuvre d’Antonin Artaud, expliquerait le fonctionnement d’un texte bricolé qui, à partir de matériaux empiriques bien choisis, peut réveiller, refaire fonctionner (réparer) le Cosmos malade. Convoquant implicitement, à travers la métaphore de la fusée, la métaphore de la machine, il assimile l’expérience[8] théâtrale à un décollage, ou comme diraient les ésotéristes, une délivrance[9]:
les images de la peste en relation avec un état puissant de désorganisation physique sont comme les dernières fusées d’une force qui s’épuise, les images de la poésie au théâtre sont une force spirituelle qui commence sa trajectoire dans le sensible et se passe de la réalité. (ARTAUD, 1938, 36)
De la même manière que la maïeutique platonicienne et autres dispositifs mystiques sont des machines à engrosser et à accoucher l’esprit, de la même manière le théâtre est une formidable machine à produire du spectaculaire, ou, pour nous en tenir à notre perspective phénoménologique, à faire vivre du spectaculaire, c'est-à-dire « des conflagrations inouïes de forces et d’images » (ARTAUD, 1938, 197). C’est une machine qui fait, tout simplement ; vivre, intensément, comme ne le fait pas cette autre machine, cette fois-ci, à faire désirer (cf. Deleuze et Guatuari) qu’est la culture[10]. Cette machine combat la machine à décerveler décrite par son maître Alfred Jarry dans une perspective de transvaluation des valeurs qui désorganise[11] puis réorganise et ainsi fait revivre.
Pour ce qui est de ce schème « Théâtralement, le problème est de déterminer et d’harmoniser ces lignes de forces [fixées çà et là sur les ondes matérielles sur lesquelles parmi la foule de spectateurs quelque conscience amoindrie, révoltée ou désespérée surnagera comme un fétu de paille], de les concentrer et d’en extraire de suggestives mélodies » (ARTAUD, 1964, 198). Pour ce faire, à l’instar de l’Envoûteur (personnage théâtral qui fonctionne comme un personnage conceptuel), le dramaturge sélectionne et rhizome[12] des fragments représentatifs de la réalité virtuelle visée. Ces fragments sont d’ailleurs parfois appelés des symboles[13] et d’autres fois des totems. Ces fragments sont choisis en vertu de leurs pouvoirs magiques et rhizomés selon des schèmes alchimiques qui peuvent parvenir à « en extraire de suggestives mélodies ». Au contraire des formes mortes et muettes, les effigies (17, 201) ou les symboles sont des fragments choisis pour leur représentativité afin d’entrer dans un bricolage dramat-urgique[14] .
Ces fragments actualisent ce double de la réalité. Le théâtre retrouve sa valeur d’ombre, de double, de répétition. Alors que les « Dieux […] dorment dans les musées occidentales » (ARTAUD, 1938, 16), la véritable dramaturgie veut, à travers l’intensité des formes, « séduire et capter une force qui, en musique, éveille un déchirant clavier » (ARTAUD, 1938, 16). A l’intérieur du langage hiéroglyphique qu’est le langage théâtral, l’acteur est un élément actif qui fait vivre cette dimension qui constitue un plan d’existence spécial. Grâce à la médiation des signifiants théâtraux, le spectateur, entraîné par le jeu de l’acteur, peut actualiser le Corps Sans Organes CsO (Deleuze et Guatuari, 1972). Antonin Artaud ne cesse de convoquer, pour compléter son système métaphysique et son système dramaturgique, un corps qu’il nomme CsO. On peut dire que c’est un concept potentiel, si présent et si bien travaillé qu’il ne saurait être un simple cri. Il n’a attendu en fait que des acteurs de la trempe d’un Gilles Deleuze et d’un Félix Guattari pour être théâtralisé. Dans la mesure où Artaud revendique explicitement la postulation d’une dimension métaphysique et récuse toute dimension religieuse, on peut dire que la sphère ontologique ainsi définie est le plan du virtualisé pour ne pas dire celui du subtil
[15]. Ce virtuel (du latin virtus, force), qu’on peut appeler, si on adopte le point de vue de l’être qui, du fait de sa création s’en est trouvé séparé, du potentiel, ne peut jamais être réalisé. A tout le moins, grâce à la mise en scène théâtrale (qui retrouve toute sa puissance médiatisante) peut-on l’actualiser, faire sentir l’instant d’une performance, sa possibilité: « le théâtre est le seul endroit au monde où un geste fait ne se recommence pas deux fois » (ARTAUD, 1938, 117). La scène est une éclaircie où l’être peut apparaître, c'est-à-dire être (re)vécu. Grâce au jeu théâtral authentique il devient possible d’opérer une mimesis qui passe par deux étapes:
- La dé-organis-ation du corps appelé organisme (en tant qu’architecture d’organes) et la destruction de la perspective psychologique qui va avec,
- La recomposition du corps virtuel (CsO).
C’est à ce titre que l’acteur (devenu un véritable dasein) peut enfin revivre dans ce corps virtuel.
Le modèle du virtuel, inscrit dans un cadre métaphysique, appelle une logique du redoublement et de l’ombre (très platonicienne). Il semble, en effet, que ce ne soit uniquement qu’à travers l’actualisation de ce qui se dédouble ou qui reste dans une ombre, qu’on peut vivre l’expérience du CsO. Le théâtre est donc le lieu où le dasein ne cesse d’expérimenter la fascination: « L’esprit croit ce qu’il voit et fait ce qu’il croit: c’est le secret de la fascination. » (ARTAUD, 1964, 39). Au théâtre l’esprit jouit de ce qui l’attire et le tient à distance. Comme le dit si bien Antonin Artaud, le secret de la représentation théâtrale (qui rappelle étrangement celle de la peinture) tient à cette dialectique du savoir et de l’ignorance résumée dans un croire qui guide l’action. A l’image de l’alchimiste et travaillant à rebours de la cosmogonie démoniaque du Démiurge (voir aussi le mythe mexicain du Quetzalcóatlla), le dramaturge recompose, ou en termes nietzschéens, (re)crée, une musique disséminée dans des corps-organes grâce à un ensemble d’opérations que nous avons appelées dans le schéma ci-dessous, dramaturgie. A la syntaxe de la dissémination répond périodiquement la contre-opération de la recomposition. Aux premiers dieux succèdent les dieux blancs, ces grands manitous qui manœuvrent dans l’ombre et envoûtent les corps. On voit se dessiner la temporalité dans laquelle se déploie la littérature. L’anarchie théâtrale est, en fait, un désordre créateur, une eschatologie régénératrice.
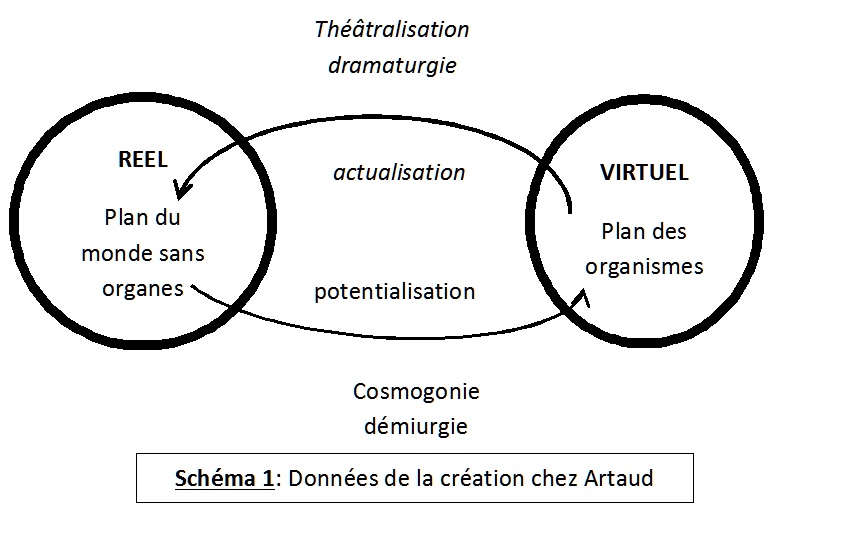
Lorsque le mystique se projette, par la retraite, dans un univers transcendantal, Antonin Artaud, imprégnée de gnosticisme, se projette dans un univers métaphysique grâce au théâtre qui fonctionne comme un dispositif, une sorte d’installation permettant de réactiver l’Archi-Corps que le corps empirique empêche d’agir dans toute sa force. Ce corps (sôma) est envisagé chez les pythagoriciens comme un sêma (tombeau). Les rhizomes théâtraux ont pour vocation de libérer, comme le réalise la peste, le CsO tel que défini par Gilles Deleuze.
Le fait de prendre la pleine mesure des enjeux de la création théâtrale nous permet à la fois de nous livrer à son anthropologie et de déterminer sa temporalité: c'est-à-dire à la fois la manière dont elle tient compte de l’histoire (son historicité) et la manière dont elle réinvente le présent et le futur (son historialité).
3.La littérature entre histoire et devenir
L’attention extrême qu’Antonin Artaud accorde aux forces (plan virtuel) à l’œuvre derrière les formes qui ne sont que des matériaux récupérés à l’intérieur d’un projet de bricolage (plan actuel) lui permet d’échapper au piège de la critique idolâtre. Du reste les histoires littéraires des écrivains[16], du moins à partir du XIXe siècle, reprennent inlassablement le même schéma explicatif qui présente l’expérience d’un genre littéraire comme une remontée vers sa conception originaire. La forme que promeut l’écrivain se veut authentique par rapport aux pratiques contemporaines. De telles formes, notamment à partir du 19e siècle, sont disqualifiées au nom d’une critique de la civilisation occidentale appauvrissante. Celle-ci est considérée comme desséchante, sclérosante: c’est en fait une nouvelle cosmogonie. La littérature, d’après Antonin Artaud, est menacée par l’oubli de l’être du théâtre qui n’est, dans son essence, qu’un ersatz du CsO. A quelques variantes philosophiques près il reprend le même schéma qu’on retrouve chez les avant-gardistes et, plus tard, chez Heidegger: le motif central de l’oubli[17] qui suppose une constante remémoration. Du reste, chez Platon lui-même, l’exercice de pensée est un exercice de remémoration (réminiscence) qui nécessite la mémoire vive. Sous ce rapport, la littérature, dans son ensemble, au regard des genres qui fonctionnent comme des corps avec organes, est un immense théâtre. Rester fidèle à l’esprit de la littérature c’est se soumettre à un régime historique qui lutte inlassablement contre l’oubli au risque de s’installer dans une anarchie permanente. La littérature se réclame d’une nudité intransigeante. Sous ce rapport, la cruauté serait cette exigence qui fait que le créateur refuse de n’exister que dans le présent, c'est-à-dire dans le temps. Refuser le temps c’est refuser la civilisation avec son régime du progrès et s’installer dans un temps de la Nature qui n’est autre que celui du pur devenir:
On comprend donc que le théâtre, dans la mesure même où il demeure enfermé dans son langage, ou il reste en corrélation avec lui, doit rompre avec l’actualité, que son objet n’est pas de résoudre des conflits sociaux ou psychologiques, de servir de champ de bataille à des passions morales, mais d’exprimer objectivement des vérités secrètes, de faire venir au jour par des gestes actifs cette part de vérité enfouie sous les formes dans leurs rencontres avec le Devenir.
Faire cela, lier le théâtre aux possibilités de l’expression par les formes, et par tout ce qui est gestes, bruits, couleurs, plastiques, etc., c’est le rendre à sa destination primitive ; c’est le replacer dans son aspect religieux et métaphysique, c’est le réconcilier avec l’univers. (ARTAUD, 1938, 107-108)Pour échapper à cet oubli de l’essence d’une forme artistique, le créateur, qui se mue alors en recréateur, s’adosse évidemment à une forme originaire remontant aux sources du théâtre (c’est le cas des dionysies pour Friederich Nietzsche). Il se réenracine également à partir de formes étrangères (c’est le rôle du théâtre balinais dans le raisonnement artaudien). Le théâtre n’a d’avenir qu’en laissant libre cours à cet autre du théâtre que le corps impérialiste a arraisonné. C’est une telle posture théorique qu’emprunte Antonin Artraud qui n’hésite d’ailleurs pas à définir son entreprise comme une volonté de rendre au théâtre son souffle métaphysique. La métaphysique, comme chez son maître René Guénon, c’est ce plan de consistance que seul le théâtre, qui reprend les principes actifs de la poésie, peut manifester sur le plan phénoménal des signes. C’est dire que l’écriture, en ce qu’elle fixe la performance, en garde une trace, la trahit.
Ce procès de l’écriture, bien après celui célèbre de Platon, est un procès du texte qui à la fois enchaîne le jeu théâtral et aliène le CsO dans un régime inauthentique de la temporalité. A l’époque de reproduction de l’œuvre d’art (BENJAMIN, 1939), le travail de déchaînement de l’œuvre artistique est un travail diabolique, combattu comme une épidémie, l’épidémie par excellence qu’est la peste qui détruit le corps et laisse libre cours à ce qui ne peut être ressenti que comme du délire. Le procès de l’assujettissement du théâtre au texte est en même temps le procès de la civilisation occidentale assujettie à l’écriture et à une certaine forme de temporalité. Comme on le voit, si le rapport du théâtral (ce dispositif qui donne en spectacle le sacré) à l’écriture occidentale est sans équivoque, son rapport avec les autres techniques (éclairage, sonorisation, cinéma…) dans la mesure où elles peuvent accueillir une archi-écriture hiéroglyphique, sont plus pacifiques. C’est que pour dramatiser une réalité totale il faut un langage total et vivant qui convoque tous les sens pour les dés-organiser méthodiquement sur un plan fugace. L’écriture théâtrale ne peut être que mystérieuse, déstabilisatrice, se communiquant à tout le corps comme une peste. Pour ce faire, fidèle à lui-même, il convoque le modèle même de l’archi-écriture, l’écriture hiéroglyphique qui ne survit pas à sa performance et ne sort pas de l’état de trace. L’écriture, afin de ramener un peu de l’éclat d’Eurydice, se doit d’être à la mesure de la cruauté du démiurge. Le théâtral, ou, si on veut, le texte hiéroglyphique, ne saurait séjourner ailleurs que dans l’éclaircie d’une durée particulière. Il en est du poète comme d’Orphée. Sa musique peut captiver les Dieux, les faire sortir de leur réserve grâce à sa lyre, mais il ne peut contempler sa récompense que le regard tue. Son existence, comme celle de la littérature, est prisonnière de la temporalité de la cruauté, celle qui fait que l’homme, à l’image de Sisyphe, ne peut sortir de sa condition humaine. Il n’y a ou presque pas d’histoire (au sens de récit épique) ni de.la littérature ni dans la littérature.
A moins que cette récursivité ne soit une forme de temporalité qui rende compte de la littérature comme histoire. A moins que cet arbre qu’est la littérature, cette magnifique bibliothèque arborescente considérée dans son ensemble, dans ses élans, ses égarements et ses ressaisissements, ne dessine une certaine forme de progression fractale. Cette cruauté, à la nécessité, à la rigueur de laquelle la littérature est soumise, donne lieu à un récit qui n’est plus de l’ordre des conquêtes (celui de l’avoir) mais bien un récit initiatique qui est agrandissement de la lucidité, acceptation de la cruauté tragique (deux mots qui signifient la même réalité) comme lieu où un sens peut naître.
Une telle démarche semble ainsi priver le texte de toute historialité dans la mesure où les origines éclairent le présent à telle enseigne que l’avant-garde ne semble que retour du passé. Analyser ainsi la modernisation des formes d’arts du spectacle comme une chute c’est, également exclure du champ de l’interprétation l’historicité de l’œuvre d’art. C’est cette historicité qui oblige le créateur à actualiser la forme qu’il a élue en écrivant à partir de l’horizon de perception de son époque. Du coup ces simples différences superficielles n’empêchent pas que les structures spectaculaires restent fidèles à leurs fonctions premières, c'est-à-dire à leur origine, à la situation qui les ont vu naître. Pour être spectaculaire, le texte a besoin de se retremper à ses sources mais, avant que de pouvoir décoller, la fusée théâtrale doit tenir compte du corps. C’est à partir de l’actuel que la théâtralisation peut dévoiler le virtuel/potentiel:
En outre, cette nécessité pour le théâtre de se retremper aux sources d’une poésie éternellement passionnante et sensible pour les parties les plus reculées et les plus distraites du public, étant réalisée par le retour aux vieux Mythes primitifs, nous demanderons à la mise en scène et non au texte le soin de matérialiser et surtout actualiser ces vieux conflits, c'est-à-dire que ces thèmes seront transportés directement sur le théâtre et matérialisés en mouvement, en expressions et en gestes avant d’être coulés dans les mouvements. Ainsi, nous renoncerons à la superstition théâtrale du texte et à la dictature de l’écrivain. (ARTAUD, 1938, 191)
Des facteurs comme les environnements démographiques, technologique n’affectent pas l’économie sémiotique originaire du théâtre. La dimension religieuse très prégnante dans le théâtre originaire est simplement repliée mais tout aussi présente et structurante dans le théâtre moderne. Il n’y a de rupture épistémologique que dans la configuration des formes expressives. Une intention dramatique étant donnée, le créateur, sinon invente, du moins se meut dans des cadres figuratifs qui puissent l’accueillir. Certes l’histoire des lieux montre que des décors nus aux grands monuments, une immense transformation s’est accomplie. Il n’en demeure pas moins qu’en tant que catégorie anthropologique, le théâtral est plus que jamais vivant. Les formes artistiques sont des espaces mentaux, des lieux où un certain nombre d’affects sont libérés, comme lorsque l’on crève un abcès:
Il semble que par la peste et collectivement un gigantesque abcès, tant moral que social, se vide ; et de même que la peste, le théâtre est fait pour vider collectivement des abcès ». […] L’action du théâtre comme celle de la peste, est bienfaisante, car poussant les hommes à se voir tels qu’ils sont, elle fait tomber le masque, elle découvre le mensonge, la veulerie, la bassesse, la tartuferie … ; et révélant à des collectivités leur puissance sombre, leur force cachée, elle les invite à prendre en face du destin une attitude héroïque et supérieure qu’elles n’auraient jamais eue sans cela. » (ARTAUD, 1938, 45-46)
Au même titre que la littérature en général, le théâtre est un laboratoire, une dramaturgie « publique » où sont expérimentées certaines valeurs. La démarche d’Antonin Artaud valide une telle lecture dans la mesure où, grâce au théâtre, certains aspects de la vie affective, comme en situation de peste, peuvent prendre leur essor. D’après son approche épidémiologique, la métaphore de la peste sert à présenter l’espace théâtral comme un espace dramatique et collectif, un espace anarchique à l’intérieur duquel on peut briser les barrières des organismes pour permettre à un certain nombre de symptômes de se donner libre cours.
Si les théâtres varient considérablement dans l’espace et dans le temps, le théâtral demeure inchangé, quoique de manière plus cachée. Du coup notre phénoménologie du genre théâtral est, de fait, une archéologie qui permet de remonter aux origines du spectaculaire. Le théâtre reste, de bout en bout, une expérience de l’archaïsme, sa réactualisation rituelle. La dramatisation, qui est au cœur de l’action théâtrale, comme y invite Artaud, ne doit pas être alignée sur le paradigme de la mimésis imitative de rigueur dans l’esthétique classique et non dans sa pratique, mais sur le modèle des pratiques magiques, métaphysiques.
En termes sémiotiques on peut dire, pour nous résumer, que si les manifestations figuratives du théâtre changent, la visée profonde de l’expérience théâtrale demeure intacte. Ces structures originaires sont aux formes, par lesquelles elles s’incarnent, ce que le texte écrit est à la pièce jouée, c'est-à-dire des textes-fantômes, des décors et rôles dans l’attente d’être actualisés. Au reste, on n’a jamais fini d’explorer la puissance heuristique de la catégorie théâtrale. Non seulement elle est au cœur du discours mais le théâtre est partout présent. Tout lieu, pourvu que des acteurs et des spectateurs réels ou potentiels y soient présents, peut se transformer en scène: la vie sociale tout court est un enchevêtrement de théâtres.
Conclusion
Réfléchir sur l’histoire littéraire, c’est partir du principe qu’il y a de l’histoire qui ordonne les œuvres, que la littérature déploie une temporalité et se constitue à travers cette temporalité. Interroger l’historicité d’une œuvre (pour nous son inscription dans une temporalité littéraire) c’est fatalement s’interroger sur la littérarité. Si la littérature semble configurée comme le champ scientifique, elle en diffère par le fait que les valeurs à l’aune desquelles la place d’un auteur est évaluée sont totalement différentes. La littérarité d’un texte est mesurée par sa capacité à s’écarter de la norme, bref par ce qu’on appelle son originalité. Un auteur comme Hans Robert Jauss parle d’écarts esthétiques. Or, tout en faisant preuve d’originalité (sa remise en cause du théâtre contemporain est radicale), un dramaturge comme Antonin Artaud ne cesse d’inscrire sa subversion dans une certaine fidélité, comme si cette fidélité permettait un certain écart qui est considéré comme progrès de s’accomplir.
La fidélité à l’essence d’un genre, dans la mesure où cette essence est un esprit de liberté, exclut l’imitation. Ou plutôt cette imitation est la reprise d’une liberté qui ne cesse de « mettre en scène » une origine qui n’arrête de se déplacer: « la représentation théâtrale, nous dit Jacques Derrida, est finie, ne laisse derrière soi, derrière son actualité, aucune trace, aucun objet à emporter » (1967, 353). L’espace littéraire est un espace de fuite sans pause où une libération continuelle se donne libre cours. On comprend dès lors que certaines valeurs, notamment celles tragiques de liberté, y aient été forgées. Cette origine qui a présidé à l’épiphanie de cette manière d’être souverain qui s’appelle littérature ne cesse de se dérober vers un abîme sans fond. Pour qui a compris ce que littérature implique, les Anciens sont moins des modèles à suivre que des exemples à imiter pour leur capacité à exceller dans l’art difficile d’échapper au ronron en faisant preuve d’originalité. Etre original c’est, d’une manière aussi déroutante et énigmatique, devenir origine d’un sens absolu qui ne survit pas à son énonciateur.
Rester fidèle à l’essence du théâtre, c'est-à-dire faire preuve d’originalité, dans le champ historique de l’histoire littéraire, nous avons dit que c’est déplacer (déconstruire, poétiser) une forme sitôt qu’elle a perdu sa force. L’anarchie dans laquelle nous plonge le dramaturge défait heureusement toute origine qui ne s’affiche pas comme abîme. C’est pour cette raison, obéissant en quelque sorte à un rituel à quoi Antonin Artaud réduit l’énonciation littéraire, l’écrivain ne peut pas ne pas convoquer le spectre des origines. Ce sont ces doubles, sur la trace desquelles le dramaturge (acteur, metteur en scène) opère, qui légitiment, en quelque sorte, la parole littéraire. L’analyse d’Artaud fait régulièrement intervenir ces figures omniprésentes dans leur absence, ces corps fantômes qui hantent la performance artistique. S’inscrivant en droite ligne dans l’exigence métaphysique à l’intérieur de laquelle il conçoit l’œuvre, ces figures arrachent l’œuvre de la temporalité ordinaire. En s’originant dans une parole sans origine, Artaud disqualifie toute généalogie qui idolâtrerait une et ou des anciens comme le firent Boileau et ses disciples au XVIIe siècle dans la querelle très célèbre des anciens et des modernes, tout comme il est erroné de fonder une école comme s’il y avait une grammaire de l’art. Artaud l’a bien compris en convoquant l’autre du théâtre dit psychologique, le théâtre balinais. La convocation de ce théâtre doit être comprise comme la simple figuration de cet autre du théâtre vers lequel pointe le théâtre authentique.
L’évolution littéraire, telle que la vit l’écrivain, est fidélité à une origine fondatrice qui, par son refus de toute origine, se définit comme mouvement de différance. Présenté comme surgi de nulle part, excédant son époque, le texte, au nom de sa littérarité, ne cesse cependant de se référer au Père fantôme. En se déplaçant ainsi vers l’abyme, le texte déploie une temporalité qui résiste à la temporalité empirique et la comprend. L’œuvre est oubli ou remémoration de l’illo tempore. Ne voilà-t-il pas un régime temporel rappelant sans cesse l’origine sans lieu au contraire d’une sphère pour laquelle le monde court vers sa chute?
BIBLIOGRAPHIE
- ALEXANDRIAN, Sarane. Histoire de la philosophie occulte (1982). Paris: Payot, 1994.
- ALLET, Natacha. Le gouffre insondable de la face. Suisse: Édition La Dogana, 2005.
- ANDRE-CARRAZ, Danièle.L'expérience intérieure d'Antonin Artaud. Paris: Librairie Saint-Germain-des-près, 1973.
- ARTAUD, Antonin.Le théâtre et son double. Paris: 1938 (chez Gallimard en 1964)
- ARTAUD, Antonin.Œuvres(édition établie, présentée et annotée par Evelyne Grossman). Paris: Gallimard, Quarto, 2004.
- BARTHES, Roland.Racine. Paris: Éditions du Seuil, 1963.
- BATAILLE, Georges.L'Expérience intérieure. Paris: Gallimard, 1943
- BENJAMIN, Walter. L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, dernière version 1939, in « ŒuvresIII ». Paris, Gallimard, 2000
- BONARDEL, Françoise. Antonin Artaud ou la fidélité à l'infini. Paris: Balland, 1987.
- BORIE, Monique. Antonin Artaud, le théâtre et le retour aux sources. Paris: Gallimard, 1989.
- BOUTHORS-PAILLART, Catherine. Antonin Artaud, l'énonciation ou l'épreuve de la cruauté. Préface de Julia Kristeva. Paris: Édition Droz, 1997.
- BLAY, Michel.Dictionnaire des concepts philosophiques. Paris: Larousse, 2007.
- BRUN Jean. LeretourdeDionysos. Paris: Les Bergers et les Mages, 1976
- CASANOVA, Pascale.La République mondiale des Lettres. Paris: Seuil, 1999
- DEBAENE, Vincent& JEANNELLE Jean-Louis, Marielle Macéet Michel Murat.L’histoire littéraire des écrivains.Paris:PU Paris-Sorbonne, 2013.
- DELEUZE, Gilles.Différence et répétition. Paris: Presses Universitaires de France, 1968, 409 p.
- DELEUZE, Gilles.Logique du sens. Paris: Les éditions de Minuit (coll. « Critique »), 1969.
- DELEUZE, Gilleset Félix Guattari.L'Anti-Œdipe – Capitalisme et schizophrénie. Paris: Les éditions de Minuit (coll. « Critique »), 1972.
- DELEUZE, Gilles. Dialogues avec Claire Parnet. Paris: Flammarion, 1977. ; 2e éd. 1996, coll. « Champs », 187 p. (contient une annexe sur L'actuel et le virtuel)
- DELEUZE, Gilles et Félix Guattari. Mille Plateaux – Capitalisme et schizophrénie 2. Paris Les éditions de Minuit (coll. « Critique »), 1980.
- DELEUZE, Gilles.Rhizome, en collaboration avec Félix Guattari. Paris: Éd. de Minuit, 1976. (Repris dans Mille-Plateaux.
- DENYS, Raphaël. Le Testament d'Artaud. Paris: Gallimard, L'Infini, 2005.
- DERRIDA, Jacques. L'écriture et la différence. Paris: Seuil, 1967 (« La parole soufflée » « Le théâtre de la cruauté et la clôture de la représentation »)
- DERRIDA, Jacques. Artaud le Moma. Paris: Galilée, 2002.
- DROUET, Isabelle. La causalité et les probabilités: analyse conceptuelle et méthodologie
- DUMOULIE Camille. Nietzsche et Artaud, Paris: P.U.F, avril 1992
- DUMOULIE, Camille. Les Théâtres de la cruauté. Paris: Éditions Desjonquères, 2000
- Eliade
- FONTANILLE, Jacques.Sémiotique du discours. Limoges: Presses Universitaires de Limoges, 2003
- FUMAROLI, Marc. La Querelle des Anciens et des Modernes. Paris: Gallimard-Folio, 2001
- GOFFMAN, Erving.Les rites d’interaction.Paris: Minuit, 1967
- GUENON, René.Aperçus sur l'Initiation. Paris: Éditions Traditionnelles, 1946 multiples rééditions
- GUENON, René.Initiation et Réalisation spirituelle. Paris: Éditions Traditionnelles, 1952.
- GROSSMAN Evelyne. Artaud, « l’aliéné authentique ». Tours: Editions Farrago Editions Léo Scheer, 2003.
- HARTOG, François.Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps. Paris: Seuil ; 2003
- Hebert, Louis.
- HEIDEGGER, Martin. 1927, Être et Temps, Paris, Gallimard, 1964, (trad. Rudolf Boehm et Alphonse de Waelhens); Paris, Gallimard, 1986, (trad. François Vezin)
- HEIDEGGER, Martin. 1950, Chemins qui ne mènent nulle part (1950) (trad. Wolfgang Brokmeier), Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1962
- JAUSS, Hans-Robert.Pour une esthétique de la réception, Gallimard, 1978 ou coll. Tel, 1990.
- JAUSS, Hans-Robert.Pour une herméneutique littéraire, Gallimard, 1988.
- LEVI-STRAUSS.La Pensée sauvage. Paris: Plon, 1962.
- MECHOULAN, Eric.Pour une histoire esthétique de la littérature. Paris: P.U.F. , 2004
- MERCIER Alain. Les sources ésotériques et occultes de la poésie symboliste (1870-1914), t. 1: Le symbolisme français, t. 2: Le symbolisme européen, Saint-Genouph, A.-G. Nizet, 1969-1974.
- MESSADIE, Gérald. Quarante siècles d'ésotérisme, Paris, Presses du Châtelet, 2006.
- MEYER, Michel.Le tragique et le comique. Penser le théâtre et son histoire. Paris: P.U.F.., 2003. MEYER, Michel.Langage et littérature. Paris: P.U.F., 1992, Quadrige.
- MOISAN, Clément.Qu'est-ce que l’histoire littéraire?Paris: PUF, 1987.
- NAUGETTE, Catherine.L’Esthétique théâtrale. Paris: Armand Colin /Cursus, 2000.
- NIETSZCHE, Friederich.La Naissance de la tragédie (Die Geburt der Tragödie), 1872
- TADIE Jean-Yves (dir.) La littérature française, dynamique & histoire tome I par J. Cerquiglini-Toulet, F. Lestringant, G. Forestier et E. Bury tome II par M. Delon, F. Mélonio, B. Marchal, J. Noiray, A. Compagnon., Paris: Gallimard ; 2007
- RICOEUR, Paul.Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II. Paris: Le Seuil, 1986.
- RICOEUR, Paul.Le conflit des interprétations. Essais d'herméneutique I. Paris: Le Seuil, 1969
- RIFFARD Pierre A.. L'ésotérisme. Qu'est-ce que l’ésotérisme?Paris: Robert Laffont, "Bouquins", 1990, 1016 p.
- RIFFARD Pierre A.. Dictionnaire de l'ésotérisme. Paris: Payot, 1993
- SERVIER Jean (dir). Dictionnaire critique de l'ésotérisme. Paris: PUF, 1998, 1449
- Schaeffer Jean-Marie (1989). Qu'est-ce qu'un genre littéraire?Paris: Seuil
- SURGY, Albert de.La voie des fétiches: Essai sur le fondement théorique et la perspective mystique des pratiques des féticheurs. Paris: L’Harmattan, 1995.
[1] On parlerait alors avec Isabelle Drouet, d’une causalité cyclique.
[2] Nous utiliserons dans certains passages de notre analyse l’expression histoire littéraire comme terme générique subsumant l’histoire de la littérature et l’histoire littéraire proprement dite –voir l’article de Didjack Faye ici-même.
[3]Voir (FUMAROLI, 2001).
[4] Nous nous référerons tout le long de cet article à son Le théâtre et son double publié pour la première fois en 1938 et réédité chez Gallimard (Idées) en 1964.
[5] Le verbe vivre a un sens très précis et très élevé chez Antonin Artaud.
[6] “L’ivresse dionysiaque tente (…) de conférer au corps de chacun le pouvoir de vagabonder en dehors des cadres de l’ici et du maintenant qui lui sont assignés; telle est la raison pour laquelle, dans le culte de Dionysos, le vertige joue un rôle si important: il vise à mettre hors de lui-même celui qui s’abandonne à des tourbillons qui l’engloutissent dans l’océan d’une sensation illimitée où toutes les synesthésies sont permises. (…) Dionysos promet la dilatation du moi jusqu’aux frontières du monde et prétend briser l’étroite prison corporelle dont chaque homme est prisonnier, en lui faisant goûter l’extase d’une vie infinie. Ainsi, Dionysos, maître du temps et de l’espace, se veut l’évangéliste d’une sensation cosmique.” (BRUN, 1976, 18).
[7]Pour la distinction entre desconventions constituantes, desconventions régulatriceset desconventions traditionnelles (voir Schaeffer, 1989)
[8] Au sens que Georges Bataille donne à ce mot dans l’expérience intérieure (1943).
[9] « Les religions parlent de salut. Le mysticisme d’union, l’initiatique de réalisation, l’ésotérisme de délivrance: telle est leur fin dernière. La délivrance est négativement, abandon de certains liens, positivement, accession à un certain état. » (RIFFARD, 1993, 98).
[10] « Le plus urgent ne me paraît pas tant de défendre une culture dont l’existence n’a jamais sauvé un homme du souci de mieux vivre et d’avoir faim, que d’extraire de ce que l’on appelle la culture, des idées dont la force vivante est identique à celle de la faim. », « Il faut insister sur cette idée de la culture en action et qui devient en nous comme un nouvel organe, une sorte de souffle second. […]. La civilisation c’est de la culture qu’on applique et qui régit jusqu’à nos actions les plus subtiles, l’esprit présent dans les choses ; et c’est artificiellement qu’on sépare la civilisation de la culture et qu’il y a deux mots pour signifier une seule et identique action. » (ARTAUD, 1938, 11-12).
[11] Par exemple par l’humour (qui fait écho à la distanciation brechtienne): ARTAUD, 1938, 193, 214, 63, 64, 140.
[12]Ce concept de rhizome est ainsi défini par Gilles Deleuze et Félix Guattari: « Résumons les caractères principaux d’un rhizome: à la différence des arbres ou de leurs racines, le rhizome connecte un point quelconque avec un autre point quelconque, et chacun de ses traits ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature, il met en jeu des régimes de signes très différents et même des états de non-signes.Le rhizome ne se laisse ramener ni à l’Un ni au multiple. Il n’est pas l’Un qui devient deux, ni même qui deviendrait directement trois, quatre ou cinq, etc. Il n’est pas un multiple qui dérive de l’Un, ni auquel l’Un s’ajouterait (n + 1). Il n’est pas fait d’unités, mais de dimensions, ou plutôt de directions mouvantes. Il n’a pas de commencement ni de fin, mais toujours un milieu, par lequel il pousse et déborde.Il constitue des multiplicités linéaires à n dimensions, sans sujet ni objet, étalables sur un plan de consistance, et dont l’Un est toujours soustrait (n - 1). Une telle multiplicité ne varie pas ses dimensions sans changer de nature en elle-même et se métamorphoser. À l’opposé d’une structure qui se définit par un ensemble de points et de positions, de rapports binaires entre ces points et de relations biunivoques entre ces positions, le rhizome n’est fait que de lignes: lignes de segmentarité, de stratification, comme dimensions, mais aussi ligne de fuite ou de déterritorialisation comme dimension maximale d’après laquelle, en la suivant, la multiplicité se métamorphose en changeant de nature. » (DELEUZE et GUATTARI, 1980, 30-31)
[13] Est élevé au rang de symbole tout élément de la réalité qui a conservé les traces de la force qui est ainsi actualisée.
[14] Par ce texte nous voulons faire résonner ce mot avec le mot liturgie qui étymologiquement vient duλειτουργία/ leitourgía, de l'adjectif λειτος/ leïtos, « public », dérivé deλεώς=λαός/ laos, « peuple » et dunom communἐργον/ ergon, « action, œuvre, service »
[15] « Est subtil ce qui, du point de vue de la connaissance, est peu ou pas accessible par les moyens habituels (sens, raison, science), ce qui, du point de vue de l’être, relève d’énergies moins matérielles, moins dominantes que les énergies physiques (mécanique, électrique, chimique). » (RIFFARD, 1993, 319).
[16]Voir à ce propos Vincent Debaene,Jean-Louis Jeannelle,Marielle MacéetMichel Murat. L’histoire littéraire des écrivains. Paris: PU Paris-Sorbonne, 2013. Dans le « prière d’insérer » de leur ouvrage, ces auteurs définissent ainsil’histoire littéraire des écrivains « Nous désignons par ce terme un ensemble de textes, de formes esthétiques et de pratiques éditoriales, qui depuis le XIXe siècle ont façonné l’idée que nous nous faisons de la littérature. L’importance de cette histoire racontée et construite par les écrivains eux-mêmes a été jusqu’ici été méconnue. ».
[17] L'orphisme professe une démarche de purification de l'Homme, dont ledivinse combine avec letitan, ce dernier représentant une souillure. La mère deZagreus,Perséphone, est folle de rage. Elle interdit que l'homme, marque vivante de la faute des Titans, gagne le monde divin. Elle le condamne à errer de vie charnelle en vie charnelle, par le biais de l'oubli de son origine divine, ce qui se retrouve dans les croyances véhiculant laréincarnation, lamétempsycose, notamment développée dans lemythe d'Er, présenté dans le livre X deLa République, dePlaton.
![]() Télécharger l’article en version PDF
Télécharger l’article en version PDF
Un des critères pour Kant du jugement esthétique est l’expérience du désintéressement. On peut se demander d’où provient ce genre de critère. Il est, bien sûr, possible de le comprendre en fonction du système kantien, voire de certains héritages conceptuels. Cependant, une histoire des idées sautant de texte en texte comme dans une sorte de jeu de marelle, suppose une curieuse autonomie des idées. Si l’on veut prendre au sérieux la référence à l’histoire, il est essentiel de réintégrer ces configurations conceptuelles dans des pratiques sociales et des fonctions politiques en même temps que dans relations aux supports matériels et aux techniques d’inscription par lesquels ces idées peuvent apparaître et être transmises.
Cela permet d’être sensible aux différences plus qu’aux identités (ou de comprendre que ces identités sont des stabilisations provisoires dans le flux temporel, des nœuds de différences créés par des mises en relation). Les différents mouvements critiques qui ont animé la scène récente vont tous dans ce sens: le New Historicism ouvre sur une critique des identités littéraires, les théories féministes et queer sur une critique des identités sexuelles, les cultural studies sur une critique de l’identité hégémonique d’une culture dominante et les études postcoloniales sur une critique des identités culturelles et politiques. On peut encore continuer avec l’intermédialité[1] comme critique des identités médiatiques. Une histoire esthétique de la littérature nous amène donc à donner toute son ampleur aux techniques historiographiques tout en insistant sur les dimensions sensibles des opérations textuelles et en les remettant dans leur configuration médiatique spécifique.
Prendre la parole publiquement
Le philosophe et sinologue, François Jullien, s’interroge sur ce que c’est que « entrer dans une pensée[2] » —, mais on entre d’abord dans un texte, avec sa matérialité propre. Sauf à devenir soi-même médium et pénétrer directement dans les pensées d’autrui (même celle des morts), il nous faut des médias afin que quelque chose comme une pensée (même celle des morts) soit articulée et accessible.
Prendre la parole publiquement n’est jamais une opération évidente. Lorsqu’il s’agit de publier un ouvrage littéraire, on ne peut même pas s’appuyer sur une institution spécifique, des compétences reconnues, un statut social affirmé. On voit exemplairement avec Kant que l’art est cette activité dont la règle est de ne pas avoir de règles. On pourrait saisir historiquement que cela provient en partie de la figure commune des auteurs à l’âge classique qui ont pour statut social de ne pas en avoir[3]. Comment saisir alors les spécificités de ces actions d’écriture qui consistent à créer et publier des textes « littéraires » ?
Il ne s’agit pas là de revenir à des intentions auctoriales. Il y a en effet deux manières de poser la question de l’intentionnalité à propos d’une œuvre: d’abord, celle qui présiderait à son écriture avec les significations que l’auteur y aurait disposé (nous sommes ici du côté de la production), mais nous rencontrons rapidement l’insondable de la conscience humaine, voire sa part inconsciente, qui rendent inaccessibles les « intentions » d’un auteur (quand bien même il nous en aurait livré clairement l’essentiel: d’une part, il peut nous tromper sur ce qu’il nous dit ; d’autre part, il peut se tromper sur lui-même) ; ensuite, celle qui organiserait sa mise à disposition de lecteurs à l’intention duquel le texte a été non seulement écrit mais publié selon des circuits connus (nous sommes là du côté de la réception ordonnée). Par réception ordonnée, il faut entendre à la fois organisée et commandée.
En introduisant la notion d’action entre lire (notre activité d’analyste des textes du passé) et écrire (l’activité des auteurs des textes dont nous prétendons parler et sur lesquels nous écrivons à notre tour), nous positionnons un coin dans le rapport trop évident (ou trop mystérieux) entre l’écriture et la lecture. La question des significations d’un texte vient après la compréhension de l’action d’écriture qui l’a rendu disponible, offerte à notre regard. Ce qu’il me semble utile à interroger est justement cette « mise à disposition ».
Bien sûr, il est possible d’écrire sans publier au sens strict: nombre de journaux intimes, de mémoires sont ainsi écrits sans être destinés à une diffusion publique. Le hasard de la conservation de documents et de la découverte de ces écrits a parfois permis leur publication posthume. Pourtant, les mémoires sont toujours destinés à un public même restreint (les enfants, la famille, les amis), et jusque dans le cas de l’écriture la plus intime, la plus secrète d’un journal, le scripteur figure comme son propre public, il écrit à l’horizon d’une lecture par un autre (sachant que les êtres varient et que l’intérêt du journal consiste justement à cette prise de distance d’avec soi-même et dans l’objectification de l’écriture: relire ce que l’on a fait ou pensé dans un moment proche ou éloigné du temps fait tout le vertige exaltant ou angoissant de l’écriture diariste, pour autant qu’on s’y astreigne). Une action d’écriture n’est jamais totalement intransitive, pour la raison simple que la structure de l’agir consiste toujours à « agir sur » et qu’elle suppose donc toujours une personne, une institution ou une chose sur laquelle on entend agir, y compris soi-même.
Le geste d’écrire
Plutôt que la notion d’action, assez générale, il est possible de saisir un mouvement plus spécifique pour étudier cette prise de parole publique: un geste. Le verbe latin gerere, à l'instar de facere et agere, suppose une action, mais selon des modalités à chaque fois singulières. Ainsi Varron, dans son De lingua latina, prend l'exemple de l'acteur, du poète et de l'imperator:
le poète fait un drame, mais ne l'agit pas; inversement l'acteur agit le drame, mais ne le fait pas. [...] En revanche, l'imperator, parce qu'on emploie dans son cas l'expression res gerere, ne fait pas ni n'agit: en l'occurrence il gerit [il accomplit quelque chose, la prend sur soi, en porte la responsabilité, s'en charge, l'administre], c'est-à-dire qu'il supporte [sustinet][4]
Pour ce qui est du grec ancien, on peut voir dans l'Ethique à Nicomaque, Aristote distinguer, du point de vue de la finalité, la praxis (l'agir qui est à soi-même sa propre fin) de la poiesis (le faire qui n'est qu'un moyen exécuté en vue d'une fin autre que lui-même[5]). En un sens le gerere occupe une position médiane, autorisée par sa récupération du troisième verbe grec pour l'action, à savoir archein qui signifie commencer, puis guider, gouverner. Geste et archive ont ainsi beaucoup en commun. Un geste n’est pas seulement une action quelconque, dans la mesure où tout se passe comme s’il constituait, dans le moment même de sa performance, sa propre archive.
Platon, dans le Politique, affirme une différence radicale entre archein et prattein: « La vraie science royale n'a point, en effet, de tâches pratiques [prattein]: elle commande [archein][6] », par où le chef est celui qui initie et donc qui fonde, qui sait se positionner à chaque geste dans l'origine, dans l'archè.[7] Il n'est donc pas étonnant que revienne à l'imperator de « gestoyer » de la sorte, comme dans l’Arkheion résidaient les archontes qui prenaient les décisions politiques (dont celle — tâche importante — de nommer les responsables des opérations théâtrales de chaque année…). Comme le remarque Du Marsais, dans un chapitre sur les synonymes, de gerere à gestare, c'est le spectacle même du geste qui apparaît, sa valeur pour autrui: « Gerere, c'est porter sur soi: Galeam gerere in capite. Gestare vient de gerere ; c'est faire parade de ce qu'on porte[8] », ou encore personam gerere, c'est tenir un rôle.
Même chez les modernes, on voit ce verbe opérer de façon identique. Ainsi, chez Hobbes, tout le caractère artificiel du contrat social repose sur le masque de l’acteur-souverain sous lequel les membres du peuple demeurent « auteurs » de leurs actes. C’est en quoi, pour lui, la résistance au souverain et la révolte sont non seulement dangereuses, mais plus profondément absurdes: puisque le peuple est auteur des actes du roi, s’il se soulève contre tel geste du souverain, il se révolte contre lui-même. À l’instar des signes qui trompent et des mots vides de sens, les résistances au souverain relèveraient de maladies du langage et de fausses conceptions du pouvoir. Inversement, le contrat, pour Hobbes, est un juste discours, au moins tacitement, tenu,
as if every man should say to every man, I Authorise and give up my Right of Governing myself, to this Man, or to this Assembly of men, on this condition, that thou give up thy Right to him, and Authorise all his Actions in like manner. This done, the Multitude so united in one Person, is called a COMMON-WEALTH […]. And he that carryeth this Person, is called SOVERAIGNE[9] .
La version latine du Leviathan formule la dernière phrase ainsi: « Is autem qui Civitatis Personam gerit, summam habere dicitur Potestatem[10] ». Formule classique où le verbe gerere signifie jouer le rôle, incarner, représenter, porter sur soi, agir, voire commander (dans le De cive, Hobbes dit que le souverain doit être, non comme la tête qui peut conseiller, mais comme l’âme qui doit commander: il utilise là encore le verbe gerere[11]). En incarnant le rôle du peuple-auteur, le souverain commande à la multitude, il la porte sur soi et la supporte en même temps (sustinet, disait déjà Varron). Chacun de ses gestes est signe d’une autorité qu’il porte immédiatement et qui lui permet de définir le juste et l’injuste, de gouverner les opinions et les doctrines publiques, de régler toutes les controverses qu’elles concernent les faits eux-mêmes ou les lois tant civiles que naturelles, et, ultimement, de statuer sur les lois de l’honneur et de déterminer le taux public des valeurs sociales:
It is necessary that there be Lawes of Honour, and a publique rate of the worth of such men as have deserved, or are able to deserve well of the Common-Wealth. ]…] To the Soveraign therefore it belongeth also to give titles of Honour ; and to appoint what Order of place, and dignity, each man shall hold ; and what signes of respect, in publique or private meetings, they shall give to one another[12].
La question de l’évaluation est bien liée au pouvoir souverain de celui qui « gerit » qui porte ou supporte les sujets sur la scène du politique ou qui porte le masque qui les unifie comme communauté. Les mouvements suivent des séquences parallèles entre ce choix souverain sous lequel s’unifie la multitude pour former une communauté politique et cette évaluation ou ce tri qui ramasse dans l’unité d’un fonds d’archives la diversité des objets conservés plutôt que rejetés, mémorisés plutôt qu’oubliés.
En un sens, le geste n’est jamais loin d’une geste: le déplacement de faits divers en événements mémorables, la transformation d’actes en histoire. Un geste est ce qui construit sa signification dans l’arrêt (au sens quasi politique et juridique du terme) de l’action. C’est ce que Lacan remarque: « Qu'est-ce que c'est qu'un geste ? Un geste de menace par exemple ? Ce n'est pas un coup qui s'interrompt. C'est bel et bien quelque chose qui est fait pour s'arrêter et se suspendre. [...] Cette temporalité très particulière, que j'ai définie par le terme d'arrêt, et qui crée derrière elle sa signification, c'est elle qui fait la distinction du geste et de l'acte[13]. » Même s’il ne semble pas exister de verbe « positif » pour le geste (gesticuler apparaît plutôt péjoratif), il est symptomatique que ce verbe existant témoigne immédiatement d’une sorte d’excès.
Toute prise de parole implique une volonté et une intention, mais pas forcément sous le seul régime de la rationalité (on peut être obligé ou se croire obligé d’écrire et de publier, on peut désirer et ne pas désirer cette exposition publique, etc.). Encore une fois, il ne s’agit pas de revenir à une intentionnalité de l’auteur (difficile à reconstituer historiquement et de toute façon souvent opaque aux acteurs eux-mêmes), mais de scruter les modes de capture et d’exposition exploités dans les gestes d’écriture. S’il n’y a pas de verbe « gester » qui corresponde au substantif, « gesticuler » avec sa connotation de mise en scène exagérée, sa tendance histrionique est exactement ce dont nous avons besoin: la mise en scène de l’action d’écrire dans un geste public est une affaire d’acteur au sens d’histrion. Il faut alors, pour chaque écrivain, négocier subtilement les manières de faire passer cet histrionisme manifeste pour une délégation de pouvoir.
L’outrecuidance de la parole et le public amical
Dans le Gargantua, publié en un moment de grande turbulence politique liée justement à des gestes de publication outrecuidants au regard des autorités en place (c’est le moment de l’affaire des placards où des textes critiquant sévèrement la messe et le pape circulent et sont affichés jusque sur la porte de la chambre du roi de France François Ier), Rabelais met en scène le public parisien et ses occupations inadéquates. Au lieu d’écouter attentivement un « bon prescheur evangelique », le public parisien est si « inepte de nature qu’un basteleur, un porteur de rogatons, un mulet avecques des cymbales[14] » les attirera plus. Voyant cela, Gargantua leur paye le spectacle en les compissant « par rys ». Ceux qui en réchappent sont soit en colère soit, « par rys » à leur tour, s’en amusent. Et c’est ainsi que Paris fut nommée. Paris n’est qu’un jeu de mots sur le rire, essence de l’homme (comme le souligne l’adresse au lecteur). Mais si certains parisiens parviennent à rire avec Gargantua, c’est qu’ils ont su entrer dans le jeu et, par extension, dans la bonne façon de lire les événements[15]. L’« ami lecteur » (qui apparaît justement dès l’adresse au lecteur) comprend les enjeux du rire et sait qu’ils fondent et nomment même la capitale du Royaume.
L’histoire ne finit pas là. Car il y a une autre étymologie, extrêmement savante celle-là, qui rend compte du public parisien: « les Parisiens, qui sont faictz de toutes gens et de toutes pieces, sont par nature et bons jureurs et bons juristes et quelque peu outrecuydez dont estime […] que sont dictz Parrhesiens en Grecisme, cest a dire fiers en parler[16]. » L’étymologie érudite renvoie ainsi les parisiens à la figure de la parrhêsia. Michel Foucault a mis en relief cette notion dans son dernier cours au Collège de France et a insisté sur la valeur philosophique essentielle de ce courage de dire vrai[17]. Avec Rabelais, nous avons l’autre facette de la parrhêsia: la prétention à dire le vrai, voire l’outrecuidance, en tous les cas la fierté (plus encore que le courage) de prendre publiquement la parole pour affirmer, d’un même mouvement, un état des choses et son propre être.
La parrhêsia relève de la thymotique, avec toute l’ambivalence que peut recéler cette fierté entre affirmation de soi et reconnaissance publique. C’est que la parrhêsia engage toujours un certain agencement public des énonciations. Michel Foucault insiste sur la dimension de production de ce dire vrai. Mais qu’arrive-t-il à ceux qui s’emparent de ce qui a été énoncé et entendent, à leur tour, entrer dans le mouvement de la parrhêsia ? Comment faire pour que les paroles franches ne soient pas prises pour trop rudes, trop abruptes ? Comment s’assurer que cette franchise soit de l’ordre d’une faveur plus que d’une censure ? L’ami est justement celui qui dit vrai à son ami, tout en le comprenant intimement et en le ménageant pour qu’il se corrige sans se rebuter[18]. On conçoit alors l’importance de cette figure liminaire de l’« ami lecteur ».
L’ami lecteur n’est pas un thème ni même une figure exploités par les auteurs sur le seuil de leurs ouvrages. Cette position indique bien qu’il s’agit d’une structure livresque (réitérable, bien sûr, dans le corps du texte). Il s’agit, en fait, d’une instance médiatique (ou une figure au sens où Jacques Rancière essaye d’utiliser le terme[19]): elle permet un passage, une circulation, c’est-à-dire une action autorisée, reconnue comme légitime. Un échangeur d’actions. Il ne faudrait, cependant, pas prendre ce fil conducteur au cours des siècles comme unique et indéfiniment réitérable. Il est en fait le résultat de multiples types d’intervention. De la même manière qu’un fil est constitué de multiples brins qui s’entremêlent, le fil conducteur de « l’ami lecteur » est fait de multiples configurations discursives.
Comment faire reconnaître son identité sociale d’auteur ? Tel est le problème fondamental de toute personne prenant la parole publiquement. Cela ne veut pas simplement dire: qui suis-je ? mais surtout: à qui puis-je m’adresser ? qui va reconnaître que je ne fais pas simplement du bruit, mais bien que je communique ? Pour constituer son identité sociale d’auteur, il faut d’abord construire/instituer son public. Un texte est tendu entre l’acceptation de l’aléa des lecteurs réels et la programmation d’une lecture virtuelle. L’écriture n’est une action qu’en s’offrant aux actes de lecture.
Observer les façons dont un texte se présente ne consiste pas à le renvoyer à ce qui l’a déterminé (une conscience individuelle, une trajectoire sociale, une fonction institutionnelle, une idéologie de groupe) ni à ses effets prévus, prévisibles ou imprévus, voire imprévisibles. C’est une façon de l’observer dans son présent d’action dans le monde, dans sa manière de se dresser dans un Maintenant et, ainsi, d’apparaître dans la singularité acceptée de son geste. Or, pour apparaître, il faut à la fois un sujet producteur de cette apparition et un tiers percevant ce qui lui apparaît. Autrement dit, tout texte est plus que lui-même: pour qu’il apparaisse comme texte, il faut que soient mobilisés avec lui et en lui un producteur et un percepteur. La langue française a réduit le sens de « percepteur » à la profession du personnage institué qui recueille les impôts des individus soumis au même État. Pourtant, c’est une manière intéressante de reconnaître qu’un sujet percevant n’est pas simplement un organisme vivant collectant des données sensorielles, mais un organisme institué qui transforme des informations en connaissances et met dans un ordre reconnaissable ces dernières.
Un livre est toujours une manière de se livrer. L’auteur existe à l’ombre de ses œuvres. Il les a organisés pour dessiner tel portrait de soi ou les a laissés déterminer sa posture sociale. Le propre des communications écrites est qu’elles représentent des forces dont les lecteurs peuvent se servir, que ce soit pour jouer de leur force d’inertie en surfant sur ce qu’elles ont rendu possible, ou pour les employer à d’autres combats que ceux initialement livrés, ou même pour les retourner contre leur auteur. C’est en quoi il est essentiel d’organiser les modes de réception. En servant du dispositif social de l’amitié, on parvient implicitement à créer une communauté d’amis prêts à recevoir ce qui est ainsi livré.
Or, l’amitié relève d’un entendement social dont nous avons perdu une bonne partie des effets[20]. Si Aristote termine son grand livre sur l’éthique par l’amitié et non par la justice, si le vocabulaire politique latin emploie régulièrement le terme d’amicitia pour désigner des relations qui n’ont rien de spécifiquement intimes, c’est bien que, chez les Anciens, l’amitié dans son usage le plus courant porte sur les relations publiques, celles qui lient les hommes d’une même société entre eux[21]. Encore faut-il saisir que l’enjeu affectif n’en est pas pour autant évacué. C’est justement parce que ce lien politique doit être ressenti comme mobilisateur d’affects que le lexique de l’amitié est exploité. Tout au long du Moyen Âge, on voit que ce vocabulaire de l’amitié structure les relations féodales comme les institutions des cités (nombre des chartes municipales s’écrivent en revendiquant une amitié entre concitoyens). À l’âge classique, pour comprendre « les modalités de construction et de représentation du lien social [...], c’est le langage de l’amitié — et non celui de la communauté ou du lien social — qui est omniprésent[22] ». On conçoit alors que l’ami lecteur devienne une ressource pour façonner le rapport problématique entre l’auteur et son public. L’invoquer en début d’ouvrage, dans une adresse directe, conduit à en contrôler les effets et à inclure d’office celui qui lit comme s’il pénétrait moins dans un livre que dans un cercle d’amis, dans un réseau de connaissances familières. Il s’agit moins de rassurer le lecteur, bien sûr, que l’auteur lui-même. La logique du don et du contre-don permettant de construire du lien social, l’amitié en apparaît comme la figure de l’excellence politique.
Le lien amical, mis en place par les humanistes dans les cercles restreints de lecteurs privilégiés qui constituaient la République des Lettres, a pu devenir un outil stratégique pour affermir les rapports de reconnaissance symbolique entre auteur et public. La logique égalitaire et affective a ainsi rendue possible l’instauration d’un lien très particulier où, comme le souligne David Hume, « we choose our favourite author as we do our friend, from a conformity of humour and disposition[23]. » Ce n’est plus simplement l’autorité qui fait l’auteur, mais l’amitié qu’on éprouve pour lui.
C’est à partir de cette configuration à la fois sociale et médiatique qu’il devient possible de comprendre comment on en arrive à une valeur esthétique des œuvres littéraires ou des œuvres d’art en général qui affichent un principe de « désintéressement » chez l’auteur comme chez le spectateur. Le modèle amical a structuré la relation entre l’artiste et le public en suivant les logiques sociales du don et du contre-don. Même si l’économie de marché rationalise de fait ces relations, la logique symbolique du don demeure indispensable afin de négocier la prise de parole et le geste de publication. On mesure ainsi l’importance de réintégrer une histoire esthétique de la littérature dans les configurations du sensible, les dispositifs médiatiques et les formes sociales d’action.
Concevoir les textes comme des écrits publiés, cela suppose en définitive de replacer les écrits dans les actions sociales des individus en prêtant attention aux spécificités impliqués par l’usage du média de l’écriture ; cela implique aussi de prendre en compte la prise de parole publique (à la fois comme capture de l’attention et exposition à autrui) et les modalités de circulation de cette parole (à la fois dans l’espace de sa production et dans sa transmission temporelle). C’est dans ce cadre que l’on peut analyser les modalités d’inscription de la figure du lecteur.
[1] Sur l’intermédialité, je me permets de renvoyer à mon ouvrage D’où nous viennent nos idées? Métaphysique et intermédialité, Montréal, Éditions VLB, 2010.
[2] François Jullien, Entrer dans une pensée ou Des possibles de l’esprit, paris, Gallimard, 2012.
[3] Sur ce point voir Christian Jouhaud, Les pouvoirs de la littérature. Histoire d’un paradoxe, Paris, Gallimard, 2000.
[4] Varron, De lingua latina, éd. et trad. P. Flobert, Paris, Les Belles Lettres, 1985, VI, VIII, 77, p. 103: « poeta facit fabulam et non agit; contra actor agit et non facit [...] ; contra imperator, quod dicitur res gerere, in eo neque facit nec agit, sed gerit, quod est sustinet. » Le Lexicon Totius Latinitatis indique d'ailleurs les trois valeurs suivantes: « agere significat vim, quae in re aliqua versatur atque exercetur eamque exsequitur perficitque; facere significat vim, quae rem aliquam creat sive producit, cujusque opus remanet; gerere significat vim, quae res ordinat, regit, disponit. »
[5] Aristote, Éthique à Nicomaque, VI, 1140b3.
[6] Platon, Politique, 305d.
[7] Il existe en fait quatre verbes, en grec, pour désigner l'action: agein (agir au sens le plus général), archein (qui signifie commencer, commander, gouverner), prattein (qui a valeur de traverser, achever, accomplir) et enfin poiein (lié à la production et à la fabrication). Par contre, dans le passage au latin, qui n'a que trois verbes, facere récupère l'extension du poiein, tandis que agere désigne l'action en général comme agein, mais aussi reprend l'idée de mise en mouvement et de commandement de l'archein, gerere, enfin, semble se situer à la jonction entre la valeur d'accomplissement du prattein et le gouvernement de l'arkhein.
[8] Du Marsais, Traité des tropes, Paris, Le nouveau commerce, 1981, p. 242.
[9] Thomas Hobbes, Leviathan, éd. C. B. Macpherson, Harmondsworth, Penguin, 1971 [1651], II, XVII, p. 227-228.
[10] Thomas Hobbes, Opera Latina, éd. Molesworth, t. III, p. 131.
[11] Thomas Hobbes, Du citoyen, trad. Samuel Sorbière, introduction Simone Goyard-Fabre, Paris, Garnier-Flammarion, 1982 [1642].
[12] Thomas Hobbes, Leviathan, II, XVIII, p. 235-236.
[13] Lacan, Séminaire, XI: les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, éd. J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1973, p. 132.
[14] Rabelais, Gargantua, éd. Guy Demerson, Paris, Seuil, 1996 [1534 ou 1535], chap. 17, p. 154.
[15] Sur ce passage et, plus généralement, sur les écrits porteurs de scandale à la Renaissance, voir Antonia Szabari, Less Rightly Said: Scandals and Readers in sixteenth-century France, Stanford University Press, 2010.
[16] Rabelais, Gargantua, éd. Guy Demerson, Paris, Seuil, 1996 [1534 ou 1535], chap. 17, p. 156
[17] Michel Foucault, Le Courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres II. Cours au Collège de France, 1984, Paris, Gallimard, Seuil, coll. « Hautes Etudes », 2009.
[18] Pour plus de détail, voir mon article en ligne « Histoire des sentiments et histoire du littéraire: le médium de l’ami lecteur à la Renaissance », Littérature et histoire en débats, éd. Catherine Coquio, Fabula, 2013, http://www.fabula.org/colloques/document2103.php ; ainsi que « L’ami lecteur: sentiment littéraire et lien social au XVIIe siècle », Les Liens humains dans la littérature (XVIe-XVIIe siècles), éd. Julia Chamard-Bergeron, Philippe Desan et Thomas Pavel, Paris, Classiques Garnier, 2012, p. 263-276.
[19] Jacques Rancière, Le Spectateur émancipé, Paris, Éditions La Fabrique, 2008, p. 137-138.
[20] En fait, nous en retrouvons sans doute certains éléments lorsque, sur Facebook, nous affichons plusieurs centaines d’« amis ». Le terme même de « réseau social », que nous utilisons pour désigner ce type de pratique, indique combien l’amitié est autant affaire de socialité que d’intimité.
[21] Les amitiés sont prisées pour les vastes réseaux de solidarité qu’elles impliquent, même si l’intérêt personnel, en un apparent paradoxe, trouve son compte dans la gratuité affichée des dons amicaux. Voir Aristote, Éthique à Nicomaque, livres IX-X, ainsi que Pierre Aubenque, « L’amitié chez Aristote », in La prudence chez Aristote, Paris, PUF, 1963, et Paul Millett, Lending and Borrowing in Ancient Athens, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, chapitre V. De même, à Rome, l’amicitia relève du vocabulaire des institutions politiques beaucoup plus que des investissements intimes (Jacqueline Hellegouarc’h, Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques, Paris, les Belles Lettres, 1972).
[22] Nicolas Schapira, « Les intermittences de l’amitié dans le dictionnaire universel de Furetière », Littératures classiques, 47, hiver 2003, p. 217.
[23]Hume, « Of the standard of taste », Essays Moral, Political and Literary, 1757.
![]() Télécharger l’article en version PDF
Télécharger l’article en version PDF
Résumé
Parler de « l’histoire de la littérature » et de « l’histoire littéraire » au moment où les deux concepts sont employés comme synonymes dans certains manuels et programmes scolaires et universitaires peut probablement provoquer quelques résistances. Pourtant, du point de vue de la théorie littéraire, ces deux notions renvoient à des pratiques et méthodes bien différentes. Dans cet article, nous allons nous livrer à un exercice de dissociation de ces deux concepts pour contribuer à l’éclairage de quelques zones d’ombre de la recherche littéraire. Il s’agira pour nous de partir de la naissance de la Critique Historique qui sera à l’origine de la conceptualisation de l’histoire de la littérature et de l’histoire littéraire comme deux disciplines distinctes. Le but de cette étude est de clarifier, à partir de la théorie littéraire, chacune de ces deux notions qui ont d’ailleurs considérablement participé à l’accessibilité des œuvres littéraires mais également à l’émergence de nouvelles méthodes d’analyse textuelle.
Abstract
To talk about “history of the literature" and "literary history» might cause some resistances as both concepts are used as synonyms on certain textbooks and school and university courses. Nevertheless, from the point of view of the literary theory, these two notions refer to totally different practices and methods. In this article, we will dissociate these two concepts to contribute to the clarification of some aspects of literary research. We will begin with the birth of the Historical Criticism which will be at the origin of the conceptualization of the history of the literature and of the literary history as two distinct disciplines. The purpose of this study is to clarify, from the literary theory, each of these two notions which, moreover, have participated considerably in the accessibility of the literary works, but also in the emergence of new methods of textual analysis.
I. NAISSANCE DE LA CRITIQUE HISTORIQUE
Du Moyen Age à la fin du XVIIIe siècle la critique littéraire était essentiellement fondée sur une approche de type rhétorique. La valeur littéraire d’une œuvre dépendait donc de la perfection du mètre, de la rime et du respect strict des normes d’écriture préexistantes. C’est cette période que Marc Fumaroli appelle « l’Âge de l’éloquence ». Pendant cette époque, l’éloquence devait être la première qualité de l’écrivain. C’est d’ailleurs pourquoi dans des pays comme la France les écrivains étaient initiés à l’art de la belle parole à travers des «cours de belles lettres» qui étaient dispensés. L’écriture était donc une exhibition du talent d’émouvoir par le verbe. La littérature était presque réduite à l’expression de la beauté verbale. Laquelle beauté avait plus d’importance pour les publics (écrivain et lecteur) que le message social qui sous-tendait le texte littéraire.
Au XIXe siècle, une nouvelle génération de critiques littéraires souligne les limites de l’approche classique en soutenant que l’élément rhétorique ne doit pas être le seul critère à mettre en avant dans l’analyse des textes littéraires et propose de conjuguer la forme au fond pour arriver à une interprétation beaucoup plus complète de la création littéraire. La nouvelle critique va donc prendre en charge l’aspect historique passé sous silence par la critique rhétorique. C’est ainsi que la nouvelle méthode d’analyse littéraire appelée critique historique a vu le jour.
Cependant, il est important de souligner que la critique historique n’a pas l’intention de combattre la critique rhétorique ni de s’ériger en une méthode opposée mais va plutôt fonctionner comme une approche complémentaire qui mettra au centre de l’interprétation littéraire le contexte historique et socioculturel dans lequel l’œuvre et son auteur ont vu jour et évolué. La critique historique reproche donc à la critique rhétorique le fait de centrer exclusivement l’étude des œuvres sur la forme alors que le fond est aussi d’une importance capitale. Dans son ouvrage sur Montaigne (1932), Gustave Lanson souligne que chez cet écrivain français « le sujet est inséparable de la forme des pensées » c’est-à-dire que la forme est indissociable du fond pour bien saisir le sens d’une œuvre littéraire. Les rhétoriciens voient donc leur méthode objectée par les critiques historiques qui réussiront à imposer leur courant de pensée durant tout le XIXe siècle et même dans la première moitié du XXe siècle. L’histoire devient dès lors l’élément indispensable dans l’analyse des textes littéraires. La critique rhétorique conçoit la littérature comme un moyen par lequel on comprend les lois du langage alors que pour la critique historique la littérature « doit être expliquée par et pour elle-même ».
La première tâche de la critique historique consistera à établir clairement la différence entre l’histoire de la littérature et l’histoire littéraire. Ce travail préliminaire de conceptualisation a permis à la critique historique de bien définir ses orientations méthodologiques en tant que doctrine littéraire proposant une démarche extrinsèque de l’analyse textuelle. Il faut rappeler qu’avant l’émergence de la critique historique, comme méthode d’analyse littéraire, les notions d’histoire de la littérature et d’histoire littéraire étaient employées sans différenciation sémantique. En Europe, le premier document d’histoire de la littérature fut publié en Espagne en 1449 par le marquis de Santillana, don Iñigo López de Mendoza, sous le titre de Proemio y carta qui avait servi de prologue aux poésies qu’il envoyait au connétable de Portugal. Dans ce document écrit en espagnol médiéval, le marquis de Santillana retrace l’itinéraire de la poésie en insistant sur ses origines gréco-latines et bibliques, son évolution à travers les écrits des grandes figures de la littérature jusqu’au XVe siècle. Il a fallu attendre trois siècles plus tard pour voir les premiers livres d’histoire de la littérature publiés dans les autres pays européens.
En 1717 Michel de la Roche imprime à Amsterdam l’Histoire littéraire de la Grande Bretagne, en 1720 des érudits qui ont pris le nom d’Anonymes (dont probablement Lenfant) publie le premier tome de la Bibliothèque germanique ou Histoire littéraire d’Allemagne et, en 1733, sous l’égide de Dom Rivet, les bénédictins de Saint-Maur publient le premier tome de l’Histoire littéraire de la France. Dans ces différents livres le travail des auteurs consistait en une classification diachronique des productions littéraires. C’est d’ailleurs pourquoi on parlait de bibliothèques française, britannique et germanique comme synonymes d’histoire littéraire. A l’image d’une bibliothèque, ces livres cataloguaient la production littéraire et la classaient par siècles, genres, courants, générations et écoles littéraires sans grandes considérations sur l’intériorité des œuvres. Le travail de ces historiens de la littérature était donc assimilable à celui d’un bibliothécaire.
Mais au XIXe siècle, au moment de la codification de l’Histoire Littéraire comme discipline qui propose une nouvelle méthode d’analyse littéraire, Gustave Lanson et ses partisans se verront obligés d’expliquer ce qui différencie leur courant de pensée de l’histoire littéraire du XVIIIe siècle incarnée par Michel de la Roche, les anonymes et Dom Rivet. C’est à partir de ce moment que les deux concepts d’histoire de la littérature et d’histoire littéraire seront théorisés et différenciés par Lanson et ses partisans.
II. HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE
Les critiques historiques du XIXe siècle appellent Histoire de la littérature les travaux initiés par les érudits comme Iñigo López de Mendoza, Michel de la Roche, les Anonymes et Dom Rivet bien que ces derniers, pour des raisons de commodités linguistiques de l’époque, aient préféré accompagner le substantif « histoire » de l’adjectif « littéraire » (Histoire littéraire) en lieu et place du complément du nom « littérature » (Histoire de la littérature). C’est pourquoi au XVIIIe siècle le concept d’histoire littéraire avait prospéré plus que celui d’histoire de la littérature, mais le contraire se produira à partir du XIXe siècle. Leurs productions sont qualifiées « d’œuvre de vulgarisation ». La démarche de ceux qui font de l’histoire de la littérature est bien résumée dans le titre complet de l’Histoire littéraire de la France publiée en 1733. Citons le titre intégral:
Histoire Littéraire de la France, où l’on traite de l’origine et du progrès, de la décadence et du rétablissement des sciences parmi les Gaulois et les Français ; du goût et du génie des uns et des autres pour les Lettres en chaque siècle ; des académies des sciences et belles-lettres ; des meilleures bibliothèques anciennes et principaux collèges ; des plus célèbres imprimeries ; et de tout ce qui a un rapport particulier à la littérature ; avec les éloges historiques des Gaulois et des Français qui s’y sont fait quelque réputation ; le catalogue et la chronologie de leurs écrits ; des remarques historiques et critiques sur les principaux ouvrages ; le dénombrement des différentes éditions ; le tout justifié par les citations des auteurs originaux.
Malgré le titre Histoire littéraire de la France préféré ici à celui d’Histoire de la littérature française –un choix surement linguistique- la première de couverture de l’édition princeps de ce prestigieux document établit les paradigmes de ce que Gustave Lanson va appeler « Histoire de la littérature ». Ce titre révèle donc la démarche de l’histoire de la littérature et énonce les différents aspects sur lesquels l’historien de la littérature va axer son travail. L’histoire de la littérature s’occupe donc de la sauvegarde des œuvres, de leur classement pour qu’elles soient plus accessibles pour les lecteurs. Elle consiste en un regroupement des archives littéraires. C’est dans ce sens que Gérard Genette, parlant de l’histoire de la littérature telle qu’elle est conçue dans les manuels de l’enseignement secondaire affirme qu’il « s’agit là, en fait, de suites de monographies disposées dans l’ordre chronologique. Que ces monographies soient en elles-mêmes bonnes ou mauvaises n’a pas d’importance ici, car de toute évidence la meilleure suite de monographies ne saurait constituer une histoire »[1].
L’histoire de la littérature ne propose pas de méthode d’analyse, sa vocation n’est pas d’interpréter les œuvres mais plutôt d’informer de leurs dates et lieux de publication, leurs différentes éditions revues, augmentées ou pas, les époques littéraires où elles ont vu jour, les courants littéraires auxquels sont rattachés leurs auteurs, etc. Elle s’intéresse également à tout ce qui a un rapport avec la littérature. Mais tout cela sans prétention aucune de fournir les éléments qui sous-tendent l’analyse du fond et de la forme des œuvres pour en saisir le sens. Cela est du ressort de l’histoire littéraire qui définit le paradigme historique comme étant le soubassement de toute analyse littéraire.
III. HISTOIRE LITTÉRAIRE
Au début des années 1810 émerge à la Sorbonne une nouvelle génération d’intellectuels dont la conjugaison des disciplines sera à l’origine de l’histoire littéraire. Le philosophe Victor Cousin, l’historien François Guizot et le littéraire Abel Villemain forment le triumvirat de cette université française qui va incarner le renouveau intellectuel. Dans son étude sur la critique historique et ses origines, Luc Fraisse écrit:
L’histoire littéraire et sa doctrine résultent de cette trilogie de disciplines: philosophie, histoire et littérature. Le souhait de la nouvelle génération est que la littérature, vérifiée par les données historiques, permette de dégager une philosophie de l’art. Dans cette optique, la littérature se voit placée à mi-chemin entre la philosophie pour sa dimension esthétique et l’histoire pour son principe de réalité.
Les trois intellectuels Victor Cousin, François Guizot et Abel Villemain, grâce aux enseignements qu’ils dispensaient parallèlement à la Sorbonne à partir de 1815 ont très tôt diffusé les idées de la nouvelle école et surtout la pensée de Mme de Staël quand celle-ci déclarait en 1800 que « la littérature est l’expression de la société » (De la littérature, 1800). Cette pensée de Madame de Staël avait poussé certains de ses contemporains à méditer sur le caractère historique de la création littéraire. La littérature n’était plus réduite à l’esthétique du verbe, désormais on essaie d’élaborer le système de transmission entre l’histoire, c’est-à-dire le contexte social, culturel et politique et l’œuvre littéraire. A côté d’une étude historique de la littérature, on fait une étude de cette histoire qui est une source d’inspiration pour la littérature, autrement dit, on s’intéresse à l’historicité du texte littéraire, c’est-à-dire aux évènements qui font naître l’enthousiasme créateur chez les écrivains. C’est ce que Lanson appelle « replacer le chef-d’œuvre dans une série, faire apparaitre l’homme de génie comme le produit d’un milieu et le représentant d’un groupe ».[3]
Cependant, cela ne signifie pas chez lui une conception de la littérature comme simple transformation verbale des faits sociaux et historiques ainsi que le prétendent Mme de Staël et Hippolyte Taine. Cette conception est, à son avis, assez réductrice, car ce qui est important pour Lanson dans la recherche des relations entre l’œuvre et son contexte social c’est l’étude de l’interaction littérature/société et société/littérature. C’est du moins le sens de ses propos quand il écrit: « Image ou miroir, ce n’est pas assez pour nous ; nous voulons savoir les actions et les réactions qui vont de l’une à l’autre, laquelle va devant ou suit, à quel moment c’est l’une, ou c’est l’autre, qui fournit le modèle ou imite.»
L’analyse des relations entre l’œuvre littéraire et la réalité sociale doit donc aller dans les deux sens pour mesurer le degré d’influence de la société dans la création artistique mais également la capacité de l’objet d’art d’impacter sur les faits sociaux. Pour lui, l’auteur part de la réalité sociale qui sera ensuite réfractée par l’œuvre avant de la retourner à la société par la médiation de la lecture. On dépasse donc l’approche exclusivement rhétorique, désormais on s’intéresse à « la vie humaine inscrite dans les formes littéraires ».
Dans les années 1870 Hippolyte Taine, partisan de la critique scientifique, identifie dans sa Philosophie de l’Art trois causes permanentes qui déterminent la production littéraire: la race, le milieu et le moment. La dernière cause – celle du moment- est une « comparaison entre l’apparition d’une œuvre et son contexte d’émergence {et} annonce directement la théorie de la réception et de l’horizon d’attente de Jauss.»[5]
Dans sa Philosophie de l’art Taine r sa théorie et écrit qu’une «œuvre d’art n’est pas isolée » d’où la nécessité de « rechercher l’ensemble dont elle dépend et qui l’explique ». Taine conclut: « …en tout cas compliqué ou simple, le milieu, c’est-à-dire l’état général des mœurs et de l’esprit, détermine l’espèce des œuvres d’art…»[6]
Donc le triumvirat de la Sorbonne, Mme de Staël et Hippolyte Taine sont les pionniers de l’histoire littéraire dans la mesure où ils ont avancé les idées sur lesquelles Gustave Lanson va fonder plus tard la codification de la discipline.
Dans son Programme d’études sur l’histoire provinciale de la vie littéraire en France (février 1903), Gustave Lanson écrit:
On pourrait écrire à côté de cette « Histoire de la littérature française », c’est-à-dire de la production littéraire, dont nous avons assez d’exemplaires, une « Histoire littéraire de la France » qui nous manque et qui est presque impossible à tenter aujourd’hui: j’entends par là… le tableau de la vie littéraire dans la nation, l’histoire de la culture et de l’activité de la foule obscure qui lisait, aussi bien que des individus illustres qui écrivaient.[7]
Cette réflexion lansonienne différencie déjà l’histoire de la littérature qu’il présente comme le catalogue de la « production littéraire » de l’histoire littéraire qui s’intéresse à des aspects beaucoup plus profonds comme les contextes dans lesquels les œuvres sont produites et reçues.
L’histoire littéraire va au-delà du travail éditorial pour aller à la recherche de l’ensemble des circonstances historiques (politiques, sociales, économiques et culturelles) et littéraires dans lesquelles les œuvres sont produites c’est-à-dire une « représentation de l’état général de l’esprit et des mœurs du temps auquel elles appartiennent ». L’historien littéraire ne juge pas les œuvres par rapport à lui mais les insère dans leur contexte. A ce propos Gustave Lanson écrit:
Il est agréable, il est utile, il est sain de rechercher ce que les chefs-d’œuvre recèlent toujours de sens et de plaisir pour nous, et je ne détournerai personne de se donner à lui-même cette joie élevée. Mais la tâche propre et principale de l’histoire littéraire est de ne point juger les œuvres par rapport à nous, selon notre idéal et nos goûts, d’y découvrir ce que leur auteur a voulu y mettre, ce que leur premier public y a trouvé, la façon réelle dont elles ont vécu, agi dans les intelligences et les âmes des générations successives. Ce travail de séparation de l’actuel et du passé, du subjectif et de l’historique suffit à l’activité des historiens littéraires. Il comporte, outre l’analyse et la lecture interne des œuvres, l’emploi de toutes sortes de documents et de faits par lesquels s’éclairent la personnalité véritable et le rôle historique d’un livre, et qui ont pour effet de le détacher de nous, de le retirer de notre vie intérieure où la simple lecture l’a souvent mêlé {…}. Toute la différence qu’il y a ici entre la critique subjective et l’histoire littéraire, c’est que par la critique je dégage le rapport de l’œuvre à moi-même, par l’histoire le rapport de l’œuvre aux divers publics devant lesquels elle est passée.[8]
Lucien Febvre aussi contribuera considérablement à l’approfondissement et à la clarification des critères qui constituent le système lansonien de l’histoire littéraire. Dans son article intitulé « Littérature et vie sociale: de Lanson à Mornet, un renoncement ? » publié d’abord dans le numéro III des Annales d’histoire sociale puis repris dans Combats pour l’histoire, Lucien Febvre critique la démarche de Daniel Mornet, auteur du livre Histoire de la littérature classique, 1600-1700 ; ses caractères véritables et ses aspects inconnus. Lucien Febvre considère que le projet de Mornet d’écrire « une histoire historique » de l’époque classique française est voué à l’échec car ne tenant pas compte des aspects fondamentaux sur lesquels doit reposer une vraie histoire littéraire. A ce propos il écrit:
Une « histoire historique » de la littérature, pour lui {Daniel Mornet}, cela veut dire ou voudrait dire l’histoire d’une littérature, à une époque donnée, dans ses rapports avec la vie sociale de cette époque. Et je n’ai pas besoin de dire qu’ainsi conçue, une telle histoire présenterait, en effet, des « aspects inconnus ». Il faudrait pour l’écrire reconstituer le milieu, se demander qui écrivait, et pour qui; qui lisait, et pour quoi ; il faudrait savoir quelle formation avaient reçue, au collège ou ailleurs, les écrivains - et quelle formation, pareillement leurs lecteurs[…]; il faudrait savoir quel succès obtenaient et ceux-ci et ceux-là, quelle était l’étendue de ce succès et sa profondeur ; il faudrait mettre en liaison les changements d’habitude, de goût, d’écriture et de préoccupation des écrivains avec les vicissitudes de la politique , avec les transformations de la mentalité religieuse, avec les évolutions de la vie sociale , avec les changements de la mode artistique et du goût , etc. {…}.
Histoire historique… Mais voilà que rien de tout cela n’apparaît dans le gros livre de M. D. Mornet.[9]
Lucien Febvre considère qu’une histoire littéraire digne de ce nom ne doit pas consister en une simple juxtaposition chronologique de noms, de dates et de titres d’ouvrages mais le processus d’historicisation doit intégrer des éléments extralittéraires permettant de bien mettre en évidence l’interaction entre l’œuvre et son contexte. Donc à côté de cette histoire de la littérature assez simpliste Lucien Febvre préfère une histoire littéraire: « qui nous renseigne sur les faits de la vie des écrivains, sur les vicissitudes de leur existence, sur les circonstances extérieures de leurs publications- celle qui recueille traditions et documents. Une érudition chronologique. »[10]
On voit donc clairement que Lucien Febvre fonde son programme d’histoire littéraire sur les cinq piliers du système lansonien: l’étude « du milieu », des « publics », des « formations reçues », des « modes » et des « mentalités ». L’œuvre littéraire est donc indissociable de l’environnement socioculturel qui a produit son auteur. Comme l’écrit Martine Jey:
L’écrivain, en effet, est bien évidemment en relation avec un milieu, porteur d’idées, d’aspirations, de joies, des rêves des générations précédentes et de la sienne. Aussi, les éléments concernant sa vie, sa formation, ses lectures, mais aussi sources, influences ne sont-ils pas externes à l’œuvre, pour lui, mais entrent dans le processus de création et doivent être étudiés en tant que tels.[11]
Une fois ces principes érigés en canons, l’histoire littéraire devient une discipline qui aura comme chef de file Gustave Lanson qui en a dégagé les axes de réflexions suivants:
1- La connaissance des textes
2- Leur classification en genres, écoles et mouvements
3- La place des individus au sein des influences collectives. L’œuvre est-elle un produit de son époque, ou bien une réalité complètement isolée? Est-elle le résultat de son époque, ou au contraire son influence a-t-elle été déterminante sur l’époque (paradoxe de l’œuf et de la poule) ?
4- L’enquête biographique
Chacun de ces quatre axes de réflexion exige une approche critique appropriée. Pour résoudre ces principales questions de l’histoire littéraire on s’appuie principalement sur quatre principales méthodes d’analyse:
1-La critique philologique
Sa principale préoccupation est la restitution des œuvres dans leurs formes primitives. Ici, il s’agira pour le critique de repérer toutes les modifications intervenues au cours de l’histoire ou pendant les différentes réimpressions de l’œuvre. La critique philologique soutient que le chercheur ne doit « travailler que sur des textes dont l’authenticité a d’abord été pleinement vérifiée ».[12] Ces textes sont ceux qui ont été contrôlés du vivant de l’auteur c’est –à- dire des textes dont tout changement se ferait avec le consentement de celui qui les a produits. La curiosité du chercheur doit l’amener, comme le révèle Luc Fraisse, « à faire initialement le tour de tout ce qui a été préalablement trouvé sur le sujet que l’on aborde, enfin de manière générale l’exactitude bibliographique ».[13]
2-L’histoire des écoles et des genres littéraires
Elle s’appuie sur les acquis de l’histoire et de l’historiographie. Le décès de l’écrivain constitue ici le repère qui rend possible l’inscription de ses œuvres dans des écoles et des genres littéraires. C’est -à- dire que le chercheur doit identifier le siècle, l’école, le genre et le mouvement littéraire auquel appartient une œuvre. Ferdinand Brunetière (1849-1907) a largement contribué à l’émergence de cette discipline. Un siècle littéraire est souvent déterminé en fonction des grands événements qui ont marqué l’histoire politique, économique ou culturelle d’une nation et qui ont eu des répercussions sur la littérature. Par exemple, le XVIIIe siècle commence en France en 1715, date de la mort de Louis XIV. En Espagne, le siècle d’or s’étend sur la seconde moitié du XVIe siècle et la première moitié du XVIIe siècle. On parle d’école littéraire quand un ensemble d’écrivains se regroupe autour d’un idéal critique commun exprimé dans un texte fondateur ou un manifeste et se choisit en son sein un chef de file. Quant au genre littéraire, il peut être considéré comme une catégorie d’œuvres définies en fonction du ton, du style, du sujet, de la manière de le traiter et de leur finalité.
3-Histoire des idées et des mentalités
A ce niveau de recherche il s’agit d’un véritable travail d’investigation qui cherche à faire ressortir les rapports que les idéologies, les rêves et les aspirations des hommes ont eu avec la littérature. On considère qu’au fond des œuvres apparaît un trait d’union entre les idées politiques, économiques, culturelles, religieuses, scientifiques etc. et les sentiments exprimés par les auteurs d’une époque donnée.
4-La critique biographique
Elle consiste en une vaste enquête sur la vie d’un auteur et qui servira d’appui pour une explication de son œuvre. Ici, il s’agira de regrouper des informations sur la naissance de l’écrivain, sur ses parents, leur statut social et leur mode de vie, sur son enfance, son éducation, son adolescence, sa vie conjugale etc. Il faut aussi recueillir des témoignages de ses proches. En somme, on accorde de l’importance à tous les détails sur la vie de l’auteur qui soient en mesure d’éclairer ses écrits. Le précurseur de la critique biographique est Sainte-Beuve qui précise que l’optique du biographe doit consister à:
…entrer en son auteur, s’y installer, le produire sous ses aspects divers; le faire vivre, se mouvoir et parler, comme il a dû le faire, la suivre en son intérieur et dans ses mœurs domestiques aussi avant que l’on peut ; le rattacher par tous les côtés à cette terre, à cette existence réelle, à ces habitudes de chaque jour, dont les grands hommes ne dépendent pas moins que nous autres, fond véritable sur lequel ils ont pied, d’où ils partent pour s’élever quelque temps, et où ils retombent sans cesse.[14]
La technique du biographe repose donc sur une pénétration dans l’intimité d’un écrivain. C’est- à- dire qu’on doit essayer de voir dans quelle mesure l’œuvre est une redisposition des caractéristiques de la personnalité de l’auteur. Pour y parvenir Sainte-Beuve révèle sa démarche dans un article de 1831 sur Diderot en ces termes:
On s’enferme pendant une quinzaine de jours avec les écrits d’un mort célèbre, poète ou philosophe; on l’étudie, on le retourne, on l’interroge à loisir ; on le fait poser devant soi; c’est presque comme si l’on passait quinze jours à la campagne à faire le portrait ou le buste de Byron, de Scott, de Goethe. Seulement, on est plus à l’aise avec son modèle, et le tête- à- tête, en même temps qu’il exige un peu plus d’attention, comporte beaucoup de familiarité. Chaque trait s’ajoute à son tour et prend place de lui-même dans cette physionomie qu’on essaie de reproduire […]. On sent naître, on voit venir la ressemblance ; et le jour, le moment où l’on a saisi le tic familier, le sourire révélateur, la gerçure indéfinissable, la ride intime et douloureuse qui se cache sous les cheveux déjà clairsemés, - à ce moment, l’analyse disparaît dans la création, le portrait parle et vit, on a trouvé l’homme.[15]
Toutes ces différentes critiques permettent à l’historien littéraire d’avoir suffisamment d’éléments extratextuels pour éclairer l’œuvre d’un écrivain.
IV. CE QUI RESTE DE L’HISTOIRE LITTÉRAIRE
L’histoire littéraire n’a pas survécu, du moins sans modification, à la polémique des années 1960 ayant opposé Raymond Picard de la Sorbonne à Roland Barthes. Cette controverse contribuera à la révision des principes de l’histoire littéraire. En effet, partisan de la critique historique, Raymond Picard, dans son œuvre intitulée La carrière de Jean Racine (1956), aborde cet auteur de la Renaissance française par son environnement socioculturel, une démarche que Barthes critiquera dans son Sur Racine qui propose une interprétation de l’œuvre comme un univers de signes clos sur lui-même, qui suscite une interprétation structurale teintée de psychanalyse. [16]
Cette querelle finira par discréditer l’histoire littéraire à cause du grand succès des idées de Roland Barthes. C’est pourquoi quelques années plus tard l’idée de réformer l’école historique est émise. Hans Robert Jauss est un des plus importants réformateurs de l’histoire littéraire. Sa théorie de la réception est fondée sur une redéfinition de l’histoire littéraire c’est-à-dire une fusion de ce que Lanson appelait « l’étude des publics et des formations reçues ». D’ailleurs Jauss le confirme quand il écrit dans le premier chapitre de son Pour une esthétique de la réception qu’il a consacré à l’histoire de la littérature:
L’esthétique de la réception ne permet pas seulement de saisir le sens et la forme de l’œuvre littéraire tels qu’ils ont été compris de façon évolutive à travers l’histoire. Elle exige aussi que chaque œuvre soit replacée dans la « série littéraire » dont elle fait partie, afin que l’on puisse déterminer sa situation historique, son rôle et son importance dans le contexte général de l’expérience littéraire.[17]
Cette importance des circonstances dans lesquelles le message littéraire (et n’importe quel message d’ailleurs) est émis et reçu est devenue aujourd’hui un solide support sur lequel s’appuient beaucoup de travaux sur l’analyse et la réception du discours. Bien avant les plus connus théoriciens de l’esthétique de la réception, Gustave Lanson avait identifié le rôle capital de la lecture et du public dans le processus de création de sens d’une œuvre littéraire. Il écrivait déjà dans « L’Histoire littéraire et la Sociologie » que:
Le livre, donc, est un phénomène social qui évolue. Dès qu’il est publié, l’auteur n’en dispose plus ; il ne signifie plus la pensée de l’auteur, mais la pensée du public, la pensée tour à tour des publics qui se succèdent. Le rapport qui s’établit n’est pas celui qui a existé dans la création littéraire, celui que la critique érudite cherche à rétablir, entre l’œuvre et l’auteur: il est exclusivement entre l’œuvre et le public, qui la retouche, la repétrit, l’enrichit ou l’appauvrit continuellement. Le contenu réel de l’ouvrage ne fait plus qu’une partie de son sens, et quelquefois il y disparait presque totalement. [18]
Voilà donc une des sources littéraires de la théorie de la réception. Dans ces propos Lanson anticipait déjà le principe selon lequel l’œuvre littéraire est une virtualité de sens (les différents publics par lesquels elle passe lui confèrent des significations différentes), ce qui va constituer plus tard le fil conducteur de la théorie de la réception de Jauss, c’est-à-dire la lecture comme acte de création de sens.
La sociocritique qui, de nos jours, a connu un grand succès dans les théories d’interprétation textuelle est également une ramification de la critique historique. On retrouve ses germes dans la théorie de Mme de Staël mais elle sera théorisée comme méthode d’analyse dans la critique historique ou histoire littéraire de Gustave Lanson.
En conclusion, il est bien clair qu’on est ici en face de deux concepts littéraires différents. L’histoire de la littérature est une œuvre de vulgarisation qui propose un classement des différentes productions littéraires selon des critères spatio-temporels. Elle nous présente donc les différents panoramas littéraires qui se sont succédé au cours de l’histoire. Quant à l’histoire littéraire, elle propose une méthode d’analyse qui consiste à expliquer l’œuvre littéraire en l’insérant dans le contexte historique, socioculturel dans lequel elle est produite et consommée. Cette histoire littéraire est au aujourd’hui la mère de beaucoup de nouvelles méthodes d’analyse littéraires.
BIBLIOGRAPHIE
- FEBVRE, Lucien, « Littérature et vie sociale : un renoncement ? » dansAnnales d’histoire sociale. 3eannée, N. 3-4, 1941.
- FRAISSE, Luc, « La critique historique » dansMéthodes critiques pour l’analyse littéraire, par Daniel Bergez, Pierre Barbéris, Pierre- Marc de Biasi, Luc Fraisse, Marcelle Marini, Ginèle Valency, sous la direction de Daniel Bergez, 2eédition revue et augmentée,Paris, Nathan/V U E F, 2002.
- GENETTE, Gérard,Figure III, Tunis, Cérès Editions, 1996.
- JEY, Martine, « Gustave Lanson : De l’histoire littéraire à une histoire sociale de la littérature ? » dansLe français aujourd’hui, 2004/2 nº 145.
- LANSON, Gustave, « La méthode de l’histoire littéraire » inRevue du Mois, 10 octobre 1910, p.385-413.
- ------ Essais de méthode, de critique et d’histoire littérairerassemblés et présentés par Henri Peyre, Paris, Hachette, 1965.
- ------ « L’Histoire littéraire et la Sociologie » dansRevue de Métaphysique et de Morale, Paris, Armand Colin, 1904.
- ------ « L’Histoire littéraire et la Sociologie » dansRevue de Métaphysique et de Morale, Paris, Armand Colin, 1904, p.631. NB : Ce texte est une conférence faite à l’Ecole des Hautes Etudes Sociale le 29 janvier 1904.
- SAINTE-BEUVE, Charles Augustin, « Pierre Corneille » dansCritiques et Portraits Littéraires, Bruxelles, Grande Place, N. 1188, tome premier, 1832.
- - « Diderot » dansRevue de Paris, Paris, N. 17, tome 27, 1831.
- TAINE, Hippolyte,Philosophie de l’art, Paris, Hachette, 1890, Tome I, cinquième édition.
* Université Gaston Berger de Saint-Louis.
[1] Gérard Genette, Figure III, Tunis, Cérès Editions, 1996, p.13.
[2] Luc Fraisse: « La critique historique » dans Méthodes critiques pour l’analyse littéraire, par Daniel Bergez, Pierre Barbéris, Pierre- Marc de Biasi , Luc Fraisse, Marcelle Marini, Ginèle Valency, sous la direction de Daniel Bergez, 2e édition revue et augmentée,Paris, Nathan/V U E F, 2002, p. 11.
[3]Gustave Lanson, « La méthode de l’histoire littéraire » in Revue du Mois, 10 octobre 1910, p.385-413.
[4] Ibid. ibidem
[5] Luc Fraisse, Op. cit., p.15.
[6] Hippolyte Taine, Philosophie de l’art, Paris, Hachette, 1890, Tome I, cinquième édition, p.70.
[7]Dans Essais de méthode, de critique et d’histoire littéraire rassemblés et présentés par Henri Peyre, Paris, Hachette, 1965, p. 81-87.
[8]Gustave Lanson, « L’Histoire littéraire et la Sociologie » dans Revue de Métaphysique et de Morale, Paris, Armand Colin, 1904, p.622.
[9] Lucien Febvre, « Littérature et vie sociale: un renoncement? » dans Annales d’histoire sociale. 3e année, N. 3-4, 1941, pp.13-14.
[10] Lucien Febvre, Op. cit. p.117.
[11] Jey, Martine, « Gustave Lanson: De l’histoire littéraire à une histoire sociale de la littérature? » dans Le français aujourd’hui, 2004/2 nº 145, p.17.
[12] Luc Fraisse, op. cit. p.19.
[13] Luc Fraisse, op. cit .p.20.
[14]Charles Augustin Sainte-Beuve, « Pierre Corneille » dans Critiques et Portraits Littéraires, Bruxelles, Grande Place, N. 1188, tome premier, 1832, p.42.
[15] Charles Augustin Sainte-Beuve, « Diderot » dans Revue de Paris, Paris, N. 17, tome 27, 1831, p.222.
[16] Luc Fraisse, Op cit., p. 5.
[17]Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978, p. 69.
[18] Gustave Lanson, «L’Histoire littéraire et la Sociologie » dans Revue de Métaphysique et de Morale, Paris, Armand Colin, 1904, p.631. NB: Ce texte est une conférence faite à l’Ecole des Hautes Etudes Sociale le 29 janvier 1904.



